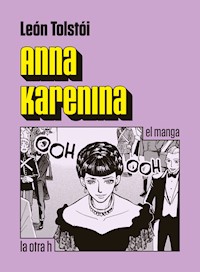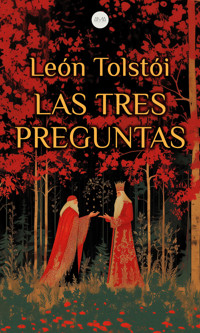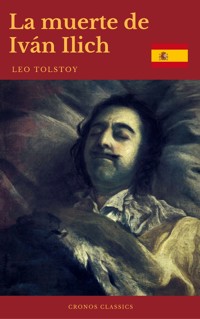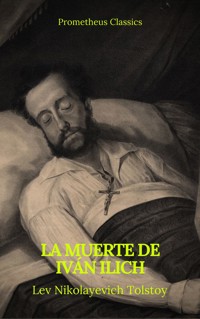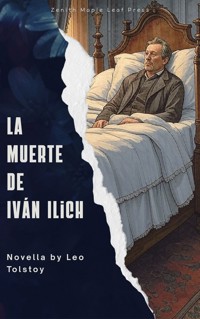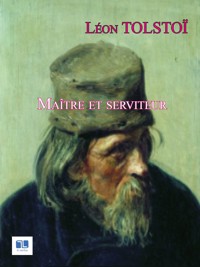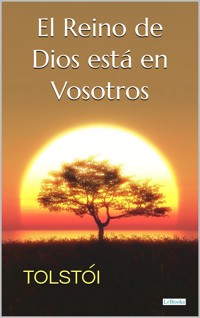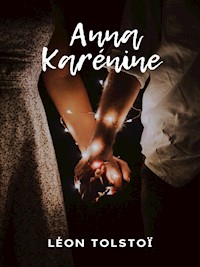
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Russie, 1880. Anna Karénine, est une jeune femme de la haute société de Saint-Pétersbourg. Elle est mariée à Alexis Karénine un haut fonctionnaire de l'administration impériale, un personnage austère et orgueilleux. Ils ont un garçon de huit ans, Serge. Anna se rend à Moscou chez son frère Stiva Oblonski. En descendant du train, elle croise le comte Vronski, venu à la rencontre de sa mère. Elle tombe amoureuse de Vronski, cet officier brillant, mais frivole. Ce n'est tout d'abord qu'un éclair, et la joie de retrouver son mari et son fils lui font croire que ce sera un vertige sans lendemain. Mais lors d'un voyage en train, quand Vronski la rejoint et lui déclare son amour, Anna réalise que la frayeur mêlée de bonheur qu'elle ressent à cet instant va changer son existence. Anna lutte contre cette passion. Elle finit pourtant par s'abandonner avec un bonheur coupable au courant qui la porte vers ce jeune officier. Puis Anna tombe enceinte. Se sentant coupable et profondément déprimée par sa faute, elle décide d'avouer son infidélité à son mari... Cette magnifique et tragique histoire d'amour s'inscrit dans un vaste tableau de la société russe contemporaine. En parallèle, Tolstoï brosse le portrait de deux autres couples: Kitty et Lévine, Daria et Oblonski . Il y évoque les différentes facettes de l'émancipation de la femme, et dresse un tableau critique de la Russie de la fin du XIXe siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Karénine
Anna KarénineQUATRIÈME PARTIECINQUIÈME PARTIESIXIÈME PARTIESEPTIÈME PARTIEHUITIÈME PARTIEPage de copyrightAnna Karénine
Léon Tolstoï
QUATRIÈME PARTIE
« Je me suis réservé à la vengeance. » dit le Seigneur.
I
Les Karénine continuèrent à vivre sous le même toit, à se rencontrer chaque jour, et à rester complètement étrangers l’un à l’autre. Alexis Alexandrovitch se faisait un devoir d’éviter les commentaires des domestiques en se montrant avec sa femme, mais il dînait rarement chez lui. Wronsky ne paraissait jamais : Anna le rencontrait au dehors, et son mari le savait.
Tous les trois souffraient d’une situation qui eût été intolérable si chacun d’eux ne l’avait jugée transitoire. Alexis Alexandrovitch s’attendait à voir cette belle passion prendre fin, comme toute chose en ce monde, avant que son honneur fût ostensiblement entaché ; Anna, la cause de tout le mal, et sur qui les conséquences en pesaient le plus cruellement, n’acceptait sa position que dans la conviction d’un dénouement prochain. Quant à Wronsky, il avait fini par croire comme elle.
Vers le milieu de l’hiver, Wronsky eut une semaine ennuyeuse à traverser. Il fut chargé de montrer Pétersbourg à un prince étranger, et cet honneur, que lui valurent son irréprochable tenue et sa connaissance des langues étrangères, lui parut fastidieux. Le prince voulait être à même de répondre aux questions qui lui seraient adressées au retour sur son voyage, et profiter cependant de tous les plaisirs spécialement russes. Il fallait donc l’instruire le matin et l’amuser le soir. Or ce prince jouissait d’une santé exceptionnelle, même pour un prince, et il était arrivé, grâce à des soins minutieusement hygiéniques de sa personne, à supporter des fatigues excessives, tout en restant frais comme un grand concombre hollandais, vert et luisant. Il avait beaucoup voyagé, et l’avantage incontestable qu’il reconnaissait aux facilités de communication modernes, était de pouvoir s’amuser de façons variées. En Espagne, il avait donné des sérénades, courtisé des Espagnoles, et joué de la mandoline ; en Suisse, il avait chassé le chamois ; en Angleterre, sauté des haies en habit rouge et parié de tuer 200 faisans ; en Turquie, il avait pénétré dans un harem ; aux Indes, il s’était promené sur des éléphants, et maintenant il tenait à connaître les plaisirs de la Russie.
Wronsky, en sa qualité de maître des cérémonies, organisa, non sans peine, le programme des divertissements ; c’étaient les blinis[1], les courses de trotteurs, la chasse à l’ours, les parties de troïka, les Bohémiennes, les réunions intimes dans lesquelles on lançait au plafond des plateaux chargés de vaisselle. Le prince s’assimilait ces divers plaisirs avec une rare facilité, et s’étonnait, après avoir tenu une Bohémienne sur ses genoux, et brisé tout ce qui lui tombait sous la main, que l’entrain russe s’arrêtât là. Au fond, ce qui l’amusa le plus, ce furent les actrices françaises, les danseuses et le champagne.
Wronsky connaissait les princes, en général ; mais, soit qu’il eût changé dans les derniers temps, soit que l’intimité de celui qu’on le chargeait de divertir fut particulièrement pénible, cette semaine lui sembla cruellement longue. Il éprouva l’impression d’un homme préposé à la garde d’un fou dangereux qui redouterait son malade, et craindrait pour sa propre raison ; malgré la réserve officielle où il se retranchait, il rougit plus d’une fois de colère en écoutant les réflexions du prince sur les femmes russes qu’il daigna étudier. Ce qui irritait le plus violemment Wronsky dans ce personnage, c’était de trouver en lui comme un reflet de sa propre individualité, et ce miroir n’avait rien de flatteur. L’image qu’il y voyait était celle d’un homme bien portant, très soigné, fort sot et enchanté de sa personne, d’humeur égale avec ses supérieurs, simple et bon enfant avec ses égaux, froidement bienveillant envers ses inférieurs, mais gardant toujours l’aisance et les façons d’un « gentleman ». Wronsky se comportait exactement de même, et s’en était fait un mérite jusque-là ; mais comme il jouait auprès du prince un rôle inférieur, ces airs dédaigneux l’exaspérèrent. « Quel sot personnage ! Est-il possible que je lui ressemble ! » pensait-il. Aussi, au bout de la semaine, fut-il soulagé de quitter ce miroir incommode sur le quai de la gare, où le prince, en partant pour Moscou, lui adressa ses remerciements. Ils revenaient d’une chasse à l’ours, et la nuit s’était passée à donner une brillante représentation de l’audace russe.
II
Wronsky trouva en rentrant chez lui un billet d’Anna : « Je suis malade et malheureuse, écrivait-elle ; je ne puis sortir et ne puis me passer plus longtemps de vous voir. Venez ce soir, Alexis Alexandrovitch sera au conseil de sept heures à dix. »
Cette invitation, faite malgré la défense formelle du mari, lui sembla étrange ; mais il finit par décider qu’il irait chez Anna.
Depuis le commencement de l’hiver, Wronsky était colonel, et depuis qu’il avait quitté le régiment il vivait seul. Après son déjeuner il s’étendit sur un canapé, et le souvenir des scènes de la veille se lia d’une façon bizarre dans son esprit à celui d’Anna, et d’un paysan qu’il avait rencontré à la chasse ; il finit par s’endormir, et, quand il se réveilla, la nuit était venue. Il alluma une bougie avec une impression de terreur qu’il ne put s’expliquer. « Que m’est-il arrivé ? qu’ai-je vu de si terrible en rêve ? » se demanda-t-il. « Oui, oui, le paysan, un petit homme sale, à barbe ébouriffée, faisait je ne sais quoi courbé en deux, et prononçait en français des mots étranges. Je n’ai rien rêvé d’autre, pourquoi cette épouvante ? » Mais, en se rappelant le paysan et ses mots français incompréhensibles, il se sentit frissonner de la tête aux pieds. « Quelle folie ! » pensa-t-il en regardant sa montre. Il était plus de huit heures et demie ; il appela son domestique, s’habilla rapidement, sortit, et, oubliant complètement son rêve, ne s’inquiéta plus que de son retard.
En approchant de la maison Karénine il regarda encore sa montre, et vit qu’il était neuf heures moins dix. Un coupé attelé de deux chevaux gris était arrêté devant le perron ; il reconnut la voiture d’Anna. « Elle vient chez moi », se dit-il, « cela vaut bien mieux. Je déteste cette maison, mais cependant je ne veux pas avoir l’air de me cacher » ; et avec le sang-froid d’un homme habitué dès l’enfance à ne pas se gêner, il quitta son traîneau et monta le perron. La porte s’ouvrit, et le suisse, portant un plaid, fit avancer la voiture. Quelque peu observateur que fût Wronsky, la physionomie étonnée du suisse le frappa ; il avança cependant et vint presque se heurter à Alexis Alexandrovitch. Un bec de gaz placé à l’entrée du vestibule éclaira en plein sa tête pâle et fatiguée. Il était en chapeau noir, et sa cravate blanche ressortait sous un col de fourrure. Les yeux mornes et ternes de Karénine se fixèrent sur Wronsky ; celui-ci salua, et Alexis Alexandrovitch, serrant les livres, leva la main à son chapeau et passa. Wronsky le vit monter en voiture sans se retourner, prendre par la portière le plaid et la lorgnette que lui tendait le suisse, et disparaître.
« Quelle situation ! » pensa Wronsky entrant dans l’antichambre les yeux brillants de colère ; « si encore il voulait défendre son honneur, je pourrais agir, traduire mes sentiments d’une façon quelconque ; mais cette faiblesse et cette lâcheté !… J’ai l’air de venir le tromper, ce que je ne veux pas. »
Depuis l’explication qu’il avait eue avec Anna au jardin Wrede, les idées de Wronsky avaient beaucoup changé ; il avait renoncé à des rêves d’ambition incompatibles avec sa situation irrégulière, et ne croyait plus à la possibilité d’une rupture ; aussi était-il dominé par les faiblesses de son amie et par ses sentiments pour elle. Quant à Anna, après s’être donnée tout entière, elle n’attendait rien de l’avenir qui ne lui vînt de Wronsky. Celui-ci entendit, en franchissant l’antichambre, des pas qui s’éloignaient, et comprit qu’elle rentrait au salon après s’être tenue aux aguets pour l’attendre. « Non, s’écria-t-elle en le voyant entrer, cela ne peut continuer ainsi ! » Et au son de sa propre voix ses yeux se remplirent de larmes.
« Qu’y a-t-il, mon amie ?
– Il y a que j’attends, que je suis à la torture depuis deux heures ; mais non, je ne veux pas te chercher querelle. Si tu n’es pas venu, c’est que tu as eu quelque empêchement sérieux ! Non, je ne te gronderai plus. »
Elle lui posa ses deux mains sur les épaules, et le regarda longtemps de ses yeux profonds et tendres, quoique scrutateurs. Elle le regardait pour tout le temps où elle ne l’avait pas vu, comparant, comme toujours, l’impression du moment aux souvenirs qu’il lui avait laissés, et, comme toujours, sentant que l’imagination l’emportait sur la réalité.
III
« Tu l’as rencontré ? demanda-t-elle quand ils furent assis sous la lampe près de la table du salon. C’est ta punition pour être venu si tard.
– Comment cela s’est-il fait ? Ne devait-il pas aller au conseil ?
– Il y a été, mais il en est revenu pour repartir je ne sais où. Ce n’est rien, n’en parlons plus ; dis-moi où tu as été, toujours avec le prince ? »
(Elle connaissait les moindres détails de sa vie.)
Il voulut répondre que, n’ayant pas dormi de la nuit, il s’était laissé surprendre par le sommeil, mais la vue de ce visage ému et heureux lui rendit cet aveu pénible, et il s’excusa sur l’obligation de présenter son rapport après le départ du prince.
« C’est fini maintenant ? Il est parti ?
– Oui, Dieu merci ; tu ne saurais croire combien cette semaine m’a paru insupportable.
– Pourquoi ? N’avez-vous pas mené la vie qui vous est habituelle, à vous autres jeunes gens ? dit-elle en fronçant le sourcil, et prenant, sans regarder Wronsky, un ouvrage au crochet qui se trouvait sur la table.
– J’ai renoncé à cette vie depuis longtemps, répondit-il, cherchant à deviner la cause de la transformation subite de ce beau visage. Je t’avoue, ajouta-t-il en souriant et découvrant ses dents blanches, qu’il m’a été souverainement déplaisant de revoir cette existence, comme dans un miroir. »
Elle lui jeta un coup d’œil peu bienveillant et garda son ouvrage en main, sans y travailler.
« Lise est venue me voir ce matin ;… elles viennent encore chez moi, malgré la comtesse Lydie,… et m’a raconté vos nuits athéniennes. Quelle horreur !
– Je voulais dire…
– Que vous êtes odieux, vous autres hommes ! Comment pouvez-vous supposer qu’une femme oublie ? – dit-elle, s’animant de plus en plus, et dévoilant ainsi, la cause de son irritation, – et surtout une femme qui, comme moi, ne peut connaître de ta vie que ce que tu veux bien lui en dire ? Et puis-je savoir si c’est la vérité ?
– Anna ! ne me crois-tu donc plus ? T’ai-je jamais rien caché ?
– Tu as raison ; mais si tu savais combien je souffre ! dit-elle, cherchant à chasser ses craintes jalouses. Je te crois, je te crois ; qu’avais-tu voulu me dire ? »
Il ne put se le rappeler. Les accès de jalousie d’Anna devenaient fréquents, et quoi qu’il fît pour le dissimuler, ces scènes, preuves d’amour pourtant, le refroidissaient pour elle. Combien de fois ne s’était-il pas répété que le bonheur n’existait pour lui que dans cet amour ; et maintenant qu’il se sentait passionnément aimé, comme peut l’être un homme auquel une femme a tout sacrifié, le bonheur semblait plus loin de lui qu’en quittant Moscou.
« Eh bien, dis ce que tu avais à me dire sur le prince, reprit Anna ; j’ai chassé le démon (ils appelaient ainsi, entre eux, ses accès de jalousie) ; tu avais commencé à me raconter quelque chose : En quoi son séjour t’a-t-il été désagréable ?
– Il a été insupportable, répondit Wronsky, cherchant à retrouver le fil de sa pensée. Le prince ne gagne pas à être vu de près. Je ne saurais le comparer qu’à un de ces animaux bien nourris qui reçoivent des prix aux expositions, ajouta-t-il d’un air contrarié qui parut intéresser Anna.
– C’est un homme instruit cependant, qui a beaucoup voyagé ?
– On dirait qu’il n’est instruit que pour avoir le droit de mépriser l’instruction, comme il méprise du reste tout, excepté les plaisirs matériels.
– Mais ne les aimez-vous pas tous, ces plaisirs ? dit Anna avec un regard triste qui le frappa encore.
– Pourquoi le défends-tu ainsi ? demanda-t-il en souriant.
– Je ne le défends pas, il m’est trop indifférent pour cela, mais je ne puis m’empêcher de croire que si cette existence t’avait tant déplu, tu aurais pu te dispenser d’aller admirer cette Thérèse en costume d’Ève.
– Voilà le diable qui revient ! dit Wronsky attirant vers lui pour la baiser une des mains d’Anna.
– Oui, c’est plus fort que moi ! tu ne t’imagines pas ce que j’ai souffert en t’attendant ! Je ne crois pas être jalouse au fond ; quand tu es là, je te crois ; mais quand tu es au loin à mener cette vie incompréhensible pour moi… »
Elle s’éloigna de lui et se prit à travailler fébrilement, en filant avec son crochet des mailles de laine blanche que la lumière de la lampe rendait brillantes.
« Raconte-moi comment tu as rencontré Alexis Alexandrovitch, demanda-t-elle tout à coup d’une voix encore contrainte.
– Nous nous sommes presque heurtés à la porte.
– Et il t’a salué comme cela ? » Elle allongea son visage, ferma à demi les yeux, et changea l’expression de sa physionomie à tel point que Wronsky ne put s’empêcher de reconnaître Alexis Alexandrovitch. Il sourit, et Anna se mit à rire, de ce rire frais et sonore qui faisait un de ses grands charmes.
« Je ne le comprends pas, dit Wronsky ; j’aurais compris qu’après votre explication à la campagne il eût rompu avec toi et m’eût provoqué en duel, mais comment peut-il supporter la situation actuelle ? On voit qu’il souffre.
– Lui ? dit-elle avec un sourire ironique… mais il est très heureux.
– Pourquoi nous torturons-nous tous quand tout pourrait s’arranger ?
– Cela ne lui convient pas. Oh ! que je la connais cette nature, faite de mensonges ! Qui donc pourrait, à moins d’être insensible, vivre avec une femme coupable, comme il vit avec moi, lui parler comme il me parle, la tutoyer ? »
Et elle imita la manière de dire de son mari : « Toi, ma chère Anna ».
« Ce n’est pas un homme, te dis-je : c’est une poupée. Si j’étais à sa place, il y a longtemps que j’aurais déchiré en morceaux une femme comme moi, au lieu de lui dire : « Toi, ma chère Anna » ; mais ce n’est pas un homme : c’est une machine ministérielle. Il ne comprend pas qu’il ne m’est plus rien, qu’il est de trop. Non, non, ne parlons pas de lui !
– Tu es injuste, chère amie, dit Wronsky en cherchant à la calmer ; mais non, ne parlons plus de lui : parlons de toi, de ta santé ; qu’a dit le docteur ? »
Elle le regardait avec une gaieté railleuse et aurait volontiers continué à tourner son mari en ridicule, mais il ajouta :
« Tu m’as écrit que tu étais souffrante : cela tient à ton état, je pense ? Quand ce sera-t-il ? »
Le sourire railleur disparut des lèvres d’Anna et fit place à une expression pleine de tristesse.
« Bientôt, bientôt… Tu dis que notre position est affreuse et qu’il faut en sortir. Si tu savais ce que je donnerais pour pouvoir t’aimer librement ! Je ne te fatiguerais plus de ma jalousie ; mais bientôt, bientôt, tout changera, et pas comme nous le pensons. »
Elle s’attendrissait sur elle-même, les larmes l’empêchèrent de continuer, et elle posa sa main blanche, dont les bagues brillaient à la lumière de la lampe, sur le bras de Wronsky.
« Je ne comprends pas, dit celui-ci, quoiqu’il comprît fort bien.
– Tu demandes quand ce sera ? Bientôt, et je n’y survivrai pas ; – elle parlait précipitamment. – Je le sais, je le sais avec certitude. Je mourrai, et je suis très contente de mourir et de vous débarrasser tous les deux de moi. »
Ses larmes coulaient, tandis que Wronsky baisait ses mains et cherchait, en la calmant, à cacher sa propre émotion.
« Il vaut mieux qu’il en soit ainsi, dit-elle en lui serrant vivement la main.
– Mais quelles sottises que tout cela, dit Wronsky en relevant la tête et reprenant son sang-froid. Quelles absurdités !
– Non, je dis vrai.
– Qu’est-ce qui est vrai ?
– Que je mourrai. Je l’ai vu en rêve.
– En rêve ? – et Wronsky se rappela involontairement le mougik de son cauchemar.
– Oui, en rêve, continua-t-elle ; il y a déjà longtemps de cela. Je rêvais que j’entrais en courant dans ma chambre pour y prendre je ne sais quoi ; je cherchais, tu sais, comme on cherche en rêve, et dans le coin de ma chambre j’apercevais quelque chose debout.
– Quelle folie ! comment crois-tu… ? »
Mais elle ne se laissa pas interrompre : ce qu’elle racontait lui semblait trop important.
« Et ce quelque chose se retourne, et je vois un petit mougik, sale, à barbe ébouriffée ; je veux me sauver, mais il se penche vers un sac dans lequel il remue un objet. »
Elle fit le geste de quelqu’un fouillant dans un sac ; la terreur était peinte sur son visage, et Wronsky, se rappelant son propre rêve, sentit cette même terreur l’envahir.
« Et tout en cherchant il parlait vite, vite, en français, en grasseyant, tu sais : « Il faut le battre, le fer, le broyer, le pétrir ». Je cherchai à m’éveiller, mais ne me réveillai qu’en rêve, en me demandant ce que cela signifiait. J’entendis alors quelqu’un me dire : « En couches, vous mourrez en couches, ma petite mère ». Et enfin je revins à moi.
– Quelles absurdités ! dit Wronsky, dissimulant mal son émotion.
– N’en parlons plus, sonne, je vais faire servir du thé ; reste encore, nous n’en avons plus pour longtemps. »
Mais elle s’arrêta, et tout à coup l’horreur et l’effroi disparurent de son visage, qui prit une expression de douceur attentive et sérieuse. Wronsky ne comprit rien d’abord à cette transfiguration soudaine : elle venait de sentir une vie nouvelle s’agiter dans son sein.
IV
Après la rencontre avec Wronsky, Alexis Alexandrovitch, comme c’était son projet, s’était rendu à l’Opéra-Italien ; il y entendit deux actes, parla à tous ceux à qui il devait parler, et, en rentrant chez lui, alla droit à sa chambre, après avoir constaté l’absence de tout paletot d’uniforme dans le vestibule.
Contre son habitude, au lieu de se coucher, il marcha de long en large jusqu’à trois heures du matin ; la colère le tenait éveillé, car il ne pouvait pardonner à sa femme de n’avoir pas rempli la seule condition qu’il lui eût imposée, celle de ne pas recevoir son amant chez elle. Puisqu’elle n’avait pas tenu compte de cet ordre, il devait la punir, exécuter sa menace, demander le divorce, et lui retirer son fils. Cette menace n’était pas d’une exécution aisée, mais il voulait tenir parole : la comtesse Lydie avait souvent fait allusion à ce moyen de sortir de sa déplorable situation, et le divorce était devenu récemment d’une facilité pratique si perfectionnée qu’Alexis Alexandrovitch entrevoyait la possibilité d’éluder les principales difficultés de forme.
Un malheur ne venant jamais seul, il éprouvait tant d’ennuis relativement à la question soulevée par lui sur les étrangers, qu’il se sentait depuis quelque temps dans un état d’irritation perpétuelle. Il passa la nuit sans dormir, sa colère grandissant toujours, et ce fut avec une véritable exaspération qu’il quitta son lit, s’habilla à la hâte, et se rendit chez Anna aussitôt qu’il la sut levée. Il craignait de perdre l’énergie dont il avait besoin, et ce fut en quelque sorte à deux mains qu’il porta la coupe de ses griefs, afin qu’elle ne débordât pas en route.
Anna, qui croyait connaître à fond son mari, fut saisie en le voyant entrer le front sombre, les yeux tristement fixés devant lui sans la regarder, et les lèvres serrées avec mépris. Jamais elle n’avait vu autant de décision dans son maintien. Il entra sans lui souhaiter le bonjour, et alla droit au secrétaire, dont il ouvrit le tiroir.
« Que vous faut-il ? s’écria Anna.
– Les lettres de votre amant.
– Elles ne sont pas là, » dit-elle en fermant le tiroir. Mais il comprit au mouvement qu’elle fit, qu’il avait deviné juste, et, repoussant brutalement sa main, il s’empara du portefeuille dans lequel Anna gardait ses papiers importants ; malgré les efforts de celle-ci pour le reprendre, il la tint à distance.
« Asseyez-vous, j’ai besoin de vous parler », dit-il, et il mit le portefeuille sous son bras et le serra si fortement du coude que son épaule en fut soulevée !
Anna le regarda, étonnée et effrayée.
« Ne vous avais-je pas défendu de recevoir votre amant chez vous ?
– J’avais besoin de le voir pour… »
Elle s’arrêta, ne trouvant pas d’explication plausible.
« Je n’entre pas dans ces détails, et n’ai aucun désir de savoir pourquoi une femme a besoin de voir son amant.
– Je voulais seulement, dit-elle rougissant et sentant que la grossièreté de son mari lui rendait son audace… Est-il possible que vous ne sentiez pas combien il vous est facile de me blesser ?
– On ne blesse qu’un honnête homme ou une honnête femme, mais dire d’un voleur qu’il est un voleur, n’est que la constatation d’un fait.
– Voilà un trait de cruauté que je ne vous connaissais pas.
– Ah, vous trouvez un mari cruel lorsqu’il laisse à sa femme une liberté entière, sous la seule condition de respecter les convenances ? Selon vous, c’est de la cruauté ?
– C’est pis que cela, c’est de la lâcheté, si vous tenez à le savoir, s’écria Anna avec emportement, et elle se leva pour sortir.
– Non, – cria-t-il d’une voix perçante, la forçant à se rasseoir, et lui prenant le bras ; ses grands doigts osseux la serraient si durement qu’un des bracelets d’Anna s’imprima en rouge sur sa peau. – De la lâcheté ? cela s’applique à celle qui abandonne son fils et son mari pour un amant, et n’en mange pas moins le pain de ce mari. »
Anna baissa la tête ; la justesse de ces paroles l’écrasait ; elle n’osa plus, comme la veille, accuser son mari d’être de trop, et elle répondit doucement :
« Vous ne pouvez juger ma position plus sévèrement que je ne la juge moi-même ; mais pourquoi me dites-vous cela ?
– Pourquoi je vous le dis ? continua-t-il avec colère : c’est afin que vous sachiez que, puisque vous ne tenez aucun compte de ma volonté, je vais prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation.
– Bientôt, bientôt, elle se terminera d’elle-même, dit Anna les yeux pleins de larmes à l’idée de cette mort qu’elle sentait prochaine, et maintenant si désirable.
– Plus tôt même que vous et votre amant ne l’aviez imaginé ! Ah ! vous cherchez la satisfaction des passions sensuelles…
– Alexis Alexandrovitch ! C’est, peu généreux, peu convenable de frapper quelqu’un à terre !
– Oh ! vous ne pensez jamais qu’à vous ; les souffrances de celui qui a été votre mari vous intéressent peu ; qu’importe que sa vie soit bouleversée, qu’il souffre… »
Dans son émotion, Alexis Alexandrovitch parlait si vite qu’il bredouillait, et ce bredouillement parut comique à Anna, qui se reprocha cependant aussitôt de pouvoir être sensible au ridicule dans un moment pareil. Pour la première fois, et pendant un instant, elle comprit la souffrance de son mari et le plaignit. Mais que pouvait-elle dire et faire, sinon se taire et baisser la tête ? Lui aussi se tut, puis reprit d’une voix sévère, en soulignant des mots qui n’avaient aucune importance spéciale :
« Je suis venu vous dire… »
Elle jeta un regard sur lui, et, se rappelant son bredouillement, se dit : « Non, cet homme aux yeux mornes, si plein de lui-même, ne peut rien sentir, j’ai été le jouet de mon imagination. »
« Je ne puis changer, murmura-t-elle.
– Je suis venu vous prévenir que je partais pour Moscou, et que je ne rentrerai plus dans cette maison ; vous apprendrez les résolutions auxquelles je me serai arrêté, par l’avocat qui se chargera des préliminaires du divorce. Mon fils ira chez une de mes parentes, ajouta-t-il, se rappelant avec effort ce qu’il voulait dire relativement à l’enfant.
– Vous prenez Serge pour me faire souffrir, balbutia-t-elle en levant les yeux sur lui ; vous ne l’aimez pas, laissez-le-moi !
– C’est vrai, la répulsion que vous m’inspirez rejaillit sur mon fils : mais je le garderai néanmoins. Adieu. »
Il voulut sortir, elle le retint.
« Alexis Alexandrovitch, laissez-moi Serge, dit-elle encore : je ne vous demande que cela ; laissez-le jusqu’à ma délivrance… »
Alexis Alexandrovitch rougit, repoussa le bras qui le retenait et partit sans répondre.
V
Le salon de réception de l’avocat célèbre chez lequel se rendit Alexis Alexandrovitch était plein de monde lorsqu’il y entra. Trois dames, l’une vieille, l’autre jeune et la troisième appartenant visiblement à la classe des marchands, y attendaient, ainsi qu’un banquier allemand portant au doigt une grosse bague, un marchand à longue barbe, et un tchinovnick revêtu de son uniforme, avec une décoration au cou ; l’attente avait évidemment été longue pour tous.
Deux secrétaires écrivaient en faisant grincer leurs plumes ; l’un d’eux tourna la tête d’un air mécontent vers le nouvel arrivé et, sans se lever, lui demanda en clignant des yeux :
« Que désirez-vous ?
– Je voudrais parler à M. l’avocat.
– Il est occupé, – répondit sévèrement le secrétaire en désignant avec sa plume ceux qui attendaient déjà ; et il se remit à écrire.
– Ne trouvera-t-il un pas moment pour me recevoir ? demanda Alexis Alexandrovitch.
– M. l’avocat n’a pas un instant de liberté ; il est toujours occupé, veuillez attendre.
– Ayez la bonté de lui passer ma carte », dit Alexis Alexandrovitch avec dignité, voyant que l’incognito était impossible à garder.
Le secrétaire prit la carte, l’examina d’un air mécontent, et sortit.
Alexis Alexandrovitch approuvait en principe la réforme judiciaire, mais critiquait certains détails, autant qu’il était capable de critiquer une institution sanctionnée, par le pouvoir suprême ; en toutes choses il admettait l’erreur comme un mal inévitable, auquel on pouvait dans certains cas porter remède ; mais la position importante faite aux avocats par cette réforme avait toujours été l’objet de sa désapprobation, et l’accueil qu’on lui faisait ne détruisait pas ses préventions.
« M. l’avocat va venir », dit en rentrant le secrétaire.
Effectivement, au bout de deux minutes, la porte s’ouvrit, et l’avocat parut, escortant un vieux jurisconsulte maigre.
L’avocat était un petit homme chauve, trapu, avec une barbe noire tirant sur le roux, un front bombé, et de gros sourcils clairs. Sa toilette, depuis sa cravate et sa chaîne de montre double, jusqu’au bout de ses bottines vernies, était celle d’un jeune premier. Sa figure était intelligente et vulgaire, sa mise prétentieuse et de mauvais goût.
« Veuillez entrer », dit-il en se tournant vers Alexis Alexandrovitch, et, le faisant passer devant lui, il ferma la porte.
Il avança un fauteuil près de son bureau chargé de papiers, pria Alexis Alexandrovitch de s’asseoir, et, frottant l’une contre l’autre ses mains courtes et velues, il s’installa devant le bureau dans une pose attentive. Mais, à peine assis, une mite vola au-dessus de la table, et le petit homme, avec une vivacité inattendue, la happa au vol ; puis il reprit bien vite sa première attitude.
« Avant de commencer à vous expliquer mon affaire, dit Alexis Alexandrovitch suivant d’un œil étonné les mouvements de l’avocat, permettez-moi de vous faire observer que le sujet qui m’amène doit rester secret entre nous. »
Un imperceptible sourire effleura les lèvres de l’avocat.
« Si je n’étais pas capable de garder un secret, je ne serais pas avocat, dit-il ; mais si vous désirez être assuré…
Alexis Alexandrovitch jeta un regard sur lui et crut remarquer que ses yeux gris pleins d’intelligence avaient tout deviné.
« Vous connaissez mon nom ?
– Je sais combien vos services sont utiles à la Russie », répondit en s’inclinant l’avocat, après avoir attrapé une seconde mite.
Alexis Alexandrovitch soupira ; il se décidait avec peine à parler ; mais, lorsqu’il eut commencé, il continua sans hésitation, de sa voix claire et perçante, en insistant sur certains mots.
« J’ai le malheur, commença-t-il, d’être un mari trompé. Je voudrais rompre légalement par un divorce les liens qui m’unissent à ma femme, et surtout séparer mon fils de sa mère. »
Les yeux gris de l’avocat faisaient leur possible pour rester sérieux ; mais Alexis Alexandrovitch ne put se dissimuler qu’ils étaient pleins d’une joie qui ne provenait pas uniquement de la perspective d’une bonne affaire : c’était de l’enthousiasme, du triomphe, quelque chose comme l’éclat qu’il avait remarqué dans les yeux de sa femme.
« Vous désirez mon aide pour obtenir le divorce ?
– Précisément ; mais je risque peut-être d’abuser de votre attention, car je ne suis préalablement venu que pour vous consulter ; je tiens à rester dans de certaines bornes, et renoncerais au divorce s’il ne pouvait se concilier avec les formes que je veux garder.
– Oh ! vous demeurerez toujours parfaitement libre », répondit l’avocat.
Le petit homme, pour ne pas offenser son client par une gaieté que son visage cachait mal, fixa ses yeux sur les pieds d’Alexis Alexandrovitch, et, quoiqu’il aperçût du coin de l’œil une mite voler, il retint ses mains, par respect pour la situation.
« Les lois qui régissent le divorce me sont connues dans leurs traits généraux, dit Karénine, mais j’aurais voulu savoir les diverses formes usitées dans la pratique.
– En un mot vous désirez apprendre par quelles voies vous pourriez obtenir un divorce légal ? » dit l’avocat entrant avec un certain plaisir dans le ton de son client ; et, sur un signe affirmatif de celui-ci, il continua, en jetant de temps en temps un regard furtif sur la figure d’Alexis Alexandrovitch que l’émotion tachetait de plaques rouges :
« Le divorce, selon nos lois, – il eut une nuance de dédain pour : nos lois, – est possible, comme vous le savez, dans les trois cas suivants… – Qu’on attende ! » s’écria-t-il à la vue de son secrétaire qui entr’ouvrait la porte. Il se leva cependant, alla lui dire quelques mots et revint s’asseoir ; « … dans les trois cas suivants ; défaut physique d’un des époux, disparition de l’un d’eux pendant cinq ans, – il pliait, en faisant cette énumération, ses gros doigts velus l’un après l’autre, – et enfin l’adultère (il prononça ce mot d’un ton satisfait). Voilà le côté théorique ; mais je pense qu’en me faisant l’honneur de me consulter c’est le côté pratique que vous désirez connaître ? Aussi, le cas de défaut physique et d’absence d’un des conjoints n’existant pas, autant que j’ai pu le comprendre… ? »
Alexis Alexandrovitch inclina affirmativement la tête.
« Reste l’adultère de l’un des deux époux, auquel cas l’une des parties doit se reconnaître coupable envers l’autre, faute de quoi il ne reste que le flagrant délit. Ce dernier cas, j’en conviens, se rencontre rarement dans la pratique. »
L’avocat se tut et regarda son client de l’air d’un armurier qui expliquerait à un acheteur l’usage de deux pistolets de modèles différents, en lui laissant la liberté du choix. Alexis Alexandrovitch gardant le silence, il continua :
« Le plus simple, le plus raisonnable, est, selon moi, de reconnaître l’adultère par consentement mutuel. Je n’oserais parler ainsi à tout le monde, mais je suppose que nous nous comprenons. »
Alexis Alexandrovitch était si troublé que l’avantage de la dernière combinaison que lui proposait l’avocat lui échappait complètement, et l’étonnement se peignit sur son visage ; l’homme de loi vint aussitôt à son aide.
« Je suppose que deux époux ne puissent plus vivre ensemble : si tous deux consentent au divorce, les détails et les formalités deviennent sans importance. Ce moyen est le plus simple et le plus sûr. »
Alexis Alexandrovitch comprit cette fois, mais ses sentiments religieux s’opposaient à cette mesure.
« Dans le cas présent ce moyen est hors de question, dit-il. Des preuves, comme une correspondance, peuvent-elles établir indirectement l’adultère ? Ces preuves-là sont en ma possession. »
L’avocat fit en serrant les lèvres une exclamation tout à la fois de compassion et de dédain.
« Veuillez ne pas oublier que les affaires de ce genre sont du ressort de notre haut clergé, dit-il. Nos archiprêtres aiment fort à se noyer dans de certains détails, – ajouta-t-il avec un sourire de sympathie pour le goût de ces bons Pères, – et les preuves exigent des témoins. Si vous me faites l’honneur de me confier votre affaire, il faut me laisser le choix des mesures à prendre. Qui veut la fin, veut les moyens. »
Alexis Alexandrovitch se leva, très pâle, tandis que l’avocat courait encore vers la porte répondre à une nouvelle interruption de son secrétaire.
« Dites-lui donc que nous ne sommes pas dans une boutique », cria-t-il avant de revenir à sa place, et il attrapa chemin faisant une mite en murmurant tristement : « Jamais mon reps n’y résistera ! »
« Vous me faisiez, l’honneur de me dire… ?
– Je vous écrirai à quel parti je m’arrête, répondit Alexis Alexandrovitch s’appuyant à la table, et puisque je puis conclure de vos paroles que le divorce est possible, je vous serais obligé de me faire connaître vos conditions.
– Tout est possible si vous voulez bien me laisser une entière liberté d’action, dit l’avocat éludant la dernière question. Quand puis-je compter sur une communication de votre part ? demanda-t-il en reconduisant son client, avec des yeux aussi brillants que ses bottes.
– Dans huit jours. Vous aurez alors la bonté de me faire savoir si vous acceptez l’affaire, et à quelles conditions.
– Parfaitement. »
L’avocat salua respectueusement, fit sortir son client, et, resté seul, sa joie déborda ; il était si content qu’il fit, contrairement à tous ses principes, un rabais à une dame habile dans l’art de marchander. Il oublia même les mites, résolu à recouvrir, l’hiver suivant, son meuble de velours, comme chez son confrère Séganine.
VI
La brillante victoire remportée par Alexis Alexandrovitch dans la séance du 17 août avait eu des suites fâcheuses. La nouvelle commission, nommée pour étudier la situation des populations étrangères, avait agi avec une promptitude qui frappa Karénine ; au bout de trois mois elle présentait déjà son rapport ! L’état de ces populations se trouvait étudié aux points de vue politique, administratif, économique, ethnographique, matériel et religieux. Chaque question était suivie d’une réponse admirablement rédigée et ne pouvant laisser subsister aucun doute, car ces réponses n’étaient pas l’œuvre de l’esprit humain, toujours sujet à l’erreur, mais d’une bureaucratie pleine d’expérience. Ces réponses se basaient sur des données officielles, telles que rapports des gouverneurs et des archevêques, basés eux-mêmes sur les rapports des chefs de district et des surintendants ecclésiastiques, basés à leur tour sur les rapports des administrations communales et des paroisses de campagne. Comment douter de leur exactitude ? Des questions comme celles-ci : « Pourquoi les récoltes sont-elles mauvaises ? » et « Pourquoi les habitants de certaines localités s’obstinent-ils à pratiquer leur religion ? » questions que la machine officielle pouvait seule résoudre, et auxquelles des siècles n’auraient pas trouvé de réponses, furent clairement résolues, conformément aux opinions d’Alexis Alexandrovitch.
Mais Strémof, piqué au vif, avait imaginé une tactique à laquelle son adversaire ne s’attendait pas : entraînant plusieurs membres du comité à sa suite, il passa tout à coup dans le camp de Karénine, et, non content d’appuyer les mesures proposées par celui-ci avec chaleur, il en proposa d’autres, dans le même sens, qui dépassèrent de beaucoup les intentions d’Alexis Alexandrovitch.
Poussées à l’extrême, ces mesures parurent si absurdes, que le gouvernement, l’opinion publique, les dames influentes, les journaux, furent tous indignés, et leur mécontentement rejaillit sur le père de la commission, Karénine.
Enchanté du succès de sa ruse, Strémof prit un air innocent, s’étonna des résultats obtenus, et se retrancha derrière la foi aveugle que lui avait inspirée le plan de son collègue. Alexis Alexandrovitch, quoique malade et très affecté de tous ces ennuis, ne se rendit pas. Une scission se produisit au sein du comité ; les uns, avec Strémof, expliquèrent leur erreur par un excès de confiance, et déclarèrent les rapports de la commission d’inspection absurdes ; les autres, avec Karénine, redoutant cette façon révolutionnaire de traiter une commission, la soutinrent. Les sphères officielles, et même la société, virent s’embrouiller cette intéressante question à tel point, que la misère et la prospérité des populations étrangères devinrent également problématiques. La position de Karénine, déjà minée par le mauvais effet que produisaient ses malheurs domestiques, parut chanceler. Il eut alors le courage de prendre une résolution hardie : au grand étonnement de la commission il déclara qu’il demandait l’autorisation d’aller étudier lui-même ces questions sur les lieux, et, l’autorisation lui ayant été accordée, il partit pour un gouvernement lointain.
Ce départ fit grand bruit, d’autant plus qu’il refusa officiellement les frais de déplacement fixés à douze chevaux de poste.
Alexis Alexandrovitch passa par Moscou et s’y arrêta trois jours.
Le lendemain de son arrivée, comme il venait de rendre visite au général gouverneur, il s’entendit héler, dans la rue des Gazettes, à l’endroit où se croisent en grand nombre les voitures de maîtres et les isvostchiks, et, se retournant à l’appel d’une voix gaie et sonore, il aperçut Stépane Arcadiévitch sur le trottoir. Vêtu d’un paletot à la dernière mode, le chapeau avançant sur son front brillant de jeunesse et de santé, il appelait avec une telle persistance, que Karénine dut s’arrêter. Dans la voiture, à la portière de laquelle Stépane Arcadiévitch s’appuyait, était une femme en chapeau de velours avec deux enfants ; elle faisait des gestes de la main en souriant amicalement. C’étaient Dolly et ses enfants.
Alexis Alexandrovitch ne comptait pas voir de monde à Moscou, le frère de sa femme moins que personne ; aussi voulut-il continuer son chemin après avoir salué ; mais Oblonsky fit signe au cocher d’arrêter et courut dans la neige jusqu’à la voiture.
« Depuis quand es-tu ici ? N’est-ce pas un péché de ne pas nous prévenir ? J’ai vu hier soir chez Dusseaux le nom de Karénine sur la liste des arrivants, et l’idée ne m’est pas venue que ce fût toi, dit-il en passant sa tête à la portière et en secouant la neige de ses pieds en les frappant l’un contre l’autre. Comment ne pas nous avoir avertis ?
– Le temps m’a manqué, je suis très occupé, répondit sèchement Alexis Alexandrovitch.
– Viens voir ma femme, elle le désire beaucoup. »
Karénine ôta le plaid qui recouvrait ses jambes frileuses et, quittant sa voiture, se fraya un chemin dans la neige jusqu’à celle de Dolly.
« Que se passe-t-il donc, Alexis Alexandrovitch, pour que vous nous évitiez ainsi ? dit celle-ci en souriant.
– Charmé de vous voir, répondit Karénine d’un ton qui prouvait clairement le contraire. Et votre santé ?
– Que fait ma chère Anna ? »
Alexis Alexandrovitch murmura quelques mots et voulut se retirer, mais Stépane Arcadiévitch l’en empêcha.
« Sais-tu ce que nous allons faire ? Dolly, invite-le à dîner pour demain avec Kosnichef et Pestzoff, l’élite de l’intelligence moscovite.
– Venez, je vous en prie, dit Dolly, nous vous attendrons à l’heure qui vous conviendra, à cinq, à six heures, comme vous voudrez. Et ma chère Anna, il y a si longtemps…
– Elle va bien, murmura encore Alexis Alexandrovitch en fronçant le sourcil. Très heureux de vous avoir rencontrée. »
Et il regagna sa voiture.
« Vous viendrez ? » cria encore Dolly. Karénine répondit quelques mots qui ne parvinrent pas jusqu’à elle.
« J’entrerai chez toi demain ! » cria aussi Stépane Arcadiévitch.
Alexis Alexandrovitch s’enfonça dans sa voiture comme s’il eût voulu y disparaître.
« Quel original ! » dit Stépane Arcadiévitch à Dolly ; et regardant sa montre il fit un petit signe d’adieu caressant à sa femme et à ses enfants, et s’éloigna d’un pas ferme.
« Stiva, Stiva ! lui cria Dolly en rougissant.
Il se retourna.
« Et l’argent pour les paletots des enfants ?
– Tu diras que je passerai. »
Et il disparut, saluant gaiement au passage quelques personnes de connaissance.
VII
Le lendemain, c’était un dimanche, Stépane Arcadiévitch, entra au Grand-Théâtre pour y assister à la répétition du ballet ; et, profitant de la demi-obscurité des coulisses, il offrit à une jolie danseuse qui débutait sous sa protection la parure de corail qu’il lui avait promise la veille. Il eut même le temps d’embrasser le visage radieux de la jeune fille, et de convenir avec elle du moment où il viendrait la prendre, après le ballet, pour l’emmener souper. Du théâtre, Stépane Arcadiévitch se rendit au marché pour y choisir lui-même du poisson et des asperges pour le dîner, et à midi il était chez Dusseaux, où trois voyageurs de ses amis avaient eu l’heureuse idée de se loger : Levine, de retour de son voyage, un nouveau chef fraîchement débarqué à Moscou pour une inspection, et enfin son beau-frère Karénine.
Stépane Arcadiévitch aimait à bien dîner ; mais ce qu’il préférait encore, c’était d’offrir chez lui à quelques convives choisis un petit repas bien ordonné. Le menu qu’il combinait ce jour-là lui souriait : du poisson bien frais, des asperges, et comme pièce de résistance un simple mais superbe roastbeef. Quant aux convives, il comptait réunir Kitty et Levine et, afin de dissimuler cette rencontre, une cousine et le jeune Cherbatzky ; le plat de résistance parmi les invités devait être Serge Kosnichef, le philosophe moscovite, joint à Karénine, l’homme d’action pétersbourgeois. Pour servir de trait d’union entre eux, il avait encore invité Pestzoff, un charmant jeune homme de cinquante ans, enthousiaste, musicien, bavard, libéral, qui mettrait tout le monde en train.
La vie souriait en ce moment à Stépane Arcadiévitch ; l’argent rapporté par la vente du bois n’était pas entièrement dépensé ; Dolly depuis quelque temps était charmante : tout aurait été pour le mieux, si deux choses ne l’avaient désagréablement impressionné, sans toutefois troubler sa belle humeur : d’abord l’accueil sec de son beau-frère : en rapprochant la froideur d’Alexis Alexandrovitch de certains bruits qui étaient parvenus jusqu’à lui sur les relations de sa sœur avec Wronsky, il devinait un incident grave entre le mari et la femme. Le second point noir était l’arrivée du nouveau chef auquel on faisait une réputation inquiétante d’exigence et de sévérité. Infatigable au travail, il passait encore pour être bourru, et absolument opposé aux tendances libérales de son prédécesseur, tendances que Stépane Arcadiévitch avait partagées. La première présentation avait eu lieu la veille, en uniforme, et Oblonsky avait été si cordialement reçu qu’il jugeait de son devoir de faire une visite non officielle. Comment serait-il reçu cette fois ? il s’en préoccupait, mais sentait instinctivement que tout s’arrangerait parfaitement. « Bah ! pensait-il, ne sommes-nous pas tous pécheurs ? pourquoi nous chercherait-il noise ? »
Stépane Arcadiévitch entra d’abord chez Levine. Celui-ci était debout au milieu de sa chambre, et prenait avec un paysan la mesure d’une peau d’ours.
« Ah ! vous en avez tué un ! cria Stépane Arcadiévitch en entrant. La belle pièce ! Une ourse ! Bonjour, Archip ! – et s’asseyant en paletot et en chapeau il tendit la main au paysan.
– Ôte donc ton paletot et reste un moment, dit Levine.
– Je n’ai pas le temps, je suis entré pour un instant, – répondit Oblonsky, ce qui ne l’empêcha pas de déboutonner son paletot, puis de l’ôter, et de rester toute une heure à bavarder avec Levine sur sa chasse et sur d’autres sujets.
– Dis-moi ce que tu as fait à l’étranger : où as-tu été ? demanda-t-il lorsque le paysan fut parti.
– J’ai été en Allemagne, en France, en Angleterre, mais seulement dans les centres manufacturiers et pas dans les capitales. J’ai vu beaucoup de choses intéressantes.
– Oui, oui, je sais, tes idées d’associations ouvrières.
– Oh non, il n’y a pas de question ouvrière pour nous : la seule question importante pour la Russie est celle des rapports du travailleur avec la terre ; elle existe bien là-bas aussi, mais les raccommodages y sont impossibles, tandis qu’ici… »
Oblonsky écoutait avec attention.
« Oui, oui, il est possible que tu aies raison, mais l’essentiel est de revenir en meilleure disposition ; tu chasses l’ours, tu travailles, tu t’enthousiasmes, tout va bien. Cherbatzky m’avait dit t’avoir rencontré sombre et mélancolique, ne parlant que de mort.
– C’est vrai, je ne cesse de penser à la mort, répondit Levine, tout est vanité, il faut mourir ! J’aime le travail, mais quand je pense que cet univers, dont nous nous croyons les maîtres, se compose d’un peu de moisissure couvrant la surface de la plus petite des planètes ! Quand je pense que nos idées, nos œuvres, ce que nous croyons faire de grand, sont l’équivalent de quelques grains de poussière !…
– Tout cela est vieux comme le monde, frère !
– C’est vieux, mais quand cette idée devient claire pour nous, combien la vie paraît misérable ! Quand on sait que la mort viendra, qu’il ne restera rien de nous, les choses les plus importantes semblent aussi mesquines que le fait de tourner cette peau d’ours ! C’est pour ne pas penser à la mort qu’on chasse, qu’on travaille, qu’on cherche à se distraire. »
Stépane Arcadiévitch sourit et regarda Levine de son regard caressant :
« Tu vois bien que tu avais tort en tombant sur moi parce que je cherchais des jouissances dans la vie ! Ne sois pas si sévère, ô moraliste !
– Ce qu’il y a de bon dans la vie… répondit Levine s’embrouillant. Au fond je ne sais qu’une chose, c’est que nous mourrons bientôt.
– Pourquoi bientôt ?
– Et sais-tu ? la vie offre, il est vrai, moins de charme quand on pense ainsi à la mort, mais elle a plus de calme.
– Il faut jouir de son reste, au contraire… Mais, dit Stépane Arcadiévitch en se levant pour la dixième fois, je me sauve.
– Reste encore un peu ! dit Levine en le retenant ; quand nous reverrons-nous maintenant ? Je pars demain.
– Et moi qui oubliais le sujet qui m’amène ! Je tiens absolument à ce que tu viennes dîner avec nous aujourd’hui ; ton frère sera des nôtres, ainsi que mon beau-frère Karénine.
– Il est ici ? – demanda Levine, mourant d’envie d’avoir des nouvelles de Kitty ; il savait qu’elle avait été à Pétersbourg au commencement de l’hiver, chez sa sœur mariée à un diplomate. – Tant pis, pensa-t-il : qu’elle soit revenue ou non, j’accepterai.
– Viendras-tu ?
– Certainement.
– À cinq heures, en redingote. »
Et Stépane Arcadiévitch se leva et descendit chez son nouveau chef. Son instinct ne l’avait pas trompé ; cet homme terrible se trouva être un bon garçon, avec lequel il déjeuna et s’attarda à causer, si bien qu’il était près de quatre heures lorsqu’il entra chez Alexis Alexandrovitch.
VIII
Alexis Alexandrovitch, en rentrant de la messe, passa toute la matinée chez lui. Il avait deux affaires à terminer ce jour-là : d’abord à recevoir une députation d’étrangers, puis une lettre à écrire à son avocat, comme il le lui avait promis.
Il discuta longuement avec les membres de la députation, les entendit exposer leurs réclamations et leurs besoins, leur traça un programme dont ils ne devaient à aucun prix se départir dans leurs démarches auprès du gouvernement, et finalement les adressa à la comtesse Lydie, qui devait les guider à Pétersbourg : la comtesse avait la spécialité des députations, et s’entendait mieux que personne à les piloter. Quand il eut congédié son monde, Alexis Alexandrovitch écrivit à son avocat, lui donna ses pleins pouvoirs, et lui envoya trois billets de Wronsky et un d’Anna, trouvés dans le portefeuille.
Au moment de cacheter sa lettre, il entendit la voix sonore de Stépane Arcadiévitch demandant au domestique si son beau-frère recevait, et insistant pour être annoncé.
« Tant pis, pensa Alexis Alexandrovitch, ou plutôt tant mieux, je lui dirai ce qui en est, et il comprendra que je ne puis dîner chez lui.
– Fais entrer, cria-t-il en rassemblant ses papiers et les serrant dans un buvard.
– Tu vois bien que tu mens, – dit la voix de Stépane Arcadiévitch au domestique, et, ôtant son paletot tout en marchant, il entra chez Alexis Alexandrovitch.
– Je suis enchanté de te trouver, commença-t-il gaiement, j’espère…
– Il m’est impossible d’y aller », répondit sèchement Alexis Alexandrovitch, recevant son beau-frère debout, sans l’engager à s’asseoir, résolu à adopter avec le frère de sa femme les relations froides qui lui semblaient seules convenables depuis qu’il était décidé au divorce. C’était oublier l’irrésistible bonté de cœur de Stépane Arcadiévitch. Il ouvrit tout grands ses beaux yeux brillants et clairs.
« Pourquoi ne peux-tu pas venir ? Tu ne veux pas le dire ? demanda-t-il en français avec quelque hésitation. Mais c’est chose promise, nous comptons sur toi !
– C’est impossible, parce que nos rapports de famille doivent être rompus.
– Comment cela ? Pourquoi ? dit Oblonsky avec un sourire.
– Parce que je songe à divorcer d’avec ma femme, votre sœur. Je dois… »
La phrase n’était pas achevée que Stépane Arcadiévitch, contrairement à ce qu’attendait son beau-frère, s’affaissait en poussant un grand soupir dans un fauteuil.
« Alexis Alexandrovitch, ce n’est pas possible, s’écria-t-il avec douleur.
– C’est cependant vrai.
– Pardonne-moi, je n’y puis croire. »
Alexis Alexandrovitch s’assit ; il sentait que ses paroles n’avaient pas produit le résultat voulu, et qu’une explication, même catégorique, ne changerait rien à ses rapports avec Oblonsky.
« C’est une cruelle nécessité, mais je suis forcé de demander le divorce, reprit-il.
– Que veux-tu que je te dise ! te connaissant pour un homme de bien, et Anna pour une femme d’élite, – excuse-moi de ne pouvoir changer mon opinion sur elle, – je ne puis croire à tout cela : il y a là quelque malentendu.
– Oh ! si ce n’était qu’un malentendu !
– Permets, je comprends, mais je t’en supplie, ne te hâte pas.
– Je n’ai rien fait avec précipitation, dit froidement Alexis Alexandrovitch ; mais dans une question semblable on ne peut prendre conseil de personne : je suis décidé.
– C’est affreux ! soupira Stépane Arcadiévitch ; je t’en conjure : si, comme je le comprends, l’affaire n’est pas encore entamée, ne fais rien avant d’avoir causé avec ma femme. Elle aime Anna comme une sœur, elle t’aime, et c’est une femme de sens. Par amitié pour moi, cause avec elle. »
Alexis Alexandrovitch se tut et réfléchit ; Stépane Arcadiévitch respecta son silence ; il le regardait avec sympathie.
« Pourquoi ne pas venir dîner avec nous, au moins aujourd’hui ? Ma femme t’attend. Viens lui parler ; c’est, je t’assure, une femme supérieure. Parle-lui, je t’en conjure.
– Si vous le désirez à ce point, j’irai, » dit en soupirant Alexis Alexandrovitch.
Et pour changer de conversation il demanda à Stépane Arcadiévitch ce qu’il pensait de son nouveau chef, un homme encore jeune, dont l’avancement rapide avait étonné. Alexis Alexandrovitch ne l’avait jamais aimé, et il ne pouvait se défendre d’un sentiment d’envie, naturel chez un fonctionnaire sous le coup d’un insuccès.
« C’est un homme qui paraît être fort au courant des affaires et très actif.
– Actif, c’est possible, mais à quoi emploie-t-il son activité ? est-ce à faire du bien ou à détruire ce que d’autres ont fait avant lui ? Le fléau de notre gouvernement, c’est cette bureaucratie paperassière dont Anitchkine est un digne représentant.
– En tout cas, il est très bon enfant, répondit Stépane Arcadiévitch. Je sors de chez lui, nous avons déjeuné ensemble, et je lui ai appris à faire une boisson, tu sais, avec du vin et des oranges. »
Stépane Arcadiévitch consulta sa montre.
« Hé bon Dieu, il est quatre heures passées ! et j’ai encore une visite à faire ! C’est convenu, tu viens dîner, n’est-ce pas ? tu nous ferais, à ma femme et à moi, un vrai chagrin en refusant. »
Alexis Alexandrovitch reconduisit son beau-frère tout autrement qu’il ne l’avait accueilli.
« Puisque j’ai promis, j’irai, répondit-il mélancoliquement.
– Merci, et j’espère que tu ne le regretteras pas. »
Et, tout en remettant son paletot, Oblonsky secoua le domestique par la tête et sortit.
IX
Cinq heures avaient sonné lorsque le maître de la maison rentra et rencontra à sa porte Kosnichef et Pestzoff. Le vieux prince Cherbatzky, Karénine, Tourovtzine, Kitty et le jeune Cherbatzky étaient déjà réunis au salon. La conversation y languissait. Dolly, préoccupée du retard de son mari, ne parvenait pas à animer son monde, que la présence de Karénine, en habit noir et cravate blanche selon l’usage pétersbourgeois, glaçait involontairement.
Stépane Arcadiévitch s’excusa gaiement et, avec sa bonne grâce habituelle, changea en un clin d’œil l’aspect lugubre du salon ; il présenta ses invités l’un à l’autre, leur fournit un sujet de conversation, la russification de la Pologne, installa le vieux prince auprès de Dolly, complimenta Kitty sur sa beauté, et alla jeter un coup d’œil sur la table et sur les vins.
Levine le rencontra à la porte de la salle à manger.
« Suis-je en retard ?
– Peux-tu ne pas l’être ! répondit Oblonsky en le prenant par le bras.
– Tu as beaucoup de monde ? Qui ? demanda Levine, rougissant involontairement et secouant avec son gant la neige qui couvrait son chapeau.
– Rien que la famille. Kitty est ici. Viens, que je te présente à Karénine. »
Lorsqu’il sut, à n’en pas douter, qu’il allait se trouver en présence de celle qu’il n’avait pas revue depuis la soirée fatale, sauf pendant sa courte apparition en voiture, Levine eut peur.
« Comment sera-t-elle ? Comme autrefois ? Si Dolly avait dit vrai ? Et pourquoi n’aurait-elle pas dit vrai ? » pensa-t-il.
« Présente-moi à Karénine, je t’en prie », parvint-il enfin à balbutier, entrant au salon avec le courage du désespoir.
Elle était là, et tout autre que par le passé !
Au moment où Levine entra, elle le vit, et sa joie fut telle que, tandis qu’il saluait Dolly, la pauvre enfant crut fondre en larmes. Levine et Dolly s’en aperçurent. Rougissant, pâlissant pour rougir encore, elle était si troublée que ses lèvres tremblaient. Levine s’approcha pour la saluer ; elle lui tendit une main glacée avec un sourire qui aurait passé pour calme, si ses yeux humides n’eussent été si brillants.
« Il y a bien longtemps que nous ne nous sommes vus, s’efforça-t-elle de dire.
– Vous ne m’avez pas vu, mais moi je vous ai aperçue en voiture, sur la route de Yergoushovo, venant du chemin de fer, répondit Levine rayonnant de bonheur.
– Quand donc ? demanda-t-elle étonnée.
– Vous alliez chez votre sœur, dit Levine, sentant la joie l’étouffer. « Comment, pensa-t-il, ai-je pu croire à un sentiment qui ne fût pas innocent dans cette touchante créature ? Daria Alexandrovna a eu raison. »
Stépane Arcadiévitch vint lui prendre le bras pour l’amener vers Karénine.
« Permettez-moi de vous faire faire connaissance, dit-il en les présentant l’un à l’autre.
– Enchanté de vous retrouver ici, dit froidement Alexis Alexandrovitch en serrant la main de Levine.
– Hé quoi, vous vous connaissez ? demanda Oblonsky avec étonnement.
– Nous avons fait route ensemble pendant trois heures, dit en souriant Levine, et nous nous sommes quittés aussi intrigués qu’au bal masqué, moi du moins.
– Vraiment ?… Messieurs, veuillez passer dans la salle à manger », dit Stépane Arcadiévitch en se dirigeant vers la porte.
Les hommes le suivirent et s’approchèrent d’une table où était servie la zakouska, composée de six espèces d’eaux-de-vie, d’autant de variétés de fromages, ainsi que de caviar, de hareng, de conserves, et d’assiettées de pain français, coupé en tranches minces.
Les hommes mangèrent debout autour de la table et, en attendant le dîner, la russification de la Pologne commençait à languir. Au moment de quitter le salon, Alexis Alexandrovitch démontrait que les principes élevés introduits par l’administration russe pouvaient seuls obtenir ce résultat. Pestzoff soutenait qu’une nation ne peut s’en assimiler une autre qu’à condition de l’emporter en densité de population. Kosnichef, avec certaines restrictions, partageait les deux avis, et pour clore cette conversation trop sérieuse par une plaisanterie, il ajouta en souriant :
« Le plus logique, pour nous assimiler les étrangers, me semblerait donc être d’avoir autant d’enfants que possible. C’est là où mon frère et moi sommes en défaut, tandis que vous, messieurs, et surtout Stépane Arcadiévitch, agissez en bons patriotes. Combien en avez-vous ? » demanda-t-il à celui-ci en lui tendant un petit verre à liqueur.
Chacun rit, Oblonsky plus que personne.
« Fais-tu encore de la gymnastique ? dit Oblonsky en prenant Levine par le bras, et, sentant les muscles vigoureux de son ami se tendre sous le drap de la redingote : Quel biceps ! tu es un vrai Samson.
– Pour chasser l’ours, il faut, je suppose, être doué d’une force remarquable ? » demanda Alexis Alexandrovitch, dont les notions sur cette chasse étaient de l’ordre le plus vague.
Levine sourit :
« Nullement : un enfant peut tuer un ours ; – et il recula avec un léger salut pour faire place aux dames qui s’approchaient de la table.
– On m’a dit que vous veniez de tuer un ours ? dit Kitty, cherchant à piquer de sa fourchette un champignon récalcitrant, et découvrant un peu son joli bras en rejetant la dentelle de sa manche. Y a-t-il vraiment des ours chez vous ? » ajouta-t-elle en tournant à demi vers lui sa jolie tête souriante.
Combien ces paroles, peu remarquables par elles-mêmes, ce son de voix, ces mouvements de mains, de bras et de tête, avaient de charme pour lui ! Il y voyait une prière, un acte de confiance, une caresse douce et timide, une promesse, une espérance, même une preuve d’amour qui l’étouffait de bonheur.
« Oh non, nous avons été chasser dans le gouvernement de Tver, et c’est en revenant de là que j’ai rencontré en wagon votre beau-frère, le beau-frère de Stiva, dit-il en souriant. La rencontre a été comique. »
Et il raconta gaiement et plaisamment comment, après avoir veillé la moitié de la nuit, il était entré de force, en touloupe, dans le wagon de Karénine.
« Le conducteur voulait m’éconduire à cause de ma tenue ; j’ai du me fâcher, et vous, monsieur, dit-il en se tournant vers Karénine, après m’avoir un moment jugé sur mon costume, avez pris ma défense, ce dont je vous ai été bien reconnaissant.
– Les droits des voyageurs au choix de leurs places sont trop peu déterminés en général, dit Alexis Alexandrovitch en s’essuyant le bout des doigts avec son mouchoir, après avoir mangé une fine tranche de pain et de fromage.
– Oh, j’ai bien remarqué votre hésitation, répondit en souriant Levine : c’est pourquoi je me suis hâté d’entamer un sujet de conversation sérieux pour faire oublier ma peau de mouton. »
Kosnichef, qui causait avec la maîtresse de la maison tout en prêtant l’oreille à la conversation, tourna la tête vers son frère. « D’où lui viennent ces airs conquérants ? » pensa-t-il.
Et en effet il semblait que Levine se sentît pousser des ailes ! Car elle l’écoutait, elle prenait plaisir à l’entendre parler ; tout autre intérêt disparaissait devant celui-là. Il était seul avec elle, non seulement dans cette chambre, mais dans l’univers entier, et planait à des hauteurs vertigineuses, tandis qu’en bas, au-dessous d’eux, s’agitaient ces excellentes gens, Oblonsky, Karénine, et le reste de l’humanité.
Stépane Arcadiévitch, en plaçant son monde à table, sembla complètement oublier Levine et Kitty, puis, se rappelant soudain leur existence, il les mit l’un auprès de l’autre.
Le dîner, servi avec élégance, car Stépane Arcadiévitch y tenait beaucoup, réussit complètement. Le potage Marie-Louise, accompagné de petits pâtés qui fondaient dans la bouche, fut parfait, et Matvei, avec deux domestiques en cravate blanche, fit le service adroitement et sans bruit.
Le succès ne fut pas moindre au point de vue de la conversation : tantôt générale, tantôt particulière, elle ne tarit pas, et lorsque, le dîner fini, on quitta la table, Alexis Alexandrovitch lui-même était dégelé.
X
Pestzoff, qui aimait à discuter une question à fond, n’avait pas été content de l’interruption de Kosnichef ; il trouvait qu’on ne lui avait pas suffisamment laissé expliquer sa pensée.
« En parlant de la densité de la population, je n’entendais pas en faire le principe d’une assimilation, mais seulement un moyen, dit-il dès le potage en s’adressant spécialement à Alexis Alexandrovitch.
– Il me semble que cela revient au même, répondit Karénine avec lenteur. À mon sens, un peuple ne peut avoir d’influence sur un autre peuple qu’à la condition de lui être supérieur en civilisation…
– Voilà précisément la question, interrompit Pestzoff avec une ardeur si grande qu’il semblait mettre toute son âme à défendre ses opinions. Comment doit-on entendre cette civilisation supérieure ? Qui donc, parmi les diverses nations de l’Europe, prime les autres ? Est-ce le Français, l’Anglais ou l’Allemand qui nationalisera ses voisins ? Nous avons vu franciser les provinces rhénanes : est-ce une preuve d’infériorité du côté des Allemands ? Non, il y a là une autre loi, cria-t-il de sa voix de basse.
– Je crois que la balance penchera toujours du côté de la véritable civilisation.
– Mais quels sont les indices de cette véritable civilisation ?
– Je crois que tout le monde les connaît.
– Les connaît-on réellement ? demanda Serge Ivanitch en souriant finement. On croit volontiers, pour le moment, qu’en dehors de l’instruction classique la civilisation n’existe pas ; nous assistons sur ce point à de furieux débats, et chaque parti avance des preuves qui ne manquent pas de valeur.
– Vous êtes pour les classiques, Serge Ivanitch ? dit Oblonsky… Vous offrirai-je du bordeaux ?
– Je ne parle pas de mes opinions personnelles, répondit Kosnichef avec la condescendance qu’il aurait éprouvée pour un enfant, en avançant son verre. Je prétends seulement que, de part et d’autre, les raisons qu’on allègue sont bonnes, continua-t-il en s’adressant à Karénine. Par mon éducation je suis classique ; ce qui ne m’empêche, pas de trouver que les études classiques n’offrent pas de preuves irrécusables de leur supériorité sur les autres.
– Les sciences naturelles prêtent tout autant à un développement pédagogique de l’esprit humain, reprit Pestzoff. Voyez l’astronomie, la botanique, la zoologie avec l’unité de ses lois !
– C’est une opinion que je ne saurais partager, répondit Alexis Alexandrovitch. Peut-on nier l’heureuse influence sur le développement de l’intelligence de l’étude des formes du langage ? La littérature ancienne est éminemment morale, tandis que, pour notre malheur, on joint à l’étude des sciences naturelles des doctrines funestes et fausses qui sont le fléau de notre époque. »
Serge Ivanitch allait répondre, mais Pestzoff l’interrompit de sa grosse voix pour démontrer chaleureusement l’injustice de ce jugement ; lorsque Kosnichef put enfin parler, il dit en souriant à Alexis Alexandrovitch :
« Avouez que le pour et le contre des deux systèmes seraient difficiles à établir si l’influence morale, disons le mot, antinihiliste, de l’éducation classique ne militait pas en sa faveur ?
– Sans le moindre doute.
– Nous laisserions le champ plus libre aux deux systèmes si nous ne considérions pas l’éducation classique comme une pilule, que nous offrons hardiment à nos patients contre le nihilisme. Mais sommes-nous bien sûrs des vertus curatives de ces pilules ? »
Le mot fit rire tout le monde, principalement le gros Tourovtzine, qui avait vainement cherché à s’égayer jusque-là.
Stépane Arcadiévitch avait eu raison de compter sur Pestzoff pour entretenir la conversation, car à peine Kosnichef eut-il clos la conversation en plaisantant qu’il reprit :
« On ne saurait même accuser le gouvernement de se proposer une cure, car il reste visiblement indifférent aux conséquences des mesures qu’il prend ; c’est l’opinion publique qui le dirige. Je citerai comme exemple la question de l’éducation supérieure des femmes. Elle devrait être considérée comme funeste : ce qui n’empêche pas le gouvernement d’ouvrir les cours publics et les universités aux femmes. »
Et la conversation s’engagea aussitôt sur l’éducation des femmes.
Alexis Alexandrovitch fit remarquer que l’instruction des femmes était trop confondue avec leur émancipation, et ne pouvait être jugée funeste qu’à ce point de vue.
« Je crois, au contraire, que ces deux questions sont intimement liées l’une à l’autre, dit Pestzoff. La femme est privée de droits parce qu’elle est privée d’instruction, et le manque d’instruction tient à l’absence de droits. N’oublions pas que l’esclavage de la femme est si ancien, si enraciné dans nos mœurs, que bien souvent nous sommes incapables de comprendre l’abîme légal qui la sépare de nous.
– Vous parlez de droits, dit Serge Ivanitch quand il parvint à placer un mot : est-ce le droit de remplir les fonctions de juré, de conseiller municipal, de président de tribunal, de fonctionnaire public, de membre du parlement ?
– Sans doute.
– Mais si les femmes peuvent exceptionnellement remplir ces fonctions, il serait plus juste de donner à ces droits le nom de devoirs ? Un avocat, un employé de télégraphe, remplit un devoir. Disons donc, pour parler logiquement, que les femmes cherchent des devoirs, et dans ce cas nous devons sympathiser à leur désir de prendre part aux travaux des hommes.
– C’est juste, appuya Alexis Alexandrovitch : le tout est de savoir si elles sont capables de remplir ces devoirs.
– Elles le seront certainement aussitôt qu’elles seront plus généralement instruites, dit Stépane Arcadiévitch ; nous le voyons…
– Et le proverbe ? demanda le vieux prince, dont les petits yeux moqueurs brillaient en écoutant cette conversation. Je puis me le permettre devant mes filles : « La femme a les cheveux longs… »
– C’est ainsi qu’on jugeait les nègres avant leur émancipation ! s’écria Pestzoff mécontent.
– J’avoue que ce qui m’étonne, dit Serge Ivanitch, c’est de voir les femmes chercher de nouveaux devoirs, quand nous voyons malheureusement les hommes éluder autant que possible les leurs !
– Les devoirs sont accompagnés de droits ; les honneurs, l’influence, l’argent, voilà ce que cherchent les femmes, dit Pestzoff.
– Absolument comme si je briguais le droit d’être nourrice et trouvais mauvais qu’on me refusât, tandis que les femmes sont payées pour cela, » dit le vieux prince.
Tourovtzine éclata de rire, et Serge Ivanitch regretta de n’être pas l’auteur de cette plaisanterie ; Alexis Alexandrovitch lui-même se dérida.
« Oui, mais un homme ne peut allaiter, tandis qu’une femme… dit Pestzoff.
– Pardon ; un Anglais, à bord d’un navire, est arrivé à allaiter lui-même son enfant, dit le vieux prince, qui se permettait quelques libertés de langage devant ses filles.
– Autant d’Anglais nourrices, autant de femmes fonctionnaires, dit Serge Ivanitch.
– Mais les filles sans famille ? demanda Stépane Arcadiévitch qui, en soutenant Pestzoff, avait pensé tout le temps à la Tchibisof, sa petite danseuse.
– Si vous scrutez la vie de ces jeunes filles, s’interposa ici Daria Alexandrovna avec une certaine aigreur, vous trouverez certainement qu’elles ont abandonné une famille dans laquelle des devoirs de femmes étaient à leur portée. »
Dolly comprenait instinctivement à quel genre de femmes Stépane Arcadiévitch faisait allusion.
« Mais nous défendons un principe, un idéal, riposta Pestzoff de sa voix tonnante. La femme réclame le droit d’être indépendante et instruite ; elle souffre de son impuissance à obtenir l’indépendance et l’instruction.
– Et moi je souffre de n’être pas admis comme nourrice à la maison des enfants trouvés », répéta le vieux prince, à la grande joie de Tourovtzine, qui en laissa choir une asperge dans sa sauce par le gros bout.
XI
Seuls Kitty et Levine n’avaient pris aucune part à la conversation.
Au commencement du dîner, quand on parla de l’influence d’un peuple sur un autre, Levine fut ramené aux idées qu’il s’était faites à ce sujet ; mais elles s’effacèrent bien vite, comme n’offrant plus aucun intérêt ; il trouva étrange qu’on pût s’embarrasser de questions aussi oiseuses.
Kitty, de son côté, aurait dû s’intéresser à la discussion sur les droits des femmes, car, non seulement elle s’en était souvent occupée à cause de son amie Varinka, dont la dépendance était si rude, mais pour son propre compte, dans le cas où elle ne se marierait pas. Souvent sa sœur et elle s’étaient disputées à ce sujet. Combien peu cela l’intéressait maintenant ! Entre Levine et elle s’établissait une affinité mystérieuse qui les rapprochait de plus en plus, et leur causait un sentiment de joyeuse terreur, au seuil de la nouvelle vie qu’ils entrevoyaient.
Questionné par Kitty sur la façon dont il l’avait aperçue en été, Levine lui raconta qu’il revenait des prairies, par la grand’route, après le fauchage.