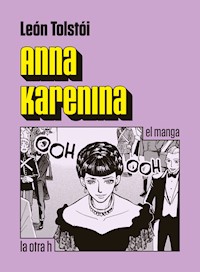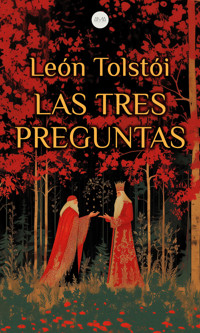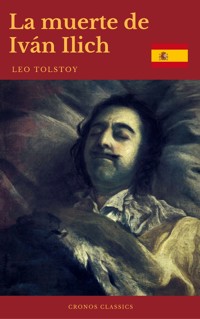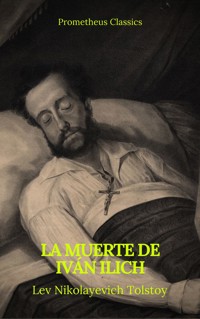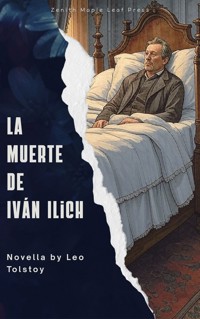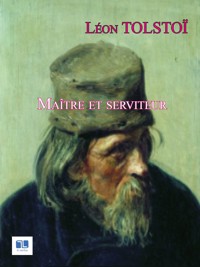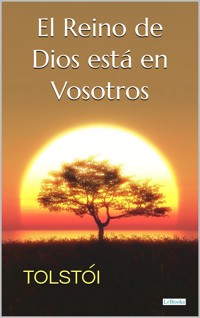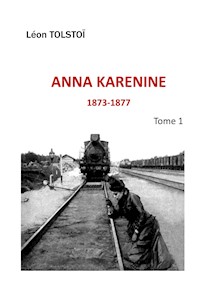
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Léon Tolstoï
- Sprache: Französisch
Paru en 1877, ANNA KARENINE est un roman de Léon Tolstoï qui se divise en deux tomes et comprend huit parties dont trois appartiennent au premier tome et cinq au second. Se déroulant en Russie, l'histoire est centrée sur l'amour, ses diverses formes et les conséquences dans la vie. Connaissant un grand succès, ce chef d'oeuvre marque également l'entrée triomphante de la littérature russe dans la culture européenne. Résumé: Stépan Arkadiévitch Oblonskï, surnommé Stiva est marié avec la princesse Daria Alexandrovna, surnommée Dolly, depuis huit ans. Ce dernier entretient une liaison avec une française, Mademoiselle Roland, qui avait été l'institutrice des ses enfants. Lorsque Dolly apprend cette liaison, elle envisage de le quitter, et celui-ci se demande comment s'y prendre pour rompre avec l'institutrice. Il invite à Moscou sa soeur ANNA, que sa femme apprécie pour essayer de la convaincre de rester..... Bonne lecture......
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Source : Ce livre est extrait de la bibliothèque numérique Wikisource et les illustrations de de Wikimedia Commons, la médiathèque libre. Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution – Partage dans les mêmes conditions 3.0 non transposé. Pour voir une copie de cette licence, visitez :http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
« C’est à moi que la vengeance appartient, je le rendrai. Romains, XII-19. »
Table des matières
TOME 1
Première partie
Chapitre premier
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
Chapitre XXXIII
Chapitre XXXIV
Deuxième partie
Chapitre premier
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
Chapitre XXXIII
Chapitre XXXIV
Chapitre XXXV
Troisième partie
Chapitre premier
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
TOME 1
Première partie
Chapitre premier
Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse, au contraire, l’est à sa façon.
Tout était bouleversé dans la famille des Oblonskï. La princesse, ayant appris que son mari entretenait des relations avec la gouvernante française qui était chez eux, avait déclaré à son mari qu’elle ne pouvait plus vivre sous le même toit que lui. Cette situation, qui durait déjà depuis trois jours, était pénible pour les époux eux-mêmes, pour tous les membres de la famille et le personnel de la maison. Tous les parents et les familiers sentaient que leur cohabitation n’avait plus de raison d’être et que les étrangers que le hasard fait se rencontrer dans une auberge sont plus liés entre eux que ne pouvaient l’être maintenant les membres de la famille Oblonskï. La femme ne sortait pas de sa chambre ; le mari était absent depuis trois jours ; les enfants erraient par toute la maison comme des abandonnés ; l’Anglaise s’était querellée avec la femme de charge et avait écrit à une amie de lui trouver une nouvelle place ; le cuisinier, la veille, s’était absenté à l’heure du dîner ; la cuisinière et le cocher demandaient leur compte.
Le troisième jour après la querelle, le prince Stépan Arkadiévitch Oblonskï, — Stiva comme on l’appelait dans le monde, — s’éveillait à son heure habituelle, c’est-à-dire à huit heures du matin, non dans la chambre à coucher de sa femme mais dans son cabinet de travail, sur le divan couvert de maroquin. Il retourna son corps puissant et bien soigné sur les ressorts du divan, comme s’il avait l’intention de s’endormir pour longtemps. De l’autre côté, il enlaça fortement l’oreiller et y appuya sa joue. Mais, tout à coup, il se redressa, s’assit sur le divan et ouvrit les yeux.
— « Oui, oui, comment était-il donc ? pensa t-il, se rappelant son rêve. Oui, comment était-ce ? C’est cela : Alabine donnait un dîner à Darmstadt ; non, pas à Darmstadt, quelque part en Amérique. Si, mais Darmstadt se trouvait en Amérique. Oui, Alabine donnait un dîner sur une table de verre et la table chantait : il mio tesore. Non, pas cela, quelque chose de mieux, de beaucoup mieux, et il y avait sur cette table de petites carafes qui étaient des femmes… »
Les yeux de Stépan Arkadiévitch brillèrent joyeusement et il songea, en souriant :
— « Oui, c’était très bien. Il y avait là-bas encore beaucoup de choses admirables, mais les paroles et même les idées sont impuissantes à les rendre, cela ne peut s’exprimer. »
Apercevant un rayon de lumière qui filtrait par l’entre-bâillement d’un des stores, il sortit vivement ses pieds du divan, cherchant les pantoufles de maroquin doré que sa femme lui avait brodées pour son dernier anniversaire, et les chaussa ; puis, par une habitude vieille de neuf ans, sans se lever, il tendit la main du côté où, dans sa chambre à coucher, se trouvait accrochée sa robe de chambre. Alors il se rappela comment et pourquoi il n’était pas couché dans la chambre de sa femme, mais dans son cabinet de travail. Le sourire s’effaça de son visage, son front se plissa.
— Ah ! ah ! ah ! gémit-il en se rappelant tout ce qui s’était passé. Et dans son imagination il revit tous les détails de la scène qu’il avait eue avec sa femme, et sa situation sans issue, qu’il ne devait qu’à sa propre faute, ainsi qu’il le déplorait.
— « Oui, pensait-il, elle ne pardonnera pas, elle ne peut pas pardonner. Et le plus terrible c’est que moi seul suis cause de tout. Je suis la cause, mais je ne suis pas coupable. C’est là qu’est tout le drame ! »
— Ah ! ah ! ah ! fit-il avec désespoir en se rappelant les impressions les plus pénibles pour lui de cette querelle. C’était le premier moment qui avait été le plus dur : quand, revenant du théâtre, joyeux et satisfait, tenant à la main une énorme poire, destinée à sa femme, il n’avait trouvé celle-ci ni au salon, ni dans le cabinet de travail et l’avait enfin découverte dans sa chambre à coucher, tenant le maudit billet révélateur.
Elle, cette Dolly toujours souriante et active, et qu’il jugeait peu clairvoyante, était assise immobile, le billet dans la main, et le regardait avec une expression d’horreur, mêlée de désespoir et de colère.
— Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est ? demandait-elle en montrant le billet.
À ce souvenir, comme il arrive souvent, Stépan Arkadiévitch était tourmenté, moins par le fait lui-même que par la façon dont il avait répondu aux paroles de sa femme.
Il lui était arrivé ce qui arrive d’ordinaire aux hommes pris à l’improviste dans quelque situation équivoque. Il n’avait pu se préparer un visage conforme à la situation dans laquelle il se trouvait, en présence de sa femme, après la découverte de son crime. Paraître offensé, nier, se justifier, demander pardon, rester même indifférent, tout aurait été mieux que ce qu’il avait fait. Son visage, tout à fait involontairement, « par suite d’un réflexe du cerveau, » pensa Stépan Arkadiévitch qui aimait la psychologie, sourit tout à coup, de son sourire ordinaire, à la fois bon et niais.
Cette attitude déplacée, il ne pouvait se la pardonner. À ce sourire, Dolly tressaillit comme sous l’aiguillon d’une douleur physique et, avec son emportement accoutumé, laissa échapper un torrent de mots cruels puis s’enfuit de la chambre. Depuis elle n’avait pas voulu revoir son mari.
« La cause de tout, c’est ce sourire bête, se disait Stépan Arkadiévitch. Mais que faire, que faire ? » répétait-il avec désespoir sans trouver de solution.
Chapitre II
Stépan Arkadiévitch était un homme franc avec lui-même. Il ne pouvait se leurrer ni se persuader qu’il se repentait de sa conduite. Il ne pouvait se faire un crime, lui, un bel homme de trente-quatre ans, de complexion ardente, de n’être pas amoureux de sa femme, qui avait donné le jour à sept enfants, dont deux étaient morts, et qui n’avait qu’un an de moins que lui. Il se repentait seulement de ne pas s’être mieux caché de sa femme ; mais il sentait tout le poids de sa situation et plaignait sa femme, ses enfants et lui-même. Peut-être eût-il mieux caché cette faute à sa femme s’il avait pu prévoir l’effet d’un tel événement sur elle. Évidemment, ils n’avaient jamais discuté cette question, mais il s’imaginait vaguement que depuis longtemps sa femme soupçonnait ses infidélités et qu’elle y était indifférente. Il lui semblait même que sa femme, fatiguée, déjà âgée, pas jolie ni remarquable en quoi que ce soit, tout simplement bonne mère de famille, devait en toute justice être indulgente. Et il venait de découvrir que c’était tout le contraire !
— « Ah ! comme c’est terrible ! Ah ! Ah ! répétait Stépan Arkadiévitch ; et il ne pouvait trouver d’issue. Et comme tout allait bien jusque-là ! Comme nous étions heureux ! Elle était contente, heureuse avec ses enfants. Je ne la gênais en rien, je la laissais s’occuper des enfants à sa guise. Ce qui est mal en effet, c’est qu’elle était gouvernante dans notre maison. Oui, ce n’est pas bien ! Il y a quelque chose de vulgaire et de banal à faire la cour à sa gouvernante. Mais aussi quelle femme ! (Et il revoyait nettement, dans sa pensée, les yeux noirs et vifs et le sourire de mademoiselle Roland). Mais tout le temps qu’elle fut à la maison je ne me suis rien permis. Et le pire de tout c’est qu’elle… C’est un fait exprès ! Ah ! Ah ! Ah ! que faire ? que faire ? »
Il n’y avait pas d’autre réponse que celle qu’apporte la vie à toutes les questions les plus compliquées et les plus difficiles à résoudre : s’accommoder du présent, c’est-à-dire oublier. Oublier dans le sommeil, c’était impossible avant la nuit ; du moins, il était impossible de retourner à cette musique que chantaient les petites femmes-carafes de son rêve, alors il lui fallait oublier dans le sommeil de la vie.
— « Plus tard, je verrai ! » se dit Stépan Arkadiévitch ; et, se levant, il endossa une robe de chambre grise doublée de soie bleu clair, noua la ceinture, et faisant provision d’air dans sa large poitrine, de son pas habituel, ferme sur ses jarrets musclés malgré le poids de son corps puissant, il s’approcha de la fenêtre, souleva le store et sonna très fort. Aussitôt parut son vieux valet de chambre Matthieu, portant les habits, les bottes et un télégramme. Derrière lui venait le barbier avec ses instruments.
— Y a-t-il des papiers de la chancellerie ? demanda Stépan Arkadiévitch, et prenant le télégramme, il s’assit en face du miroir.
— Ils sont sur la table, répondit Matthieu en regardant son maître d’un air interrogateur et compatissant. Et, après un moment, il ajouta avec un fin sourire :
— On est venu de chez le loueur de voitures.
Stépan Arkadiévitch ne répondit rien, mais dans le miroir il regarda Matthieu. Leurs regards se rencontrèrent : ils se comprenaient. Le regard de Stépan Arkadiévitch semblait dire : Pourquoi dis-tu cela ? Ne sais-tu pas ?
Matthieu mit ses mains dans les poches de sa jaquette, les jambes un peu écartées, et, en silence, souriant à peine, regarda avec bonhomie son maître.
— J’ai donné l’ordre de revenir dimanche prochain et d’ici là de ne pas vous importuner, au reste il est inutile qu’il se dérange pour rien, dit-il, ayant évidemment préparé sa phrase à l’avance.
Stépan Arkadiévitch comprit que Matthieu voulait plaisanter et se faire remarquer. Il ouvrit le télégramme et le lut en devinant les mots écorchés comme toujours ; aussitôt son visage s’éclaircit.
— Matthieu, ma sœur, Anna Arkadiévna, arrive demain ! dit-il, en arrêtant pour un moment la main luisante et épaisse du barbier qui traçait une raie rose dans sa barbe frisée.
— Grâce à Dieu ! dit Matthieu montrant par cette exclamation qu’il comprenait comme son maître l’importance de cette nouvelle : il savait qu’Anna Arkadiévna, la sœur préférée de Stépan Arkadiévitch, pouvait aider à la réconciliation des époux.
— Vient-elle seule ou avec son mari ? demanda Matthieu.
Stépan Arkadiévitch ne pouvait parler, car le barbier, tout à son travail, l’en empêchait. Il leva un doigt. Matthieu, dans le miroir, hocha la tête.
— Seule ! dit-il. Faut-il préparer la chambre d’en haut ?
— Annonce la nouvelle à Daria Alexandrovna. Elle te donnera les ordres.
— À Daria Alexandrovna ! répéta Matthieu d’un air de doute.
— Oui, annonce-lui. Tiens, prends le télégramme ; donne-le-lui, tu verras ce qu’elle dira.
« Il veut essayer », pensa Matthieu ; et il répondit simplement :
— Oui, monsieur.
Stépan Arkadiévitch était déjà lavé, peigné et se préparait à s’habiller, quand Matthieu, chaussé de bottes grinçantes, rentra dans la chambre à pas lents, le télégramme à la main. Le barbier était parti.
— Daria Alexandrovna m’a donné l’ordre de vous dire qu’elle part et que vous agissiez comme il vous plaira, dit Matthieu, les yeux riants, en mettant les mains dans ses poches, la tête penchée de côté et le regard fixé sur son maître.
Stépan Arkadiévitch se tut ; puis un sourire lent et quelque peu triste parut sur son joli visage.
— Ah ! Matthieu ! fit-il en hochant la tête.
— Ce n’est rien, monsieur, tout s’arrangera.
— Que dis-tu ?
— Parfaitement.
— Tu crois ? Qui donc est là ? demanda Stépan Arkadiévitch en entendant derrière la porte le froissement d’une robe de femme.
— C’est moi ! répondit une voix féminine, ferme et agréable.
Et dans l’ouverture de la porte parut le visage sévère et grêlé de Matriona Philémonovna, la vieille bonne.
— Eh bien, qu’y a-t-il, Matriocha ? demanda Stépan Arkadiévitch en allant vers la porte.
Bien qu’il fût absolument coupable envers sa femme et qu’il s’en rendît compte, toute la maison, même la vieille bonne, amie de Daria Alexandrovna, était de son côté.
— Eh bien qu’y a-t-il ? fit-il tristement.
— Allez, monsieur, allez trouver Daria Alexandrovna. Dieu sera peut-être miséricordieux. Elle ne cesse de se lamenter, elle fait peine à voir, et, dans la maison, maintenant, tout va de travers. Il faut avoir pitié des enfants, monsieur. Repentez-vous, monsieur. Que faire ? Il faut expier sa faute…
— Mais elle ne me recevra pas…
— Faites quand même votre devoir. Dieu est miséricordieux, priez-le, monsieur, priez-le.
— Bon, bon, va ! fit soudain Stépan Arkadiévitch en rougissant. Allons, donne-moi mes habits, dit-il à Matthieu, et, d’un geste résolu, il enleva sa robe de chambre.
Matthieu, tout en soufflant sur une poussière imaginaire, tenait la chemise comme un collier, et avec un plaisir évident y passa le corps très soigné de son maître.
Chapitre III
Une fois habillé, Stépan Arkadiévitch se parfuma, d’un geste habituel tira ses manchettes, mit dans sa poche ses cigarettes, son portefeuille, ses allumettes, sa montre et sa chaîne double à breloques, déplia son mouchoir, et, se sentant propre, parfumé, bien portant et physiquement gai malgré son malheur, tout en traînant un peu les jambes passa dans la salle à manger où l’attendaient, à côté de son café, les lettres et les papiers du ministère.
Il lut les lettres : L’une d’elles, fort désagréable, était d’un marchand qui voulait acheter la forêt et le domaine de sa femme. Il était nécessaire de vendre, mais, avant sa réconciliation avec sa femme, il n’y pouvait plus penser, et le plus désagréable c’était qu’un intérêt d’argent se mêlât à cette réconciliation. La pensée qu’il pouvait être incité à se réconcilier avec sa femme par une question d’argent, le blessait.
Après avoir lu les lettres, Stépan Arkadiévitch rapprocha de lui les papiers du ministère, feuilleta rapidement deux dossiers, écrivit au crayon quelques notes et, repoussant les dossiers, prit son café. Tout en buvant, il déplia le journal du matin encore humide et se mit à lire. Stépan Arkadiévitch recevait et lisait un journal libéral non d’opinions extrêmes mais de cette moyenne où se tient la majorité. Bien que ni la science, ni l’art, ni la politique proprement dite ne l’intéressassent il avait une opinion arrêtée sur tous ces sujets : celle de la majorité et de son journal, et il n’en changeait qu’avec la majorité, ou, pour mieux dire il n’en changeait point, mais c’était les opinions elles-mêmes qui se modifiaient insensiblement en lui. Stépan Arkadiévitch ne choisissait ni la direction ni les opinions, elles venaient à lui d’elles-mêmes, de même qu’il ne choisissait pas la forme d’un chapeau ou d’un vêtement mais se conformait à la mode. Avoir des opinions, pour cet homme qui vivait dans un certain milieu, avec le besoin d’une certaine activité de pensée dont le développement s’effectue généralement à l’âge mûr, c’était aussi nécessaire que d’avoir un chapeau. S’il préférait l’opinion libérale à la conservatrice, à laquelle se rangeaient beaucoup de personnes de son monde, c’était moins parce qu’il trouvait l’opinion libérale plus raisonnable que parce qu’elle était plus en rapport avec son train de vie. Le parti libéral disait qu’en Russie tout allait mal, et, en effet Stépan Arkadiévitch avait beaucoup de dettes et manquait d’argent. Le parti libéral affirmait que le mariage est une institution démodée et bonne à réformer, et en effet, la vie familiale procurait peu de plaisirs à Stépan Arkadiévitch et le forçait à mentir et à feindre, au mépris de sa franchise naturelle. Le parti libéral disait, ou plutôt laissait entendre, que la religion n’est qu’un frein pour la classe illettrée de la population, et, en effet, Stépan Arkadiévitch ne pouvait écouter, sans avoir mal aux jambes, la messe la plus courte et ne pouvait comprendre l’utilité de toutes ces paroles pompeuses et terribles sur l’autre monde quand la vie ici-bas peut être si gaie. En outre, Stépan Arkadiévitch, qui aimait la plaisanterie gaie, prenait parfois plaisir à étonner un homme pacifique quelconque, en disant que si l’on s’enorgueillit de la race, il ne faut cependant pas s’arrêter au prince Rurik et renier ce premier ancêtre : le singe. Ainsi la direction libérale devenait une habitude pour Stépan Arkadiévitch, et il aimait son journal, comme un cigare après dîner, pour le léger brouillard qu’il produisait en sa tête.
Il lut le premier article.
« De notre temps, y disait-on, l’on crie vainement que le radicalisme menace d’engloutir tous les éléments conservateurs et que le gouvernement est obligé de prendre des mesures pour la suppression de l’hydre révolutionnaire. Au contraire, selon nous, le danger n’est pas dans l’hydre imaginaire de la révolution mais dans l’obstacle des traditions qui entravent le progrès, etc. »
Il lut ensuite un article financier où étaient cités les noms de Bentham, de Mill, etc., et qui contenait des pointes à l’adresse du ministère. Avec sa vivacité habituelle d’assimilation, il saisissait le sens de chaque allusion, il voyait de qui elles venaient, à qui elles s’adressaient, au sujet de quoi, et, d’ordinaire, il en éprouvait un certain plaisir. Mais ce jour-là ce plaisir était empoisonné par le souvenir des conseils de Matriona Philémonovna et du désarroi de sa maison où tout allait si mal. Il lut aussi que le comte de Beust, comme le bruit en avait couru, était parti pour Wiesbaden ; qu’il n’existait plus de cheveux gris ; il lut l’annonce de la vente d’une voiture légère, et la demande d’emploi d’une jeune personne, mais ces renseignements ne lui procuraient pas, comme d’habitude, un plaisir doux, ironique. Ayant terminé son journal, il but une deuxième tasse de café, mangea un croissant beurré, puis il se leva et secoua les miettes tombées sur son gilet ; ensuite, dilatant sa large poitrine, il sourit joyeusement, non qu’il eût en l’âme quelque sentiment particulièrement agréable : la bonne digestion seule était cause de ce joyeux sourire.
Mais soudain tout lui revint à la mémoire et il devint pensif.
Deux voix d’enfants se firent entendre derrière la porte. Stépan Arkadiévitch reconnut la voix de Gricha, son jeune fils, et celle de Tania, sa fille aînée. Ils traînaient quelque chose qu’ils laissèrent tomber.
— Je te disais bien de ne pas mettre les voyageurs sur l’impériale, cria la fillette, en anglais. Voilà ! maintenant, ramasse !
« Tout va de travers, pensa Stépan Arkadiévitch. Maintenant les enfants ne sont plus surveillés ! »
Il s’approcha de la porte et les appela. Ils quittèrent la boîte qu’ils avaient transformée en chemin de fer et vinrent près de leur père.
La fillette, favorite du père, accourut hardiment. Il l’embrassa. Toute rieuse, elle resta suspendue à son cou, ravie comme toujours de l’odeur des parfums qui se dégageait des favoris de son père. Ayant enfin embrassé son visage congestionné par la position inclinée où elle le maintenait et illuminé par la tendresse, la fillette détacha ses bras et voulut s’en aller. Son père la retint.
— Que fait maman ? demanda-t-il en caressant le petit cou délicat et doux de sa fille. Puis s’adressant à son fils. « Bonjour, » lui dit-il. Il reconnaissait qu’il aimait moins le garçon et il s’efforçait toujours d’être juste ; mais l’enfant sentait cette préférence, et il ne répondit pas au sourire de son père.
— Maman, répondit la fillette, elle est levée.
Stépan Arkadiévitch soupira.
« Elle n’a encore pas dormi de la nuit », pensa-t-il.
— Eh bien, est-elle gaie ? poursuivit-il.
La fillette savait qu’une querelle avait eu lieu entre ses parents et que sa mère ne pouvait être gaie ; elle comprit que son père dissimulait en posant cette question si délibérément et elle rougit pour lui. Il s’en aperçut aussitôt et rougit aussi.
— Je ne sais pas, dit-elle. Elle ne nous a pas ordonné d’étudier ; elle nous a dit d’aller chez grand’mère avec miss Hull.
— Eh bien, va, ma petite Tanioucha. Ah, attends, dit-il, la retenant encore et caressant sa petite main délicate.
Il prit sur la cheminée une petite boîte de bonbons qu’il y avait placée la veille et lui en donna deux, en choisissant ceux qu’elle préférait : un chocolat et un fondant.
— Celui-ci est pour Gricha ? demanda la fillette en montrant le chocolat.
— Oui, oui, répondit-il ; et, caressant encore sa petite épaule, il lui embrassa les cheveux et le cou, puis la laissa partir.
— La voiture est avancée ! dit Matthieu. Ah ! il y a une solliciteuse, ajouta-t-il.
— Depuis longtemps ?
— À peu près une demi-heure.
— Combien de fois t’ai-je ordonné de m’avertir aussitôt.
— Il faut au moins vous donner le temps de prendre votre café, dit Matthieu d’un ton amical et familier contre lequel on ne pouvait se fâcher.
— Eh bien, dépêche-toi de faire entrer ! dit Oblonskï en fronçant les sourcils de dépit.
La solliciteuse, veuve d’un capitaine d’état-major nommé Kalinine, demandait une chose impossible et insensée. Mais Stépan Arkadiévitch, comme il en avait coutume, la pria de s’asseoir, l’écouta attentivement sans l’interrompre et lui indiqua exactement la marche à suivre ; il lui écrivit même, de sa belle écriture longue et lisible, un petit mot pour quelqu’un qui pouvait lui être utile.
Aussitôt la solliciteuse partie, Stépan Arkadiévitch prit son chapeau et s’arrêta, se demandant s’il n’avait point oublié quelque chose : il n’avait rien oublié, sauf ce qu’il voulait principalement oublier : sa femme.
— Ah ! oui ! s’écria-t-il en baissant la tête, et son joli visage prit une expression de mélancolie. Dois-je y aller ou non ?
Une voix intérieure lui disait de n’y pas aller, que tout ce qu’il dirait ne serait que feinte et mensonge, que la situation était irréparable parce qu’il était aussi impossible de rendre à sa femme le charme et l’attrait de la jeunesse que de faire de lui un vieillard inaccessible à l’amour. Maintenant le mensonge et l’hypocrisie pouvaient seuls le tirer de ce mauvais pas, et ces moyens répugnaient à sa franchise naturelle.
— « Cependant, il faudra bien en arriver là. On ne peut laisser les choses en cet état », se dit-il en tâchant de se donner du courage.
Il se redressa, prit une cigarette, l’alluma, aspira deux bouffées et la jeta dans un cendrier de nacre ; puis, à pas rapides, il traversa le salon et ouvrit la porte de la chambre de sa femme.
Chapitre IV
Daria Alexandrovna, vêtue d’une matinée, sa maigre chevelure, autrefois si belle et si épaisse, nouée en tresse sur le sommet de la tête, le visage fané, amaigri, les yeux effrayés, encore agrandis par la maigreur, était debout, entourée d’objets en désordre devant un chiffonnier ouvert dont elle triait d’autres objets.
Au bruit des pas de son mari elle s’arrêta et regarda la porte en s’efforçant, en vain, de donner à son visage une expression sévère et méprisante. Elle sentait qu’elle avait peur de lui et redoutait une explication. Pour la dixième fois depuis trois jours, elle venait de se mettre à faire le triage de ce qui lui appartenait à elle et aux enfants pour l’emporter chez sa mère ; mais, de nouveau, elle ne pouvait s’y résoudre. Cependant, la fois précédente, elle s’était dit qu’il fallait en finir ; elle avait décidé qu’elle devait agir sans hésitation, le punir, l’humilier, au moins se venger un peu du mal qu’il lui avait fait. Elle continuait à dire qu’elle allait le quitter, mais, au fond, elle se rendait compte que c’était impossible. C’était impossible parce qu’elle ne pouvait se déshabituer de le regarder comme son mari et de l’aimer. En outre, elle sentait que si chez elle, dans sa maison, elle arrivait à peine à soigner ses cinq enfants, cela lui serait encore plus difficile là où elle voulait s’en aller. Depuis trois jours le plus jeune était souffrant parce qu’on lui avait mal préparé sa bouillie, et la veille, les autres avaient à peine pu dîner. Elle sentait que son départ ne pouvait avoir lieu ; néanmoins, se leurrant elle-même, elle continuait ses préparatifs, s’en donnant ainsi l’illusion.
Quand elle aperçut son mari, elle plongea les mains dans le tiroir du chiffonnier comme pour y chercher quelque chose et se retourna seulement quand il fut très près d’elle. Son visage auquel elle s’efforçait de donner une expression de sévérité n’exprimait que la souffrance et l’abattement.
— Dolly ! fit-il d’une voix douce et timide. Et enfonçant sa tête dans les épaules, il cherchait une contenance humble et soumise, mais ne parvenait pas à atténuer son apparence de fraîcheur et de parfaite santé.
D’un regard rapide, elle le toisa des pieds à la tête.
— « Oui, pensa-t-elle, il est heureux et satisfait. Mais moi… Et cette bonté exaspérante, qui lui vaut l’amitié et les louanges de tous, m’inspire au contraire de la haine pour lui ! »
Ses lèvres se serrèrent, sa joue droite fut prise d’un tremblement convulsif, son visage devint pâle et se contracta.
— Que voulez-vous ? dit-elle d’une voix grave et brève que l’émotion rendait méconnaissable.
— Dolly, répéta-t-il la voix tremblante. Anna arrive aujourd’hui…
— Eh bien, que m’importe ? Je ne puis la recevoir, s’écria-t-elle.
— Mais cependant, Dolly, il le faut…
— Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! cria-t-elle sans le regarder et comme sous l’empire d’une douleur physique.
Stépan Arkadiévitch avait pu être tranquille tant qu’il avait pensé à sa femme ; il avait pu croire que, suivant l’expression de Matthieu, tout s’arrangerait, et il avait lu tranquillement le journal et bu son café, mais quand il vit ce visage tourmenté de martyre, quand il entendit le son de cette voix accablée et désespérée, ces soupirs étouffés, sa gorge se serra et ses yeux s’emplirent de larmes.
— Mon Dieu, qu’ai-je fait ? Dolly ! Au nom de Dieu !… s’écria-t-il ; mais il ne put continuer, les sanglots étouffaient sa voix.
Elle ferma brusquement le chiffonnier et le regarda.
— Dolly, que puis-je te dire ? Rien, sinon implorer mon pardon ! Souviens-toi des neuf années que nous avons vécues ; ne peuvent-elles racheter un moment, un moment…
Les yeux baissés elle écoutait, attendant ce qu’il allait dire pour la fléchir, la rassurer.
— Un moment d’entraînement ?… prononça-t-il.
Il voulut continuer, mais à ce mot, les lèvres de Dolly se crispèrent comme sous l’aiguillon d’une douleur physique, et, de nouveau, le côté droit de son visage tressaillit.
— Allez-vous-en ! Sortez d’ici ! cria-t-elle encore plus fort, et ne me parlez pas de vos entraînements et de vos turpitudes.
Elle voulut s’éloigner, mais elle chancela et s’appuya au dossier d’une chaise. Son visage se détendit, ses lèvres se gonflèrent et ses yeux s’emplirent de larmes.
— Dolly, prononça-t-il en sanglotant. Au nom de Dieu, pense aux enfants, ils ne sont pas coupables, eux ! Moi seul suis coupable ; punis-moi, ordonne-moi de racheter ma faute par n’importe quel moyen. Je suis prêt à tout ! Je suis coupable, il n’y a pas de mots pour exprimer combien je suis coupable, mais, Dolly, pardonne-moi !
Elle s’était assise. Il entendait sa respiration profonde et pénible et il la plaignait sincèrement. Plusieurs fois elle voulut parler, mais elle ne le put. Il attendait.
— Tu te souviens des enfants pour en jouer, mais moi j’y pense sérieusement, je sais qu’ils sont perdus maintenant.
Pendant ces trois derniers jours, elle avait dû se répéter fréquemment cette phrase.
Elle l’avait tutoyé ; il la regarda avec reconnaissance et s’avança pour lui prendre la main, mais elle s’écarta de lui avec dégoût.
— Oui, dit-elle, je me souviens des enfants, c’est pourquoi je ferai tout au monde pour les sauver, mais je ne sais pas moi-même de quelle façon m’y prendre pour cela : dois-je les éloigner de leur père ou les laisser vivre près d’un débauché… Voyons, après ce qui s’est passé, dites s’il nous est possible de vivre ensemble ? Est-ce possible, répétait-elle en élevant la voix, quand mon mari, le père de mes enfants, a une liaison avec leur gouvernante ?…
— Mais que faire ? que faire ? dit-il d’un ton navré, ne sachant lui-même ce qu’il disait et baissant de plus en plus la tête.
— Vous êtes vil, et vous m’inspirez du dégoût ! s’écria-t-elle, s’emportant davantage. Vos larmes ne sont que de l’eau ! Vous ne m’avez jamais aimée, vous n’avez ni cœur, ni fierté ! Vous êtes un homme méprisable et vil ; vous n’êtes plus pour moi qu’un étranger, oui, tout à fait un étranger !
Elle prononça avec une expression de souffrance et de colère ce mot étranger, auquel elle attachait un sens si terrible.
Il la regardait, et la colère qui se lisait sur son visage l’effrayait et l’étonnait tout à la fois. Il ne comprenait pas que sa pitié pour elle l’exaspérait. De son côté elle voyait qu’il la plaignait mais qu’il ne l’aimait plus.
« Non, elle me hait, pensa-t-il, elle ne me pardonnera jamais ! »
— C’est affreux, affreux ! s’écria-t-elle.
À ce moment, dans une chambre voisine, un des enfants, qui probablement venait de tomber, se mit à crier. Daria Alexandrovna l’entendit, et soudain, son visage s’adoucit.
Pendant quelques secondes elle parut se ressaisir et se demander ce qu’elle devait faire, puis brusquement elle se leva et se dirigea vers la porte.
« Elle aime mon enfant, pensa-t-il, en remarquant le changement de son visage aux cris de l’enfant, mon enfant… Comment donc peut-elle me haïr ? »
— Dolly, encore un mot, dit-il en la suivant.
— Si vous me suivez, j’appellerai les domestiques, les enfants, afin que tout le monde sache que vous êtes un lâche ! Je pars aujourd’hui. Vous pouvez rester ici avec votre maîtresse !
Elle sortit en frappant la porte.
Stépan Arkadiévitch soupira, essuya son visage, et sortit à pas lents.
« Matthieu a dit que tout s’arrangera. Mais comment ? Je n’en vois même pas la possibilité. Hélas ! quel ennui ! Et, dans sa colère, comme elle s’est servie d’expressions vulgaires, se dit-il se rappelant ses cris et les mots lâche et maîtresse. Et la femme de chambre aura peut-être entendu. C’est mal, c’est vulgaire ; oui, c’est très mal ! »
Stépan Arkadiévitch s’arrêta pendant quelques secondes, puis essuya ses yeux, soupira, et, se redressant, sortit de la chambre.
C’était un vendredi ; dans la salle à manger, l’horloger, un Allemand, remontait la pendule. Stépan Arkadiévitch se rappela une plaisanterie qu’il avait faite un jour sur cet horloger chauve et que lui avait inspirée la régularité de cet homme.
— On a dû le remonter pour toute sa vie, avait-il dit, afin qu’il puisse remonter les pendules.
Ce souvenir le fit sourire. Stépan Arkadiévitch aimait fort la plaisanterie.
— Et puis cela s’arrangera peut-être, conclut-il. Un joli mot : s’arrangera. Il faut raconter cela.
— Matthieu ! s’écria-t-il. Installe le divan avec Marie pour Anna Arkadiévna.
Le domestique accourut.
— Bien, dit-il.
Stépan Arkadiévitch revêtit sa pelisse et sortit sur le perron.
— Vous ne dînerez pas à la maison ? demanda Matthieu qui l’accompagnait.
— Je ne sais pas. Tiens, voici pour la dépense, dit-il en prenant dix roubles dans son portefeuille. Est-ce assez ?
— Assez ou pas assez, il faut évidemment s’en contenter, dit Matthieu en remontant le perron après avoir fermé la portière.
Pendant ce temps, Daria Alexandrovna avait consolé l’enfant. Au roulement de la voiture, elle comprit que son mari était parti et elle revint dans sa chambre. Là seulement elle se sentait à l’abri des soucis de famille qui l’accablaient dès qu’elle en sortait. L’Anglaise et la bonne avaient profité des quelques instants qu’elle avait passés dans la chambre des enfants pour lui poser certaines questions auxquelles seule elle pouvait répondre : comment habiller les enfants pour la promenade ? Fallait-il leur donner du lait ? Ne devait-on pas envoyer chercher un autre cuisinier ?
— Ah ! laissez-moi, laissez-moi ! dit-elle en se réfugiant dans sa chambre. Elle s’assit à cette même place qu’elle occupait en causant avec son mari, joignit ses mains osseuses dont les doigts amaigris laissaient glisser les bagues, et se remémora la conversation qu’elle venait d’avoir quelques instants auparavant.
— Parti ! s’écria-t-elle, mais a-t-il rompu avec elle ? La voit-il encore ? Pourquoi ne le lui ai-je pas demandé ? Non, non, toute réconciliation est impossible. Si même nous restons sous le même toit, nous serons des étrangers pour toujours, répétait-elle de nouveau, attachant à ce mot une signification particulièrement terrible pour elle. Ah ! comme je l’aimais ! Mon Dieu, comme je l’aimais ! Et maintenant, est-ce que je ne l’aime pas encore ? Est ce que je ne l’aime pas plus, même, qu’auparavant ? Voilà bien le plus terrible.
Elle n’acheva pas. Matriona Philémonovna apparut à la porte.
— Madame devrait donner l’ordre d’envoyer chercher mon frère, dit-elle, il préparerait le dîner ; autrement ce sera comme hier ; les enfants resteront jusqu’à six heures sans manger.
— Bien, bien, répondit-elle, je sortirai tout à l’heure et je donnerai des ordres. A-t-on envoyé chercher du lait frais ?
Et Daria Alexandrovna, se plongeant dans les soucis quotidiens, y noya momentanément sa douleur.
Chapitre V
Stépan Arkadiévitch avait fait de bonnes études, grâce à ses capacités naturelles, mais il était paresseux et léger, c’est pourquoi il sortit l’un des derniers de l’école. Mais malgré sa vie toujours frivole, ses titres médiocres et son âge peu avancé, il occupait la situation très honorifique et bien appointée de chef d’une des chancelleries de Moscou. Il avait obtenu cette place par l’intervention du mari de sa sœur Anna, Alexis Alexandrovitch Karénine, qui occupait un poste très important au ministère duquel dépendait cette chancellerie. Mais s’il n’avait pas obtenu cette place par l’entremise de Karénine, alors par d’autres relations, par ses frères, sœurs, cousins, oncles ou tantes, Stépan Oblonskï l’eût obtenue, ou, à défaut de celle-ci, une analogue, d’un revenu de 6.000 roubles, traitement qui lui était nécessaire, puisque ses affaires, malgré la fortune assez importante de sa femme, étaient peu prospères. La moitié de Moscou et de Pétersbourg avait des liens de parenté ou d’amitié avec Stépan Arkadiévitch. Il était né parmi ces gens qui étaient ou devinrent les puissants de ce monde. Un tiers des hommes d’État, âgés, amis de son père, l’avaient connu au berceau, l’autre tiers le tutoyait, et le troisième était composé de ses meilleurs amis. Ainsi les dispensateurs des biens de ce monde, des places, des concessions, des sinécures et autres, étaient de ses amis et ne pouvaient négliger un des leurs.
Oblonskï n’avait donc aucun effort à faire pour obtenir une place avantageuse. Il n’avait qu’à ne pas la refuser, à ne pas exciter de jalousies, de querelles, ni d’offenses, ce qui lui était facile en raison de sa bonté naturelle. Il eût trouvé plaisante l’idée qu’on pût lui refuser une place dont les appointements lui étaient nécessaires, d’autant plus qu’il n’exigeait rien d’extraordinaire. Il ne demandait qu’à bénéficier des mêmes faveurs que ses camarades et il ne s’en trouvait pas plus indigne que les autres.
Non seulement Stépan Arkadiévitch était aimé de tous ceux qui connaissaient son humeur bon enfant et sa parfaite affabilité, mais il y avait dans toute sa personne, dans son visage agréable et ouvert, dans ses yeux brillants, ses sourcils et ses cheveux noirs, ses joues blanches et roses, il y avait quelque chose qui incitait à la joie et à la gaîté ceux qui se trouvaient avec lui. « Ah ! ah ! Stiva ! Oblonskï ! ah ! c’est lui ! » disait-on presque toujours avec un sourire joyeux quand on le rencontrait. Bien que parfois cette rencontre n’eût pas un résultat spécialement gai, on n’en éprouvait pas moins de plaisir à le rencontrer de nouveau, le lendemain. Depuis trois ans qu’il occupait le poste de chef d’une chancellerie de Moscou, Stépan Arkadiévitch s’était acquis le respect et l’affection de ses subordonnés et de ses chefs ainsi que de tous ceux qui avaient affaire à lui.
Ce qui lui valait surtout ce respect dans son service, c’était : tout d’abord, son extrême bienveillance basée sur la conscience de ses propres défauts, puis, son complet libéralisme, non pas celui des journaux qu’il lisait, mais celui qu’il avait dans le sang et qui le faisait se conduire avec une égale aménité envers tous, quels que fussent leurs titres ; enfin, et par-dessus tout, sa complète indifférence pour la besogne qui l’occupait, indifférence grâce à laquelle il conservait tout son sang-froid et ne commettait point d’erreurs.
Arrivé à son bureau, Stépan Arkadiévitch, accompagné du suisse portant respectueusement sa serviette, entra dans son cabinet, endossa son uniforme et passa dans la chancellerie. Tous les scribes et autres employés se levèrent et le saluèrent avec plaisir et déférence.
Comme de coutume, Stépan Arkadiévitch passa rapidement à sa place, serra la main de ses subalternes et s’assit. Il plaisanta et parla dans la mesure des convenances, puis commença son travail. Personne mieux que lui ne savait observer la limite des convenances et se montrer libre et simple tout en restant correct ainsi qu’il convient pour rendre le service agréable. Le secrétaire, gaiment et respectueusement, suivant la coutume observée par tous ceux qui abordaient Stépan Arkadiévitch, s’approcha, tenant des papiers, et, du ton familier et libéral, dont le chef lui-même donnait l’exemple, dit :
— Nous avons enfin obtenu des renseignements de la Chambre de la province de Penza. Veuillez, s’il vous plaît, en prendre connaissance.
— Ah, les voici, enfin !… dit Stépan Arkadiévitch en posant les papiers sous sa main. Eh bien, alors, messieurs… Et la séance commença.
« S’ils savaient ! pensait-il en inclinant la tête avec importance pendant la lecture de ce rapport, s’ils savaient que leur chef, il y a à peine une demi-heure, avait l’attitude d’un enfant coupable ! » Et ses yeux riaient à la lecture du rapport. Jusqu’à deux heures il devait travailler sans interruption, puis, à deux heures, il y avait une pause pour le déjeuner.
Il n’était pas encore deux heures quand la grande porte vitrée de la salle s’ouvrit brusquement ; quelqu’un voulait entrer. Tous, heureux de cette distraction, se retournèrent, mais le gardien de service accourut et referma aussitôt la porte vitrée. Quand la lecture du rapport fut terminée, Stépan Arkadiévitch se leva en bâillant, et, payant tribut au libéralisme d’alors, prit une cigarette et s’en alla fumer dans son cabinet de travail. Deux de ses camarades, le vieux fonctionnaire Nikitine et le chambellan Grinévitch, l’y suivirent.
— Nous terminerons après le déjeuner, dit Stépan Arkadiévitch.
— Comment donc ! fit Nikitine.
— Ce doit être un fameux coquin ce Fomine, dit Grinévitch, faisant allusion à l’un des personnages en cause dans l’affaire qu’ils discutaient.
À ces paroles, Stépan Arkadiévitch fronça les sourcils, donnant à entendre par là qu’il était inconvenant de préjuger ainsi, et il ne répondit rien.
— Qui donc est entré ? demanda-t-il en s’adressant au gardien.
— Un monsieur quelconque, Votre Excellence. Il est entré sans se faire annoncer, profitant d’un instant où je m’éloignais. Il a demandé à vous entretenir. Je lui ai répondu : Lorsque la séance sera terminée, alors…
— Où est-il ?
— Il est probablement sorti dans le vestibule ; il s’est promené quelque temps par ici. Le voilà, c’est lui-même, dit le garçon en désignant un homme de forte corpulence, aux larges épaules, à la barbe frisée, qui, sans ôter son bonnet d’astrakan, montait rapidement et avec agilité les marches usées de l’escalier de pierre. Un fonctionnaire maigre qui descendait, une serviette sous le bras, s’arrêta et regarda d’un œil peu bienveillant les jambes du visiteur, puis, d’un air interrogateur, se tourna vers Oblonskï.
Stépan Arkadiévitch se trouvait en haut de l’escalier. Sa bonne figure qui souriait au-dessus du collet brodé de son uniforme s’épanouit encore davantage quand il reconnut celui qui venait à lui.
— C’est bien lui ! Lévine ! enfin ! fit-il avec un sourire amical et railleur en toisant le nouveau venu qui s’avançait vers lui. Alors tu n’as pas craint de venir me trouver dans cette caverne ? poursuivit-il, et, non content de serrer la main de son ami, il l’embrassa affectueusement. Y a-t-il longtemps que tu es arrivé ?
— J’arrive à l’instant et je désirais vivement te voir, répondit Lévine en jetant autour de lui un regard timide dans lequel se lisaient le dépit et l’inquiétude.
— Eh bien, passons dans mon cabinet, dit Stépan Arkadiévitch, qui connaissait le caractère à la fois timide et fier de son ami. Et, le prenant par le bras, il l’entraîna derrière lui, comme s’il l’eût guidé à travers des dangers.
Stépan Arkadiévitch tutoyait presque toutes ses connaissances, vieillards de soixante ans ou jeunes gens de vingt ans : acteurs, ministres, marchands, généraux ou aides de camp, de sorte que dans le nombre de ceux qui le tutoyaient, il y en avait aux deux extrémités de l’échelle sociale et ceux-là s’étonnaient fort de se découvrir un trait d’union dans Oblonskï. Il tutoyait tous ceux avec qui il avait bu le champagne, mais quand en présence de ses subordonnés il rencontrait un de ces « toi » honteux, comme il appelait en plaisantant beaucoup de ses connaissances douteuses, il savait, avec un tact qui lui était particulier, atténuer la mauvaise impression qu’ils en auraient pu éprouver. Lévine n’était pas un « toi » honteux mais Oblonskï sentit qu’il serait gêné de montrer leur intimité devant des tiers, c’est pourquoi il se hâta de le faire passer dans son cabinet.
Lévine était presque du même âge qu’Oblonskï et ne le tutoyait pas uniquement à cause du champagne. Lévine était son camarade, un ami de la première enfance. Ils s’aimaient malgré la différence de leurs caractères et de leurs goûts comme s’aiment les hommes qui se sont liés tout jeunes encore. Malgré cela, comme il arrive souvent parmi les gens qui ont choisi des genres d’activité différents, chacun d’eux, bien que comprenant l’existence de l’autre, la méprisait au fond de son âme. Chacun considérait sa propre vie comme la seule vraie et celle de son ami lui paraissait vaine. Oblonskï ne pouvait retenir un léger sourire railleur chaque fois que Lévine arrivait à Moscou venant de la campagne où il avait quelque occupation. Mais que faisait-il au juste, Stépan Arkadiévitch ne se l’expliquait pas trop et ne s’y intéressait guère. Lévine arrivait toujours à Moscou ému, pressé, un peu gêné et agacé de sa gêne, et la plupart du temps avec une opinion tout à fait nouvelle et inattendue sur les événements. Stépan Arkadiévitch se moquait de cela et s’en amusait. De son côté Lévine en lui-même méprisait la vie mondaine de son ami, et sa situation qu’il ne prenait pas au sérieux, et souvent il l’en raillait. Mais tandis qu’Oblonskï, en homme qui sent qu’il agit normalement, se contentait de rire avec confiance et bonhomie, Lévine manifestait de la crainte et surtout de la colère.
— Il y a longtemps que nous t’attendons, dit Stépan Arkadiévitch en entrant dans son cabinet et abandonnant le bras de Lévine, indiquant par là que les dangers étaient passés. Je suis très content de te voir, continua-t-il. Eh bien ! Comment vas-tu ? Quand es-tu arrivé ?
Lévine garda le silence à la vue des visages des deux camarades d’Oblonskï qu’il ne connaissait pas ; la main surtout de l’élégant Grinévitch aux doigts blancs et effilés, aux ongles longs, jaunis et courbés du bout, et les gros brillants de sa chemise ne lui laissaient évidemment pas la liberté de penser et accaparaient toute son attention.
Oblonskï s’en aperçut aussitôt et sourit.
— Ah oui ! dit-il, permettez-moi de vous présenter mes collègues : Philippe Ivanitch Nikitine, Michel Stanislevitch Grinévitch, et, présentant Lévine : Un travailleur des zemstvos, un homme nouveau, un athlète qui soulève d’une main cinq pouds, un amateur de bétail, un chasseur passionné, et mon ami : Constantin Dmitriévitch Lévine, le frère de Serge Ivanitch Koznichev.
— Très heureux, dit le plus âgé.
— J’ai l’honneur de connaître votre frère Serge Ivanitch, dit Grinévitch en lui tendant sa main fine aux ongles soigneusement taillés.
Lévine fronça les sourcils, serra froidement la main qu’on lui tendait et, aussitôt, entra en conversation avec Oblonskï. Bien qu’il eût beaucoup d’estime pour son demi-frère, écrivain connu dans toute la Russie, il détestait qu’on s’adressât à lui uniquement comme au frère du célèbre Koznichev.
— Non, je ne travaille plus au zemstvo, je me suis querellé avec tout le monde et je ne mets plus les pieds aux séances, dit-il s’adressant à Oblonskï.
— Pas possible ! fit en souriant Oblonskï. Mais comment ? Pourquoi ?
— C’est une longue histoire, je te la raconterai un jour, dit-il, cependant il en entama le récit aussitôt.
— Eh bien ! bref, je me suis convaincu que les zemstvos ne font rien et ne peuvent rien faire, se mit-il à dire du ton de quelqu’un que l’on vient d’offenser. À certain point de vue, c’est un jeu : on joue au parlement ; or, je ne suis ni assez jeune, ni assez vieux pour m’amuser d’un jouet. D’autre part (il hésita), c’est un moyen pour la coterie de province d’amasser de l’argent. Autrefois il y avait les tutelles, les jugements, et maintenant ce sont les zemstvos, le pot-de-vin a fait place aux appointements injustifiés, dit-il avec chaleur comme si l’un des auditeurs l’eût contredit.
— Eh ! eh ! mais je vois que tu es dans une nouvelle phase, dans la phase conservatrice, fit Stépan Arkadiévitch. Mais laissons cela pour plus tard.
— Oui, plus tard. J’avais besoin de te voir, dit Lévine en regardant avec animosité la main de Grinévitch.
Stépan Arkadiévitch eut un sourire imperceptible.
— Mais comment donc ! tu avais dit que tu ne porterais plus jamais l’habit européen ! dit-il en regardant le costume neuf de son ami qui sortait évidemment de chez un tailleur français. Oui, oui, je le vois, tu es dans une nouvelle phase !
Lévine rougit soudain non pas à la manière d’un homme fait dont le visage se colore légèrement, mais comme un tout jeune homme qui se sent d’une ridicule timidité, et en éprouve un trouble plus grand encore, si bien qu’il rougit jusqu’aux larmes. Et c’était si étrange de voir dans cette attitude puérile ce visage intelligent et mûr qu’Oblonskï détourna les yeux.
— Mais où nous verrons-nous ? J’ai absolument besoin de te parler, dit Lévine.
Oblonskï eut l’air de réfléchir.
— Eh bien ! Allons déjeuner chez Gourine, là-bas nous causerons ; je suis libre jusqu’à trois heures.
— Non, je dois encore faire une visite, dit Lévine après réflexion.
— Bon. Alors dînons ensemble.
— Dîner ? Mais je n’ai rien de particulier à te dire, seulement deux mots, et après nous causerons.
— Alors dis tout de suite tes deux mots et nous causerons pendant le dîner.
— Ces deux mots, les voici, mais, je te le répète, ce n’est rien d’extraordinaire.
Son visage prit soudain une expression méchante due à l’effort qu’il faisait pour vaincre sa timidité.
— Que font les Stcherbatzkï ? Tout se passe-t-il comme de coutume ? dit- il.
Stépan Arkadiévitch qui savait depuis longtemps que Lévine était amoureux de sa belle-sœur Kitty, eut un léger sourire, et ses yeux eurent un éclat de gaîté.
— À tes deux mots je ne puis répondre aussi brièvement parce que… Excuse-moi pour un moment…
Il fut interrompu par l’arrivée de son secrétaire qui entra d’un air respectueux et familier avec cette conscience particulière, commune à tous les secrétaires, la conscience de sa supériorité sur son chef, au point de vue de l’expédition des affaires. Il s’approcha d’Oblonskï avec les papiers, et, tout en lui demandant son avis, il lui exposa une difficulté quelconque.
Stépan Arkadiévitch, sans l’écouter jusqu’au bout, posa la main amicalement sur le bras de son secrétaire.
— Non, faites comme je vous l’ai dit, fit-il tout en adoucissant l’observation par un sourire, et il expliqua brièvement comment il comprenait l’affaire, puis il repoussa les papiers et dit :
— Faites donc ainsi, s’il vous plaît, Zakhar Nikititch.
Le secrétaire s’éloigna confus. Lévine pendant cette conversation s’était ressaisi ; maintenant il était debout, les deux mains appuyées au dossier d’une chaise, le visage empreint d’une expression moqueuse.
— Je ne comprends pas, non, je ne comprends pas, dit-il.
— Qu’est-ce que tu ne comprends pas ? fit Oblonskï en souriant gaiement et en prenant un cigare. Il attendait de la part de Lévine quelque étrange sortie.
— Je ne comprends pas ce que vous faites, fit Lévine en haussant les épaules. Comment peux-tu faire cela sérieusement ?
— Pourquoi ?
— Mais parce qu’au fond il n’y a rien à faire.
— Tu crois cela ? Mais nous sommes surchargés de travail…
— De paperasses. Ah oui ! cela te convient bien, ajouta Lévine.
— Dis donc tout de suite qu’il me manque quelque chose !
— Peut-être. Toutefois j’admire ta grandeur et suis fier d’avoir pour ami un si grand homme. Mais tu n’as pas répondu à ma question, ajouta Lévine, faisant un effort désespéré pour regarder droit dans les yeux d’Oblonskï.
— Bon ! bon ! bon ! Attends donc ! Toi aussi, tu y viendras. Cela va bien avec trois mille déciatines dans la province de Karazine, des muscles comme les tiens et la fraîcheur d’une petite fille de douze ans… Mais toi aussi, tu y viendras. Et quant à ce que tu m’as demandé, il n’y a aucun changement. Mais c’est dommage que tu sois resté si longtemps sans venir.
— Pourquoi ? fit Lévine effrayé.
— Rien. Nous causerons plus tard. Oui, mais enfin dis-moi exactement pourquoi tu es venu.
— Ah ! nous en recauserons après, dit Lévine, de nouveau rougissant jusqu’aux oreilles.
— Eh bien ! c’est bon, entendu, dit Stépan Arkadiévitch. Alors, vois tu… Je t’emmènerais bien chez nous, mais ma femme n’est pas bien portante. Maintenant voilà, si tu veux les voir, aujourd’hui elles seront certainement au Jardin zoologique, de quatre à cinq. Kitty patine là-bas. Va, moi, je te rejoindrai et nous irons dîner ensemble quelque part.
— C’est cela. Alors, au revoir.
— Fais attention, je te connais, ne va pas oublier et tout à coup repartir à la campagne ! s’écria Stépan en riant.
— Non, c’est sûr !
Et déjà sur la porte, Lévine se rappela qu’il avait oublié de saluer les collègues de son ami.
— Ce monsieur doit être très énergique ? dit Grinévitch quand Lévine fut sorti.
— Oui, mon cher, dit Stépan Arkadiévitch en hochant la tête, voilà un homme heureux ! Trois mille déciatines dans la province de Karazine, tout l’avenir devant lui, et quelle fraîcheur ! Ah ! ce n’est pas comme nous autres !
— De quoi donc pouvez-vous vous plaindre, Stépan Arkadiévitch ?
— Moi ? Euh ? ça va mal… fit-il avec un long soupir.
Chapitre VI
Quand Oblonskï demanda à Lévine la raison de son voyage, celui-ci rougit et s’emporta contre lui-même, furieux d’avoir rougi et de n’avoir pu lui répondre : « Je suis venu pour demander la main de ta belle-sœur ! » puisque c’était là le seul but de son voyage. Les familles Lévine et Stcherbatzkï appartenaient à la vieille noblesse de Moscou et avaient toujours entretenu des relations amicales et suivies. Ces liens s’étaient encore resserrés pendant les études de Lévine à l’Université. Il s’était préparé aux examens avec le jeune prince Stcherbatzkï frère de Dolly et de Kitty, et ils avaient fait ensemble leurs études universitaires. À cette époque Lévine venait souvent chez les Stcherbatzkï dont il aimait la maison. Si étrange que cela puisse paraître, Constantin Lévine aimait toute la maison des Stcherbatzkï, et principalement la partie féminine de cette famille. Lui-même ne se rappelait pas sa mère, sa sœur unique était plus âgée que lui, aussi était-ce dans la maison des Stcherbatzkï qu’il avait vu pour la première fois ce milieu instruit et honnête des vieilles familles aristocratiques, dont il avait été privé par la mort de son père et de sa mère.
Tous les membres de cette famille, surtout l’élément féminin, lui semblaient entourés de quelque voile mystérieux et poétique, et non seulement il ne voyait en eux aucun défaut, mais sous ce voile poétique qui les couvrait, il supposait les sentiments les plus élevés et les perfections les plus grandes.
Pourquoi ces trois demoiselles devaient-elles parler un jour le français, l’autre l’anglais, et à certaines heures jouer du piano, dont les sons montaient jusqu’à la chambre de leur frère où travaillaient les étudiants ?
Pourquoi recevaient-elles des professeurs de littérature française, de musique, de dessin, de danse ?
Pourquoi, à certaines heures, ces trois demoiselles allaient-elles avec mademoiselle Linon faire une promenade en voiture au boulevard Tverskoï en pelisses de soie, Dolly en pelisse longue, Natalie en pelisse demi-longue et Kitty en pelisse tout à fait courte, laissant voir ses petites jambes serrées dans des bas rouges bien tirés ; pourquoi leur fallait-il, accompagnées d’un valet coiffé d’un bonnet à cocarde d’or, se promener au boulevard Tverskoï ? Il ne comprenait point ces choses ainsi que beaucoup d’autres qui se passaient dans ce monde mystérieux, mais il savait que tout ce qui se faisait là était beau et il était précisément amoureux de ce mystère.
Pendant ses études il fut presque épris de l’aînée, Dolly, mais bientôt elle épousa Oblonskï. Il devint ensuite amoureux de la seconde, il éprouvait le besoin d’être épris de l’une des sœurs, il ne savait au juste de laquelle, mais Natalie dès qu’on l’eut menée dans le monde épousa le diplomate Lvov.
Kitty était encore une enfant quand Lévine sortit de l’Université. Le jeune Stcherbatzkï entra dans la marine et fut envoyé sur la Baltique, de sorte que les relations de Lévine avec les Stcherbatzkï, malgré son amitié avec Oblonskï, se relâchèrent de plus en plus.
Mais, cette année, quand, au commencement de l’hiver, Lévine vint à Moscou, après avoir passé un an à la campagne, et qu’il vit les Stcherbatzkï, il comprit de laquelle des trois sœurs il lui était réservé, en effet, d’être amoureux.
Rien, semblait-il, n’était plus simple pour lui que de demander en mariage la princesse Stcherbatzkï : il était de bonne famille, plutôt riche que pauvre, avait trente-deux ans et passait pour un brillant parti. Mais Lévine était amoureux et Kitty lui semblait si parfaite sous tous les rapports, il la trouvait tellement au-dessus de tout être terrestre, il se sentait si inférieur à elle, qu’il ne pouvait penser qu’elle-même et les autres, le trouveraient digne d’elle. Après avoir passé dans le tourbillon de la vie moscovite deux mois, pendant lesquels il rencontrait chaque jour Kitty dans le monde où il commençait à aller dans ce but, il décida tout d’un coup que son projet était d’une réalisation impossible et il repartit à la campagne.
La conviction que Lévine avait de cette impossibilité se basait sur ce que, aux yeux des parents, il était un parti peu brillant, indigne de la charmante Kitty, et qu’elle-même ne pouvait pas l’aimer.
Aux yeux des parents il n’avait aucune situation dans le monde, tandis que ses camarades du même âge étaient déjà colonels, aides de camp, professeurs de l’Université, directeurs de banques, de chemins de fer, ou chefs d’une Chancellerie comme Oblonskï. Et lui (il se rendait très bien compte de l’opinion qu’on pouvait avoir de sa personne) était un simple propriétaire terrien s’occupant de l’élevage des vaches, de la chasse aux bécassines et de bâtisses, c’est-à-dire un garçon pas très doué, n’ayant rien produit et faisant, selon les conceptions du monde, ce que font les gens de rien.
Et Kitty elle-même, cette Kitty mystérieuse, charmante, ne pouvait aimer un homme aussi laid — il se jugeait ainsi — et surtout aussi ordinaire. En outre, ses anciens rapports avec Kitty — rapports d’un homme fait envers une enfant, par suite de l’amitié qui l’unissait au frère — lui semblaient un obstacle de plus pour se faire aimer. Il supposait bien qu’on peut avoir de l’amitié pour un garçon laid mais bon, ainsi qu’il se jugeait, mais que pour inspirer un amour semblable à celui qu’il ressentait pour Kitty, il fallait être beau et surtout sortir de l’ordinaire.
Il avait bien entendu dire que les femmes aiment parfois des hommes laids et communs, mais il n’y croyait pas, parce qu’il jugeait d’après lui-même et que lui-même n’aurait pu aimer qu’une femme jolie, remarquable et distinguée. Cependant, durant les deux mois qu’il passa seul à la campagne, il se convainquit qu’il ne s’agissait pas là d’un de ces caprices d’amour comme il en avait éprouvés dans sa première jeunesse, mais bien d’un sentiment véritable, qui ne lui laissait pas un moment de repos ; il sentit qu’il ne pouvait vivre plus longtemps dans le doute, qu’il lui fallait savoir si oui ou non elle serait sa femme, que son désespoir était imaginaire, n’ayant aucun motif de se voir évincer, et il arriva à Moscou fermement décidé à se déclarer et à se marier si on l’acceptait, ou… Il ne pouvait penser à ce qu’il ferait si on l’éconduisait.
Chapitre VII
Lévine arrivé à Moscou par le train du matin descendit chez son demi-frère, Koznichev. Sa toilette faite, il vint le trouver dans son cabinet de travail avec l’intention de lui apprendre aussitôt le motif de son voyage et de lui demander un conseil. Mais son frère n’était pas seul : avec lui se trouvait un célèbre professeur de philosophie, venu tout exprès de Kharkov pour dissiper un malentendu qui s’était élevé entre eux au sujet d’une question de méthode très importante. Le professeur avait engagé contre les matérialistes une polémique très vive qu’avait suivie avec intérêt Serge Koznichev, et, après avoir lu le dernier article du professeur, il lui avait écrit une lettre dans laquelle il lui reprochait ses trop grandes concessions aux matérialistes. Aussitôt le professeur était venu pour s’expliquer. La question, qui était alors très à la mode, était la suivante : Y a-t-il une limite entre les phénomènes psychologiques et physiologiques dans l’activité de l’homme, et où se trouve-t-elle ?
Serge Ivanovitch accueillit son frère avec son sourire habituel, doux et froid, puis, l’ayant présenté au professeur, il continua sa conversation. Le savant, un petit monsieur à lunettes, au front étroit, quitta un moment la conversation pour saluer le nouveau venu, puis continua l’entretien sans plus faire attention à lui. Lévine s’assit en attendant le départ du professeur, mais bientôt il se prit d’intérêt pour la conversation ; il avait remarqué, dans les revues, les articles dont il s’agissait ; il les avait lus et s’y était intéressé comme à une évolution des principes des sciences naturelles qu’il connaissait, pour avoir suivi les cours de la Faculté des sciences ; mais il n’avait jamais rapproché ses conclusions scientifiques sur l’origine zoologique de l’homme, sur les réflexes, sur la biologie et la sociologie, des questions sur l’importance de la vie et de la mort qui, depuis ces derniers temps, lui venaient fréquemment à l’esprit.