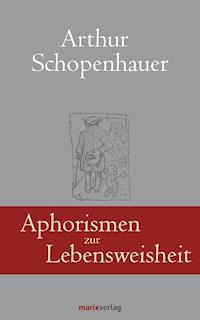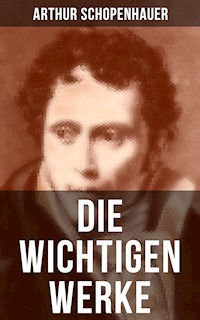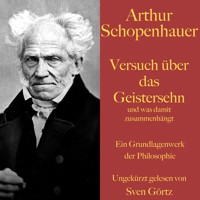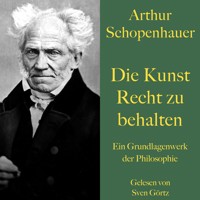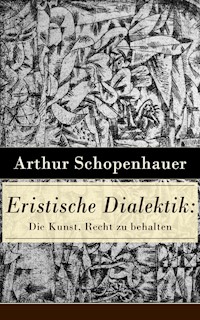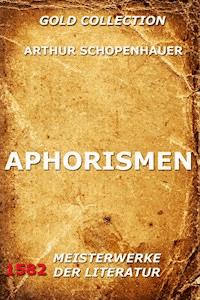DIVISION
FONDAMENTALE
Aristote (Morale à Nicomaque, I,
8) a divisé les biens de la vie humaine en trois classes, les biens
extérieurs, ceux de l'âme et ceux du corps. Ne conservant que la
division en trois, je dis que ce qui différencie le sort des
mortels peut être ramené à trois conditions fondamentales. Ce
sont:
1° Ce qu'on est: donc la
personnalité, dans son sens le plus étendu. Par conséquent, on
comprend ici la santé, la force, la beauté, le tempérament, le
caractère moral, l'intelligence et son développement.
2° Ce qu'on a: donc propriété et
avoir de toute nature.
3° Ce qu'on représente: on sait
que par cette expression l'on entend la manière dont les autres se
représentent un individu, par conséquent ce qu'il est dans leur
représentation. Cela consiste donc dans leur opinion à son égard et
se divise en honneur, rang et gloire.
Les différences de la première
catégorie dont nous avons à nous occuper sont celles que la nature
elle-même a établies entre les hommes; d'où l'on peut déjà inférer
que leur influence sur le bonheur ou le malheur sera plus
essentielle et plus pénétrante que celle des différences provenant
des règles humaines et que nous avons mentionnées sous les deux
rubriques suivantes. Les vrais avantages personnels, tels qu'un
grand esprit ou un grand cœur, sont par rapport à tous les
avantages du rang, de la naissance, même royale, de la richesse et
autres, ce que les rois véritables sont aux rois de théâtre. Déjà
Métrodore, le premier élève d'Épicure, avait intitulé un chapitre:
Περι του μειζονα ειναι την παρ‘ ημας αιτιαν προς ενδαιμονιαν της εχ
των πραγματων (Les causes qui viennent de nous contribuent plus au
bonheur que celles qui naissent des choses.—Cf. Clément d'Alex.,
Strom., II, 21, p. 362 dans l'édition de Wurtzbourg des Opp.
polem.)
Et, sans contredit, pour le
bien-être de l'individu, même pour toute sa manière d'être, le
principal est évidemment ce qui se trouve ou se produit en lui.
C'est là, en effet, que réside immédiatement son bien-être ou son
malaise; c'est sous cette forme, en définitive, que se manifeste
tout d'abord le résultat de sa sensibilité, de sa volonté et de sa
pensée; tout ce qui se trouve en dehors n'a qu'une influence
indirecte. Aussi les mêmes circonstances, les mêmes événements
extérieurs, affectent-ils chaque individu tout différemment, et,
quoique placés dans un même milieu, chacun vit dans un monde
différent. Car il n'a directement affaire que de ses propres
perceptions, de ses propres sensations et des mouvements de sa
propre volonté: les choses extérieures n'ont d'influence sur lui
qu'en tant qu'elles déterminent ces phénomènes intérieurs. Le monde
dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir, laquelle
diffère pour chaque tête; selon la nature des intelligences, il
paraîtra pauvre, insipide et plat, ou riche, intéressant et
important. Pendant que tel, par exemple, porte envie à tel autre
pour les aventures intéressantes qui lui sont arrivées pendant sa
vie, il devrait plutôt lui envier le don de conception qui a prêté
à ces événements l'importance qu'ils ont dans sa description, car
le même événement qui se présente d'une façon si intéressante dans
la tête d'un homme d'esprit, n'offrirait plus, conçu par un cerveau
plat et banal, qu'une scène insipide de la vie de tous les jours.
Ceci se manifeste au plus haut degré dans plusieurs poésies de
Gœthe et de Byron, dont le fond repose évidemment sur une donnée
réelle; un sot, en les lisant, est capable d'envier au poète
l'agréable aventure, au lieu de lui envier la puissante imagination
qui, d'un événement passablement ordinaire, a su faire quelque
chose d'aussi grand et d'aussi beau. Pareillement, le mélancolique
verra une scène de tragédie là où le sanguin ne voit qu'un conflit
intéressant, et le flegmatique un fait insignifiant.
Tout cela vient de ce que toute
réalité, c'est-à-dire toute «actualité remplie» se compose de deux
moitiés, le sujet et l'objet, mais aussi nécessairement et aussi
étroitement unies que l'oxygène et l'hydrogène dans l'eau. À moitié
objective identique, la subjective étant différente, ou
réciproquement, la réalité actuelle sera tout autre; la plus belle
et la meilleure moitié objective, quand la subjective est obtuse,
de mauvaise qualité, ne fournira jamais qu'une méchante réalité et
actualité, semblable à une belle contrée vue par un mauvais temps
ou réfléchie par une mauvaise chambre obscure. Pour parler plus
vulgairement, chacun est fourré dans sa conscience comme dans sa
peau et ne vit immédiatement qu'en elle; aussi y a-t-il peu de
secours à lui apporter du dehors. À la scène, tel joue les princes,
tel les conseillers, tel autre les laquais, ou les soldats ou les
généraux, et ainsi de suite. Mais ces différences n'existent qu'à
l'extérieur; à l'intérieur, comme noyau du personnage, le même être
est fourré chez tous, savoir un pauvre comédien avec ses misères et
ses soucis.
Dans la vie, il en est de même.
Les différences de rang et de richesses donnent à chacun son rôle à
jouer, auquel ne correspond nullement une différence intérieure de
bonheur et de bien-être; ici aussi est logé dans chacun le même
pauvre hère, avec ses soucis et ses misères, qui peuvent différer
chez chacun pour ce qui est du fond, mais qui, pour ce qui est de
la forme, c'est-à-dire par rapport à l'être propre, sont à peu près
les mêmes chez tous; il y a certes des différences de degré, mais
elles ne dépendent pas du tout de la condition ou de la richesse,
c'est-à-dire du rôle.
Comme tout ce qui se passe, tout
ce qui existe pour l'homme ne se passe et n'existe immédiatement
que dans sa conscience; c'est évidemment la qualité de la
conscience qui sera le prochainement essentiel, et dans la plupart
des cas tout dépendra de celle-là bien plus que des images qui s'y
représentent. Toute splendeur, toutes jouissances sont pauvres,
réfléchies dans la conscience terne d'un benêt, en regard de la
conscience d'un Cervantès, lorsque, dans une prison incommode, il
écrivait son Don Quijote.
La moitié objective de
l'actualité et de la réalité est entre les mains du sort et, par
suite, changeante; la moitié subjective, c'est nous-mêmes, elle est
par conséquent immuable dans sa partie essentielle. Aussi, malgré
tous les changements extérieurs, la vie de chaque homme
porte-t-elle d'un bout à l'autre le même caractère; on peut la
comparer à une suite de variations sur un même thème. Personne ne
peut sortir de son individualité. Il en est de l'homme comme de
l'animal; celui-ci, quelles que soient les conditions dans
lesquelles on le place, demeure confiné dans le cercle étroit que
la nature a irrévocablement tracé autour de son être, ce qui
explique pourquoi, par exemple, tous nos efforts pour faire le
bonheur d'un animal que nous aimons doivent se maintenir forcément
dans des limites très restreintes, précisément à cause de ces
bornes de son être et de sa conscience; pareillement,
l'individualité de l'homme a fixé par avance la mesure de son
bonheur possible. Ce sont spécialement les limites de ses forces
intellectuelles qui ont déterminé une fois pour toutes son aptitude
aux jouissances élevées. Si elles sont étroites, tous les efforts
extérieurs, tout ce que les hommes ou la fortune feront pour lui,
tout cela sera impuissant à le transporter par delà la mesure du
bonheur et du bien-être humain ordinaire, à demi animal: il devra
se contenter des jouissances sensuelles, d'une vie intime et gaie
dans sa famille, d'une société de bas aloi ou de passe-temps
vulgaires. L'instruction même, quoiqu'elle ait une certaine action,
ne saurait en somme élargir de beaucoup ce cercle, car les
jouissances les plus élevées, les plus variées et les plus durables
sont celles de l'esprit, quelque fausse que puisse être pendant la
jeunesse notre opinion à cet égard; et ces jouissances dépendent
surtout de la force intellectuelle. Il est donc facile de voir
clairement combien notre bonheur dépend de ce que nous sommes, de
notre individualité, tandis qu'on ne tient compte le plus souvent
que de ce que nous avons ou de ce que nous représentons. Mais le
sort peut s'améliorer; en outre, celui qui possède la richesse
intérieure ne lui demandera pas grand'chose; mais un benêt restera
benêt, un lourdaud restera lourdaud, jusqu'à sa fin, fût-il en
paradis et entouré de houris. Gœthe dit:
Volk und Knecht und
Ueberwinder,
Sie gestehn, zu jeder
Zeit,
Höchstes Glück der
Erdenkinder
Sei nur die
Persönlichkeit.
(Peuple et laquais et
conquérant,—en tout temps reconnaissent—que le suprême bien des
fils de la terre—est seulement la personnalité. Gœthe, Divan Or.
Occ., ZULECKA).
Que le subjectif soit
incomparablement plus essentiel à notre bonheur et à nos
jouissances que l'objectif, cela se confirme en tout, par la faim,
qui est le meilleur cuisinier, jusqu'au vieillard regardant avec
indifférence la déesse que le jeune homme idolâtre, et tout au
sommet, nous trouvons la vie de l'homme de génie et du saint. La
santé par-dessus tout l'emporte tellement sur les biens extérieurs
qu'en vérité un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi
malade. Un tempérament calme et enjoué, provenant d'une santé
parfaite et d'une heureuse organisation, une raison lucide, vive,
pénétrante et concevant juste, une volonté modérée et douce, et
comme résultat une bonne conscience, voilà des avantages que nul
rang, nulle richesse ne sauraient remplacer. Ce qu'un homme est en
soi-même, ce qui l'accompagne dans la solitude et ce que nul ne
saurait lui donner ni lui prendre, est évidemment plus essentiel
pour lui que tout ce qu'il peut posséder ou ce qu'il peut être aux
yeux d'autrui. Un homme d'esprit, dans la solitude la plus absolue,
trouve dans ses propres pensées et dans sa propre fantaisie de quoi
se divertir agréablement, tandis que l'être borné aura beau varier
sans cesse les fêtes, les spectacles, les promenades et les
amusements, il ne parviendra pas à écarter l'ennui qui le torture.
Un bon caractère, modéré et doux, pourra être content dans
l'indigence, pendant que toutes les richesses ne sauraient
satisfaire un caractère avide, envieux et méchant. Quant à l'homme
doué en permanence d'une individualité extraordinaire,
intellectuellement supérieure, celui-là alors peut se passer de la
plupart de ces jouissances auxquelles le monde aspire généralement;
bien plus, elles ne sont pour lui qu'un dérangement et un fardeau.
Horace dit en parlant de lui-même:
Gemmas, marmor, ebur,
Tyrrhena sigilla, tabellas,
Argentum, vestes Gaetulo
murice tinctas,
Sunt qui habeant, est qui
non curat habere.
(Il en est qui n'ont ni pierres
précieuses, ni marbre, ni ivoire, ni statuettes tyrrhéniennes, ni
tableaux, ni argent, ni robes teintes de pourpre gaétulienne; il en
est un qui ne se soucie pas d'en avoir.—Horace, Ep. II, L. II, vers
180 et suiv.)
Et Socrate, à la vue d'objets de
luxe exposés pour la vente, s'écriait:
«Combien il y a de choses dont je
n'ai pas besoin!»
Ainsi, la condition première et
la plus essentielle pour le bonheur de la vie, c'est ce que nous
sommes, c'est notre personnalité; quand ce ne serait déjà que parce
qu'elle agit constamment et en toutes circonstances, cela suffirait
à l'expliquer, mais en outre, elle n'est pas soumise à la chance
comme les biens des deux autres catégories, et ne peut pas nous
être ravie. En ce sens, sa valeur peut passer pour absolue, par
opposition à la valeur seulement relative des deux autres. Il en
résulte que l'homme est bien moins susceptible d'être modifié par
le monde extérieur qu'on ne le suppose volontiers. Seul le temps,
dans son pouvoir souverain, exerce également ici son droit; les
qualités physiques et intellectuelles succombent insensiblement
sous ses atteintes; le caractère moral seul lui demeure
inaccessible.
Sous ce rapport, les biens des
deux dernières catégories auraient un avantage sur ceux de la
première, comme étant de ceux que le temps n'emporte pas
directement. Un second avantage serait que, étant placés en dehors
de nous, ils sont accessibles de leur nature, et que chacun a pour
le moins la possibilité de les acquérir, tandis que ce qui est en
nous, le subjectif, est soustrait à notre pouvoir établi jure
divino, il se maintient invariable pendant toute la vie. Aussi les
vers suivants contiennent-ils une inexorable vérité:
Wie an dem Tag, der dich der
Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusze
der Planeten,
Bist alsobald und fort und
fort gedichen,
Nach dem Gesetz, wonach du
angetreten.
So muszt du seyn, dir kannst
du nicht entfliehen,
So sagten schon Svbillen, so
Propheten;
Und keine Zeit und keine
Macht zerstückelt
Geprügte Form, die lebend
sien entwickelt.
(Gœthe.)
(Comme, dans le jour qui t'a
donné au monde, le soleil était là pour saluer les planètes, tu as
aussi grandi sans cesse, d'après la loi selon laquelle tu as
commencé. Telle est ta destinée; tu ne peux t'échapper à toi-même;
ainsi parlaient déjà les sibylles; ainsi les prophètes; aucun
temps, aucune puissance ne brise la forme empreinte qui se
développe dans le cours de la vie.—Poésies, trad. Porchat, vol. I,
p. 312.)
Tout ce que nous pouvons faire à
cet égard, c'est d'employer cette personnalité, telle qu'elle nous
a été donnée, à notre plus grand profit; par suite, ne poursuivre
que les aspirations qui lui correspondent, ne rechercher que le
développement qui lui est approprié en évitant tout autre, ne
choisir, par conséquent, que l'état, l'occupation, le genre de vie
qui lui conviennent.
Un homme herculéen, doué d'une
force musculaire extraordinaire, astreint par des circonstances
extérieures à s'adonner à une occupation sédentaire, à un travail
manuel, méticuleux et pénible, ou bien encore à l'étude et à des
travaux de tête, occupations réclamant des forces toutes
différentes, non développées chez lui et laissant précisément sans
emploi les forces par lesquelles il se distingue, un tel homme se
sentira malheureux toute sa vie; bien plus malheureux encore sera
celui chez lequel les forces intellectuelles l'emportent de
beaucoup et qui est obligé de les laisser sans développement et
sans emploi pour s'occuper d'une affaire vulgaire qui n'en réclame
pas, ou bien encore et surtout d'un travail corporel pour lequel sa
force physique n'est pas suffisante. Ici toutefois, principalement
pendant la jeunesse, il faut éviter recueil de la présomption et ne
pas s'attribuer un excès de forces que l'on n'a pas.
De la prépondérance bien établie
de notre première catégorie sur les deux autres, il résulte encore
qu'il est plus sage de travailler à conserver sa santé et à
développer ses facultés qu'à acquérir des richesses, ce qu'il ne
faut pas interpréter en ce sens qu'il faille négliger l'acquisition
du nécessaire et du convenable. Mais la richesse proprement dite,
c'est-à-dire un grand superflu, contribue peu à notre bonheur;
aussi beaucoup de riches se sentent-ils malheureux, parce qu'ils
sont dépourvus de culture réelle de l'esprit, de connaissances et,
par suite, de tout intérêt objectif qui pourrait les rendre aptes à
une occupation intellectuelle. Car ce que la richesse peut fournir
au delà, de la satisfaction des besoins réels et naturels a une
minime influence sur notre véritable bien-être; celui-ci est plutôt
troublé par les nombreux et inévitables soucis qu'amène après soi
la conservation d'une grande fortune. Cependant les hommes sont
mille fois plus occupés à acquérir la richesse que la culture
intellectuelle, quoique certainement ce qu'on est contribue bien
plus à notre bonheur que ce qu'on a.
Combien n'en voyons-nous pas,
diligents comme des fourmis et occupés du matin au soir à accroître
une richesse déjà acquise! Ils ne connaissent rien par delà
l'étroit horizon qui renferme les moyens d'y parvenir; leur esprit
est vide et par suite inaccessible à toute autre occupation. Les
jouissances les plus élevées, les jouissances intellectuelles sont
inabordables pour eux; c'est en vain qu'ils cherchent à les
remplacer par des jouissances fugitives, sensuelles, promptes, mais
coûteuses à acquérir, qu'ils se permettent entre temps. Au terme de
leur vie, ils se trouvent avoir comme résultat, quand la fortune
leur a été favorable, un gros monceau d'argent devant eux, qu'ils
laissent alors à leurs héritiers le soin d'augmenter ou aussi de
dissiper. Une pareille existence, bien que menée avec apparence
très sérieuse et très importante, est donc tout aussi insensée que
telle autre qui arborerait carrément pour symbole une
marotte.
Ainsi, l'essentiel pour le
bonheur de la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. C'est
uniquement parce que la dose en est d'ordinaire si petite que la
plupart de ceux qui sont sortis déjà victorieux de la lutte contre
le besoin se sentent au fond tout aussi malheureux que ceux qui
sont encore dans la mêlée. Le vide de leur intérieur, l'insipidité
de leur intelligence, la pauvreté de leur esprit les poussent à
rechercher la compagnie, mais une compagnie composée de leurs
pareils, car similis simili gaudet. Alors commence en commun la
chasse au passe-temps et à l'amusement, qu'ils cherchent d'abord
dans les jouissances sensuelles, dans les plaisirs de toute espèce
et finalement dans la débauche. La source de cette funeste
dissipation, qui, en un temps souvent incroyablement court, fait
dépenser de gros héritages à tant de fils de famille entrés riches
dans la vie, n'est autre en vérité que l'ennui résultant de cette
pauvreté et de ce vide de l'esprit que nous venons de dépeindre. Un
jeune homme ainsi lancé dans le monde, riche en dehors, mais pauvre
en dedans, s'efforce vainement de remplacer la richesse intérieure
par l'extérieure; il veut tout recevoir du dehors, semblable à ces
vieillards qui cherchent à puiser de nouvelles forces dans
l'haleine des jeunes filles. De cette façon, la pauvreté intérieure
a fini par amener aussi la pauvreté extérieure.
Je n'ai pas besoin de relever
l'importance des deux autres catégories de biens de la vie humaine,
car la fortune est aujourd'hui trop universellement appréciée pour
avoir besoin d'être recommandée. La troisième catégorie est même
d'une nature très éthérée, comparée à la seconde, vu qu'elle ne
consiste que dans l'opinion des autres. Toutefois chacun est tenu
d'aspirer à l'honneur, c'est-à-dire à un bon renom; à un rang, ne
peuvent y aspirer, uniquement, que ceux qui servent l'État, et,
pour ce qui est de la gloire, il n'y en a qu'infiniment peu qui
puissent y prétendre. L'honneur est considéré comme un bien
inappréciable, et la gloire comme la chose la plus exquise que
l'homme puisse acquérir; c'est la Toison d'or des élus; par contre,
les sots seuls préféreront le rang à la richesse. La seconde et la
troisième catégorie ont en outre l'une sur l'autre ce qu'on appelle
une action réciproque; aussi l'adage de Pétrone: Habes, habeberis
est-il vrai, et, en sens inverse, la bonne opinion d'autrui, sous
toutes ses formes, nous aide souvent à acquérir la richesse.