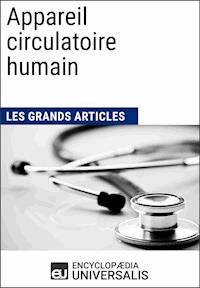
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Au cours du développement humain, l'appareil circulatoire est l'un des premiers à s'ébaucher. Ce fait traduit l'importance vitale du flux circulatoire dès le début de l'embryogenèse. Il alimente en effet les tissus en formation et draine les résidus de la nutrition...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341003179
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Lenetstan/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Appareil circulatoire humain
Au cours du développement humain, l’appareil circulatoire est l’un des premiers à s’ébaucher. Ce fait traduit l’importance vitale du flux circulatoire dès le début de l’embryogenèse. Il alimente en effet les tissus en formation et draine les résidus de la nutrition. Très vite le cœur est fonctionnel. Ses battements, d’abord imperceptibles, deviennent audibles au stéthoscope, ce qui est l’un des moyens dont dispose le médecin pour suivre le développement du fœtus.
À partir de la naissance, d’importantes transformations vont avoir lieu car l’enfant, qui jusqu’alors menait une vie « aquatique » dans l’utérus maternel, sans respiration pulmonaire, passe brusquement à la vie aérienne pendant laquelle ses poumons vont fonctionner. Le cœur s’adapte à ce changement en achevant son cloisonnement : le cœur droit d’où part le sang destiné à l’hématose pulmonaire est ainsi séparé du cœur gauche, responsable de l’irrigation des tissus, par l’intermédiaire de l’aorte et de ses branches. Cette dualité de la fonction circulatoire au sein d’un même appareil constitue l’un des caractères biologiques les plus fondamentaux des vertébrés supérieurs, donc de l’homme. En effet, la bonne coordination des deux circulations, pulmonaire et générale, exige la mise en jeu de régulateurs, nerveux et hormonaux, particulièrement délicats. Ils s’ajustent aussi à la volémie, volume du liquide circulant endigué, elle-même contrôlée par des mécanismes sophistiqués responsables de l’osmorégulation en fonction de l’absorption de liquide et de sels d’une part, et de l’excrétion de ces substances (par le rein surtout) d’autre part.
Le réglage des pressions hydrostatiques qui commandent l’écoulement du sang dans les fins vaisseaux des tissus, les capillaires, n’est pas moins essentiel car c’est de là que dépend toute leur nutrition tissulaire, donc leur vie, tout spécialement dans le cas de la circulation cérébrale. D’où l’importance des mécanismes régulateurs de la pression artérielle ou de ceux qui contrôlent la coagulabilité du sang et la perméabilité vasculaire en pathologie générale : hypertension, hypotension, ischémie, infarctus, thrombose, embolie, athérosclérose, ruptures vasculaires sont quelques-uns des termes les plus couramment évocateurs de circonstances pathologiques menaçant la vie.
Face à ces dangers, on a pu qualifier de « ressuscitation » l’œuvre salvatrice accomplie par la médecine réanimatoire, et en particulier la réanimation cardiovasculaire et respiratoire, dont l’importance est cruciale.
E.U.
1. Description
La notion d’appareil circulatoire est une acquisition relativement récente, puisque le terme « artère » consacre de nos jours encore l’erreur des anciens auteurs qui croyaient, avec Hippocrate, que l’air pulmonaire était conduit dans le corps par les vaisseaux. Claude Galien fut le premier à y reconnaître la présence du sang, mais c’est seulement en 1553 que Michel Servet décrit un cœur droit et un cœur gauche indépendants. Enfin, en 1628, William Harvey découvre la circulation sanguine.
Les noms de Thomas Bartholin, pour les vaisseaux lymphatiques (1653), Marcello Malpighi (1661) et François Magendie pour les capillaires, Claude Bernard et René Leriche pour la vasomotricité, André Thomas et Clarence Lillehei pour le cœur-poumon artificiel, W. B. Kouwenhoven pour le massage cardiaque externe, Norman Shumway et Chris Barnard pour la transplantation cardiaque, d’autres encore, jalonnent les progrès de l’étude du système circulatoire dont l’intérêt est capital. En effet, la circulation est le gage de la vie des animaux supérieurs : un arrêt cardiaque de trois minutes suffit à provoquer chez l’homme la suppression définitive du fonctionnement cérébral, avec ce tracé plat à l’électro-encéphalogramme qui est considéré comme le signe irréversible de la « mort réelle » de l’individu.
• Chez l’adulte
Le cœur
Comme chez tous les vertébrés supérieurs, oiseaux et mammifères, une cloison, normalement étanche dès la naissance, partage le cœur humain en deux moitiés et subdivise le circuit sanguin en deux secteurs totalement indépendants (fig. 1).
Appareil circulatoire humain. Schéma de l'appareil circulatoire humain.
Le cœur droit, ou moitié droite du cœur, ne contient que du sang veineux, rouge foncé, « noir », pauvre en oxygène, riche en gaz carbonique. Ce cœur droit est axé sur les poumons, organes des échanges respiratoires ; il représente l’agent dynamique, la pièce maîtresse de la petite circulation ou circulation pulmonaire, tout entière contenue dans le thorax.
Le cœur gauche, ou moitié gauche, renferme du sang artériel, rouge vif, « rutilant », riche en oxygène, épuré de son gaz carbonique ; il le propulse dans tous les tissus, par l’intermédiaire des vaisseaux de la grande circulation qui intéresse la totalité de l’organisme.
Chacun des deux compartiments du cœur est subdivisé en oreillette et ventricule, séparés par une valvule auriculo-ventriculaire qui canalise le sang de l’oreillette vers le ventricule.
Les oreillettes reçoivent le sang qui arrive au cœur par de gros vaisseaux à paroi mince, les veines. À l’oreillette droite arrivent les veines caves supérieure et inférieure ; elles ramènent le sang pauvre en oxygène, issu de tous les organes à l’exception des poumons. Dans l’oreillette gauche débouchent, venant des poumons, quatre veines pulmonaires, deux droites et deux gauches, qui transportent du sang hématosé, c’est-à-dire riche en oxygène.
Chaque ventricule donne naissance à un seul gros vaisseau ou artère, dont la paroi est épaisse mais élastique. Du ventricule droit part l’artère pulmonaire ; elle se divise en deux branches, droite et gauche, qui se ramifient dans le poumon correspondant. Elle transporte du sang peu oxygéné. Du ventricule gauche naît l’aorte, tronc commun de toutes les artères de l’organisme, sauf l’artère pulmonaire ; elle véhicule du sang riche en oxygène (sang hématosé).
Les vaisseaux
De l’artère aux veines pulmonaires, le sang accomplit la petite circulation, tandis que l’aorte et les veines caves assurent la grande circulation. Le relais entre les artères et les veines correspondantes s’effectue au niveau des tissus, par l’intermédiaire d’un riche réseau de petits canalicules, les vaisseaux capillaires, de telle sorte que le sang est complètement endigué : le système circulatoire est « clos ».
Pour décrire la vascularisation d’un organe, on choisira d’étudier la paroi musculaire du cœur ou myocarde. Elle reçoit deux artères coronaires, droite et gauche, nées de l’aorte ; leur diamètre est d’environ 5 mm. Chacune possède un territoire précis, et les anastomoses sont généralement insuffisantes pour rétablir la circulation, en cas d’obstacle sur l’une des coronaires.
L’oblitération brutale d’une branche de l’artère coronaire gauche, par exemple, supprime l’irrigation de tout un secteur de la paroi du ventricule gauche ; ce secteur, perdant tout apport sanguin, se dévitalise. C’est le mécanisme de l’infarctus du myocarde.
Chaque artère coronaire se divise en branches de plus en plus fines ; la paroi artérielle s’amincit progressivement. Aux ultimes ramifications des artères succèdent les vaisseaux capillaires, constitués par une couche pavimenteuse de cellules aplaties, l’endothélium. La grande minceur de la paroi du capillaire (1 micromètre d’épaisseur) favorise la diffusion des gaz et le passage des substances dissoutes entre sang et territoire vascularisé.
Le calibre d’un capillaire est de l’ordre de 7 à 8 micromètres, soit le diamètre d’un globule rouge. C’est par transitions insensibles que l’on passe des capillaires aux veinules. Celles-ci succèdent au réseau capillaire et confluent en branches de plus en plus volumineuses. Finalement, la circulation de retour du myocarde est assurée par un seul tronc veineux, le sinus coronaire, qui débouche dans l’oreillette droite. Un tel schéma vaut bien sûr pour d’autres organes ; le principe de leur vascularisation est identique à celui qu’on vient de voir.
La circulation lymphatique
La circulation lymphatique joue un rôle considérable ; elle draine les espaces interstitiels, extracellulaires, qui contiennent la lymphe. Ce liquide pénètre dans un système de vaisseaux de petit calibre, bosselés, multivalvulés, les canaux lymphatiques. Ils sont interrompus par des nodules, les ganglions lymphatiques. Les collecteurs lymphatiques s’unissent en troncs volumineux. Le plus important, le canal thoracique, naît dans l’abdomen, traverse le thorax, et se déverse à la base du cou, dans la veine sous-clavière gauche. La circulation lymphatique, très lente, est particulièrement abondante au niveau de l’intestin grêle. La lymphe est un liquide blanchâtre, riche en globules blancs, dépourvu de globules rouges et drainé par la circulation veineuse systémique.
• Chez le fœtus
La circulation est très particulière chez le fœtus humain (fig. 2). L’appareil respiratoire est à l’état quiescent, non fonctionnel. Les sangs veineux et artériel sont largement mêlés au niveau du cœur et des gros vaisseaux par suite de communications entre les cavités gauches et droites ; si ces communications persistent après la naissance, elles entraînent certaines malformations cardiaques.
Dans les conditions normales, le ventricule est cloisonné longitudinalement par un septum interventriculaire, mais il peut persister un orifice, le trou de Panizza, créant une communication interventriculaire.





























