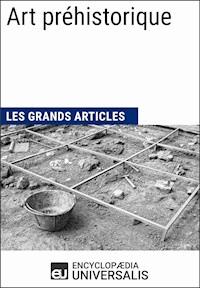
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Près de trois millions d'années séparent les premiers outils fabriqués par l'homme des premières images préhistoriques : cette longue période, équivalente de celle qui marqua l'émergence de Homo au sein des Hominidés quelque part en Afrique orientale, est dominée par un phénomène évolutif spécifique à l'homme : sa cérébralisation. Avec ses lobes frontaux développés, le cerveau d'Homo sapiens sapiens fossilis offrait une complexité et des possibilités fonctionnelles sans précédent ; c'est alors qu'apparaît l'art, trente mille à quarante mille ans à peine avant notre ère ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852298620
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Marques/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Art préhistorique
Près de trois millions d’années séparent les premiers outils fabriqués par l’homme des premières images préhistoriques : cette longue période, équivalente de celle qui marqua l’émergence de Homo au sein des Hominidés quelque part en Afrique orientale, est dominée par un phénomène évolutif spécifique à l’homme : sa cérébralisation. Avec ses lobes frontaux développés, le cerveau d’Homo sapiens sapiens fossilis offrait une complexité et des possibilités fonctionnelles sans précédent ; c’est alors qu’apparaît l’art, trente mille à quarante mille ans à peine avant notre ère.
Ce lien en quelque sorte organique entre le cerveau évolué de l’homme préhistorique moderne et la création artistique dont il est l’auteur s’inscrit dans la perspective des comportements métaphysiques proprement et exclusivement humains attestés par des sépultures aménagées dès le Paléolithique moyen, deux à trois dizaines de millénaires auparavant : une bonne trentaine d’inhumations individuelles ou collectives, réalisées par des Néandertaliens (Homo sapiens neandertalensis) en Europe et au Moyen-Orient.
Cependant, l’acte de représenter, c’est-à-dire d’inventer entre soi et son univers une forme, de l’inscrire pour durer dans la pierre ou l’os, bref d’introduire de l’imaginaire pur dans la matérialité concrète des objets et des parois rocheuses, est absolument nouveau et conduit à notre modernité, celle du visuel et de l’abstrait.
Nouveau, le phénomène artistique est également universel. Jusqu’aux années 1970, l’ancienneté et la multitude des travaux consacrés à l’art paléolithique franco-cantabrique d’une part, la rareté des recherches appliquées ailleurs – à l’exception de l’Afrique saharienne et australe – s’étaient conjuguées pour laisser croire que les origines de l’art préhistorique étaient européennes ; il n’en est rien. En Australie, des travaux ont donné des datations absolues au carbone 14 archéologiquement bien fondées ; celles-ci montrent que d’assez nombreux ensembles gravés ou peints en abris et en grottes sont contemporains de l’art pariétal magdalénien de France et d’Espagne ; certains sites ont même plus de vingt mille ans ; ils sont donc plus anciens que l’essentiel de l’« art occidental préhistorique ». Il en est de même sans doute en Amérique du Sud, au Brésil notamment, mais aussi en Argentine et au Chili, où les sites correctement datés au-delà de 10 000 B.P. (before present), voire 15 000 B.P. et plus, se multiplient sous l’effet de recherches intensives développées à partir de 1980. L’Afrique et l’Asie – l’Inde en particulier – offrent aussi une multitude de sites d’art rupestre appartenant à des cultures anciennes dont les modes de vie permettent de les comparer aux cultures du Paléolithique supérieur européen.
Sites d'art pariétal et d'art mobilier paléolithiques en Europe. Répartition des sites d'art pariétal et d'art mobilier paléolithiques en Europe.
L’universalité du phénomène artistique résulte bien entendu de celle de son auteur, c’est-à-dire du type humain sapiens, qui, précisément, achève de conquérir le monde au cours de ces quatre dernières dizaines de millénaires ; en même temps qu’il s’approprie de nouveaux espaces, Homo sapiens les peuple d’images.
Séries d’incisions, nappes de cupules ou de points, signes géométriques, files d’animaux, d’hommes, d’armes... témoignent abondamment de la conception de rythmes, de séquences, en un mot de types de numération : une dimension abstraite caractérise la plupart des formes d’art préhistorique monumentales – art rupestre et art pariétal – ou mobilières – les objets et supports amovibles. En ce sens, les arts préhistoriques annoncent les écritures ; cependant, ils sont profondément figuratifs par les deux thèmes majeurs qu’ils privilégient : l’homme et les animaux. Le premier fut dessiné dans la variété infinie de ses attitudes, postures, accoutrements ; les animaux dans leur extrême diversité témoignent des choix des chasseurs aussi bien qu’ils illustrent partiellement les faunes sauvages locales ou encore la domestication, lorsqu’elle intervint à diverses époques et sur chaque continent.
Le choix des supports montre aussi la richesse des comportements symboliques des hommes préhistoriques : armes et outils furent parfois richement décorés comme pour souligner la valeur et l’importance qu’ils revêtaient pour l’accomplissement des tâches quotidiennes ; mais les « objets d’art », sans fonction utilitaire, sont également nombreux dès les périodes les plus anciennes comme le prouvent les statuettes animales et humaines modelées en terre et cuites par des Gravettiens d’Europe centrale, il y a plus de 25 000 ans.
Partout dans le monde, l’art monumental est un mode d’expression de plein air, qu’il s’agisse de représentations en abri, sur roches ou même sur dalles au sol ; la seule exception fut celle, merveilleuse, de l’art pariétal paléolithique, un art des profondeurs, celui des grottes et des cavernes.
Plus que tout autre vestige archéologique, l’art préhistorique reflète directement la pensée, le rêve de ses auteurs, les cosmogonies et les symboles de leurs groupes. Il est un lien privilégié de compréhension entre les hommes préhistoriques et nous-mêmes.
1. Europe
• Historique des découvertes
La découverte en 1940 de la grotte de Lascaux en Dordogne conféra à l’art paléolithique pariétal une célébrité mondiale et lui donna la première place dans l’histoire universelle de l’art. Cependant, un siècle de trouvailles et de recherches avait précédé la révélation de Lascaux – et l’on ne cesse de découvrir d’autres grottes décorées (une quinzaine en France entre 1975 et 1986) grâce à des prospections et à des observations systématiques dans les cavités karstiques des régions à forte densité d’occupation du Paléolithique supérieur (Périgord, Quercy, Pyrénées, Pays basque, Cantabres et Asturies).
Les objets gravés de figures animales et de motifs abstraits ou géométriques trouvés avant les grandes recherches et classifications d’Édouard Lartet, Henry Christy, Félix Garrigou en Périgord et dans les piémonts pyrénéens, au cours des années 1860, passèrent pour « celtiques », tel l’os gravé de deux biches du Chaffaud (Vienne), dégagé vers 1834. Les fouilles des grands gisements comme Laugerie-Basse, La Madeleine le long de la Vézère en Dordogne, celles de Bruniquel (Tarn-et-Garonne), de Brassempouy (Landes), de Lourdes (Hautes-Pyrénées), puis d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques), du Mas-d’Azil (Ariège) permirent d’établir des classifications chronologiques relatives, à partir des séquences stratigraphiques mises au jour. Ainsi l’idée de l’ancienneté pré-historique d’un art d’objets s’imposa peu à peu aux savants pionniers (Édouard Piette, en particulier) de la seconde moitié du XIXe siècle, parallèlement donc aux découvertes d’hommes fossiles et leurs habitats, industries et sépultures. D’entrée, les préhistoriens avaient été frappés par les représentations d’animaux appartenant à des espèces éteintes ou disparues de nos régions : des mammouths, des bisons, des rennes ; l’abondance des débris osseux de rennes consommés par les chasseurs les inclina à attribuer à un « Âge du renne » les couches d’habitats qui recélaient ces vestiges, associés à des objets gravés. Alors même que l’ancienneté « antédiluvienne » de l’Âge du renne ne pouvait être évaluée correctement ni bien sûr datée, l’art mobilier des chasseurs préhistoriques avait été reconnu sans difficultés majeures. Lorsque, en 1879, don Marcelino de Sautuola découvrit les peintures du plafond de la grotte d’Altamira (Cantabrie) où il pratiquait des fouilles en amateur éclairé, l’homme préhistorique était encore envisagé comme un sauvage, bon ou mauvais, mais en tout cas pas comme l’auteur des splendides bisons bichromes d’Altamira ! L’art mobilier avait été admis ; c’était principalement un art de gravure, parfois de sculpture ou de découpage de lames osseuses, toujours de dimensions réduites ; on n’avait pas encore compris l’extraordinaire niveau esthétique et artistique atteint par ces chasseurs primitifs. Ce n’est qu’au début de ce siècle, en 1902, qu’Émile Cartailhac, premier titulaire d’une chaire d’enseignement de la préhistoire, reconnut dans son célèbre écrit Mea culpa d’un sceptique l’authenticité des peintures d’Altamira qu’il avait intempestivement contestée. En réalité, une vingtaine de grottes découvertes à partir de 1895 avaient conduit à la reconnaissance de l’art monumental souterrain : la grotte Chabot dans le canyon de l’Ardèche avec ses vigoureuses gravures de mammouths, la grotte de Pair-non-Pair au milieu du vignoble girondin, offrant plusieurs panneaux de gravures d’animaux profondément incisés, la longue et étroite galerie de Marsoulas (Haute-Garonne) possédant de multiples signes peints et gravés, ainsi que des représentations de bisons et de chevaux, les gravures variées de la galerie sinueuse et basse de La Mouthe (Dordogne) dont les sédiments livrèrent une lampe en calcaire décorée d’un bouquetin contribuèrent d’abord à l’identification de l’art pariétal et à son extension dans tout le sud-ouest de la France jusque sur la rive droite du Rhône ; les deux découvertes presque simultanées à la fin de l’été de 1901 des Combarelles et de Font-de-Gaume, près des Eyzies-de-Tayac au cœur du Périgord noir, emportèrent ensuite et définitivement la conviction générale ; elles étaient dues à Denis Peyrony dont les fouilles en Périgord furent fondamentales pour l’établissement d’une chronologie stratigraphique renouvelée et encore en partie valide, et furent aussitôt mises en valeur par Henri Breuil qui en fit les relevés ; elles comptent, comme Lascaux, parmi les « géants » de l’art préhistorique pour reprendre le vocable d’Henri Breuil, avec leurs centaines de gravures (Combarelles) et de gravures et peintures (Font-de-Gaume) attribuées à la phase classique du Magdalénien.
• Datations de l’art paléolithique
Si, de nos jours, aucun problème majeur d’identification et d’authenticité ne se pose plus lors d’une découverte, les questions de datation de l’art paléolithique ne trouvent pas toujours une réponse satisfaisante ou définitive. Sur ce point, il faut distinguer l’art mobilier de l’art pariétal.
Lorsqu’un objet préhistorique est découvert en surface comme la « Vénus » de Sireuil, hors de tout contexte stratigraphique ou culturel, son attribution reste conjecturale et, dans le meilleur des cas, ne repose que sur une comparaison morphologique et stylistique ; dans cet exemple, la ressemblance de la Vénus de Sireuil avec celle effectivement gravettienne de l’abri du Facteur à Tursac autorise à l’introduire dans l’ensemble des « Vénus gravettiennes » trouvées dans toute l’Europe jusqu’en Ukraine (Kostienki).
L’appartenance à une couche archéologique datée, soit relativement dans une séquence stratigraphique, soit absolument par le carbone 14, est bien entendu déterminante pour des blocs gravés ou sculptés comme ceux du Roc de Sers (Charente), solutréens, ou pour tout objet d’art ; a fortiori lorsqu’il s’agit d’un type d’objets trouvés en de multiples exemplaires dans des gisements différents et plusieurs fois datés comme, par exemple, les figurines animales en « contour découpé » (Saint-Michel d’Arudy), les rondelles osseuses perforées (Mas-d’Azil), les propulseurs sculptés (La Madeleine, Enlène - Trois-Frères, Bruniquel), tous caractéristiques du Magdalénien moyen. En définitive, les milliers d’objets décorés ou sculptés trouvés en fouilles sont pour la plupart datés ou placés de façon valide dans la chronologie du Paléolithique supérieur étendu à l’Europe entière.
Il n’existe de datation directe de l’art pariétal que dans les cas d’un rapport stratigraphique dûment établi : une paroi décorée enfouie dans une (ou plusieurs) couche archéologique déterminée et datée, ou un élément décoré de paroi trouvé dans une couche archéologique également bien définie ; moins de dix grottes paléolithiques pourraient prétendre encore aujourd’hui à une datation de cette qualité ; la petite grotte à gravures fines sur calcaire concrétionné de la Mairie à Teyjat (Dordogne) serait de celles-ci ; elle est datée de la fin du Magdalénien. Les dessins aux traits rouges de la grotte de la Tête du Lion à Bidon (Ardèche), un bovidé, une tête de bouquetin et une de cerf, une nappe de points, sont pratiquement les seuls à être datés directement : en effet, des éclaboussures des colorants utilisés furent décelées sur le sol préhistorique à proximité d’un foyer, datés au 14C de 20 650 A 800 ans B.P. (laboratoire de Lyon, Ly. 848) : ils appartiennent donc au Solutréen ancien rhodanien.
Il arrive enfin que l’attribution chronologique soit avancée de façon incontestable lorsque le contexte archéologique trouvé dans la grotte ornée ou à son entrée le permet. La grotte de Fontanet (Ariège) dont l’entrée paléolithique fut bouchée naturellement, vraisemblablement à la fin du Paléolithique, contient des foyers datés, des outils, des restes osseux d’animaux consommés, ainsi que des empreintes humaines et animales, du Magdalénien moyen ; or c’est précisément à cette culture bien développée dans cette région pyrénéenne que renvoient toutes les comparaisons techno-stylistiques appliquées aux quelques dizaines de splendides gravures et peintures parfaitement conservées sur ses parois.
Principales grottes ornées d'Europe. Les principales grottes ornées paléolithiques d'Europe. La différence de teinte entre les bleus montre la position des lignes de côte durant le dernier maximum glaciaire, autour de – 18 000 ans
Les comparaisons techno-stylistiques et thématiques restent le dernier recours pour une éventuelle attribution chronologique et culturelle ; elles ne sont véritablement fondées que dans le cas d’une uniformité des représentations de la cavité concernée en correspondance avec une homogénéité culturelle régionale, par exemple Niaux appartenant au Magdalénien de l’Ariège.
• Réflexions méthodologiques
L’analyse des colorants utilisés conjuguée à la recherche de leurs origines géologiques, les observations directes et photographiques en lumière normale, en infrarouge et en ultraviolet des tracés, des états de surface, de leur évolution, l’inventaire précis et rigoureux de toutes les représentations, y compris les tracés incomplets ou les vestiges, l’étude descriptive des cavités, de la localisation exacte des représentations et de tous les vestiges et traces qui s’y rencontrent ont complètement transformé la recherche préhistorique consacrée à l’art paléolithique et à sa conservation.
Désormais, il apparaît clairement que les analyses, descriptions, inventaires et classifications doivent précéder les interprétations des représentations mobilières et pariétales ; il est plus fondé de faire apparaître ces documents dans tous leurs caractères propres et leurs liens archéologiques et chronologiques que de prêter à leurs auteurs, muets, nos discours et nos théories.





























