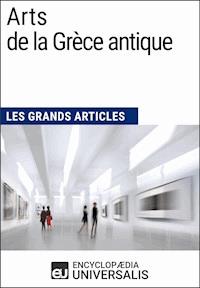
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le sort de l'art grec à partir de la fin de l'Antiquité est des plus étranges. C'est un art qui n'est connu directement que depuis peu, et dont pourtant on n'a cessé des siècles durant de se recommander, qu'on s'est efforcé d'imiter, qu'on a de confiance admiré. Cette admiration remontait aux temps les plus anciens : il était à peine né que déjà...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852297449
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Bluraz/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Arts de la Grèce antique
Le sort de l’art grec à partir de la fin de l’Antiquité est des plus étranges. C’est un art qui n’est connu directement que depuis peu, et dont pourtant on n’a cessé des siècles durant de se recommander, qu’on s’est efforcé d’imiter, qu’on a de confiance admiré. Cette admiration remontait aux temps les plus anciens : il était à peine né que déjà les riches Étrusques faisaient à grand prix venir la vaisselle décorée par les Rhodiens, les Corinthiens ou les Athéniens. Les statues pillées par les Romains dans les villes conquises figuraient à la place d’honneur dans le défilé triomphal des généraux vainqueurs, et, plus tard, les collectionneurs s’arrachèrent les pièces qui venaient d’un pays dont ils pensaient avoir tout à apprendre.
Après l’éclipse du Moyen Âge, qui cependant ne l’ignora pas autant qu’on le prétend parfois, l’art grec connaît à partir de la Renaissance une faveur nouvelle, mais en fait il vit alors sur sa réputation, aucun des monuments qui font aujourd’hui sa gloire n’étant encore mis au jour. On le découvrit peu à peu et, par une heureuse chance, les œuvres qu’on exhumait se trouvaient correspondre au goût de chaque époque. Ce furent d’abord des œuvres hellénistiques transcrites par des copistes romains, et pendant très longtemps on ne sut les distinguer des originaux ; la fin du XVIIIe siècle révèle le classicisme, qu’on n’accepte d’ailleurs pas sans réticence : lorsque les plaques du Parthénon arrivèrent à Londres, elles passèrent aux yeux de certains pour des répliques médiocres et tardives ; c’est à la fin du XIXe siècle que l’archaïsme, sans cesse enrichi par de nouvelles trouvailles, est devenu familier à notre civilisation qui se penche avec amour vers toutes les créations de caractère plus ou moins primitif.
Malgré bien des lacunes et des incertitudes, on a aujourd’hui sous les yeux le développement complet de l’art grec depuis ses premiers balbutiements à l’aube du Ier millénaire avant J.-C. jusqu’au jour où, vieilli, il sombra dans l’académisme et la médiocrité, avant de se renouveler complètement sous l’influence de l’idéal chrétien et de donner naissance à l’art byzantin.
Il nous est dès lors loisible de l’examiner de façon plus objective, de renoncer à certaines idées qu’on avait de lui lorsqu’il était encore mal connu, telles que celle du « miracle grec ». On sait maintenant que Phidias n’a pas créé à partir du néant le décor du Parthénon, mais que les chefs-d’œuvre du Ve siècle avaient été préparés par trois ou quatre cents ans d’efforts lents et patients. On sait aussi que l’art grec n’aurait jamais été ce qu’il fut en réalité si ne l’avait précédé celui d’autres civilisations. Depuis le IIIe millénaire au moins, l’Égypte et le Moyen-Orient avaient inventé et perfectionné des moyens d’expression graphiques et plastiques d’une inégalable valeur ; entre le XVIIIe et le XIIe siècle, les Crétois, puis ceux que l’on appelle les Mycéniens avaient à leur tour développé un art de très haute qualité. De ce passé lointain, les Grecs ont profité. De plus, même dans les périodes les plus brillantes, leur art s’est tenu en contact avec ceux de l’Asie et de la vallée du Nil, il leur a emprunté des idées, des formules, des ambitions. On peut dire que les artistes grecs n’ont créé que sous le souffle d’inspirations étrangères.
Et pourtant, leur art resta profondément original. Il exprime toujours une pensée grecque, un idéal grec ; il ne se sert de ses emprunts que pour lancer plus haut son esprit. À l’instar des philosophes grecs, c’est en approfondissant toujours les mêmes thèmes que les artistes eux aussi progressent.
L’étude de l’art grec ne se suffit évidemment pas à elle-même, l’art n’est pas indépendant des autres formes de la vie, de la littérature, de la science aussi, dans ce pays où la mathématique et la géométrie sont si fort prisées. L’hellénisme forme un tout : on peut admirer pour son interne beauté telle statue, telle peinture de vase, on ne peut les pénétrer si l’on ignore l’histoire et la civilisation grecques.
Pour les Grecs, l’homme est la mesure de toute chose. Rien n’est plus beau que son corps lorsqu’il est développé par l’athlétisme, rien n’est plus adroit que sa main, plus subtil que son esprit. Et si les dieux jouissent de l’immortalité et d’une puissance presque sans bornes, c’est pourtant à l’image de l’homme qu’ils ont été conçus. Est-ce à cause de la pureté de leur ciel, de l’harmonie de leur paysage, les Grecs n’ont ni le sens ni le goût du mystère et du mysticisme. S’ils apprécient la nature, elle ne leur paraît digne d’intérêt, dans leur littérature comme dans leur art, que dans la mesure où elle est peuplée d’êtres humains, domestiquée par eux. La raison partout domine, et les aspects les plus violents du culte de Dionysos, le dieu de l’extase, restent pendant longtemps réprouvés par l’opinion publique. Il faut attendre le IVe siècle et l’établissement de rapports suivis avec le monde asiatique pour que la passion s’introduise dans l’art.
Autre trait : le goût de l’universel. « Il n’est de science que du général », disait Aristote, et pendant des siècles les artistes eux aussi ont évité tout ce qui, dans leurs représentations, offrait un caractère trop particulier, disons même trop actuel : deux jeunes gens partent-ils pour la guerre, le peintre inscrit à côté de leur image les noms de Castor et Pollux et la scène quotidienne prend ainsi plus de poids, et les combats entre les Grecs et les légendaires Amazones, sculptés sur les frises des temples, évoquent les batailles récentes que les Athéniens ont livrées aux Perses pendant les guerres médiques.
On comprend mieux dès lors pourquoi l’art grec paraît si vivant. Il s’adresse à des hommes, dans ce que leur tempérament comporte de plus foncier, de plus éternel. De nos jours encore, le champion sportif peut se reconnaître dans l’athlète qu’a sculpté Polyclète ; de nos jours encore, la lumineuse clarté des figures du Parthénon garde toute sa valeur ; de nos jours encore, une coupe peinte au VIe siècle avant notre ère n’a rien perdu de son actualité, parce qu’universel est l’esprit de l’hellénisme.
Cependant, nulle œuvre ne peut survivre à tant de siècles si son exécution n’est pas parfaite. Or, les anciens Grecs ont de tout temps attaché le plus grand prix à l’exécution. L’artiste, pour eux, c’est celui qui connaît parfaitement une technique, et l’on a noté que ce qu’ils appelaient les Sept Merveilles du monde les frappaient moins par leur beauté que par le talent et la science avec lesquels leurs auteurs avaient triomphé de difficultés matérielles à première vue insurmontables.
Les artistes grecs ont pratiqué maintes techniques : ils ont su dessiner et peindre, selon des procédés dont certains nous déconcertent, ils ont modelé la terre, fondu le bronze, ciselé l’or et l’argent, ils ont taillé le bois et la pierre et n’ont pas négligé le travail difficile de l’ivoire. Les réussites ne sont pas toujours égales, bien sûr, mais, si l’on ne tient pas compte des productions populaires, le soin apporté à l’exécution est presque toujours remarquable. La plupart des vases peints conservés dans nos musées sont l’œuvre de très modestes artisans et pourtant, sitôt que les tâtonnements de l’archaïsme sont dépassés, la pureté, la sûreté du trait révèlent une science qui, dans d’autres pays, serait le fait de grands maîtres.
C’est là chose d’autant plus étonnante que, de tout temps, le nombre des artistes dans la Grèce antique fut considérable. La céramique peinte est un art industriel et les vases de terre, en un temps où le métal était rare, connaissaient un succès inouï, se fabriquaient par milliers ; des modeleurs façonnaient par milliers aussi des figurines que l’on dédiait dans des sanctuaires ou que l’on déposait, images de divinités protectrices, dans les tombes ; et les ex-voto des particuliers consistaient en statues, en objets de matière précieuse que la piété d’innombrables fidèles commandait à des artistes de tous genres. Mais pendant la plus grande partie de l’histoire grecque, le client principal, c’était l’État, la cité : c’est pour la cité et à ses frais que travaillaient surtout peintres, sculpteurs, architectes de renom, chargés de remercier les dieux par de magnifiques offrandes au nom de toute la communauté civique. Jusqu’au IVe siècle avant notre ère, il n’est pas un monument qui n’ait été élevé, avec son décor, pour le compte d’un État ou, ce qui revient au même, d’un sanctuaire international : temples, portiques, locaux pour les assemblées, théâtres, fontaines monumentales ; et ce n’est que plus tard que la commande privée prend une importance notable. Si l’on songe que tout grand édifice exigeait la collaboration de plusieurs corps de métiers, que la sculpture et la peinture faisaient partie intégrante de tout grand bâtiment, on voit quelle place les artistes occupaient dans la société.
Place numérique au vrai, car il semble bien que la plupart d’entre eux étaient un peu traités comme de simples ouvriers et qu’ils ne jouissaient que d’une faible considération ; les plus grands, cependant, échappaient bien sûr à cette règle et le succès leur assurait une considération qui pouvait porter certains d’entre eux, un Zeuxis par exemple, à des excès dignes de nos vedettes les plus en vue.
Cette modestie matérielle correspondait chez la plupart des artistes à une modestie morale. Chacun cherche à faire le mieux possible et désire éclipser ses rivaux, mais en même temps reste fidèle à ses maîtres ; ceux mêmes qui apportent à leur art quelque chose de tout à fait nouveau ne sont point révolutionnaires. Ils se recommandent du patron qui les a formés, ils ne souhaitent point rompre avec la tradition mais se surpasser eux-mêmes, et peut-être faut-il attribuer cette modestie au fait que, pour une bonne part, l’art grec était d’intention religieuse, que c’était pour plaire aux dieux qu’on travaillait le mieux possible.
1. La naissance de l’art grec
Il est aujourd’hui bien établi qu’étaient déjà grecs les peuples qui, dans le courant du IIe





























