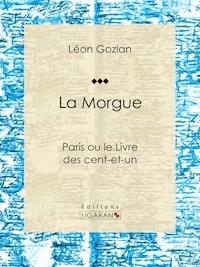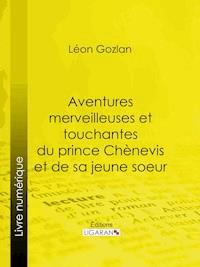
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ce beau château de marbre, qui se déploie, dans ses proportions colossales, sous un ciel chaud et azuré, et qui s'élève majestueusement au milieu d'un lac tranquille, est la résidence du prince Orfano-Orfana. Les douze gradins au sommet desquels il apparaît sont couverts de cyprès toujours verts, de citronniers et d'orangers couleur d'or, de pins et de peupliers ; le dernier de tous les gradins est planté de rosiers de Messine qui répandent au loin, quand le..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La féerie est-elle le seul domaine où l’on doive aller chercher des sujets de contes pour les enfants ? Après le sublime Perrault, qui a écrit jusqu’ici les plus jolis contes d’enfants, n’y a-t-il plus rien à créer pour eux dans un autre genre ? Réussissez, répondra-t-on, et la question sera résolue en votre faveur. Cette réponse n’est que spécieuse ; car je pourrais fort bien ne pas réussir dans ma tentative, sans qu’il fût prouvé pour cela que les enfants ne voudront jamais se plaire qu’aux naïves, qu’aux inimitables fictions du Petit Chaperon rouge et du Petit Poucet. Un plus habile viendra qui, après avoir démontré que les grands-parents, en souvenir du passé, par reconnaissance pour leur jeune âge, sont pour plus de moitié dans la vogue éternelle acquise à Perrault, prendra place auprès de cet heureux écrivain en élevant le conte à la hauteur d’un enseignement. Mais faut-il toujours enseigner ? crieront ceux qui volontiers crient sur tout. On leur répliquera doucement : Ne faut-il jamais enseigner ? Quelle meilleure occasion de graver un principe de justice ou d’humanité dans le cœur des enfants, que celle qu’offre tout naturellement un récit qui les captive et les intéresse ? Perrault en vaudrait-il moins si Barbe-Bleue apprenait quelque vérité destinée à germer plus tard ? Les fleurs sont de charmantes choses ; mais les fleurs qui deviennent des fruits sont, je crois, d’un ordre supérieur.
Les enfants ne le sont pas autant qu’on le croit. Si on peut leur offrir sans danger des images fausses, telles que des souris blanches qui se métamorphosent en chevaux ; qu’une citrouille qui se change en magnifique équipage ; si leur intelligence courte, mais saine, redresse facilement ces ingénieux mensonges, n’est-il pas de raison de les initier tout de suite à la vérité, dans les écrits qu’on leur destine ? Mais le charme de la fiction ? objectera-t-on. Soyez tranquilles : Dieu a mis assez de charme et de poésie dans la vérité, sans qu’il soit rigoureusement besoin de recourir à l’imagination de l’homme pour ajouter à la vérité.
Il s’agit uniquement de la leur faire aimer dans nos contes nouveaux, comme Perrault, dans les siens, leur fait aimer le mensonge. Rien n’est plus facile. Que faut-il pour cela ? Être Perrault.
LÉON GOZLAN.
Ce beau château de marbre, qui se déploie, dans ses proportions colossales, sous un ciel chaud et azuré, et qui s’élève majestueusement au milieu d’un lac tranquille, est la résidence du prince Orfano-Orfana. Les douze gradins au sommet desquels il apparaît sont couverts de cyprès toujours verts, de citronniers et d’orangers couleur d’or, de pins et de peupliers ; le dernier de tous les gradins est planté de rosiers de Messine qui répandent au loin, quand le vent les agite le soir, une odeur vivifiante et suave. Bâti sur l’une des îles Borromées par les ancêtres du prince Orfano-Orfana, qui avaient été autrefois les plus puissants seigneurs du Piémont, ce château fut surnommé, à cause de sa rare magnificence, la Perle du lac Majeur.
Vous savez que le lac Majeur est à l’entrée de l’Italie occidentale, dans les États du roi de Sardaigne, au centre d’une fertile et riante plaine. On l’aperçoit de l’autre côté des Alpes, immédiatement après avoir quitté les frontières de la Savoie.
Les appartements vastes et nombreux de ce château sans égal répondaient à sa beauté extérieure. Rien ne pourrait se comparer à la richesse de ses tapis brodée en Perse, à l’élégance de ses meubles en bois des Indes, à l’éclat et à la variété infinie de ses dorures. Les tableaux qui l’ornaient étaient dus aux meilleurs peintres de l’Italie. Enfin, il était si remarquable, que le roi Victor-Emmanuel de Savoie dit un jour à l’un de ses courtisans : « En vérité, si je n’étais roi de Sardaigne, je voudrais être seigneur du château Orfano-Orfana. » Un pareil souhait, formé par un souverain justement célèbre dans l’histoire, aurait pu nous dispenser de tout autre éloge.
Le maître de ce splendide château, le prince Orfano-Orfana, n’avait pas seulement le bonheur de joindre à une grande fortune un pouvoir fort étendu sur ses vassaux, il jouissait encore du bonheur mille fois plus doux de posséder une femme digne de lui et deux enfants charmants.
Le premier, l’aîné, reçut en naissant le nom de Léopold-Léopoldini ; la jeune fille s’appelait Olympe comme sa mère. On vous dira bientôt à quelle occasion Léopold-Léopoldini fut décoré du surnom bizarre de prince Chènevis, surnom qu’il tint à honneur de porter et que nous lui avons religieusement conservé dans cette histoire dont il est le héros. Olympe avait sept ans ; elle était rose et blonde, vive, pimpante, gracieuse, mignonne, montrant ses blanches petites dents de souris quand elle riait, et elle riait toujours ; elle riait comme elle respirait. Sur son front développé et dessiné en diadème, dans ses yeux agités et bleus comme les eaux pures du lac Majeur, on lisait la finesse, l’esprit, la gaieté, mais aussi, car il faut faire d’elle un portrait exact, la fierté dédaigneuse de sa race. Ses lèvres pincées exprimaient le mépris, pour peu qu’on blessât, même involontairement, son amour-propre. Quand elle cessait d’être une bonne petite fille, elle prenait aussitôt des airs de reine. Simple avec ses égales, elle affectait les manières superbes avec les petites villageoises qu’elle rencontrait sur son chemin, quoique celles-ci ne manquassent jamais de lui offrir des fleurs et de lui tirer leurs plus belles révérences. L’âge devait exagérer ses défauts, si une bonne éducation, donnée à temps et avec prudence, ne venait faire triompher ses heureuses qualités.
Son frère Léopold-Léopoldini, mais que nous appellerons le prince Chènevis, était plus âgé qu’elle d’un an ; il était par conséquent dans sa huitième année. Figurez-vous un gentil garçon vêtu d’un élégant habit de velours bleu tendre, comme en portaient alors les marquis et les personnes de cour, d’une fine culotte de satin chamois, touffue de rubans aux genoux ; caressant de son menton, frais comme une pomme d’api, du linge plissé et brodé divinement ; portant l’épée au côté : une épée d’acier les jours ordinaires, une épée de nacre et d’or les jours de fête.
Il ressemblait beaucoup à sa sœur. Il était blond, d’une blancheur charmante, et finement coloré comme elle. Il possédait sa gentillesse, sa grâce, sa pétulance et son enjouement. Mais là s’arrêtait l’analogie. Le petit prince Chènevis montrait de la dignité, autant du moins qu’on en peut avoir à son âge, et non de la morgue, quand il se trouvait en compagnie des enfants de son rang ; et il se conduisait avec une bonté vraie, simple, toute naturelle, lorsque le hasard le mettait en rapport avec les fils des bateliers du lac Majeur et ceux des jardiniers et des vignerons de la vallée. Aussi l’aimaient-ils beaucoup.
Cette bonté du petit prince Chènevis ne se bornait pas uniquement à ses semblables ; elle s’étendait, par l’effet de son caractère généreux, aux êtres que l’homme n’a pas l’habitude, – et c’est là une grande faute quand ce n’est pas un crime, – de traiter avec douceur. Le prince Chènevis ne comprenait pas qu’on fît du mal aux animaux, qui sont comme nous l’œuvre d’un créateur intelligent, juste et bon ; qu’on traitât sans pitié le chien qui garde le troupeau ou défend la ferme, le cheval qui traîne péniblement la voiture, l’âne patient et docile qui porte au marché le produit de nos champs, le chat chargé d’empêcher les souris de dévorer la moisson, l’oiseau qui égayé par son chant la solitude de la maison. Il se disait avec un bon sens parfait que, puisque l’homme s’est donné le droit de commander aux animaux, de leur ravir leur liberté, il s’est imposé aussi le devoir de les abriter, de les nourrir et de remplacer à quelque degré le Créateur, qui ne les laisse manquer de rien dans leur état d’indépendance.
Comme le château Orfano-Orfana était situé sur les frontières de l’Italie, il était constamment visité en passant par ces troupes de montreurs de curiosités, de comédiens ambulants aux haillons pittoresques, de saltimbanques, venus de Bergame et de Milan pour aller chercher fortune en France. Ces bohémiens basanés et spirituels ne recevaient pas toujours un accueil royal de la part des domestiques. Mais, s’ils avaient le bonheur d’être aperçus par le petit prince Chènevis, ils évitaient les affronts du balai et les coups de fourche. Il les laissait entrer, et il prenait un plaisir très vif à leurs exercices. Il aimait surtout à voir les tours qu’ils enseignent aux animaux dont l’adresse les fait vivre. Il cherchait à savoir comment ils obtiennent d’un chien qu’il joue aux cartes ou aux dominos, d’un singe qu’il valse en mesure au son de la musique, d’un oiseau qu’il fasse le mort. Pour quelques pièces de menue monnaie, il apprenait d’eux ces secrets qui ne sont, après tout, que l’art de tirer parti, à l’aide de beaucoup de patience, de l’instinct des animaux, instinct perfectible à l’infini. Il augmentait en lui de plus en plus l’affection raisonnée qu’il leur portait, par la vue de ces exercices pleins d’utiles enseignements.
Croirait-on qu’on se moquait au château de cette généreuse sollicitude du prince Chènevis pour les animaux ? Son père et sa mère, qui étaient bons, ne l’en blâmaient pas ; mais les femmes de chambre, race moqueuse, les valets et les domestiques le raillaient sans pitié, et se faisaient un malin plaisir de tourmenter ses protégés, afin de le tourmenter lui-même. Ils avaient toujours un prétexte pour oublier de donner du foin aux chevaux, du son à l’âne, de mettre du chènevis dans la volière. C’est dans le but de rendre tout à fait ridicule le bon petit prince Léopold-Léopoldini qu’ils l’avaient surnommé, faisant allusion aux soins de toutes sortes qu’il avait pour les bêtes, le prince Chènevis, nom, comme vous savez, d’une grosse graine dont se nourrissent beaucoup d’oiseaux.
Telle est l’origine fort simple, fort claire, et nullement déshonorante, du surnom qu’il avait reçu.