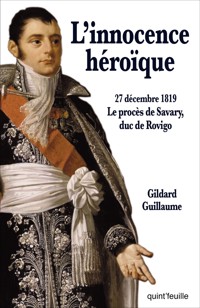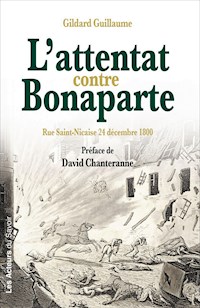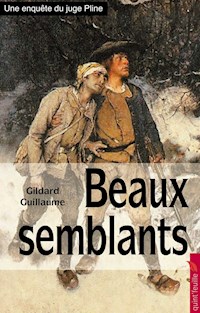
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Quint'feuille
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Le département de Maine-et-Loire, comme beaucoup d’autres, a connu les tempêtes, les délires et les exactions révolutionnaires. Situés aux confins orientaux du territoire insurgé, Saumur et le Saumurois ont en outre été frappés de plein fouet par la guerre fratricide dite de Vendée, subissant d’abord une conquête humiliante en juin 1793, multipliant ensuite par vengeance les atrocités et les ignominies, le massacre de Bournan (26 décembre 1793) étant le point d’orgue. C’est en cette période cruelle que sont nés les passions et les rêves, les haines et les générosités des hommes et femmes auxquels le juge Pline et le commissaire Cuzet, trente ans plus tard, dans de nouvelles enquêtes difficiles et trépidantes, sont confrontés. « Et que de beaux semblants cachent des âmes basses ! » aurait pu dire Pierre Corneille."
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gildard Guillaume est avocat honoraire, écrivain et administrateur de l’Institut Napoléon. Il est l’auteur de romans, essais et articles historiques concernant la période 17801880 et plus particulièrement la Révolution, le Consulat et le Premier Empire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beaux semblants
notre catalogue complet sur
saintlegerproductions.fr
Du même auteur :
Les noces rouges, L’Harmattan, Paris, 2003.
La sentinelle de Cabrera, Fayard, Paris, 2005.
Terreur blanche, Fayard, Paris, 2006.
Qu’un sang impur…, Albin Michel, Paris, 2010.
Les damnés de la République, L’Harmattan, Paris, 2012.
La berline. Le retour de Varennes, La Bisquine, Paris, 2014.
Oser et brûler, Thaddée, Paris, 2015.
Jésus et la femme adultère, Thaddée, Paris, 2017.
Les femmes de l’Arc. Mme Roland et Joséphine, La Bisquine, Paris, 2017.
Le silence des cris, Quint’feuille, 2020.
La Gourmette. Un drame vendéen, Quint’feuille, 2020.
Reposez en guerre !, Quint’feuille, 2020.
Postes mortels, Quint’feuille, 2020.
Lie de mort, Quint’feuille, 2021.
© Quint’feuille, 2021.
Tous droits réservés.
Gildard Guillaume
Beaux semblants
Roman
Quint’feuille
À Gérard et Muguette Lièvre.
Et que de beaux semblants cachent des âmes basses !
Pierre Corneille (1606-1684),
Le Menteur (comédie en cinq actes et en vers).
La clémence est aussi une mesure révolutionnaire.
Camille Desmoulins (1760-1794),
Le Vieux Cordelier, n° 4, 20 décembre 1793.
Cependant jouissons ; l’âge nous y convie. Avant de la quitter, il faut user la vie.Le moment d’être sage est voisin du tombeau.
André Chénier (1762-1794),
Au chevalier de Pange.
Le vrai bonheur coûte peu ; s’il est cher, il n’est pas d’une bonne espèce.
François-René de Chateaubriand (1766-1848),
Mémoires d’outre-tombe.
Préambule
Les événements ont souvent des connexités, cachées ou non, et il revient aux hommes et femmes en charge de leur traitement de les mettre à jour. Peu importe que tel fait soit profondément original, nouveau, spécifique, il y a probablement entre lui et d’autres manifestations des adhérences, des relations. Peu importe évidemment que telle circonstance soit très ancienne par rapport à des situations récentes, il n’est pas exclu qu’un lien ténu les unisse.
Ce qui vaut pour les occurrences vaut également pour leurs auteurs. Des moments mettant en scène des acteurs bien contrastés ne sont pas nécessairement issus de scénarios différents.
Le juge Pline, avec le commissaire Cuzet et l’incomparable Aude, va vérifier cette vérité de la filiation entre les faits. Il lui reviendra de déceler ces connexions, de les exploiter et d’en tirer les éléments permettant à une Cour de Justice de remplir son office.
Il sera confronté à des hommes et femmes qui se dérobent, déguisent, simulent, trichent, se fardent plus ou moins outrancièrement, retardant simplement le jaillissement de la vérité.
Mais, au bout du compte, il triomphera des faux-semblants, si beaux soient-ils.
Prologue
Le 21 décembre 1793, le Comité révolutionnaire d’Angers prévient son homologue de Saumur de l’arrivée imminente de trois cents « brigands », arrêtés ici ou là rive droite de la Loire. Il insiste sur le fait qu’il ne dispose en ce qui les concerne d’aucun procès-verbal. Il ne sait pas quoi en faire : les prisons croulent sous le nombre malgré les contingents qu’on livre à la fusillade le long de la Maine ou aux Ponts-de-Cé, et la disette règne partout.
Saumur n’est pas dans une meilleure situation, malgré les prélèvements pour des évacuations vers Orléans. Il n’y a plus de place dans la Tour Grenetière, la Tour du Bourg, le château ou les grands hôtels particuliers du centre. La Commission militaire, que préside Félix, a déjà pris quelques « dispositions utiles » : le 19 décembre, dix-huit Vendéens ont été fusillés par les gendarmes du général Commaire ; le 23 décembre, ça a été le tour de soixante-dix-neuf insurgés, près de Douces, dans le Bois d’Asnières ; soixante-quinze autres ont subi le même sort le lendemain, au même endroit.
Le troupeau envoyé par Angers est enfourné dans l’église-mère, la plus ancienne des quatre églises de la ville, Notre-Dame de Nantilly. On commence par retirer du groupe les garçons qui n’ont pas atteint dix-huit ans et les filles qui n’ont pas encore fêté leur vingtième anniversaire. Le 26 décembre, les membres de la Commission militaire se rendent à cette église et font comparaître devant eux, en fin de matinée, un par un, tous les hommes plus âgés. Il ne s’agit pas de les juger – à quoi bon juger ceux qu’on considère déjà comme coupables ? - mais d’enregistrer nom, prénom, profession et commune de domiciliation. Aucun procès-verbal n’est dressé immédiatement après cet interrogatoire sommaire : il le sera en fin de journée. Tous les individus concernés, après ce « recollement », sont emmenés immédiatement, attachés deux par deux, sous escorte de trois cents gendarmes de la 35e division, d’un groupe de cavaliers de la Commission militaire, de représentants du Comité révolutionnaire et de l’état-major de Commaire. À 3 heures de l’après-midi, peut-être un peu plus tard, en passant par le pont Fouchard et le village de Bagneux, le convoi atteint un petit bois qui se trouve sur la côte de Bournan et qu’on nomme lieudit des Moulières. Des gendarmes creusent en toute hâte des tranchées. On aligne devant une première fosse un groupe de prisonniers, tandis qu’un peloton se met en place dans leur dos. Un feu roulant projette les corps dans la terre humide. On recommence l’opération pour la deuxième fosse, pour la troisième, puis on revient à la première.
Et ainsi de suite.
Le massacre dure une éternité. Mais le plus saisissant est le silence assourdissant qui tombe sur les lieux entre les tirs de peloton. Nul ne parle dans cet abattoir que noie la fumée de poudre noire. Les prisonniers qui pleurent le font sans bruit ou sans être entendus, comme s’ils craignaient de troubler le bel ordonnancement de la tragédie jouée sous le ciel gris. Les exécuteurs serrent les dents, peut-être inquiets du temps qui passe et du déclin de la lumière. L’unique son est cet ordre lancé à intervalle régulier par un sous-officier au regard vide, comme s’il fallait rythmer l’instant, le structurer : « Feu ! »
Quand le troupeau des prisonniers s’est fondu dans la glaise, offrant le spectacle d’un moutonnement de blouses ou de chemises, quelques gendarmes, en pestant, déplacent des corps qui font épi dans ce champ de morts puis, en hâte, on recouvre sommairement les dépouilles et ferme les excavations. Les représentants du Comité révolutionnaire et de la Commission militaire observent sans rien dire.
Ensuite, un procès-verbal est dressé, dont voici le texte : « Et ledit jour six nivôse de l’an II de la République une et indivisible, et le premier de la mort du tiran (sic). Nous, Joseph Roussel et Antoine Félix président et membres de la Commission militaire. Soussignés sommes transportés sur la hauteur de Bournand (sic) pour être présents à l’exécution du jugement à mort rendu ce jour contre les deux cent trente-trois dénommés ci-dessus. Laquelle exécution a eu lieu ce jour par le moyen de la fusillade sur les quatre heures de relevée. » Ce document est signé de Laporte, Roussel et Millier.
Même si ces additions et soustractions, dans le contexte qui vient d’être rappelé, peuvent apparaître incongrues, voire malsonnantes, il faut bien, ici, les présenter et commenter rapidement. Le procès-verbal ci-dessus vise deux cent trente-trois fusillés. Or, la liste annexée à ce document porte deux cent trente-six noms. Il reste cependant que deux noms sont doublés, de telle sorte que, en réalité, deux cent trente-quatre noms seulement doivent être pris en compte. De surcroît, sur cette liste, neuf noms ont été rayés dans les heures, voire les jours qui ont suivi la rédaction du procès-verbal. Les fusillés seraient donc au nombre de deux cent trente-six moins deux doublés, moins neuf, soit deux cent vingt-cinq. Le procès-verbal est nécessairement erroné.
Ceux qui ont témoigné sur cette terrible affaire après la chute de Robespierre et les événements de Thermidor, n’ont fait qu’augmenter le mystère de cette erreur. Chevallier, adjudant de la place de Saumur, parle de deux cent trente-cinq individus mis à mort, « à l’exception de deux qui s’évadèrent ». Gaudichon, commissaire à la guerre, dans un témoignage du 29 octobre 1794, indique que, le 26 décembre 1793, revenant de Saint-Florent à cheval, il a rencontré un convoi de prisonniers se dirigeant vers la butte de Bournan et qu’on l’a sollicité d’accompagner la Commission militaire. Il souligne surtout que, à cette occasion, il a vu Félix, président de ladite Commission, interroger les prisonniers les plus jeunes et renvoyer vers l’église de Nantilly, sous escorte, un jeune qui était âgé de dix-sept ans. Mais, comme Chevallier, il parle bien de deux cent trente-cinq fusillés.
Le mystère des chiffres concernant cette tragédie reste donc entier.
Faut-il considérer que les neuf noms rayés sur le procès-verbal correspondent à huit jeunes rebelles libérés dès le démarrage du convoi ou dans la première partie du parcours, le neuvième étant celui qui a été reconduit à Nantilly au vu et au su du témoin Gaudichon ?
S’agissant des deux évadés, Gaudichon ne dit rien et, finalement, seul Chevallier porte témoignage de ce fait. Pouvait-on s’évader en étant attaché deux par deux ? Pouvait-on s’évader avec une escorte aussi fournie ? Pouvait-on s’évader quand il faisait encore suffisamment jour ?
Dans les semaines qui suivent le massacre, le charnier, trop hâtivement refermé, commence à exhaler des odeurs pestilentielles. Les chiens errants se mettent à déterrer les cadavres. Les riverains se plaignent. Les autorités prennent des dispositions à base de chaux vive ou d’énormes pierres.
Le lieudit des Moulières, au-dessus du village de Munet, se fait oublier. Il est devenu le lieudit Champ-Moreau. Parce qu’un Champ-Moreau est un champ des morts. Autour de trois dépressions garnies de grosses pierres, les arbres ont poussé : ils sont le jaillissement de la vie autour d’un tombeau, ils sont les aumôniers desservant la chapelle des martyrs.
Deux cent vingt-cinq insurgés vendéens, au moins, ont été fusillés le six nivôse an II (26 décembre 1793). Mais Chevallier avait raison : deux hommes, promis au même sort, ont pu échapper au destin tragique qui était le leur. Leur nom ? Il n’est pas dans la liste annexée au procès-verbal. Leur histoire ? Elle est dans les pages qui suivent.
On peut, pour l’instant, seulement dire qu’il s’agit de deux frères et que ces deux frères vont précisément permettre au juge Pline de vérifier le principe de connexité énoncé en préambule.
Chapitre I
L’assassinat de Madame de Léverain
Le bourg du Coudray-Macouard, en 1824, surprend par ses rues bordées de hauts murs aveugles, des rues qui, tantôt tournent autour de la butte, tantôt filent à pic jusqu’à la cime. À l’extrémité du coteau dominant le Thouet et la Dive, il ouvre le regard sur Montreuil-Bellay, Loudun, Thouars. Tout au plus huit cents habitants y résident, qui font commerce lors de la foire annuelle tenue le jour de la Décollation de Saint-Jean ou lors des marchés du jeudi, cultivent la vigne, soignent à l’hôpital Saint-Jean ou, pour les nobles, chevauchent le long des ruisseaux de la Gravelle, de la Casse-Potier, de la Rabonnière ou des Fontaines des Halbrans et des Ermites. De la place forte primitive, il ne subsiste, au point culminant et à quelques mètres de l’église, qu’un haut logis orné de deux tours rondes à toit pentu, inhabité depuis qu’il a été racheté par des paysans de Chacé en pluviôse an III. Mais le site est riche en grandes demeures : la Seigneurie, le logis seigneurial du Bois, d’autres encore et, en particulier, le manoir de Philippe Jours de Léverain et de son épouse Françoise-Xavière.
Quand, ce dimanche 4 avril 1824, vers quatre heures et demie du matin, on réveille le maire, l’homme essoufflé qui vient de frapper à sa porte lui explique rapidement que, dans l’heure précédente, des cris venant de l’appartement de Madame de Léverain se sont fait entendre.
–Des cris terribles, insiste l’homme, André, qui fait partie du personnel du couple Léverain. On s’est précipité, avec Lisette. Mais les portes étaient fermées. On a frappé, mais personne ne répondait. On est allé à l’appartement de Monsieur. Il n’était pas là. On a pu rentrer dans sa chambre et ainsi rejoindre celle de Madame. Elle était… Elle était étendue sur un petit fauteuil. Elle avait… Elle avait la gorge ouverte. Il y avait du sang partout. Elle avait le cou et la poitrine littéralement hachés. Il y avait du sang par terre, du sang sur les meubles, du sang sur les murs. Du sang partout.
–Monsieur Philippe de Léverain n’était pas chez lui ?
–Non, Monsieur, je crois, est à Saumur.
–Laisse-moi m’habiller. Je te rejoins au manoir de Monsieur de Léverain.
Chapitre II
Drain et l’insurrection vendéenne
Le pays de Drain, ancienne baronnie de Champtoceaux, en rive gauche de Loire, face à Ancenis, a longtemps été couvert de landes et de bois propices aux attaques des loups. Selon ce que révèlent les registres paroissiaux, ce fut aussi dans le passé un univers de crimes. Pour ne citer que les plus effroyables, il y a eu l’occupation violente des Huguenots, qui ont saccagé l’église, les pillages et viols des troupes royales au XVIIe siècle, les épidémies. La misère y a été également toujours prégnante.
En 1787, dans l’ancienne cure transformée en auberge, les hommes, après le labeur du jour, aiment à se raconter les histoires tragiques de ces époques heureusement révolues. Particularité : on peut voir à l’époque, au premier étage de cette auberge, sur la cheminée, un trumeau en pierre représentant la chute d’Adam et d’Ève, qui serait l’œuvre d’un ancien prêtre de la paroisse.
À Drain, il n’y a ni foire, ni marché, mais le commerce des vins y est actif. D’ailleurs, les tonneliers sont nombreux. La pêche y tient aussi une place importante.
Installée dans cette commune depuis quatre générations, la famille Géreau y exploite des terres au sud des boires de la Rompure et de la Basse-Pierre. Sa ferme est plantée près de la boire des Grelliers, à la naissance d’un ruisseau. Elle survit plus qu’elle ne vit.
À la fin de l’année 1787, Louise Géreau s’éteint. Le mal qui rongeait ses poumons a eu raison de cette femme courageuse. Elle laisse un veuf désemparé, Robert, un laboureur né en 1749, et ses deux fils, Mathurin, quatorze ans, et Baptiste, treize ans.
En cette même année, le printemps et l’été ont été extraordinairement secs, si secs qu’on n’a pas du tout ramassé de foin et que le fourrage s’est vendu à un prix exorbitant.
L’année suivante, la terre ne donne pas de blé et, à partir du mois de novembre, la température entame une baisse sensible : dès la fin de ce mois, la Loire se met à charrier de gros blocs de glace et, à la veille de l’année nouvelle, le thermomètre indique une température de 18° au-dessous de 0. Il faut attendre la fin de janvier 1789 pour que les choses s’améliorent. Entretemps, le gel du fleuve royal et de ses affluents a emporté ponts et chaussées, inondé des fermes, détruit les cultures, noyé les bêtes, créé la famine, tué des enfants.
Ces catastrophes climatiques ont désespéré maints laboureurs et vignerons. Robert Géreau et ses fils y ont trouvé le gisement d’une énergie nouvelle, comme si la neige, la glace et le verglas, après la disparition tragique de Louise, nourrissaient leur force. Robert a tenu à participer aux réunions présidant à la rédaction du cahier de doléances de la paroisse, avec d’autres paysans, mais aussi un charpentier, un boucher, un cordonnier, deux mariniers, un tonnelier, etc… Puisque le roi souhaitait des états généraux permettant aux hommes inscrits sur le rôle des impositions d’exprimer leurs souhaits, Robert, mû par un très grand espoir, voulait faire entendre sa voix. C’est ainsi que le cahier de doléances, tout en rappelant l’attachement profond à la monarchie, remettait en cause l’excessive centralisation, la pesanteur de la société féodale, les inégalités et le défaut de rationalité des privilèges, le poids désespérant de la fiscalité.
Pour Robert Géreau, approuvé en cela par ses fils, les premières décisions révolutionnaires sont totalement satisfaisantes. « Elles vont dans le bon sens », aime-t-il à dire. Cependant, les violences qui éclatent ici ou là ne manquent pas d’inquiéter ce paysan et ses fils et, dès 1790, il suit avec attention l’évolution des débats à l’Assemblée, avec évidemment le retard de communication et les déformations qu’on peut imaginer. S’ils accueillent de manière relativement positive la vente de certains biens du clergé, ils déplorent que les acquéreurs soient les habitants les plus fortunés de la commune, en tout cas ceux qui disposent de liquidités. La Constitution civile du clergé les plonge dans la consternation, même s’ils ne sont pas d’une foi éprouvée : comme le dit le curé, devenu fonctionnaire par la volonté de l’Assemblée, cette Constitution touche à la foi elle-même. Le nouveau pouvoir souhaite-t-il faire disparaître la religion, comme il a aboli les vœux religieux en février ? Les prêtres contestataires ont bien raison, qui dénoncent cette volonté suspecte de placer la France en rébellion avec la papauté et soumettre l’autorité religieuse à l’autorité civile.
Mais vient le 27 novembre 1790 et l’institution d’un serment solennel par lequel tous les fonctionnaires ecclésiastiques doivent, sous peine d’être déchus de leur statut et écartés de leur apostolat, reconnaître la nouvelle constitution de l’église. L’évêque de Nantes, dès le mois de janvier 1791, donne des instructions claires aux prêtres : il faut s’abstenir de prêter serment mais demeurer dans les cures. Il est approuvé par le pape Pie VI au mois de mars, un pape qui parlera d’une constitution civile « hérétique et schismatique ».
Désormais, il y a deux sortes de prêtres : ceux qui ont prêté serment, les assermentés ou « intrus », et ceux qui s’y sont refusés, les insermentés ou réfractaires.
Après les mises en demeure de choisir, les représailles contre le clergé insermenté interviennent rapidement. Les prêtres réfractaires se cachent dans les forêts ou chez des paroissiens sûrs.
« Mais où est donc la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » s’interroge Robert Géreau. Lui ne développe pas des raisonnements philosophiques, il exprime simplement, dans son évidence, le contraste saisissant entre les conquêtes révolutionnaires et la haine de la religion.
En juin 1791, Louis XVI, avec sa famille, tente de fuir Paris, où il est en réalité un prisonnier. Rattrapé à Varennes, il fait un retour piteux vers les Tuileries. Ce château est investi le 10 août 1792 par les sans-culottes : c’est l’événement marquant la déchéance du roi. L’abolition de la monarchie est proclamée le 21 septembre 1792, début de l’an I de la République. Le mois de septembre a commencé par des massacres ignobles dans les prisons de Paris. Ces événements, nés et commentés principalement dans la capitale, ne sont connus en province lointaine qu’avec retard et largement dénaturés. Entretemps, des circulaires sont multipliées pour rendre la vie impossible aux prêtres insermentés, qualifiés de prêtres fanatiques et dont on dit que l’existence compromet partout le bon ordre et la tranquillité publique. Les autorités leur donnent la chasse. On imagine les angoisses de ces ecclésiastiques qui doivent en même temps vivre dans la clandestinité et continuer d’assurer leur fonction curiale, tandis que s’amplifie la délation encouragée, voire récompensée. Robert et ses fils, sensibles et compatissants au drame que ces hommes vivent, non seulement participent à quelques cérémonies associant des prêtres insermentés, mais encore, dans la mesure de leurs moyens, les aident en les approvisionnant ou en assurant leur sécurité.
L’étape suivante était prévisible : la gendarmerie est mobilisée dès le mois de janvier 1793 pour rechercher et arrêter les prêtres réfractaires, et le mandat est d’autant plus intéressant pour la maréchaussée qu’il est rémunéré par des primes.
C’est dans ce contexte délétère qu’intervient le texte décrétant l’enrôlement dans l’armée de tous les hommes jeunes, pour faire front à l’Europe coalisée dans les territoires de l’est et du nord-est, une décision qu’on appelle traditionnellement la « levée de 300 000 hommes ». Chaque commune est invitée de la manière la plus ferme, par la Convention nationale, à dresser la liste des conscrits. Dans toutes les communes, c’est une levée en masse mais pas celle que le gouvernement espérait : armés de ce qu’ils ont pu trouver, les hommes concernés bousculent les commissaires, saccagent les bureaux municipaux, organisent des marches. Ils hurlent que la terre a besoin de leurs bras après les mauvaises récoltes. Ils réclament le retour des « bons prêtres », l’exil des « intrus », et, quand l’exécution du roi, guillotiné le 21 janvier 1793, leur est connue, menacent tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin en clamant qu’ils ne sauraient servir un gouvernement qui a tué Louis XVI. Robert Géreau, toujours lucide, fait remarquer que la résistance à l’oppression fait partie des droits proclamés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et que, par conséquent, ses fils ont raison de refuser leur envoi au front. Les recruteurs s’enfuient. Les camps sont désormais bien définis : il y a les fidèles de la République, d’un côté, les fidèles de la Foi et de la Monarchie, de l’autre. On chasse les curés constitutionnels, ces fameux intrus. On attaque les gardes nationaux, exécutants d’un mandat honteux. On prend d’assaut les bâtiments que l’on soupçonne d’abriter des républicains. Des drapeaux sont déchirés, qui rappellent le régime honni de Paris. On allume des incendies.
C’est à poings nus que l’on frappe d’abord, mais on s’arme vite de piques, de faux retournées et de fusils. Au départ, on bouscule, on enferme, on emprisonne. Rapidement, le premier blessé grave hurle, bientôt suivi du râle d’un homme qui meurt. Et, en quelques jours, au sud de la Loire, entre Machecoul et Argenton-Château, Saint-Florent-le-Vieil et Chantonnay, les morts s’accumulent sur les marches de la mairie, sur le parvis de l’église, dans la poussière de la place du marché.
Robert, Mathurin et Baptiste Géreau, au nom de la liberté de conscience, au nom de ce qu’ils considèrent comme leurs droits les plus élémentaires, furieux que la Révolution leur ait donné tant d’espoirs et débouche finalement sur une oppression criminelle, sont de l’insoumission.
Chaque heure qui passe et chaque jour qui s’éteint livrent leur lot de violences. Quand ils ne sont pas sévèrement malmenés, voire tués, les conseillers municipaux et les notables n’ont qu’une issue, la fuite.
Il faut admettre que des hommes jeunes ont répondu à l’appel de la conscription. On en compte un sur trois à peu près. Quand ils rencontrent ceux qui ont refusé, ils s’injurient, se battent, s’entretuent. Mathurin et Baptiste ne peuvent plus croiser certains de leurs amis sans incident.
À l’intérieur des familles, les conflits sont légion : les insurgés insultent les républicains et les républicains invectivent les contre-révolutionnaires, quand ils n’en viennent pas aux mains.
Le gouvernement girondin vante le courage de ceux qui se sont battus ou continuent de se battre contre l’ennemi. Il dénonce la « faiblesse » qui retient dans leurs foyers tous les citoyens en âge de se battre, en soulignant que, plus l’effort sera prompt, plus la victoire sera aisée. Il rappelle aux laboureurs que l’on peut acheter des remplaçants quand le tirage au sort s’est révélé néfaste. Robert et ses fils ne veulent pas emprunter cette voie.
C’est désormais la guerre. La guerre civile. La guerre dite de Vendée, qui oppose les Vendéens, les royalistes, les Blancs, les « brigands » ou l’Armée catholique, d’une part, aux républicains, aux Bleus ou aux « patauds », d’autre part. La guerre qui emporte dans un ouragan fatal quatre départements de France, la Vendée, qui lui donne son nom, les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire et la Loire-Inférieure, ce périmètre étant admis si l’on s’en tient aux opérations conduites au sud de la Loire.
Mathurin et Baptiste s’engagent dans une petite troupe commandée par un ancien officier de carrière, Lyrot de La Patouillère, originaire de Basse-Goulaine. Les fils Géreau sont désormais de solides gaillards de vingt et dix-neuf ans. L’aîné est très grand, impressionnant même. Quand il ne sourit pas, on remarque, sous une chevelure châtain abondante, des yeux d’un brun profond mais surtout des traits forts, découpés à la serpe. Baptiste est plus fin, plus petit aussi, mais très musclé. Ses cheveux couleur de paille bouclent largement. Il a un charme tout particulier. Il parle d’une voix très posée quand son frère bouscule un peu les mots.
Avec La Patouillère, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, et d’autres, les frères Géreau, jusqu’à la fin du printemps 1793, multiplient les coups de main. Ayant chassé avec leur père dès le plus jeune âge, ils maîtrisent parfaitement le fusil et les techniques de l’affût.
Leur père est demeuré sur l’exploitation, dont il faut impérativement s’occuper. À Drain. Seul.
Chapitre 3
Début d’enquête dans l’affaire Léverain
Le maire du Coudray-Macouard, assis devant la porte de la chambre de Françoise-Xavière de Léverain, a attendu pendant trois heures l’arrivée des forces de l’ordre, représentées par le chef de la police de Saumur. Il n’était pas question pour lui de laisser qui que ce soit brouiller les indices. Il a quand même pu vérifier, à son arrivée au manoir, l’extrême sauvagerie de l’assassinat : André, le domestique, avait parfaitement raison de décrire une scène d’apocalypse.
Le lecteur connaît bien Sébastien Cuzet, actif et sympathique commissaire de police de Saumur, un homme de trente-sept ans qui associe fermeté, technicité et persévérance1.
Prenant les choses en main, Cuzet, en présence de deux lieutenants, entend rapidement et séparément tous les domestiques. André confirme ce qu’il a déclaré au maire. Lisette, la femme de chambre, corrobore ce que dit André. Georges, l’homme à tout faire et palefrenier, crée la surprise lorsqu’il précise en outre que, au moment du drame, ne parvenant pas à dormir, il a aperçu une silhouette, celle d’un homme qui fuyait rapidement vers un bosquet en limite du domaine et qui, éclairé par la lune, ressemblait à s’y méprendre à son maître.
–Vous étiez où à ce moment-là ? interroge le commissaire.
–Dans ma chambre, qui est au-dessus des écuries. J’ai été réveillé comme André et Lisette par les cris et je me suis précipité à la fenêtre. C’est là que j’ai vu…
–Que vous avez vu ?
–Que j’ai vu Monsieur.
–Vous êtes sûr de vous ?
–Absolument.
–Pourquoi Monsieur de Léverain aurait-il assassiné sa femme ?
–Cela n’allait pas bien entre eux. Depuis plusieurs mois. Il y avait souvent des scènes, des scènes très violentes.
–Vous voulez dire que Monsieur de Léverain frappait sa femme ?
–Absolument.
–Et quel était le motif en général de ces scènes ?
–La plupart du temps, c’était Mademoiselle Adèle. Adèle Musseau. C’était la gouvernante des enfants. Madame était jalouse…
Cuzet, à la suite, reprend l’audition d’André et Lisette : ils n’ont pas vu leur maître durant la nuit ; il est exact que le ménage Léverain n’allait pas très fort.
Entendu à son tour, le maire résume pour Cuzet l’histoire du couple, une histoire qu’il connaît bien pour en avoir partagé de nombreux moments :
–Philippe Jours de Léverain a épousé Françoise-Xavière en 1815, un peu après la défaite de Waterloo, raconte le maire. Cinq enfants sont nés mais, après le décès accidentel du dernier, le couple, apparemment heureux, a connu un certain refroidissement. Dans la foulée, Adèle Musseau a été engagée comme institutrice. Elle avait vingt-deux ans, venait de Tours, était jolie et souriante, jouissait déjà d’une solide culture. Sans rien forcer, Adèle Musseau a pris rapidement une place essentielle dans cette famille. Monsieur de Léverain ne faisait rien qui ne fût préalablement approuvé par cette institutrice. Les enfants se comportaient comme si elle avait été leur mère. Elle donnait des ordres aux domestiques et les domestiques voyaient en elle la véritable maîtresse. Françoise-Xavière de Léverain a vite éprouvé un angoissant sentiment de solitude et d’abandon, d’autant plus que son mari n’avait plus pour elle la moindre attention. Adèle Musseau régnait sans partage sur une famille dont Françoise-Xavière était exclue.
–Comment savez-vous tout cela ?
–Madame de Léverain se confiait volontiers à moi. On se connaît depuis longtemps…
–Continuez…
–Les choses se sont encore aggravées lorsque Monsieur de Léverain s’est comporté comme si sa femme n’existait pas : il déjeunait, dînait et soupait avec Adèle Musseau, il partageait toutes les promenades de celle-ci, il partait avec elle en voyage. Françoise-Xavière restait confinée dans sa chambre, pleurant ou hurlant sa douleur. Elle tentait bien de temps en temps de ramener son mari à la raison, de lui faire prendre conscience, mais ses démarches s’avéraient vaines et ne débouchaient que sur des scènes violentes.
Le maire boit un peu d’eau, se mouche puis reprend son exposé.
–L’oncle paternel de Françoise-Xavière, vieux soldat de l’Empire, a décidé d’intervenir et a pu convaincre Monsieur de Léverain de se séparer de l’institutrice moyennant une substantielle indemnité. La transaction a été passée et Adèle Musseau s’est retirée à Thouars, dans une pension de famille. Toutefois, cette séparation n’a rien changé aux relations de Monsieur de Léverain avec son épouse : Philippe et Adèle ont remplacé les moments partagés par un échange nourri de courriers. Quand la correspondance n’a plus été suffisante pour apaiser les tourments des auteurs, Monsieur de Léverain a été de plus en plus absent du manoir, passant des moments intenses dans quelque hôtel ou auberge de Saumur et plus largement du Saumurois.
–Où sont les enfants ?
–À Angers, chez une sœur de Madame de Léverain.
–Depuis longtemps ?
–Deux ou trois semaines, d’après ce que je sais.
Cuzet vient à peine de terminer l’audition du maire que surgit Philippe de Léverain. C’est un homme assez massif, très brun de cheveu et de peau, qui porte en avant une bouche aux lèvres épaisses. Déjà averti du drame, et demeurant sourd aux commandements policiers, il se rue sur la porte de la chambre où le corps de sa femme est encore étendu. Cuzet l’arrête brutalement.
–Je crois préférable que vous restiez là pour l’instant, dit-il froidement. Vous la verrez plus tard, quand on aura fait disparaître toutes les traces de sang qui maculent son corps et son visage.
Philippe de Léverain n’insiste pas. Il reste simplement agité (un tic déforme sa paupière gauche) et tendu. Cuzet l’invite à se rendre à la salle de billard.
–Où étiez-vous cette nuit ? questionne-t-il quand ils sont assis.
–À Saumur.
–Seul ?
Hésitation.
–Je vous prie, Monsieur, de répondre très clairement à toutes mes questions, intime Cuzet. Étiez-vous seul cette nuit ?
–Non.
–Avec qui étiez-vous ?
–Avec Mademoiselle Adèle Musseau.
–Où ?
–À l’Hôtel de la Montée du Fort.
–En dehors de Mademoiselle Musseau, qui peut en témoigner ?
–Personne.
–Un témoin vous a reconnu quittant ce manoir vers quatre heures du matin.
–