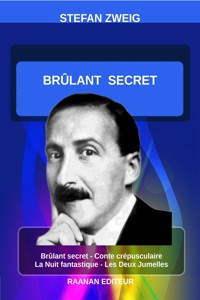
1,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Brûlant secret est un récit historique de Stefan Zweig publié pour la première fois à Vienne (Autriche) en 1938. Conte crépusculaire - La Nuit fantastique - Les Deux Jumelles - Nouvelles - Contes Comment le désir et la passion, enracinés au fond de chaque être, peuvent le révéler à lui-même et bouleverser son destin. Brûlant Secret: Un homme et une femme vivent une idylle contrariée par la jalousie du fils de cette dernière. Conte crépusculaire: Un adolescent vit une histoire d’amour surprenante dans un château écossais. La Nuit fantastique: Un dandy orgueilleux, retranché dans la dignité et la froideur du mondain se frotte à la vie et se découvre. Les Deux Jumelles (conte drolatique): La rivalité de deux soeurs, l’une religieuse et l’autre courtisane.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table of Contents
BRÛLANT SECRET
Le partenaire
Une amitié rapide
Trio
L’attaque
Les éléphants
Escarmouches
Brûlant secret
Silence
Les menteurs
Traces au clair de lune
L’embuscade
Orage
Début de raison
Obscurité troublante
CONTE CRÉPUSCULAIRE
LA NUIT FANTASTIQUE
LES DEUX JUMELLES
Conte drolatique
Notes
Série :Stefan Zweig
|9| BRÛLANT SECRET
STEFAN ZWEIG
BRÛLANT SECRET
RECUEIL DE QUATRE NOUVELLES
Paris, 1911
Traducteur Alzir Hella
Raanan Éditeur
Livre 1261 | édition 1
raananediteur.com
LISTE DES NOUVELLES
BRÛLANT SECRET
Le partenaire
Une amitié rapide
Trio
L’attaque
Les éléphants
Escarmouches
Brûlant secret
Silence
Les menteurs
Traces au clair de lune
L’embuscade
Orage
Début de raison
Obscurité troublante
CONTE CRÉPUSCULAIRE
LA NUIT FANTASTIQUE
LES DEUX JUMELLES
BRÛLANT SECRET
Le partenaire
La locomotive fit entendre un rauque sifflement : on était arrivé au Semmering. Pendant une minute les noirs wagons stationnèrent sous la lumière faiblement argentée du ciel ; ils rejetèrent un mélange de personnes et en avalèrent d’autres ; des voix nerveuses résonnèrent çà et là, puis la machine siffla de nouveau et entraîna bruyamment la chaîne sombre des wagons dans la gueule du tunnel. Et la paix régna de nouveau sur le vaste paysage aux clairs arrière-plans balayés par le vent humide.
L’un des arrivants, un jeune homme, qui attirait la sympathie et l’attention par son costume de bon goût et par l’élasticité naturelle de sa marche, prit vite, avant tous les autres, un fiacre pour le conduire à l’hôtel. Les chevaux gravirent sans hâte le chemin montant. Il y avait du printemps dans l’air. Dans le ciel flottaient de blancs et turbulents nuages comme on n’en voit qu’en mai et juin –, ces compagnons toujours jeunes et volages, qui courent en jouant sur la piste bleue pour se cacher soudain derrière de hautes montagnes, qui s’embrassent et ensuite se fuient, qui tantôt se chiffonnent comme des mouchoirs et tantôt s’effilochent en bandeaux et qui, finalement, comme pour leur faire une niche, mettent sur la tête des monts de blancs bonnets. Il y avait aussi de l’agitation là-haut dans le vent, qui secouait si violemment les maigres arbres encore tout mouillés par la pluie, que leurs articulations craquaient doucement et que mille gouttelettes en jaillissaient, comme des étincelles. Parfois aussi le parfum de la neige semblait apporter sa fraîcheur du haut des montagnes ; alors on sentait dans sa respiration quelque chose qui était à la fois doux et piquant. Tout dans l’air et sur la terre était mouvement, bouillonnement et impatience. Maintenant qu’ils dévalaient la pente du chemin, les chevaux couraient en soufflant légèrement et le tintement de leurs grelots s’entendait de très loin.
À l’hôtel, la première chose que fit le jeune homme fut de consulter la liste des hôtes, qu’il parcourut, bientôt déçu. « Pourquoi donc suis-je ici ? » se demanda-t-il tout d’abord avec inquiétude. « Être seul, dans la montagne, sans société, c’est pire que le bureau. Il est clair que je suis arrivé trop tôt, ou trop tard. Je n’ai jamais de chance avec mes vacances. Pas un seul nom connu parmi tous ces gens-là. Si, du moins, il y avait quelques femmes, la possibilité d’un petit flirt – à la rigueur même innocent – pour ne pas passer cette semaine trop tristement. » Le jeune homme, un baron de cette noblesse autrichienne de peu d’éclat issue de la bureaucratie, était employé de ministère. Il avait pris ce petit congé sans aucun besoin, simplement parce que tous ses collègues avaient obtenu en cette saison printanière une semaine de vacances et qu’il ne voulait pas faire cadeau de la sienne à l’administration. Quoique ne manquant pas d’une certaine personnalité, il était d’une nature essentiellement mondaine, recherché pour cela, et bien vu dans tous les milieux. Il avait pleinement conscience de son incapacité à supporter la solitude, à rester seul en face de lui-même, et il évitait autant que possible ces moments-là parce qu’il ne voulait pas du tout faire plus intimement connaissance avec son moi. Il savait qu’il avait besoin du contact des hommes pour faire briller tous ses talents, pour animer la chaleur et la pétulance de son cœur, et que, laissé à lui seul, il était sans valeur et froid comme une allumette dans sa boîte.
Mécontent, il se mit à aller et venir dans le hall vide, tantôt feuilletant les journaux avec indécision, tantôt entamant une valse sur le piano du salon sans que ses doigts pussent en trouver le rythme parfait. Enfin, il s’assit dans un coin, de mauvaise humeur, regardant l’obscurité tomber lentement et le brouillard sortir des pins sous forme de vapeurs grises. Il émietta ainsi une heure sans aucun agrément et dominé par ses nerfs. Puis il se réfugia dans la salle à manger.
Il n’y avait d’abord que quelques tables d’occupées et il en fit le tour d’un regard rapide. Vainement. Il ne connaissait personne sauf, là-bas (et il rendit négligemment un salut), un entraîneur qu’il avait connu aux courses, puis, ailleurs, un visage qu’il avait croisé sur le Ring… c’est tout. Pas une femme qui lui permît d’espérer ne fût-ce qu’une fugitive aventure. Son humeur devint plus impatiente. C’était un de ces hommes qui doivent beaucoup de bonnes fortunes à leur joli visage et chez qui, à chaque moment, tout est prêt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle expérience amoureuse ; un de ces jeunes hommes qui sont toujours au potentiel voulu pour se précipiter dans l’inconnu d’une aventure, que rien ne surprend, parce que, sans cesse à l’affût, ils ont tout calculé ; qui ne manquent aucune occasion galante parce que leur premier regard pénètre, inquisiteur, dans la sensualité charnelle de chaque femme, sans faire de différence entre l’épouse de leur ami et la servante qui leur ouvre la porte. Lorsque, avec un certain dédain superficiel, on appelle ces gens-là des « chasseurs de femmes », c’est sans savoir combien de vérité positive incarne ce mot, car, effectivement, tous les instincts passionnés de la chasse, le flair, l’excitation et la cruauté mentale, s’agitent dans l’attitude de ces hommes. Ils sont sans cesse aux aguets, toujours prêts, et résolus à suivre jusqu’au bord de l’abîme la moindre piste d’aventure. Ils sont toujours chargés de passion, non pas de la passion, estimable, de l’amant, mais de celle du joueur, froide, calculatrice et périlleuse. Il y en a parmi eux d’une ténacité extraordinaire dont, même au-delà de leur jeunesse, toute l’existence se passe dans l’attente de l’éternelle aventure ; pour qui la journée se divise en cent petits événements sensuels (un coup d’œil en passant, un sourire glissé en coulisse, un genou effleuré quand on est assis en face l’un de l’autre) et l’année, à son tour, en une centaine de ces jours-là ; pour qui, enfin, l’événement sensuel est la source éternellement jaillissante, nourricière, et brûlante de la vie.
Ici il n’y avait pas de femme, pas de partenaire. Et il n’est pas d’irritation plus vive que celle du joueur, assis les cartes à la main devant le tapis vert, conscient de sa supériorité, et qui attend en vain un partenaire. Le baron demanda un journal et laissa couler ses regards maussades sur les lignes imprimées ; mais ses pensées étaient paralysées et trébuchaient contre les mots comme un homme ivre.
Soudain il entendit derrière lui le frou-frou d’une robe et une voix légèrement irritée qui disait avec un accent affecté : « Mais tais-toi donc, Edgar|1|. »
Une robe de soie crissa en passant contre sa table ; il vit une silhouette de femme, grande et bien en chair, avec derrière elle, vêtu d’un costume de velours noir, un petit garçon pâle, dont le regard l’effleura avec curiosité. Tous deux s’assirent en face l’un de l’autre, à la table réservée, l’enfant s’efforçant visiblement d’observer une correction qui paraissait en contradiction avec l’agitation de ses yeux noirs. La dame (le jeune baron ne faisait attention qu’à elle) était très soignée, et mise avec une élégance recherchée. En outre elle avait un type qu’il aimait beaucoup : c’était une de ces juives un peu grasses, à la veille de dépasser la maturité, manifestement passionnée, elle aussi, mais habile à cacher son tempérament derrière une mélancolie distinguée. Il ne put tout d’abord voir ses yeux, mais il admira la ligne bien formée des sourcils, s’arrondissant avec pureté au-dessus d’un nez délicat, qui, à vrai dire, trahissait la race, mais qui par sa noblesse rendait le profil de cette femme net et intéressant. Ses cheveux, comme tout ce qu’il y avait de féminin dans ce corps épanoui, étaient d’une luxuriance remarquable, et sa beauté, dans la fière conscience qu’elle avait d’être très admirée, paraissait rassasiée et orgueilleuse. Elle commanda le repas d’une voix très basse, rappela encore à l’ordre le gamin qui faisait du bruit en jouant avec sa fourchette, tout cela avec une apparente indifférence devant le regard glissant et prudent du baron, dont elle avait l’air de ne pas remarquer la présence, tandis qu’en réalité c’était la vigilance active de celui-ci qui lui imposait cette réserve soucieuse.
La figure assombrie du baron s’était tout à coup éclairée ; dans leur vie souterraine les nerfs se mirent à l’animer, firent disparaître les plis, tonifièrent les muscles, si bien que sa taille se redressa et que la lumière brilla dans ses yeux. Il n’était pas lui-même sans ressembler à ces femmes qui ont besoin de la présence d’un homme pour tirer de leur être tout leur pouvoir. Il lui fallait un excitant sensuel pour déployer toute la puissance de son énergie. Le chasseur flaira une proie. D’un air provocant son œil chercha à rencontrer le regard de la femme, ce regard qui, parfois, croisait le sien dans un coup d’œil luisant et indécis, mais qui ne lui donnait jamais une réponse claire. Autour de la bouche, il croyait découvrir par instants comme la détente d’un sourire qui commence, mais tout cela était incertain et c’est cette incertitude qui l’excitait. La seule chose qui lui parût prometteuse était cette façon continuelle dont la femme dirigeait son regard à côté de lui, parce que c’était à la fois de la résistance et de la gêne – et aussi la nature étudiée de la conversation qu’elle avait avec l’enfant, conversation qui sans nul doute était destinée à être entendue. Même la réserve forcée de cette attitude tranquille indiquait, il le sentait, un commencement d’inquiétude. Lui aussi était excité : la partie allait s’engager. Il ralentit savamment son dîner ; pendant une demi-heure, presque sans arrêt, il tint son regard fixé sur cette femme jusqu’à ce qu’il eût dessiné pour ainsi dire, dans son esprit, chaque ligne de son visage et qu’il eût touché secrètement chaque partie de son corps épanoui. Au-dehors l’obscurité tombait lourdement ; les arbres soupiraient avec une peur enfantine lorsque les grands nuages pluvieux se mettaient à étendre vers eux leurs mains grises ; les ombres envahissaient de plus en plus la salle et les hommes semblaient de plus en plus oppressés par le silence. La conversation de la mère avec son enfant, il le remarqua, devenait toujours plus affectée, plus artificielle, sous le poids de ce silence menaçant. Bientôt, il le sentait, elle allait toucher à sa fin. Alors il résolut de faire un essai. Il se leva le premier et se dirigea à petits pas vers la porte, en jetant, au moment où il passait près d’elle, un long regard sur le paysage. Puis, brusquement, comme s’il avait oublié quelque chose, sa tête se retourna, et il s’aperçut qu’elle le regardait avec des yeux pleins de vivacité.
Cela l’excita. Il attendit dans le hall. Elle vint bientôt après, tenant son enfant par la main ; elle feuilleta les revues en passant et montra au petit quelques images. Mais lorsque le baron alla négligemment vers la table, comme pour prendre une revue, mais en réalité pour pénétrer d’une façon plus profonde dans la lueur humide de ses yeux et peut-être même pour engager une conversation, elle se détourna, frappa légèrement sur l’épaule de son fils, en lui disant : « Viens, Edgar, au lit|2| ! » Puis elle passa froidement. Un peu déçu, le baron la regarda partir. Il avait compté que ce soir même il ferait sa connaissance, et cette manière brusque de s’en aller était pour lui une désillusion. Mais, somme toute, il y avait du charme dans cette résistance, et l’incertitude dans laquelle il se trouvait enflammait son désir. Enfin, il avait trouvé son partenaire et la partie pouvait s’engager.
Une amitié rapide
Le lendemain, lorsque le baron entra dans le hall, il y vit l’enfant de la belle inconnue en conversation animée avec les deux liftiers, à qui il montrait les images d’un livre de Karl May. Sa maman n’était pas là ; sans doute était-elle encore occupée à sa toilette. Ce n’est qu’alors que le baron examina le gamin. C’était un enfant timide, nerveux et peu développé, d’une douzaine d’années, avec des mouvements indolents et des yeux sombres et fureteurs. Comme beaucoup de gosses de cet âge, il donnait l’impression de quelqu’un que l’on a effrayé, comme s’il venait d’être soudain arraché au sommeil et placé, sans transition, dans un entourage étranger. Son visage, non sans beauté, n’était pas encore formé ; la lutte du caractère masculin avec le caractère enfantin paraissait n’être qu’à son début ; tout chez lui n’était encore que comme une pâte que l’on pétrit, sans aucune forme bien nette, sans aucune ligne bien accusée. En outre, il était précisément à cet âge ingrat où les enfants n’ont jamais des vêtements qui leur vont bien, où les manches et les culottes flottent mollement autour des maigres articulations et où d’ailleurs aucune vanité ne les porte à surveiller leur extérieur.
L’enfant produisait là, par sa façon de rôder partout sans savoir que faire, une impression pénible. À vrai dire, il gênait tout le monde, tantôt le portier qu’il paraissait importuner par ses questions et qui l’écartait ; tantôt les gens qu’il embarrassait à l’entrée de l’hôtel ; visiblement il lui manquait la fréquentation d’un ami. C’est pourquoi, dans son besoin enfantin de bavarder, il cherchait à se rapprocher des domestiques, qui, lorsqu’ils avaient le temps, lui répondaient, mais qui brisaient aussitôt la conversation dès qu’apparaissait une grande personne ou qu’ils avaient quelque chose de plus urgent à faire. Le baron observait en souriant et avec intérêt le malheureux gamin dont la curiosité s’attachait à tout et devant qui tout se dérobait inamicalement. À un certain moment, il capta un de ses regards de curiosité, mais les yeux noirs rentrèrent peureusement dans leur retraite dès qu’ils se sentirent pris en flagrant délit de vagabondage et se dissimulèrent sous les paupières baissées. La chose amusa le baron. Le gamin commença à l’intéresser et il se demanda si cet enfant, qui, à coup sûr, n’était rendu si timide que par la crainte, ne pourrait pas être un rapide intermédiaire entre lui et l’inconnue. Toujours est-il qu’il allait essayer. Sans en avoir l’air, il suivit le gamin qui venait de s’élancer vers la porte et qui, dans sa soif enfantine de tendresse, se mit à caresser les naseaux roses d’un cheval blanc – jusqu’au moment (véritablement, il n’avait pas de chance !) où, ici encore, le cocher l’écarta assez rudement. Froissé et ennuyé, il s’était remis à badauder çà et là, les yeux vides et un peu tristes. Alors le baron s’approcha de lui.
– Eh bien, jeune homme, te plais-tu ici ? fit-il soudain en s’efforçant de donner à son apostrophe un ton aussi jovial que possible.
L’enfant devint rouge comme le feu et le regarda fixement avec inquiétude. Puis, d’un air craintif, il rapprocha ses mains de son corps et dans sa gêne il tourna la tête à droite et à gauche. C’était la première fois qu’un inconnu engageait avec lui une conversation.
– Oui, je vous remercie.
Ce fut tout ce qu’il eut la force de balbutier. Et encore le dernier mot eut-il de la peine à sortir de sa bouche.
– Cela m’étonne », dit le baron en riant ; « c’est pourtant un endroit assez morne, surtout pour un petit homme comme toi. Que fais-tu donc toute la journée ? » Le gamin était encore trop troublé pour trouver immédiatement une réponse. Était-il possible vraiment que cet élégant monsieur qu’il ne connaissait pas, désirât s’entretenir avec lui dont personne ne s’occupait ? Cette pensée le rendait à la fois timide et fier. Il se ressaisit péniblement :
– Je lis, et puis souvent nous allons nous promener. Parfois nous sortons aussi en voiture, Maman et moi. Je suis ici pour reprendre des forces, j’ai été malade. Le médecin a dit qu’il me fallait rester longtemps assis au soleil.
Ces derniers mots furent dits déjà avec assez d’assurance. Les enfants sont toujours fiers d’une maladie, parce qu’ils savent que le danger les rend deux fois plus importants aux yeux de leurs parents.
– Oui, le soleil est une bonne chose ; il te brunira vite. Mais il ne faudrait pas que tu restes assis toute la journée. Un garçon comme toi devrait courir, être plein d’animation et faire aussi quelques bêtises. Il me semble que tu es trop sage ; tu as l’air d’une momie avec ton grand et gros livre sous le bras. Quand je pense au gibier de potence que j’étais à ton âge ! Chaque soir je rentrais les culottes déchirées. Il ne faut pas être trop sage.
Malgré lui, l’enfant fut obligé de sourire et cela lui ôta toute crainte. Il aurait aimé répondre quelque chose, mais c’eût été selon lui faire montre d’impolitesse, de trop de hardiesse devant ce beau monsieur inconnu, qui lui parlait d’un ton si amical. Jamais il n’avait été exubérant et il était vite embarrassé ; aussi, maintenant, le bonheur et la honte le remplissaient d’un trouble extrême. Il aurait tant aimé continuer l’entretien, mais il ne trouvait rien à dire. Heureusement que le grand chien fauve de l’hôtel, un saint-bernard, vint à passer ; il les flaira tous les deux et se laissa gentiment caresser.
– Aimes-tu les chiens ? demanda le baron.
– Oh ! oui, beaucoup ; Bonne-Maman en a un dans sa villa de Baden, et quand nous y habitons il est avec moi toute la journée. Mais ce n’est qu’en été, quand nous y sommes invités.
– Nous en avons chez nous, dans notre propriété, je crois bien deux douzaines. Si tu es gentil ici, je t’en donnerai un. Un brun avec des oreilles blanches, un tout jeune, veux-tu ?
L’enfant rougit de plaisir :
– Oh ! oui », fit-il aussitôt, d’une voix brûlante et avide. Mais ensuite une pensée lui vint, qui lui donna un air anxieux et presque effrayé :
– Mais Maman ne le permettra pas. Elle dit qu’elle ne veut pas de chien à la maison ; ils donnent trop de tracas.
Le baron sourit. Enfin la conversation se portait sur la maman.
– Ta maman est-elle si sévère ?
L’enfant réfléchit, regarda une seconde le monsieur, comme pour se demander si l’on pouvait déjà avoir confiance dans cet étranger. La réponse resta prudente :
– Non, ma maman n’est pas sévère. Maintenant, parce que je suis malade, elle me permet tout. Peut-être me permettra-t-elle même d’avoir un chien.
– Faut-il que je le lui demande ?
– Oh ! oui, je vous en prie », fit le gamin exultant de joie. « Dans ce cas Maman y consentira certainement. Et quel air a-t-il ? Il a les oreilles blanches, n’est-ce pas ? Sait-il apporter ?
– Oui, il sait tout faire.
Le baron sourit malgré lui à l’aspect des étincelles brûlantes qu’il avait fait jaillir si vite dans les yeux de l’enfant. À présent la timidité du début était vaincue et la passion, qui avait été retenue par la crainte, déborda. L’enfant peureux et anxieux de tout à l’heure était devenu subitement un gamin plein de pétulance. Ah ! si sa mère était ainsi, pensa involontairement le baron, si elle était aussi ardente derrière sa réserve ! Mais, déjà, le gamin l’assaillait de questions :
– Comment s’appelle le chien ?
– Caro.
– Caro ! » – jubila l’enfant. Malgré lui il riait et exultait à chaque parole, enivré par cet événement inattendu, par le fait de voir quelqu’un s’occuper de lui amicalement. Le baron s’étonnait lui-même de son rapide succès et il résolut de battre le fer tant qu’il était chaud. Il invita l’enfant à faire avec lui un brin de promenade, et le pauvre diable, qui depuis des semaines portait en lui le désir affamé d’avoir un compagnon, fut ravi de cette offre. Ingénument il révélait tout ce que son nouvel ami cherchait à savoir de lui par de menues questions, semblant toutes fortuites. Bientôt le baron fut parfaitement renseigné sur la famille d’Edgar ; l’enfant était le fils unique d’un avocat de Vienne, qui appartenait à la riche bourgeoisie israélite ; il eut vite appris que la mère n’était pas enchantée de son séjour au Semmering et qu’elle s’était plainte de l’absence d’une société sympathique ; il crut même pouvoir induire de la façon évasive avec laquelle Edgar lui répondit, lorsqu’il lui demanda si sa maman aimait beaucoup son papa, que là tout n’était pas idéal. Il avait presque honte de la facilité avec laquelle il arrachait à l’innocent enfant tous ces petits secrets de famille, car Edgar, très fier de voir que ce qu’il racontait était capable d’intéresser un adulte, ne cachait rien à son nouvel ami. Son cœur d’enfant battait d’orgueil à la pensée d’être vu publiquement dans une parfaite intimité avec une grande personne (le baron, en marchant, lui avait mis son bras sur l’épaule) et, peu à peu, il oubliait qu’il n’était qu’un enfant et il caquetait librement et sans retenue, comme s’il eût parlé à quelqu’un de son âge. Ainsi que la conversation le montrait, Edgar était très intelligent, un peu précoce même, comme la plupart des enfants maladifs qui sont restés plus souvent dans la société des adultes qu’avec des camarades de classe, et ses sympathies ou ses antipathies atteignaient un degré de passion extraordinaire. Il ne paraissait jamais garder la mesure ; il parlait de chaque personne ou de chaque objet soit avec enthousiasme, soit avec une haine si violente qu’elle tordait son visage et lui donnait presque un aspect méchant et hideux. Quelque chose de sauvage et de primesautier, qui provenait peut-être de la maladie qu’il venait de surmonter, mettait dans ses paroles une ardeur fanatique et il semblait que sa gaucherie n’était qu’une crainte, péniblement refrénée, de sa propre passion.
Le baron gagna aisément sa confiance. Au bout d’une demi-heure, il était maître de ce cœur brûlant et agité. Il est si facile de tromper un enfant, ces naïfs dont on recherche si rarement l’amour ! Le baron n’avait qu’à se reporter à son propre passé pour trouver tout naturel que le gamin, très spontanément, ne vît plus en lui qu’un camarade et qu’au bout de quelques minutes il eût perdu le sentiment de la distance qu’il y avait entre eux. Il était si heureux d’avoir trouvé soudain dans cet endroit solitaire un ami, et quel ami ! Il les oubliait tous, les petits garçons de Vienne, avec leurs voix fluettes, leurs bavardages sans expérience ; cette heure unique et nouvelle avait suffi pour noyer leur image et leur souvenir. Toute sa passion enthousiaste appartenait à présent à son nouveau, à son grand ami, et son cœur se dilata de fierté lorsque celui-ci, au moment du départ, l’invita à revenir le lendemain matin, et qu’ensuite son nouvel ami lui fit signe de loin, tout comme un frère. Cette minute fut peut-être la plus belle de sa vie. Il est si facile d’abuser un enfant. – Le baron sourit en voyant le gamin s’en aller en courant. L’intermédiaire cherché était maintenant gagné. L’enfant, il le savait, accablerait sa mère de récits, jusqu’à satiété ; il répéterait chaque mot. Et le baron se félicita en se rappelant qu’il avait avec adresse tressé quelques compliments à l’égard de l’étrangère et qu’il avait toujours parlé à Edgar de sa « jolie maman ». Il était évident pour lui que le communicatif enfant n’aurait de cesse avant de les avoir mis en relation, sa maman et lui. Lui-même n’avait pas besoin de bouger le petit doigt pour atteindre la belle inconnue ; il pouvait maintenant rêver tranquillement et contempler le paysage, car il savait que d’ardentes mains d’enfant étaient en train de construire le pont qui le conduirait vers le cœur de la dame.
Trio
Le plan, ainsi qu’il s’en aperçut une heure plus tard, était excellent et réussit jusque dans ses plus petits détails. Lorsque le baron, s’étant à dessein mis un peu en retard, pénétra dans la salle à manger, Edgar tressauta sur sa chaise et le salua vivement, avec un sourire de bonheur dans les yeux. En même temps, il tira sa mère par la manche et lui parla avec animation en désignant le baron par des gestes sans discrétion. Gênée et rougissante, elle blâma sa trop grande exubérance, mais, malgré tout, elle ne put s’empêcher de regarder du côté que montrait l’enfant, pour lui faire plaisir. Le baron en profita aussitôt pour incliner la tête avec respect. La connaissance était faite. Elle fut obligée de rendre le salut, mais ensuite elle tint son visage penché sur son assiette et évita avec soin, pendant tout le repas, de regarder dans la direction du baron. Il en était tout autrement d’Edgar, dont les yeux étaient tournés sans cesse vers son ami et qui même, une fois, essaya de lui parler, malgré la distance, incorrection qui fut aussitôt énergiquement censurée par sa mère. Après le repas, on lui signifia d’aller dormir, mais un actif chuchotement s’engagea entre lui et sa maman, dont le résultat fut l’autorisation accordée à ses ardentes supplications d’aller jusqu’à l’autre table pour faire ses compliments à son ami. Le baron lui dit quelques paroles cordiales qui, de nouveau, firent briller les yeux de l’enfant, en causant avec lui pendant quelques minutes. Mais, soudain, par une adroite volte-face, il se dressa en se tournant vers l’autre table et félicita sa voisine, quelque peu troublée, d’avoir un fils si intelligent et si éveillé, vanta la matinée si agréable qu’il avait passée avec lui (Edgar était là, debout, écoutant rouge de joie et de fierté) et il s’informa ensuite de la santé de l’enfant, posant tant de questions que la mère fut obligée de répondre. Et ainsi ils aboutirent à un entretien assez long, auquel le gamin assistait tout heureux, avec une sorte de respect. Le baron se présenta et crut remarquer que son nom sonore faisait une certaine impression, qu’il la flattait. En tout cas, elle était à son égard d’une prévenance extraordinaire, bien qu’elle restât très réservée et qu’elle prît même congé de bonne heure, à cause de l’enfant, ainsi qu’elle ajouta en manière d’excuse.
Edgar protesta vivement ; il n’était pas fatigué et il était tout disposé à rester debout toute la nuit. Mais déjà la mère avait tendu la main au baron, qui la baisa respectueusement.
Cette nuit-là Edgar dormit mal. Il y avait à la fois en lui un chaos de bonheur et de désespoir enfantins, car quelque chose de tout nouveau s’était produit dans son existence. Pour la première fois il était intervenu dans le destin des grandes personnes. Déjà presque en rêve, il oubliait qu’il était un enfant et il lui semblait avoir grandi tout d’un coup. Élevé jusqu’alors dans l’isolement et souvent malade, il n’avait guère eu d’amis. Personne ne s’était trouvé là pour satisfaire son besoin de tendresse, à l’exception de ses parents, qui s’occupaient peu de lui, et des domestiques. Et la force d’un amour est toujours mal mesurée quand on l’apprécie seulement d’après ce qui en fait l’objet et non pas d’après la tension psychique qui l’anticipe – d’après cet intervalle vide et sombre, fait de déception et de solitude, qui précède tous les grands événements du cœur. Ici il y avait une sensibilité débordante, inemployée, en état d’attente, qui se précipitait au-devant du premier être qui semblait la mériter. Edgar était là dans l’obscurité, à la fois ravi de bonheur et tout troublé ; il voulait rire et il était obligé de pleurer, car il aimait le baron comme il n’avait jamais aimé un ami, ni son père ni sa mère, ni même Dieu. Toute la passion précoce de ses années passées s’attachait à l’image de cet homme dont, deux heures auparavant, le nom lui était encore inconnu.
Mais il était malgré cela assez intelligent pour ne pas se laisser dominer par l’inattendu et l’originalité de cette amitié nouvelle. Ce qui le troublait, c’était le sentiment de sa non-valeur, de son néant. « Suis-je donc digne de lui, moi un gamin de douze ans, moi qui dois encore aller à l’école et qui, le soir, suis obligé d’aller me coucher avant les autres ? » pensait-il en se tourmentant. « Que puis-je être pour lui, que puis-je lui donner ? » Cette impuissance douloureuse dans laquelle il se trouvait de manifester d’une manière quelconque son attachement à son ami le rendait malheureux. D’habitude, quand il avait gagné l’amitié d’un camarade, son premier acte était de partager avec lui les petits trésors de son pupitre, des timbres-poste et des pierres, ces possessions naïves de l’enfance, mais ces choses-là, qui hier encore avaient pour lui une grande importance et un charme rare, lui semblaient à présent dénuées de valeur, misérables et ridicules. Du reste, comment aurait-il pu offrir ces bagatelles à son nouvel ami, à qui il ne pouvait même pas se permettre de rendre le « tu » que celui-ci lui donnait ? Quel moyen, quelle possibilité avait-il de révéler ses sentiments ? Il éprouvait de plus en plus le tourment d’être petit, d’être quelque chose d’à demi formé et d’incomplet, un enfant de douze ans ; jamais encore il n’avait si violemment maudit sa condition d’enfant, jamais il n’avait si intimement désiré se réveiller le lendemain transformé, tel qu’il se voyait dans ses rêves : grand et fort, un homme, un adulte comme les autres.
Dans ces inquiètes pensées s’intercalèrent vite les premiers rêves colorés de ce nouveau monde de la maturité. Edgar s’endormit enfin avec un sourire, mais le souvenir du rendez-vous qu’il avait pour le lendemain mina cependant son sommeil. Dès sept heures du matin, il se réveilla avec la crainte d’arriver trop tard. Il s’habilla en hâte ; il alla embrasser sa mère, étonnée, qui d’habitude ne pouvait le tirer du lit qu’avec peine et, avant qu’elle eût pu le questionner, il se précipita dans l’escalier. Jusqu’à neuf heures il déambula avec impatience, oubliant son déjeuner et uniquement préoccupé de ne pas faire attendre son ami pour la promenade.
Enfin, à neuf heures et demie, le baron arriva d’un pas nonchalant et insouciant. Il avait bien sûr oublié depuis longtemps le rendez-vous ; mais, maintenant que l’enfant accourait vers lui, il fut obligé de sourire devant tant de passion et il se montra disposé à tenir sa promesse. Il prit de nouveau le gamin par le bras et se mit à faire les cent pas avec lui ; seulement il se refusa, doucement mais avec fermeté, à entreprendre tout de suite la promenade. Il paraissait attendre quelque chose, du moins c’est ce que laissait supposer son regard, qui surveillait les portes avec une certaine nervosité. Soudain son corps se redressa. La maman d’Edgar venait de se montrer et, rendant le salut du baron, elle se dirigea d’un air affable vers les deux amis. Elle sourit en guise de consentement lorsqu’elle apprit le projet de promenade qu’Edgar lui avait dissimulé, comme étant quelque chose de trop précieux ; puis elle se laissa vite gagner par l’invitation du baron à venir avec eux.
Aussitôt Edgar devint maussade et se mordit les lèvres. Comme c’était ennuyeux qu’elle arrivât juste à ce moment-là ! Cette promenade lui avait, pourtant, été promise à lui seul, et, s’il avait présenté son ami à sa maman, ce n’avait été qu’une gentillesse de sa part, et non pas dans l’intention de partager son amitié. Quelque chose comme de la jalousie s’éveilla en lui dès qu’il remarqua l’amabilité du baron à l’égard de sa mère.





























