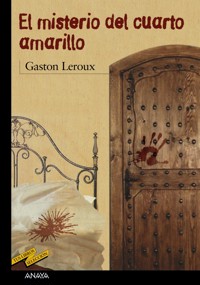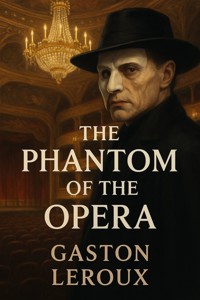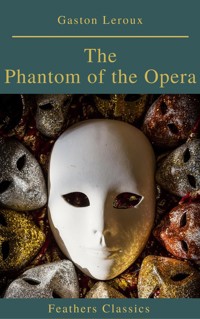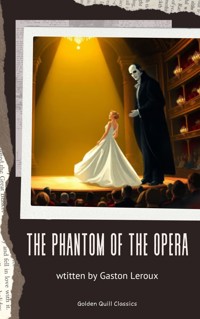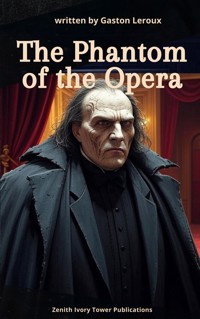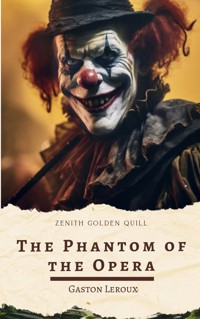2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Dans l'oeuvre de Gaston Leroux (1868-1927), le cycle de Chéri-Bibi est le second ensemble romanesque centré autour d'un personnage. Après Rouletabille (Le Mystère de la chambre jaune, Le Parfum de la dame en noir), Leroux met en scène les aventures de Chéri-Bibi, un forçat en rupture de ban, tendre et violent, implacable et doux, victime d'un coup du sort et de la " fatalitas ". Ce chef-d'oeuvre de la littérature populaire, initialement publié durant l'année 1913 en 120 feuilletons, dans "Le Matin" journal parisien, méritait d'être tiré de l'oubli. Condamné au bagne pour un crime qu'il n'a pas commis, Chéri-Bibi subit une opération de chirurgie esthétique et prend l'identité du Marquis du Touchais. De retour en France, il trouve bonheur et joie de vivre auprès de Cécily, la femme dont il a toujours été amoureux en secret. Hélas, il apparaît bientôt que le Marquis, dont il a pris les traits, n'est autre que le véritable auteur du crime pour lequel Chéri-Bibi a été condamné..
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Chéri-Bibi et Cécily
Chéri-Bibi et CécilyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVPage de copyrightChéri-Bibi et Cécily
par
Gaston Leroux
Le cycle desAventures de Chéri-Bibicomprend :
1. Les cages flottantes.
2. Chéri-Bibi et Cécily.
3. Palas et Chéri-Bibi.
4. Fatalitas !
5. Le coup d’État de Chéri-Bibi.
I
Cécily
L’auto s’arrêta au haut de la côte de Dieppe, avant d’arriver au Pollet.
« Dois-je attendre monsieur le marquis ? demanda le chauffeur.
– Non, Carolle, tu vas retourner au Tréport, et là, tu attendras mes ordres. »
Le marquis et son secrétaire descendirent de l’auto.
« Eh bien, mon brave Hilaire, nous voici au bout de nos tribulations.
– Monsieur le marquis doit être bien ému ! » fit Hilaire en regardant son maître, un homme superbe, de grande et forte corpulence, tandis que lui, chétif, flottait dans un complet veston de voyage qui paraissait trop grand pour son étroite poitrine, pour ses membres grêles et fragiles.
« Oui, Hilaire, oui, je suis ému, tu peux le croire, si ému que je ne suis point fâché d’arriver à la nuit tombante dans un pays où chaque pierre, tu entends, chaque pavé de la route évoque pour moi un souvenir.
« Ah ! que d’années passées depuis les événements fatals qui m’en ont arraché et que tu connais ! C’est là que j’ai vécu une enfance et une adolescence bien heureuses. Ô terre bénie ! sol de ma patrie ! Enfin je reviens à toi après tant d’espérances qui se sont brisées et de combats et de fatigues ! Se peut-il que le plus cher de mes vœux soit exaucé ! Ah ! mon cher Hilaire, je ne me flattais plus de mourir un jour, comme un honnête homme, dans ce pays de Caux qui m’a vu naître, d’avoir un jour mon tombeau dans ces lieux si chers.
« Salut donc, ô mon pays ! Je revois tes humbles demeures, les toits qui fument dans la paix du soir, les petits enfants qui se poursuivent avec des cris joyeux, et les bonnets blancs de mes Polletaises assises au pas de leurs portes pour mieux voir passer l’étranger.
« Voici derrière les fenêtres les feux qui s’allument. Comme mon cœur bat à l’aspect de ce porche, où, si souvent, je montai dans la diligence retentissante qui me conduisait vers Biville ou Criel et dans toute la vaste campagne ! Mon Dieu ! Hilaire, arrêtons-nous ici. Tu vois cette route dont la montée bifurque vers la falaise, c’est le chemin du Puys où j’ai connu mes premières joies et mes plus grandes douleurs ! C’est là qu’avec ma petite sœur nous filions comme le vent à travers les prés verts pour arriver bientôt aux grands buissons d’aubépines, tramés de chèvrefeuille et d’églantiers, qui abritaient la demeure de Cécily... Cécily !... Cécily !... Laisse-moi pleurer, Hilaire !... D’où vient qu’une invincible tristesse, en ce jour qui devrait être le plus beau de ma vie, m’envahit, m’emplit d’un mystérieux effroi... comme si je courais au-devant d’une catastrophe fatale, d’un malheur que rien ne pourra détourner de ma tête ?
– Avançons un peu, monsieur le marquis, fit Hilaire... On commence à nous regarder.
– Tu as raison, mon ami, il ne faut point nous faire remarquer. Je ne tiens pas à ce que le marquis du Touchais soit reconnu, ni à ce que l’on salue son heureux retour avant que je n’aie goûté pleinement la joie solitaire de revoir tant de choses et de gens qui me tiennent au cœur par des fibres si sensibles... Ah ! c’est elle !... la voici... la devanture !... rien n’a changé, Hilaire !... rien n’a changé !... Voici la devanture de fer de la première boucherie où je fis mon apprentissage !...
– Je vous avouerai, monsieur le marquis, dit Hilaire, que je n’aime point beaucoup ces sortes de grilles qui me rappellent, à moi, les plus fâcheuses heures de votre chère existence !... »
Et il essaya de l’entraîner en le prenant respectueusement par le bras.
Mais le marquis se dégagea et dit :
« Le beau veau ! Regarde, Hilaire, ce veau, il est superbe ! Et cette fressure... Elle est magnifique ! Ils ont toujours eu ici de la belle fressure, parce que jamais ils n’achetaient de viande trèfle, c’est-à-dire malade. Je n’en veux, du reste, pour preuve que ces poumons qui sont tout à fait « coches », comme on dit dans la partie, c’est-à-dire excellents. C’est comme ce bœuf attaché encore au tinet, il fait plaisir à voir, je t’assure !
– Monsieur le marquis, je vous en prie, on s’attroupe déjà autour de nous...
– Oui, oui, Hilaire, je viens... tu as raison, mon garçon ; mais excuse-moi, tu sais. C’est ici que j’ai appris à donner mon premier coup de couteau ! »
Ils traversèrent le pont, et encore le marquis s’arrêta pour embrasser d’un coup d’œil ce port, sur les quais duquel il avait joué avec l’entrain de l’innocence. Il dit à son secrétaire en lui montrant la sombre silhouette d’un steamer :
« Ça c’est le bateau de Newhaven. Nous assisterons à son départ demain matin. Pense ce soir à me faire regarder l’heure de la marée. Et maintenant, je vais te montrer la statue de Duquesne. »
Ils furent arrêtés par un grand encombrement de voitures comme il s’en produit, au moment des courses, en pleine saison (ce qui était le cas) et il dit :
« Je vois avec plaisir qu’il y a toujours de la circulation. »
Quand ils arrivèrent sur la place où s’érige la statue du grand marin, le marquis campa Hilaire à un endroit propice, et bien que l’ombre du soir fût déjà tombée, le secrétaire put admirer la noble attitude du héros dieppois dans ses larges bottes.
« Quand nous étions petits, ma sœur et moi, dit le marquis, nous ne passions jamais devant cette statue sans que je fasse remarquer : « Tu vois, Jacqueline, ce n’est pas du bronze, c’est Du...quesne ! »
Le marquis rappelait ces enfantillages avec attendrissement et il lui semblait qu’il était redevenu petit enfant.
« Où allons-nous dîner ? demanda Hilaire qui avait faim.
– Écoute, Hilaire, si tu le veux bien, nous allons lâcher ce soir les palaces, et je vais te conduire dans une modeste gargote du port où je me régalais quelquefois avec les camarades, aux jours de congé, quand j’étais en apprentissage. Ça nous coûtera 1,50 F par tête, vin compris, moins les suppléments, bien entendu, et nous aurons une excellente friture.
– Je remarque que monsieur le marquis, fit Hilaire, qui ne tenait point du tout à la gargote, devient fort économe depuis quelque temps.
– Je n’ai jamais aimé le gaspillage, répondit le marquis, et ma foi, sans être avare, un sou est un sou.
– Monsieur le marquis comptait moins quand il était pauvre.
– La belle affaire de ne point compter quand on n’a point d’argent !
– C’est juste ! se rendit Hilaire.
– Mais de quoi te plains-tu ? Nous privons-nous de quelque chose et ne vivons-nous point selon notre rang ? Ce que je n’aime point, vois-tu, Hilaire, c’est le coulage. Il ne profite à personne. Enfin n’oublions pas que nous avons à rattraper six millions.
– Chut ! interrompit vivement Hilaire, en pinçant respectivement le bras de son maître.
– Je ne dis rien que tout le monde ne puisse entendre, continua le marquis en se frottant le bras... Je le répète, six millions, c’est de l’argent ! Que d’honnêtes gens on pourrait faire avec six millions ! »
Et il poussa sous les arcades où ils étaient revenus, en face de la poissonnerie, la porte vitrée d’un « bistro ».
Il y avait là une douzaine de matelots et de petits employés qui dînaient assez bruyamment. Le patron de l’établissement – M. Oscar, on l’appelait – flatté de voir entrer chez lui des clients aussi reluisants, se précipita. Mais le marquis connaissait les aîtres et il n’eût point besoin de ses services pour pénétrer dans une sorte de cabinet particulier séparé de la salle commune par des cloisons munies de vitres sur lesquelles glissaient de petits rideaux sales.
« Ça sent le graillon, fit Hilaire dégoûté.
– Ça sent la friture dieppoise ! fit le marquis. Monsieur Oscar, vous nous donnerez quatre fritures dieppoises, des crabes et des crevettes et quatre portions de tête de veau à l’huile et deux carafes de cidre pour commencer !
– Ces messieurs attendent des amis ? demanda M. Oscar, obséquieux.
– Nullement, fit le marquis. Mais je sais quelles sont les portions de la maison, et je prends mes précautions, monsieur Oscar.
– Vous me connaissez donc, monsieur, sauf votre respect ?
– Nullement, mais j’ai vu votre nom sur votre porte. De mon temps, le patron s’appelait Lavallée.
– Il est mort, dit Oscar, et je lui ai succédé.
– Et les affaires vont toujours bien ?
– Que non point, monsieur, et tel que vous me voyez, je cherche à vendre. Les palaces me font le plus grand tort. Les clients sont difficiles, et il faut maintenant faire venir le poisson de Paris.
– Et pourquoi donc, monsieur Oscar ?
– Mais parce que les palaces achètent tout le poisson frais de Dieppe, mon cher monsieur !
– Vous voyez bien, fit Hilaire, mélancolique, que nous aurions mieux fait d’aller dans un palace.
– Monsieur, vous n’aurez pas à vous plaindre, déclara Oscar, je cours à la cuisine ! »
Le marquis soupira :
« S’il n’y a plus moyen de manger de poisson dans les ports de mer ! »
Mais il ajouta tout de suite :
« Vois-tu, Hilaire, ça m’est bien égal. C’est le décor que je suis venu chercher.
– Il est propre ! » fit Hilaire...
Mais il mit aussitôt un frein à sa mauvaise humeur, car une délicieuse petite bonniche venait de faire son entrée. Jeune et coquette, le bonnet bien blanc sur l’oreille, l’œil éveillé, le sourire futé, adroite et vive, elle mit le couvert avec tant de grâce qu’Hilaire en tomba en extase.
« Comment vous appelez-vous, mademoiselle ? demanda-t-il en rougissant.
– Virginie, monsieur, pour vous servir ! »
Hilaire, immédiatement, grava ce nom dans son cœur.
Ainsi qu’il sied aux commencements de l’amour, Hilaire resta silencieux pendant tout ce fâcheux repas et ne toucha guère à ces « horribles rogatons » comme il disait. Le marquis, lui, parlait pour deux, rappelant vingt anecdotes de sa jeunesse et cherchant beaucoup, apparemment, à s’étourdir, Hilaire, qui le connaissait bien, ne s’y méprenait pas, persuadé que tous ces bavardages cachaient avec soin la seule pensée dont le marquis était alors préoccupé et qu’il n’exprimait point.
Sur ces entrefaites, un gamin pénétra dans l’établissement en criant le titre d’un journal du soir dont les matelots de la salle voisine s’emparèrent.
« Mes enfants, fit entendre presque aussitôt un lecteur, paraît qu’on en a fini avec le fameux Bayard. »
À ces mots, le marquis et Hilaire se prirent la main et écoutèrent avec une curieuse anxiété.
L’homme continuait :
« Oui, tenez, c’est dans le journal. On a fini par le rattraper, depuis un an qu’on lui courait dessus, et il a été coulé.
– Lis donc, lis donc ! » crièrent les autres.
Alors l’autre lut tout haut :
« Dépêche du Times : « Nous recevons de notre correspondant de Singapour une courte dépêche nous apprenant la fin du fameux Bayard et de son équipage de forbans. C’est dans la mer des Moluques, près des îles Soula, que le croiseur français la Gloire, qui était à sa recherche depuis un an, et auquel il avait réussi jusqu’alors à échapper à travers les innombrables archipels de la Malaisie, a pu le rejoindre. Un combat rapide s’est engagé, et le Bayard, canonné par la Gloire, a sauté. Les trois quarts de l’équipage ont été noyés. Le reste, qui s’était réfugié dans des chaloupes et qui tentait de fuir, a préféré se laisser fusiller que de se rendre. La Gloire a recueilli plus de cent cadavres parmi lesquels on a pu identifier le chef des bandits, le Kanak et sa terrible épouse, la Comtesse. On sait que le Kanak avait remplacé défunt Chéri-Bibi à la tête de ces abominables corsaires. Ainsi se termine cette effroyable aventure, qui occupe le monde entier depuis de longs mois et qui avait terrorisé toutes les mers de Chine. »
Le lecteur avait terminé.
Dans le cabinet particulier, les deux convives, qui étaient plus pâles que la nappe certainement, poussaient un profond soupir en disant : « Amen ! »
Dans la salle commune, on se livrait à des commentaires touchant la veine qu’avait eue le marquis du Touchais d’échapper à de pareils brigands.
« Ça lui a tout de même coûté cinq millions ! fit un des matelots, car on était maintenant tout à fait au courant des événements dont le commandant Barrachon et le marquis et bien d’autres avaient failli être victimes ; et le marquis lui-même, à son passage à Paris, s’était laissé très complètement interviewer par les reporters des plus grands journaux.
« On dit que le marquis va bientôt revenir à Dieppe, fit un soupeur. C’est « la Belle Dieppoise » qui va être contente ! Elle va recommencer, pour sûr, à écraser le pauvre monde, tandis que la marquise, qu’est si bonne, va recommencer à pleurer toutes les larmes de son corps ! Tout de même il y a des choses qu’est pas juste !
– À ce qu’il paraît que c’est elle qui ouvre, ce soir, le bal du « Denier du pauvre marin », dit un autre, dans la grande salle du Casino.
– Oui, avec le sous-préfet, la chère dame ! C’est la première fois qu’on la revoit dans une fête de charité, depuis qu’elle a appris la mort de son frère, là-bas, en Océanie.
– Son frère, encore un joli coco ! Il est mort de faire la noce, paraît-il, et de fumer de l’opium. Elle ne doit pas beaucoup le regretter.
– Si seulement son mari avait pu crever comme son frère, elle serait bien débarrassée, la pauvre ! Mais avec l’idée que son marquis va lui revenir un de ces quatre matins, elle ne doit pas avoir le cœur à la danse ! Sans compter qu’elle était bien tranquille sans lui ! Ah ! si j’avais été à la place de la marquise, moi, c’est pas moi qu’aurais donné les cinq millions pour que les brigands me rendent un oiseau pareil !
– Le marquis est riche de ses spéculations de Rouen à Saint-Julien. Son notaire n’avait besoin de la permission de personne pour le tirer de là, bien sûr !
– Enfin, je la plains !
– Vous n’avez pas vu « la Belle Dieppoise » qui revenait des courses aujourd’hui ? Elle en avait une toilette « tape-à-l’œil » !
– C’est tout de même une belle femme, c’te baronne Proskof, seulement le marquis sait ce qu’elle lui a coûté ! »
Comme les dîneurs en étaient là de leur conversation, ils durent déranger leurs chaises pour laisser passer les deux clients du cabinet particulier.
« Tiens ! fit le matelot quand les deux hommes furent sous les arcades, en voilà un qui ressemble au marquis comme deux gouttes d’eau !
– Pas possible ! s’exclamèrent les autres. Crois-tu que le marquis viendrait dîner ici ? T’es pas malade ! »
Dehors, le marquis, qui était de plus en plus agité, regarda sa montre.
« Il n’est que huit heures et demie ! fit-il.
– Ça ne commencera pas avant dix heures, dit Hilaire.
– Le programme annonce l’ouverture du bal pour neuf heures !... Ah ! quand je pense que dans une demi-heure... j’ai peur, Hilaire, je tremble comme un enfant... Je peux bien te le dire maintenant... L’idée de revoir Cécily m’épouvante. Oui, d’abord ça m’a été une immense joie !... Et c’est ce qui m’a fait tout souffrir, tout supporter : c’est ce qui m’a fait endurer le supplice ! L’idée que je serais son mari, son maître... qu’elle m’appartiendrait... que cette femme que j’adorais, et qui était si loin, si loin de moi, allait être à moi !... à moi !... que je pourrais vivre à ses côtés, la voir tous les jours, la respirer, marcher dans son parfum, et, Hilaire, le soir, lui tendre les bras !... N’était-ce pas le sublime des enchantements, le paradis ?... Eh bien, Hilaire, de ce paradis, voilà plus d’un an que je retarde le moment où j’en pousserai la porte !...
– Vous avez bien fait, monsieur le marquis, répondit le secrétaire, – n’eût-ce été que pour attendre ce jour où nous apprenons la disparition de ces deux êtres qui étaient les seuls au monde à avoir notre secret. Maintenant, nous voilà tranquilles ! Enfin, cette année vous aura profité et à moi aussi ! Vous avez voyagé, vous avez vu le monde et du monde ! Vous avez appris bien des choses ! Vous avez traversé « la société ». Vous savez comment on s’y tient, comme on y réussit ! Vous avez fréquenté votre notaire ! Vous avez compulsé vos papiers ! Vous connaissez votre fortune ! Elle ne vous étonne plus. Vous savez parler aux femmes : vous êtes un vrai gentilhomme. Vos manières se sont affinées et votre langage s’est épuré. Je vous écoutais tout à l’heure saluer votre pays en des termes choisis, comme on lit dans les livres ; aucun mot vulgaire ne vous échappait plus, et bien que l’occasion s’en présentât, vous n’avez pas une seule fois laissé passer ce fatalitas ! qui, autrefois, émaillait si souvent vos discours ! Moi-même, je vous ai suivi sur ce beau chemin, j’ai profité des leçons que nous avons prises en commun et je ne me reconnais plus !
– Tu as toujours ta bonne figure pâlote, et tes bons yeux de chien fidèle, mon vieux la Ficelle.
– Ne prononcez plus ce nom-là, monsieur le marquis ; il est mort avec toutes nos misères.
– Tu as tout à fait l’étoffe d’un parvenu, mon pauvre la Ficelle, moi ça ne me déplaît point quand tu t’oublies à dire « Chéri-Bibi ! » comme autrefois, et que nous sommes seuls, bien entendu !
– Ne me mécanisez point, monsieur le marquis, pria la Ficelle, blessé. Si j’ai l’air d’un parvenu, je vous trouve bien souvent maintenant celui d’un Joseph Prud’homme. Ah ! bien sûr, on n’a point seulement changé que votre visage !
– Qu’importe, la Ficelle, si mon cœur est toujours le même !
– De ce côté-là, vous n’avez point changé, il faut le dire. Vous aimez toujours Mme Cécily. Vous ne songez qu’à elle... Tenez, nous voici déjà au casino, qui est tout illuminé. Que comptez-vous faire ?
– Viens, la Ficelle, mon bon la Ficelle, viens faire un tour de jetée... Nous avons le temps.
– Comme vous tremblez, monsieur le marquis ! Vous me faites pitié. Appuyez-vous sur mon bras.
– Vois-tu, Hilaire, je suis bien malheureux ! Comprends-moi... Cette femme... cette femme, c’est toute ma vie !... et j’ai sur elle tous les droits... Voilà ce qui est terrible... Si j’allais la faire souffrir !... Elle ne m’aime pas... Elle est heureuse de mon absence... Si j’étais brave et si j’avais le cœur que tu dis, je m’enfuirais ce soir, sans l’avoir revue... Conçois-tu les transes par lesquelles je passe, et pourquoi, au Tréport, nous sommes restés trois jours à ne rien faire, alors que tout m’appelait ici ? Je ne sais où diriger mes pas... J’hésite... Je suis comme un pauvre homme dans les ténèbres... Un instant, j’avais eu l’idée de rester là-bas, dans les Amériques... de m’y installer... Mais je n’ai pas pu, non, non... Sa pensée m’attire, comme le fer attire l’aimant.
– Comme l’aimant attire le fer, crut devoir corriger le bon Hilaire.
– Si tu veux... Alors je me suis embarqué pour l’Europe... et puis ça a été Paris... et puis toujours plus vers elle. Nous nous sommes rapprochés... et maintenant il faut que je la voie... Je vais d’abord essayer de la voir de loin... Ce bal m’a décidé... Quand j’ai su qu’elle serait à ce bal, je me suis dit : « Voilà une occasion ! »... Je pénétrerai dans le casino, après avoir payé mon entrée, bien entendu !... Je resterai en dehors de la salle des fêtes... Mais à travers les grandes fenêtres, on voit les danses... on assiste au spectacle... Je reverrai Cécily... Je brûle de savoir si elle a gardé cette beauté d’autrefois que j’ai emportée dans mon cœur !... Asseyons-nous un peu sur ce banc, mon cher Hilaire, mon bon et excellent la Ficelle, mon cher, mon seul ami... Je suis heureux, vois-tu, que lors de ton voyage aux millions, tu n’aies pas vu Cécily !
– Non ! vous savez bien, monsieur le marquis, que c’est par l’entremise du notaire que tout a été réglé... Et je suis heureux, moi, que ce notaire soit mort ; comme ça, il ne me reconnaîtra plus !
– Maître Régime, qui l’a remplacé, est un bien digne homme, la Ficelle ; mais je te disais donc que j’étais heureux que tu n’aies point vu Cécily, et je vais te dire pourquoi : tous les hommes n’ont point les mêmes goûts... Tu n’aurais peut-être pas trouvé Cécily aussi belle que je l’eusse désiré, et j’en aurais eu une grosse peine... et je t’en aurais voulu, vois-tu, la Ficelle... Je ne puis comprendre qu’on n’admire pas Cécily ! »
« Me voilà prévenu », se dit le dévoué secrétaire.
Ils étaient sur la jetée ; la brise du large leur apportait, en même temps que les senteurs marines, les bruits des premiers flonflons.
« Allons-y, s’écria Chéri-Bibi, le sort en est jeté ! »
Et se levant, il entraîna rapidement la Ficelle vers le Casino. Il y avait déjà foule aux grandes grilles de l’entrée, et des voitures, des autos ne cessaient d’amener un public des plus élégants. Nos deux hommes pénétrèrent dans la cour réservée, et rapidement se dirigèrent vers l’une des hautes fenêtres de la salle de gala, près de laquelle ils s’installèrent extérieurement, dans un coin d’ombre qui les protégeait contre les regards indiscrets. On ne les voyait point et ils voyaient. Chéri-Bibi s’était assis pour calmer ses agitations, les yeux fixés sur le salon où les groupes commençaient déjà à évoluer. Sur une estrade, à côté de l’orchestre, on avait disposé les riches lots de la tombola qui devait être tirée à la fin de la fête. De gaies jeunes filles, de charmantes jeunes femmes montaient et descendaient, regardant les lots, se les passant de main en main avec des réflexions et des sourires. Des jeunes gens, une fleur à la boutonnière, allaient de chaise en chaise, saluer ou « retenir » leurs danseuses. Quelques-uns faisaient le beau, tendaient le jarret, prenaient des airs ridicules. Un homme qui paraissait une quarantaine d’années fit son entrée, remarquablement élégant, portant haut une tête futile et jolie et tout à fait déplaisante pour ceux qui n’aiment point les bellâtres. Chéri-Bibi qui, justement, ne les aimait pas, se leva en étouffant un vilain juron. Il reconnaissait cet homme.
« Monsieur de Pont-Marie ! siffla-t-il ; en voilà un qui m’a toujours déplu ! »
M. de Pont-Marie donnait le bras à une vieille dame qui avait fort grand air sous ses cheveux blancs et son fichu de dentelle.
« Tiens, la marquise douairière du Touchais ! dit Chéri-Bibi à la Ficelle.
– Vous la connaissez, monsieur le marquis ? demanda la Ficelle.
– Je te crois, c’est ma mère ! »
Dans tout cela, il ne voyait pas Cécily. Son regard plongeait dans les groupes, cherchait autour des jeunes femmes, car pour lui, Cécily était toujours une jeune femme, bien qu’elle dût avoir maintenant dans les trente-cinq ans, « la belle âge » avait dit la Ficelle consolateur. Sans doute n’était-elle pas encore arrivée. Elle n’était pas en retard puisque le sous-préfet n’était pas encore là.
Une seconde il pensa qu’elle était là, peut-être, qu’elle « lui crevait les yeux » et qu’il ne la reconnaissait pas !... Une idée pareille lui faisait couler des gouttes de sueur, en abondance, sur le front qu’il épongeait, fébrile, fiévreux, ne tenant plus en place, le pauvre garçon !
Mais ce n’était pas possible !... Son cœur battait à grands coups sourds dans sa poitrine qui résonnait comme un tambour... et il savait bien que, même si ses yeux n’avait pas reconnu Cécily, son cœur s’arrêterait, ça, c’était sûr ! Et il était bien capable d’en mourir, ma foi ! Il s’appuya sur la Ficelle qui le sentait grelotter.
À un moment, il y eut une sorte de remue-ménage dans le salon. Les groupes se retournèrent... Des personnes qui étaient assises se levèrent... Tous les visages paraissaient curieux... et les jeunes hommes empressés couraient à la porte où il semblait que se produisît une entrée sensationnelle.
« C’est Cécily, ou le sous-préfet !... » se dit à moitié mourant Chéri-Bibi, car il ne pouvait imaginer un tel dérangement que pour sa bien-aimée ou pour le représentant galonné du gouvernement. Mais ce n’était ni le sous-préfet, ni Cécily. C’était, par exemple, un couple rutilant...
La dame était admirablement empanachée. La Ficelle, qui s’était mis un peu à la littérature depuis qu’il était le secrétaire de Chéri-Bibi, la jugea « d’une altière beauté ». Grande et d’une harmonie de lignes idéale, exhalant de toute sa personne, de sa démarche, de sa façon de regarder et de sourire, un charme des plus sensuels, elle arrivait là en conquérante, en véritable reine de la fête. Elle portait avec audace une robe de princesse en bengaline jaune paille épousant de très près les formes et barrée en sautoir par une vaste écharpe en crêpe de Chine cramoisi.
Chéri-Bibi, furieux, allait demander tout haut : « Quelle est cette péronnelle ? » quand il aperçut son « cavalier ». Son cavalier, c’était le baron Proskof, qui, lui, était revenu en France, aussitôt qu’il l’avait pu, auprès de la baronne, « son épouse », laquelle avait, par miracle, échappé au naufrage de la Belle-Dieppoise dans une chaloupe qui avait été recueillie par le navire abordeur.
Si Chéri-Bibi avait douté plus longtemps que cette superbe personne fût la baronne elle-même, il aurait été vite renseigné par les propos qui se tenaient autour de lui, à toutes les fenêtres. Les spectateurs du dehors murmuraient : « La Belle Dieppoise ! » Et peut-être n’eût-il point résisté à l’envie d’exprimer assez haut sa façon de penser à l’égard de cette effrontée. Mais il n’en eut pas le temps. Cécily venait d’arriver.
Comme Chéri-Bibi était monté sur une chaise, il s’effondra. La Ficelle le reçut dans ses bras, le redressa, lui glissa quelques paroles d’encouragement, auxquelles il répondit avec de vagues coups de tête, qu’il promettait d’être raisonnable et il retourna à sa vitre, contre laquelle il appuya une figure de mort.
Le sous-préfet était allé au-devant de la présidente du « Denier du pauvre marin » et maintenant il la conduisait à sa place, lui ayant offert son bras et lui parlant fort galamment. Chéri-Bibi, immédiatement, se mit à détester ce sous-préfet.
Ah ! elle était d’une grâce merveilleuse, la petite marquise du Touchais, et combien paraissait touchante sa naturelle mélancolie ! Autant sa rivale répandait d’éclat sur son passage, autant celle-ci plaisait par son charme modeste et son élégance de bon ton. Car élégante, elle l’était autant que l’autre, sinon plus, si tant est que l’on doive appeler élégance cet agrément qui est inné chez certaines femmes et qui résulte de la parfaite distinction des manières, de la facilité dans les mouvements, d’un goût sans défaillance dans la parure et de la simplicité dans la richesse. La marquise du Touchais était habillée d’un fourreau de soie blanche recouvert de chantilly noir.
« Ciel ! commença Chéri-Bibi dans le secret de son for intérieur, où son amour pour Cécily s’exprimait toujours avec un lyrisme qui dépassait la vulgaire humanité... Ciel ! la voilà, la douce lumière de ma vie ! Celle qui a quatre parts dans mon cœur ! Ô cher objet de mes alarmes ! Espoir tant pleuré ! Qu’elle est belle ! Ses malheurs n’ont fait que la rendre plus belle à mes yeux ! Femme, elle dépasse les promesses de la jeune fille. Regardez-la marcher, et dites-moi si les fées qui glissent dans les prés fleuris ont des pas plus légers ! Regardez-la sourire, et dites-moi si la douleur qui sourit, sœur de la pitié qui pleure, n’est point la plus belle ! Ô jeunes insensés, qui tourbillonnez « comme un essaim volage » autour de cette reine bourdonnante qu’est sa rivale, comment pouvez-vous l’avoir vu passer sans avoir été conquis pour toujours ? »
Là-dessus il soupira, et voilà qu’après s’être étonné du peu d’empressement que les amoureux de la baronne mettaient à saluer son idole, une fureur à la Chéri-Bibi l’entreprit des pieds à la tête, en voyant Cécily danser avec le sous-préfet.
M. le sous-préfet avait une façon de sourire à Cécily qui déplaisait souverainement à Chéri-Bibi. Celui-ci trouvait également que ce haut fonctionnaire en prenait trop à son aise avec la taille de la marquise. Il la serrait trop ; ce n’était point convenable ; et il avait un petit air fat en la faisant tourner qui méritait des gifles. D’abord, c’était bien simple : Chéri-Bibi ne comprenait point comment on osait toucher à son idole, et il maudissait les usages du monde qui, sous prétexte de charité, ordonnaient de pareils jeux dont l’indécence le révoltait.
Il finit par ne plus regarder le sous-préfet, parce que « ça lui faisait trop mal », et il ne s’occupa plus que de la danseuse. Celle-ci glissait sans effort, le regard lointain, l’âme ailleurs. Chéri-Bibi la vit passer tout près de lui et il en reçut une commotion qui le fit s’appuyer pantelant à la muraille. La fenêtre avait été entrouverte. Il lui parut qu’au passage il avait respiré l’haleine de sa bien-aimée. Cette bouche aux lèvres vermeilles, ces yeux adorables, cette taille qui pliait, cette robe qui se soulevait, retenue par la main et laissant voir des chevilles divines, les petits pieds gantés de soie fine dans les petits souliers de satin !... Ah ! c’était tout cela, sa Cécily !... Et tout cela était à lui ! à lui !... Il n’avait qu’à vouloir... Cette pensée, comme il l’avait confié tout à l’heure à la Ficelle, cette pensée, en vérité avait de quoi le faire devenir fou... Alors demain, après-demain, enfin quand il oserait... ce soir même, s’il en avait le courage... il n’avait qu’à se présenter et dire : « Me voilà ! »... Le maire, le curé, le bon Dieu, les gendarmes au besoin, tout le monde était avec lui, sur la terre et dans les cieux, pour lui apporter, pour lui donner Cécily, pour lui dire : « Prends-la... elle t’appartient !... » Il serra de ses mains crispées son front brûlant... Ah ! oui, il oserait, il oserait... D’abord, maintenant qu’il l’avait vue, le reste n’était plus possible... le reste, c’est-à-dire la fuite, l’abnégation, le départ pour toujours, l’abandon de tant de beauté et de jeunesse... Il ne pouvait plus se passer de cette femme... Quoi qu’il arrivât, il la voulait...
La danse était terminée ; le sous-préfet avait reconduit Cécily à sa place, auprès de la marquise douairière. Chéri-Bibi se calma un peu. Désormais, il était sûr de lui, de ce qu’il ferait.
Il n’y avait plus à y revenir. Il serait le marquis du Touchais jusqu’au bout.
Ah ! bien, si on avait dit ça au petit garçon du Pollet, à l’enfant qui osait à peine lever les yeux sur la demoiselle des Bourrelier !... Maintenant Chéri-Bibi ne regrettait plus rien, absolument rien des extraordinaires événements de sa criminelle vie, ni les années de prison, de bagne, de misère, ni son innocence méconnue par des juges aveugles, ni ses révoltes épouvantables, ni les heures d’atroce haine contre un implacable destin, et pour la première fois il remercia la fatalitas qui, par les chemins de trahison et de sang, l’avait conduit dans les bras de Cécily. Les bras de Cécily !... Il les voyait nus pour la première fois ! Ah ! les beaux bras !... les bras de sa femme !... sa femme !...
L’orchestre préludait aux premières mesures de la prochaine valse. Chéri-Bibi vit tout à coup M. de Pont-Marie qui, le monocle à l’œil, s’inclinait avec un sourire idiot (pensait Chéri-Bibi) devant Cécily. Celle-ci sourit au danseur, se leva et parut accepter son bras avec plaisir. Alors ils commencèrent de tourner. Ce qu’avait éprouvé Chéri-Bibi en regardant la danse du sous-préfet et de Cécily n’était rien hélas ! en comparaison de la tempête qui, dans l’espace d’un instant, lui bouleversa l’âme. La Ficelle, dont il pétrissait les bras, se retint pour ne pas crier et crut prudent, après s’être dégagé, d’assister d’un peu plus loin aux manifestations de l’amour et de la haine de Chéri-Bibi.
Ce M. de Pont-Marie était un polisson. Il dansait les yeux sur Cécily, et certes il ne lui souriait pas, en dansant, comme le sous-préfet, mais toute sa haïssable physionomie de bellâtre, amateur de femmes, reflétait l’ardeur de ses honteux sentiments intimes. Par instants, ses lèvres murmuraient des mots que Chéri-Bibi bien certainement n’entendait pas, mais dont il devinait le sens. C’étaient, de toute évidence, « des paroles de flamme », alors que Cécily rougissait et détournait la tête. Ah ! ce que Chéri-Bibi souffrait !
« Le monstre, pensait âprement Chéri-Bibi qui, dès que le couple se rapprochait, avait des envies folles de sauter à la gorge du danseur, le misérable ! Il abuse de cette soirée à laquelle la marquise a été obligée d’assister, il profite de ce que, publiquement, au milieu de ce bal, pendant cette danse qu’elle lui a aimablement accordée, Cécily ne peut pas le traiter comme il le mérite, pour lui dire des choses qui l’auraient fait jeter à la porte par les larbins s’il avait eu l’audace de les prononcer chez elle ! »
Et les yeux de ce Pont-Marie brillaient, sa main pétrissait la petite main de Cécily qui, visiblement, se défendait. Ah ! ce que Chéri-Bibi souffrait ! C’était à hurler de douleur et de rage impuissante !... Et elle continuait de danser... et elle continuait de l’entendre !
Le malheureux Chéri-Bibi se rappela les propos abominables des filles à bord du Bayard quand elles accusaient sa Cécily de s’en laisser conter par ce Pont-Marie !... Si... vraiment... Allons donc !... allons donc !... allons donc ! Une pareille horrible pensée !... Il était bien maudit pour avoir eu une pensée aussi monstrueuse ! Il s’enfonça les ongles dans les joues et ses joues pleurèrent des larmes de sang. Sa Cécily !... Sa pure Cécily !... aimer un imbécile pareil !... Un idiot à monocle !... (l’astigmatisme attesté par le monocle équivalait toujours, aux yeux de Chéri-Bibi, à un brevet d’idiotie)... Mais c’était lui, Chéri-Bibi, l’idiot !... et la preuve, la preuve en était qu’au beau milieu de la danse, la jolie marquise se dégageait doucement mais fermement de son danseur et lui demandait d’un ton très net (Chéri-Bibi eut la joie surhumaine de l’entendre) de la reconduire à sa place.
Ça, par exemple, c’était bien fait ! Chéri-Bibi se mit à rire comme un insensé. L’autre faisait une tête, mais une tête !... Ah !... bien ! il était remis à sa place !... Et comment !... Chéri-Bibi trépignait de joie. Il n’entendait pas autour de lui des personnes qui le considéraient avec effarement et qui disaient :
« Ce pauvre monsieur est fou ! »
La Ficelle dut le tirer par la manche pour le faire revenir au sentiment des réalités et des convenances... Ah ! que Chéri-Bibi était heureux maintenant ! Certes, il n’eût jamais douté de sa Cécily, mais enfin, si jamais on racontait des choses (les hommes, et les femmes aussi, sont si méchants), il savait, lui, que sa Cécily n’aimait pas le Pont-Marie. Il venait d’en avoir la preuve, bien mieux, cette scène au bal prouvait que jamais Cécily n’avait permis que Pont-Marie lui adressât le moindre propos « volage »...
Le comble fut mis à son enthousiasme quand il vit la jeune marquise du Touchais se pencher à l’oreille de la douairière et la décider à quitter la place. Elles se levèrent. Et Chéri-Bibi, qui se retenait d’applaudir, se disait en a parte :
« Tu as bien raison, ma chérie ! Je suis tout à fait de ton avis ! Va, ma colombe, rentre dans ton doux nid ! Cet endroit où l’on rencontre des baronnes Proskof et des Pont-Marie n’est point fait pour toi ! »
Justement, la baronne Proskof et son mari se trouvaient près de la porte de sortie au moment où les deux marquises allaient la franchir, après avoir pris congé du sous-préfet et de quelques-uns de ces messieurs, sous prétexte d’une grande fatigue de la douairière. La baronne avait demandé tout haut au baron de la conduire un instant dans les salons de jeux, et il y eut rencontre inévitable.
La « Belle Dieppoise », avec une hauteur sans pareille, passa devant Cécily en lui coupant carrément le chemin, et même en la bousculant un peu. Toute l’assemblée s’aperçut de cela, et il y eut un léger murmure. La Ficelle eut toutes les peines du monde à retenir Chéri-Bibi qui voulait sauter par la fenêtre et aller corriger dare-dare le baron. Une dame assise sur une banquette, non loin de Chéri-Bibi, dit tout haut :
« C’est honteux ! Mais la pauvre petite marquise fait bien de s’en aller ! Ce n’est pas la première fois que cette grue lui fait des avanies ! »
Chéri-Bibi, qui traînait derrière lui la Ficelle suspendu à son veston, courut au couloir de sortie et vit passer les deux marquises qui se dirigeaient vers la grille. Il les suivit. À la grille, par une fatalité cruelle, ces dames se heurtèrent encore à cette péronnelle de baronne, dont le mari appelait une voiture. Sans doute, du moment que Cécily quittait la place et qu’elle n’avait plus à lui imposer d’affront, trouvait-elle la soirée terminée et avait-elle résolu d’aller s’amuser ailleurs.
Les deux marquises attendaient leur auto.
Le malheur voulut encore que la pluie commençât à tomber drue et fine, ce qui amena une légère bousculade et de la précipitation dans le mouvement des équipages. L’auto des marquises se présenta dans le même moment que la calèche à deux chevaux demandée par le baron.
Aussitôt la « Belle Dieppoise » éleva la voix, pour commander au cocher de se hâter et de venir se ranger près d’elle, au plus court : ce que fit le cocher, gênant l’auto des marquises, qui dut attendre et s’arrêter net, au risque d’un accident.
La baronne en profita pour – passant sous le nez de Cécily – poser déjà le pied sur le marchepied. Mais elle dut se rejeter vite en arrière et elle poussa un cri d’effroi. Sous une poussée irrésistible, les deux chevaux, qu’un inconnu avait saisis au mors, reculaient en hennissant et en se débattant sous deux poings de fer, et tout l’équipage glissa en arrière, avec une brutalité et une rapidité inattendues.
Mais la place était dégagée et le chauffeur de la marquise put se ranger le long du trottoir. Les deux femmes montèrent vivement pendant que l’inconnu criait d’une voix retentissante :
« Les honnêtes femmes d’abord ! »
L’auto démarra en beauté, cependant que, penchée à la portière, Cécily essayait vainement de revoir le personnage qui lui valait cette extraordinaire revanche. Mais il avait déjà disparu. Et le baron Proskof, qui brandissait sa carte et qui ne savait à qui la donner, fut l’objet d’une risée générale.
« Il est temps de rentrer à l’hôtel, fit la Ficelle à Chéri-Bibi, après ce beau coup. Mais permettez-moi mon cher marquis, de vous faire remarquer, avec toute l’amitié que j’ai pour vous, que voilà revenue cette humeur batailleuse qui nous a valu déjà tant de déboires. Et puis, laissez se débrouiller entre eux chauffeurs et cochers. Prendre des chevaux au mors, faire reculer un équipage, c’est la besogne de palefrenier, monsieur le marquis ! »
II
Un joli monsieur
Cécily jouait avec son enfant. Greuze lui-même n’a jamais mis plus de grâce dans les jeux maternels. Ils se poursuivaient tous deux dans les allées ombreuses de la villa de Puys. Le petit Bernard, qui avait sept ans, était déjà un aimable garnement qui faisait de sa mère tout ce qu’il voulait. Les faiblesses de Cécily s’excusaient de toutes les misères de son foyer.
Son enfant était tout pour elle. Elle n’éprouvait aucune joie hors de lui. Et bien qu’il fût déjà fort insupportable, elle le trouvait le plus gentil des enfants des hommes. Il est vrai qu’il ne ressemblait point à son père.
Ce matin-là, qui était le lendemain de la fête du « Denier du pauvre marin », elle avait serré le petit Bernard sur sa poitrine avec une émotion exceptionnelle, et l’enfant s’en était aperçu. Il avait demandé :
« Qu’as-tu, maman ? Tu as du chagrin, tu as pleuré ? »
Et comme la mère, sans lui répondre, détournait la tête, il avait cassé d’un coup de pied solide son beau cheval mécanique.
De quoi Cécily avait été fort touchée. Avec cet aveuglement adorable des mères, elle se disait : « Du moment qu’il me voit du chagrin, le pauvre petit ne peut plus supporter ses jouets. »
C’était elle qui lui avait appris à lire, à écrire, à compter. Bernard, qui était extrêmement intelligent, s’était montré un écolier facile et la mère en avait conçu un orgueil incommensurable. Son fils était promis aux plus hautes destinées. Le ciel, qui avait départi à la pauvre mère de si grands malheurs d’une part, lui avait, d’autre part, donné bien de la consolation avec cet enfant-là. Elle ne souriait que lorsqu’elle était avec lui et faisait tous ses caprices.
L’enfant, du reste, adorait sa mère, qu’il trouvait belle, la plus belle de toutes les mamans, disait-il, et il aimait à couvrir de caresses et de baisers ses joues harmonieuses et ses beaux bras nus, relevant à cet effet, comme un jeune amant, les manches du peignoir.
« Bernard, viens m’embrasser !
– Oh ! maman, comme tu sens bon ! »
Elle n’était coquette que pour lui et se parait pour qu’il l’admirât.
Un domestique vint annoncer M. de Pont-Marie.
« Ah ! mon ami Georges ! Qu’il vienne, qu’il vienne tout de suite !... Courons, maman, au-devant de lui ! » s’écria joyeusement le gamin dont M. de Pont-Marie avait su se faire un ami en le gâtant de jouets et de friandises (Bernard était gourmand.)
Mais, au grand étonnement de Bernard, sa mère donna l’ordre au concierge de faire entrer M. de Pont-Marie au petit salon, et, prenant la main de l’enfant, elle l’entraîna dans sa salle d’études où elle le confia à « Miss ».
« Mais, maman, je veux voir mon ami Georges !
– Une autre fois, mon chéri. Maintenant il faut travailler. Miss, je vous le confie, ne le quittez pas ! »
Et elle l’embrassa avec passion. Mais le petit la laissa partir en boudant.
Cécily était très troublée. Elle passa dans son boudoir pour donner le temps à son émoi de se calmer un peu. L’audace de M. de Pont-Marie était vraiment excessive. Revenir ce matin, après ce qui s’était passé hier !... Elle soupira. Quelle basse engeance, en vérité, que celle des hommes !... Elle n’en avait connu qu’un, un seul qu’elle mettait au-dessus du troupeau !... mais un cœur d’or, celui-là !... et qui n’avait vécu que pour elle !... et dont l’image, entourée, hélas ! d’un cordon de deuil, ne la quittait jamais... Cécily, à ce souvenir, ne put retenir ses larmes. Mais elle les sécha vite, car elle se rappelait que M. de Pont-Marie l’attendait.
Elle se leva, se fit un front de colère et pénétra dans le petit salon, très émue au fond, et un peu plus pâle qu’à l’ordinaire.
En face d’elle « l’ami de la famille » se tenait incliné et fort correct, attendant un geste d’elle comme un étranger en visite.
Cécily lui montra un fauteuil, s’assit elle-même assez loin de lui et lui dit :
« Je suis satisfaite, monsieur de Pont-Marie, de vous voir ce matin. Vous saurez plus tôt ce que j’ai à vous dire. Il ne faudra plus mettre les pieds ici, mon pauvre ami.
– Madame ! protesta immédiatement « le pauvre ami » en se soulevant.
– Oh ! monsieur de Pont-Marie, vous êtes un homme du monde. Comment avez-vous pu vous conduire comme vous l’avez fait hier soir ?...
– Mais, madame, je vous assure que tous les hommes du monde à ma place en auraient fait autant. Vous étiez si jolie ! Ils n’auraient certainement pu résister au plaisir de vous le dire... Je vous l’ai dit ; je ne vois point que mon crime soit si grand !...
– Mais, monsieur de Pont-Marie, à quoi bon tout ceci ? Vous m’aimez, dites-vous ? Moi, je ne vous aime pas et ne vous aimerai jamais, et mon devoir est de ne point vous entendre plus longtemps. Une première fois, quand vous m’avez parlé de ces choses, je vous ai pardonné. Devant la menace de ma porte fermée, vous avez montré un si sincère repentir que j’ai eu pitié de vous, et aussi un peu, je dois le dire pour être exacte, de moi-même... J’étais si seule, si abandonnée, je n’avais pas d’amis... mon mari me délaissait... j’étais triste à mourir... depuis quelques mois vous sembliez avoir changé complètement votre vie, vous m’entouriez de soins si touchants, et apparemment si désintéressés, vous me plaigniez si bien et vous compreniez si parfaitement ma tristesse que j’éprouvais une réelle sympathie pour vous... je ne m’en défends pas, loin de là !... et puis, tout d’un coup, je me suis vue en face d’un homme comme les autres, qui ne demandait qu’à profiter de la faiblesse et de l’isolement d’une pauvre femme...
« Je vous assure que j’en ai eu, alors, la plus grande peine... et je suis bien excusable de vous avoir pardonné alors, une première fois !... Vous avez su vous faire aimer de mon enfant, mon Bernard, qui montrait toujours une si grande joie de vous revoir... de jouer, comme il disait, avec son bon camarade Georges ! Il était entendu qu’on ne reparlerait plus du passé... que vous en feriez loyalement l’essai... et peu à peu, je me suis laissée aller à la douceur de nos fréquentations, j’ai goûté à nouveau le calme de nos entretiens et tous les soins assidus de votre parfaite amitié... Je vois bien aujourd’hui qu’en agissant ainsi c’est moi qui étais coupable... Eh bien, monsieur de Pont-Marie, pardonnez-moi, comme je vous pardonne ces paroles enflammées et un peu ridicules que vous m’adressâtes hier... mais vous comprenez bien que l’expérience a assez duré... qu’elle est concluante... que nous ne devons plus nous revoir... Serrons-nous la main une dernière fois, et disons-nous adieu !
– Mais, Cécily, moi, je vous aime !
– Adieu, monsieur !