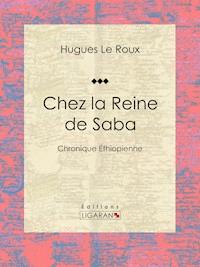
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Depuis que son nom a été prononcé pour la première fois, il y a trois mille ans, la Reine de Saba n'est jamais sortie de la mémoire des hommes. Des intérêts religieux et politiques l'ont, tour à tour, exaltée et puis diffamée. Au gré de l'heure, on l'a représentée comme une femme philosophe, comme une courtisane hardie, comme une magicienne."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335049893
©Ligaran 2015
Depuis que son nom a été prononcé pour la première fois, il y a trois mille ans, la Reine de Saba n’est jamais sortie de la mémoire des hommes. Des intérêts religieux et politiques l’ont, tour à tour, exaltée et puis diffamée. Au gré de l’heure, on l’a représentée comme une femme philosophe, comme une courtisane hardie, comme une magicienne. On lui a donné des sosies ; des points opposés de l’horizon ils s’acheminent vers Jérusalem avec des visages de couleurs différentes, voire avec des pieds d’oie et des sabots de chèvre.
De ces contradictions une évidence se dégage. Si la Grèce a gardé le reflet d’Hélène et la Méditerranée le nom de Cléopâtre, la région mystérieuse où le monde africain et le mondeasiatique se touchent s’est révélée dans le récit mi-légendaire, mi-historique, qui associe les souvenirs du Roi Sage et de la Reine Amoureuse.
Chaque contrée impose au type de femme qu’elle façonne une intensité particulière. La sensibilité du Nord se mire dans cette brume de découragement où Ophélie s’efface. L’innocence impersonnelle de Marguerite est broyée entre une obéissance instinctive aux appels de la nature, et les rigueurs de la convention sociale. Lucrèce Borgia, politique et jalouse, tue ce qui fait obstacle à sa passion ou à son ambition. Autant d’élans qui finissent dans la mort. Par contre, pour la Française, l’amour, c’est la vie, – la vie dès ici-bas aménagée comme dans un Paradis Terrestre.
Il était peut-être réservé à Israël, à qui la Reine de Saba se rattache dans les pages que l’on va lire, de produire la femme amoureuse, éprise à la fois d’un homme et d’un Idéal.
Privée de ce qu’elle a de spirituel, cette aventure de la Reine de Saba et de Salomon serait une fable banale. Ce ne sont, d’autre part, ni la tradition que la Reine incarne ni le sacrifice qu’elle consent qui l’imposent à nous. Ce qui nous émeut au travers de la passion qui la possède, c’est le triomphe de son âme, dans la douceur de l’amour auquel elle s’abandonne, c’est l’éveil de son espoir aux certitudes de la vie éternelle. Elleavait adoré le Soleil, la Nature. Elle adorera Celui qui a créé le Monde. Salomon féconde à la fois sa chair et son esprit. Vierge et Reine dans un pays où les femmes ont toujours régné, elle transmettra le sceptre à son fils avec la croyance qu’un homme lui a inspirée.
Au moment où, avec une violence que l’on regrette, les mœurs modernes insistent sur les inévitables oppositions des sexes, on prend plaisir à remettre en lumière cette histoire d’une femme que son simple amour pour un homme et sa foi parfaite en un Dieu rendent immortelle.
J’avertis ceux qui, en ma compagnie, chemineront au travers de cette chronique éthiopienne : le guide qu’ils vont suivre n’est pas un érudit. Seulement un chasseur, un voyageur de l’école du bon Hérodote, contant, sans parti pris, ce qu’il a vu, répétant ce qu’il a entendu. Aux savants techniques de choisir entre les traditions et les documents qu’on leur apporte ; à eux de les grouper en systèmes qui ne respectent pas toutes les conclusions de leurs devanciers, qui ne s’imposeront pas sans retouches aux inductions de leurs successeurs.
Sans sortir de la modestie qui convient à un homme de route, je remarque que, au cours d’une vie moyenne, j’ai assisté au total effondrement de la Légende. Je l’ai vue s’écrouler dans l’éclat de rire de la critique positiviste. On la saccageait avec une espèce de rage. On ne lui savait même plus gré de sa grâce poétique. Elle avait, paraît-il, été trop nuisible. Après cette éclipse, avec tous les enfants, tous les jeunes gens de ma génération, j’ai marché dans les chemins desséchés de la critique pure. Je ne dis pas que cette discipline ne nous a pas été bienfaisante, mais, à la façon d’un traitement dont le malade s’affranchit après la convalescence.
Sur la fin de cette longue journée, avant que pour moi et pour ceux de ma génération la nuit se refasse, le rayon doré de la Légende, son azur, ses pourpres, réjouissent à nouveau les grisailles de notre ciel. On s’avise que l’on a eu tort de fermer les yeux toutes les fois qu’elle éclairait l’horizon, de se boucher les oreilles toutes les fois qu’elle chantait sur les lèvres de la foule. On recommence à convenir qu’il y a de la vérité dans ses réminiscences d’aïeule. On reconnaît que la tradition colportée enferme peut-être autant de vérité que les chartes, les inscriptions, les parchemins. S’ils sont la lettre, elle est l’esprit.
N’est-ce point d’hier qu’en traitant par les procédés de la science moderne les poussières de la mine, nos prospecteurs tirent souvent plus d’or que de la poursuite du filon ?
Je ramasserai ici sans critique cette poussière de la Légende Dorée et je demanderai à nos savants de l’analyser encore une fois.
Toutes les chances de connaître la vérité sur les origines des peuples qui se développèrent entre la Mer Rouge et le Nil ne tiennent point peut-être dans des hypothèses un peu surannées. N’a-t-on pas commis une injustice en écartant a priori le témoignage que les Éthiopiens rendent sur eux-mêmes, dans ce procès historique, où, si souvent, en l’absence de documents irréfutables, il faut se contenter de recueillir la tradition et de la filtrer ?
Le Royaume d’où la tradition éthiopienne veut que sa Reine soit descendue pour aller à Jérusalem saluer le Roi Sage se révèle d’abord au visiteur comme un lieu prédestiné.
Entre les vallées de la Mer Rouge et des Nils, l’Éthiopie prend la figure heureuse d’un château d’eau qui, au-dessus des marais et des déserts, monte, superbement, vers le ciel.
Trois secousses sismiques l’ont constituée en trois étages. À trois mille mètres d’altitude s’épanouissent les villes : la capitale elle-même, cet Addis-Ababâ dont le nom signifie « Nouvelle Fleur ».
Deux termes fixes, la latitude équatoriale qui impose la chaleur, l’altitude alpestre qui apporte le rafraîchissement, combinent ici leurs effets pour attribuer à cette terre de prédilection les vertus de trois serres superposées. Au pied du plateau, c’est la serre chaude ; à la hauteur des pays gallas, la serre tempérée ; en haut, la serre froide.
Trois fleuves, nés des brouillards de l’Océan Indien, tout chargés de la lente désagrégation d’une roche très ferrugineuse, coulent sur les flancs de cette Suisse africaine : le Nil Bleu s’échappe dans l’orientation d’un Rhin ; il va vers la Méditerranée ; l’Aouache ruisselle vers l’est, dans le départ d’un Danube ; l’Omo fuit au sud vers les grands lacs, comme notre Rhône vers la mer provençale.
Façonnée pour être nourricière d’hommes et de chevaux, cette forteresse montagnarde est sûrement apparue à ceux qui, les premiers, l’escaladèrent, sous les apparences d’une Terre Promise.
Ce n’est pas impunément que d’une telle hauteur l’homme contemple de tels paysages, et que, dans les richesses de la nature qui l’entoure il trouve une occasion de remercier cette « Immense Bonté, qui tombe des étoiles ».
Quels qu’aient été les aïeux de cette Reine si sage, si tendre, elle a contemplé de ses yeux les montagnes que j’ai vues, ces vallées, à l’aurore pleines de lumière bleue, ces prairies chargées de troupeaux domestiques et sauvages, ces fleuves qui font ruisseler la fécondité, ces lacs qui reflètent le ciel.
De tels spectacles ont un double effet sur l’âme : ils l’affranchissent des inquiétudes trop pesantes qu’impose à des peuples moins favorisés la conquête du pain de chaque jour ; et puis, dans un détachement facile des préoccupations trop matérielles, ils donnent à la pensée comme au cœur plus de loisir pour s’attacher aux conquêtes spirituelles.
C’est sans doute le cas de rappeler qu’il convient de distinguer les peuples qui vivent de l’idée de « patrie » d’avec ceux qui évoluent dans le concept de la « race ».
Typiquement les Anglo-Saxons ont trouvé dans la formule de la race leur force d’expansion et les raisons de leurs supériorités. Une terre incapable de les nourrir leur sert de berceau. Dès l’enfance ils rêvent aux possibilités de la quitter pour leurs affaires, au moins pour leurs plaisirs. Et ils vont travailler dans le monde au triomphe de la race anglo-saxonne.
Au contraire une « patrie », c’est une « terre d’aboutissement ». Peu importe que ceux qui, à des heures anciennes de l’histoire, se sont établis sur ce sol, y soient venus, eux aussi, en immigrants. Dès qu’ils ont goûté à la douceur de la terre vers laquelle leur humeur vagabonde où quelque cataclysme les avait portés, ils perdent tout désir de connaître des lointains nouveaux. Comme des nourrissons, ils s’étendent contre le sein de cette bonne mère. Ils sucent son lait. Ils se laissent transformer par sa substance, modeler par ses caresses. À côté de leurs berceaux ils veulent leurs tombeaux. L’amour succède à la violence. Le rêve des créations durables remplace l’ancienne passion pour le rapt et pour la destruction. Les heures de la civilisation sont commencées. Une clarté s’allume qui d’abord éclairera les habitants de cette terre bénie, et puis l’Humanité.
C’est ainsi que la France s’est formée, ainsi qu’elle est aimée, d’une tendresse qui, comme le veut la pensée catholique dans le mystère de sa communion, comporte l’union intime et totale avec l’idéal recherché.
De la même façon l’Éthiopie est une « patrie ». De la même façon elle a été aimée par sa Reine, de la même façon elle est encore chérie par ces hommes dont j’ai fait mes compagnons.
C’est dans la Mer Rouge, à travers les voiles d’un boutre arabe, que cette patrie montagnarde m’est apparue pour la première fois.
Le musulman qui tenait la barre étendit le bras vers le couchant. Autour des lèvres il avait un pli de dédain.
Il dit :
– Ça ?… C’est le pays des Habech.
C’est-à-dire des « métis ».
L’épithète d’« Abyssins » que les descendants de la Reine de Saba et du Roi Salomon écartent pour se désigner eux-mêmes sous le nom d’« Éthiopiens » découlerait de cette flétrissure.
Je sais que de notoires philologues haussent les épaules quand on soumet à leur verdict cette étymologie pittoresque. Le fait que précise cette anecdote doit, en tout cas, être retenu. Il reflète le dédain que des hommes vivant, comme les Arabes, des disciplines de la race pure, professent pour des voisins qui, d’eux-mêmes, placent une bâtardise à l’origine de leurs sources ethniques et religieuses.
Que de fois en voyant passer, avec une charge sur leurs têtes, ces femmes si libres, si fières, que l’on croise dans les chemins, quand de la Mer Rouge on monte vers le Haut Plateau, je me suis demandé :
– À laquelle de ces coéphores a-t-elle ressemblé la « Belle à la figure noire » que Salomon aima ?
Le fait est qu’il est plus malaisé d’établir la qualité et la date des immigrations humaines dont ces plateaux ont reçu les apports que de dresser la carte géologique de l’Éthiopie elle-même à travers les sursauts que lui imposa le feu.
Il suffit toutefois à un chasseur de dévisager les hommes qui forment son escorte, et puis les gens qu’il croise dans les pistes, pour démêler que les Éthiopiens proprement dits ne diffèrent pas seulement par la langue, mais par la race, des peuples qui, du sud au nord, de l’est à l’ouest, encerclent ce plateau.
J’ai vécu dans la camaraderie des grandes chasses avec les Somali-Issas ; je les ai visités dans le Somaliland anglais ; j’ai été frappé de leur parenté avec les Hindous. Et aussi bien n’est-ce pas sans raison que l’on a donné le nom d’Océan Indien à la mer qui, dans ces parages, relie les littoraux de deux continents.
Pour les Danakils qui forment un État tampon entre les pays somalis et la montagne éthiopienne, comment les rattacher avec sécurité à une origine définie ? On évoque à leur sujet le souvenir de ces Hyksos, dans lequel d’aucuns croient apercevoir des Chananéens égyptianisés. Ceci est sur : comme s’ils entretenaient un souvenir atavique, ces pasteurs continuent à décolorer leurs cheveux avec de la chaux. Ils ont la volonté de se rendre blonds ou roux. Leurs femmes sont coiffées à la mode des sphinx. Leur sommaire mobilier rappelle quelques-uns des objets qui furent les plus familiers aux sujets des Pharaons. Et, peut-être, surnage ici un débris de ces migrations qui, successivement, couvrirent l’Égypte, puis se fondirent dans le Nil.
Pour les Gallas qui, du sud-est à l’ouest-nord-ouest, cerclent, à mi-hauteur, la montagne éthiopienne, verrons-nous les modernes historiens des Celtes les rattacher un jour à la poussée des hommes blonds venus de l’Ouest, qui suivirent les vallées du Pô, celles du Danube, franchirent le Bosphore, et allèrent jeter leurs filets dans le lac de Tibériade ? Cette hypothèse a été émise par un missionnaire, d’ailleurs fort renseigné sur le compte des gens dont il raisonnait, et elle a fait sourire les philologues. Ceci est sûr : les visages de ces Gallas rappellent les traits des paysans des contrées gallo-romaines plutôt que ceux des sémites bédouins ou Beni-Israël.
Quand les prisonniers italiens entrèrent en contact avec ces rustres d’Afrique, des unions se nouèrent, fécondes, dans un attrait réel. Les Gallas sont d’ailleurs pasteurs et cavaliers. Ils ne témoignent d’aucune des aptitudes administratives, politiques et financières, qui apparaissent si remarquables chez les Éthiopiens proprement dits. Ils étaient prédestinés à être conquis par les maîtres des Hauts Plateaux. Leur courage n’était pas de qualité inférieure, mais à une bravoure notoire ils mêlent ces penchants anarchiques dont parle César quand il juge les Gaulois et quand il énumère les raisons qui causèrent leur défaite.
Enfin, s’il est des peuples avec lesquels les Éthiopiens n’ont aucune parenté quelconque, ce sont bien ces farouches nègres Béni-Changouls dont j’ai exploré l’habitacle en 1901.
La hideur de ces monstres aux faces à peine humaines, est si repoussante, que leurs femelles elles-mêmes ont été refusées par les vainqueurs toutes les fois qu’une razzia a fait des prisonniers, sur le bord des marais où les Beni-Changouls vivent, nus, logés dans les arbres, exclusivement nourris de rats que le soleil boucane.
C’est sur le plateau le plus élevé, là où, maîtres de la hauteur, vivent les Éthiopiens proprement dits que j’ai rencontré celles qui peuvent prétendre à l’honneur d’avoir servi par les mains de leurs aïeules l’Amoureuse de Salomon. À travers les accidents du métissage, des apparences, très fixes et très caractéristiques, se dégagent de leur aspect.
Les variétés les plus en relief du masque bien connu d’Israël se manifestent ici dans le dessin des visages.
Je ne songe pas à ces types d’Israélites européens que des milieux tels que la Russie, l’Allemagne, la France, l’Espagne ont façonnés ; je pense aux Beni-Israël que j’ai rencontrés dans l’Afrique méditerranéenne, – par exemple, à Tougourt, où des Juifs qui, depuis plus d’un demi-siècle, ont renoncé au mosaïsme, continuent de se marier entre eux.
Cette présence sur la montagne éthiopienne d’Israélites qui reproduisent avec tant de pureté les types originels de leur race peut s’expliquer de deux façons : par une immigration relativement récente, ou par la version que nous apportent les Éthiopiens eux-mêmes.
Il s’agirait dans ce dernier cas de la fécondation par un large afflux de sang jacobélite, des peuples qui habitaient primitivement autour des sources du Nil Bleu. La vague en aurait déferlé sur le Haut Plateau au moment même où le gros des Beni-Israël quittait l’Égypte sous la conduite de Moïse. Il resterait encore en Éthiopie des représentants de cette colonisation archaïque. Le mot d’ordre serait de faire le silence sur leur existence, sur leurs pratiques. Abadie semble les avoir ignorés. Je répéterai à leur sujet ce que le Ras Makonnen me confia dans une minute d’expansion.
Le Ras Makonnen apercevait dans ces Éthiopiens archaïques les directs ancêtres de la Reine de Saba. Il les logeait dans la région du lac Tzana. Avec ses compatriotes il les désignait sous le nom de « Kemant » pour lequel il acceptait cette traduction : les « aïeux ».
J’avais profité d’un séjour qu’il fit à Addis-Ababâ en 1904 pour l’interroger sur les origines de son peuple. Seul peut-être parmi les siens il pouvait raisonner d’un tel problème du double point de vue éthiopien et européen.
– Ces « Kemant », me dit-il, sont les descendants de ces Fils de Jacob qui, pendant leur séjour en Égypte, étaient tombés dans le culte des faux dieux. Après le départ de Moïse ces idolâtres crurent qu’en raison de leur apostasie, ils pourraient se maintenir dans le Delta. Mais, en quittant la « Maison de l’Esclavage », les Israélites avaient surexcité la haine populaire. On leur attribuait les maux, – les « plaies », – dont bêtes et gens étaient ravagés. De leurs péchés, vrais ou imaginaires, on rendit responsables les frères rénégats qu’ils avaient laissés derrière eux. On s’acharna sur ces étrangers avec la volonté de les détruire. Eux s’enfuirent, non pas du côté de la Mer Rouge qui, sans doute, ne se serait point rouverte pour leur livrer passage, mais vers la Haute Égypte. Ils remontèrent le Nil. À la bifurcation des deux cours d’eau ils suivirent le Fleuve Bleu. Ainsi ils arrivèrent jusqu’à sa source éthiopienne, au lac Tsana. C’est là qu’ils habitent encore. Ils se marient entre eux. Ils n’ont pas fini d’adorer Osiris et Isis.
Lors de mon voyage au Ouallaga, j’avais eu l’occasion de toucher du doigt la rigueur avec laquelle, depuis sa conquête récente, l’Éthiopie traite le paganisme des Gallas. Je ne pus m’empêcher d’exprimer au Ras mon étonnement que, si près de son trône, Ménélik tolérât chez des sujets peu nombreux, certainement inoffensifs, une idolâtrie si caractérisée.
Le Ras me répondit avec une nuance d’hésitation :
– Nous touchons ici à la tradition même de nos origines. Dans ces « Kemant » qui montèrent d’Égypte pour échapper à un massacre, l’Empereur lui-même ménage, sans trop se l’avouer, nos directs aïeux. C’est par eux que nous descendons des Enfants de Jacob ; par eux que fut constitué sur cette montagne un royaume qu’ils organisèrent d’après les traditions religieuses et d’après les symboles qu’ils avaient rapportés d’Égypte. Enivrés de la beauté de la terre qu’ils venaient de découvrir, ils s’attachèrent d’un amour jaloux au principe femelle de la Vie. En lui, comme les Égyptiens, ils aperçurent la source de toute fécondité. Ils voulurent être gouvernés par les Reines-Vierges qui, pour eux, reflétaient sur le trône, l’image de l’Isis. Successivement ils placèrent auprès de ces reines des intendants mâles qu’ils appelaient les « Chefs des Commerçants ». Ces personnages avaient la haute main sur la gestion des affaires temporelles. Et quatre cents années passèrent ainsi au cours desquelles l’Éthiopie se fonda dans une grande paix et dans une grande prospérité. Nos aïeux n’oubliaient pourtant pas leurs origines jacobélites. Ils conservaient un vif désir de savoir ce qu’étaient devenus après le passage de la Mer Rouge ceux de leurs sangs qui avaient suivi Moïse en Asie. Leur curiosité se rencontra avec les intentions de Salomon. Ce grand politique voulait attirer dans l’orbite de son influence des peuples nombreux. Il avait fait publier aux limites de son monde qu’il paierait au double de leur prix les matériaux précieux qu’on lui livrerait pour la construction du Temple. Même avec la lenteur que les nouvelles mettaient alors à se propager, peu de mois suffirent pour que, par la Mer Rouge, l’Érythrée, le Tigré, une telle indication parvînt aux oreilles des nôtres. Ils avaient à fournir de l’or, du bois de cèdre, de l’ivoire. Surtout ils voulaient profiter de l’occasion pour renouer avec les parents perdus qu’ils se connaissaient du côté de l’Est. La Reine qui régnait alors sur le plateau d’Éthiopie se nommait Makeda. Bien entendu, comme le font encore aujourd’hui les Kemant, elle adorait Isis. Elle dépêcha vers Salomon le Chef de ses Commerçants. Celui-ci, au retour de son voyage, décrivit de façon si entraînante les miracles dont il avait eu le spectacle, que la Reine rêva de se rendre elle-même à Jérusalem. Elle accomplit le projet qui lui était si cher. Elle vit Salomon. Elle l’aima. Elle revint grosse de ses œuvres. Elle mit au monde un fils, l’aïeul de notre Ménélik, auquel elle donna le nom de Baina-Lekhem c’est-à-dire « Fils du Sage ». C’est là une histoire dont vous avez des notions. Je souhaite que l’occasion vous soit un jour donnée de la connaître en son entier, car elle est l’expression de la vérité, et de la vérité ne peut sortir que le bien.
Ceux qui ont connu le Ras Makonnen et franchi le rempart de timidité derrière lequel cet intrépide soldat se murait dans la causerie savent que sa vie spirituelle fut intense. Cette noble disposition s’alliait malheureusement chez lui à des accès de scrupules dont le caractère était presque maladif.
Regretta-t-il, au lendemain de notre entretien, de m’avoir si librement découvert sa pensée sur un sujet qui en Éthiopie n’est pas seulement le fondement de la religion mais tout le soutien de la politique ?
Je ne réussis plus par la suite à mettre l’entretien sur le compte des Kemant. Il semblait avoir oublié leur existence. En revanche il prenait plaisir à me faire toucher du doigt les raisons morales que les Éthiopiens invoquent à l’appui de la tradition qui les rattache à des Israélites échappés d’Égypte et montés sur le Haut Plateau par le chemin des Nils.
Au cours de ces causeries, le Ras se plaisait à laisser transparaître son érudition des choses sacrées. Tout comme notre grand Condé, cet homme de guerre avait poussé loin sa culture théologique.
Et aussi bien la théologie est-elle la seule gymnastique de philosophie et la seule école de politique léguée par le byzantinisme à ses clients de cette banlieue d’Afrique.
Sans doute, me disait le Ras, nos aïeux avaient commis le crime de s’adonner aux cultes égyptiens. Ils avaient péché par politique autant que par faiblesse. Mais, sous cette écorce de mensonge, ils conservaient, croyez-le bien, la pure doctrine des patriarches. Ils sont toujours demeurés étrangers au culte de Jahvé. Ils ont ignoré cet égoïste Protecteur d’Israël qui se fait cruel dans l’intérêt de son peuple favori. L’élan qui obligea cette Reine éthiopienne, dont je vous parlais naguère, à venir trouver Salomon, fut, en vérité, la mémoire, conservée au fond des cœurs, de cet Élohim, absolu, simple, juste, universel, Roi et Providence de l’Univers, que, dans les contemplations de leurs nuits, les patriarches avaient aperçu derrières les étoiles. Qu’est-ce qu’une Reine d’Éthiopie et son peuple auraient eu à faire d’un Dieu étroitement national comme le fut Jahvé ? Ce qui passionnait les nôtres dans la tradition qui leur était restituée, c’était le noble idéalisme, la tradition du Grand Dieu, du Père Universel, que Jésus, plus tard, devait nous rapprendre à invoquer dans son oraison dominicale.
Et, avec une flamme dans ses yeux de Christ byzantin, le Ras concluait :
– Ceci est la double grandeur de l’Éthiopie : dès ses origines elle chérit passionnément la Vérité. Elle aime la Vérité plus que son idolâtrie égyptienne, plus que la révélation dont Salomon la gratifie quand il initie la Reine Makeda aux mystères de son Arche d’Alliance. Lorsqu’au troisième siècle de notre ère Frumentius vient lui apporter la parole chrétienne, elle consent tout de suite à se détacher du Dieu que l’on enferme dans un tabernacle afin d’adorer le Dieu que l’on porte dans son âme. Elle voit dans la Rédemption de Jésus s’accomplir les promesses d’Élohim. Puisse-t-elle rester fidèle à cette Vérité définitive sans négliger pourtant les progrès dont j’ai eu le spectacle au cours de mes voyages en Europe et dont notre Négus est si résolument épris !
Les Européens qui, dans les vingt-cinq dernières années, sont montés sur le Haut Plateau, ont eu sous les yeux l’illustration vivante de ce double état d’âme salomonesque et évangélique dans lequel le Ras Makonnen apercevait la grandeur particulière de sa nation. Ils ont contemplé le Négus Ménélik, roi très chrétien, rendant la justice suprême, la Bible en main, dans les termes mosaïques du code de « la dent pour la dent. » J’ai eu la curiosité d’aller au-delà de cet impressionnant spectacle. Je me suis fait commenter les premières pages de ce code éthiopien qui, dans ses traits essentiels, reproduit le Code Justinien. Elles gardent la trace de l’émotion qui assaillit les Négus lorsque, après leur conversion au christianisme, ils se demandèrent, avec un grand trouble, si, afin de se conformer à la Loi de Jésus, il leur fallait renoncer au droit de punir.
Dieu seul pouvait répondre à ces angoisses de conscience.
Dans la préface que les Éthiopiens ont ajoutée au Code byzantin le Saint Esprit apparaît à une assemblée d’évêques. Il les charge d’informer les Chefs des Peuples que la Loi du Pardon est encore un idéal. Elle ne peut être appliquée en toute occasion dans les affaires de ce monde. Il convient de la réserver pour les rapports privés, entre chrétiens, entre frères. En attendant que les hommes deviennent meilleurs, le droit public est encore obligé d’appliquer aux délinquants la vieille formule du Code mosaïque.
Ce serait méconnaître cet amour de la vérité la plus haute qui, il y a trois mille ans, mit la Reine Makeda dans le chemin du pèlerinage et dont les fils de ses fils sont restés possédés, qu’apercevoir un compromis hypocrite dans cette adhésion au pardon privé, sous la réserve d’une impitoyable rigueur de la loi publique. Dans l’âme de chaque Éthiopien se continue ce débat moral qui fit hésiter les Négus du troisième siècle au seuil de leur conversion.
Que de fois, sans sortir de mon camp, j’ai assisté à cette scène :
Une querelle s’était produite entre mes soldats, les couteaux avaient brillé, le sang avait coulé. Le blessé m’apportait sa plaie.
Il me disait :
– Tu connais notre loi ? Œil pour œil…
La journée ne finissait point sans que le même homme revint, cette fois entouré des plus vieux d’entre ses compagnons. De loin, l’aspect de la petite troupe avait une allure solennelle qui m’avertissait du but de la démarche.
Et le plus âgé disait :
– Tout à l’heure notre frère a réclamé son droit, – mais nous l’avons rappelé à lui-même. Nous ne poursuivons plus la Vengeance : nous sommes les Gens de la Rémission. Celui qui a été offensé vient te dire qu’il pardonne.
Cette maîtrise des passions de revanche descend de l’Élu de Juda sur ses peuples.
Nul ne s’étonnera que les vainqueurs d’Adoua aient tout d’abord pris plaisir à commémorer le souvenir de leurs succès. Aussi bien le hasard a-t-il voulu que la date de cette bataille correspondit avec les retours de la fête de saint Georges, qui est le patron militaire de l’Éthiopie. Or il arriva qu’au moment où l’Italie reprenait avec le Négus des rapports diplomatiques l’officier distingué qui venait représenter son pays en Éthiopie se présenta aux portes d’Addis-Ababâ la veille des anniversaires d’Adoua et de la fête de saint Georges.
Ménélik lui envoya ce message :
« J’ai renoué mes relations avec ton pays. Entre chez nous sans inquiétude. Ici tu ne verras rien qui t’attriste. »
Depuis, la fête religieuse de saint Georges est célébrée comme autrefois, mais la parade militaire, les salves de canons ont été supprimées.
J’ai eu l’occasion de peindre ailleurs les rapports que Ménélik a entretenus avec les Puissances européennes. Je voudrais noter ici les aspects de caractère, les gestes instinctifs et voulus par lesquels ce Négus s’est révélé comme le continuateur de la tradition, qui, à travers le cœur de Makeda, le rattachait au Temple.
Dans des contacts avec les publics européens, voire avec des chancelleries, j’ai eu l’occasion de constater que l’énumération des titres qui s’alignent au-dessous du sceau impérial d’Éthiopie et en tête des lettres officielles du Négus « Lion Vainqueur de Juda, Élu du Seigneur, Roi des Rois » provoquent, chez des gens insuffisamment renseignés, un imperceptible sourire. Ce serait commettre une faute de goût que de hausser délibérément les épaules parce que ces dignités ont eu leur développement à l’écart de nos souvenirs et de nos propres grandeurs.
La tradition éthiopienne conte que, vingt années après la visite qu’il avait reçue de la Reine Makeda, Salomon vit entrer dans Jérusalem, un jeune homme accompli. Cet adolescent reflétait, trait pour trait, les apparences de son propre visage. Et c’était ce Baina-Lekhem que la Souveraine d’Éthiopie avait conçu de ses œuvres.
Le jeune prince venait aviser son père que, par la grâce du Très Haut et par l’effet du zèle de Makeda, la doctrine du vrai Dieu s’était heureusement développée sur la montagne africaine. Afin d’interrompre les pratiques d’idolâtrie qui perpétuaient sur le trône d’Éthiopie les souvenirs égyptiaques de l’Isis, Makeda était résolue à clore avec son règne la lignée des Femmes-Reines. Elle avait décidé d’abdiquer elle-même entre les mains de son fils.
Mais il convenait que ce fondateur d’une dynastie nouvelle fût un oint du Seigneur. Baina-Lekhem venait donc demander à son père la bénédiction qui, dans le Temple, descend des mains du Grand Prêtre.
L’histoire éthiopienne veut que Salomon ne se soit point contenté d’exaucer un désir si pieux. Afin de lier plus étroitement la fortune de son fils avec les destinées d’Israël, il aurait résolu d’élever avec des pompes de trônes et des titres de rois douze représentants des douze tribus jacobélites au-dessus des provinces d’Éthiopie. Il aurait complété l’organisation qu’il créait en plaçant son propre fils, Baina-Lekhem, oint de Juda, au sommet de cette hiérarchie. Il l’aurait honoré du titre de Négus des Négus, c’est-à-dire de Roi des Rois.
Ainsi cette dénomination correspond en somme à celle de « comtes » et de « ducs », dans la hiérarchie d’un état féodal, dominé par un seigneur suzerain. L’équivalence est, dans l’occasion, si rigoureuse que la forme de commandement ici dépeinte a représenté pour l’établissement de l’unité éthiopienne les mêmes chances de progrès et de faiblesse que les luttes du Roi de l’Île-de-France contre ses ducs d’Aquitaine, de Bourgogne et de Normandie.
Lorsque, d’autre part, on passe à vol d’oiseau par-dessus les convulsions de l’histoire d’Éthiopie, on constate que les heures de sa paix, de sa prospérité, coïncident avec les phases où la tradition salomonesque s’est tenue en équilibre. Ce sont les périodes où la dynastie des suzerains, – en l’espèce les Rois de Choa, directs aïeux de Ménélik, – réussit à contenir et à dominer les puissants vassaux. Au contraire, l’anarchie, les invasions, les guerres civiles, suivent toutes les usurpations des ducs ou comtes, qualifiés « rois » qui, à l’aide de leurs sièges d’administrateurs de provinces, escaladent pour un temps le trône du Roi des Rois.
On peut juger par là de l’importance que l’histoire générale d’Éthiopie attribuera au règne de Ménélik : il a été le restaurateur de la tradition écroulée. Par la persuasion comme par la force il l’a relevée sur son socle.





























