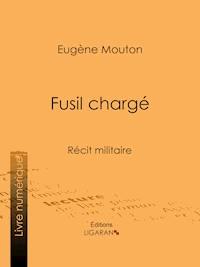Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "La mort, oui, la mort ! est préférable à l'état où je me trouvais ! On m'enfonça mon chapeau sur la tête, on me fourra mon paletot, la porte s'ouvrit, quelqu'un me poussa par les épaules, je descendis l'escalier en trébuchant, et par une allée étroite et obscure je me dirigeai comme je pus, en tâtonnant le long d'une muraille humide, vers la porte de cette maison."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La mort, oui, la mort ! est préférable à l’état où je me trouvais !
On m’enfonça mon chapeau sur la tête, on me fourra mon paletot, la porte s’ouvrit, quelqu’un me poussa par les épaules, je descendis l’escalier en trébuchant, et par une allée étroite et obscure je me dirigeai comme je pus, en tâtonnant le long d’une muraille humide, vers la porte de cette maison.
Il était cinq heures et demie du matin ; il faisait nuit, la pluie tombait, et à travers des nuages roulant tumultueusement dans le ciel, on voyait tour à tour pâlir et s’aviver la lumière trouble de la lune. Devant moi, les rues et les carrefours de la grande ville s’étendaient pareils à des fleuves ou à des lacs de fange, et sur cette surface noire et luisante les becs de gaz traçaient leurs sillons de feu.
Rien, rien n’est sinistre comme l’aspect de Paris par une nuit d’hiver, lorsqu’on le voit béant, silencieux, couvert de la boue infecte que verse chaque jour sur son pavé la corruption de deux millions d’hommes ; rien n’est plus sinistre, surtout quand on sort d’une nuit d’orgie.
Et j’en sortais.
Oui, de faiblesse en faiblesse et de chute en chute, j’en étais venu à ce degré d’abaissement, de demander à l’orgie ses hoquets pour soulever du moins ce cœur que rien ne pouvait plus faire battre ! Amitié, devoirs, intérêts, plaisirs, amour même, j’avais tout renié, tout brisé, tout foulé aux pieds, tout jeté au vent avec des cris de malédiction et de rage. En quelques années de cette vie-là, j’étais arrivé peu à peu à la crise finale qui est la conséquence de la débauche, et qui en est l’expiation. Un égoïsme furieux, implacable, s’était élevé comme un mur de glace entre mon cœur et tout ce que j’avais aimé sur la terre. L’amertume du remords, le déchirement des regrets, la honte aussi et le dégoût de moi-même m’avaient enfoncé lentement dans le cœur les griffes empoisonnées de la jalousie, et mes mauvaises actions, le châtiment qui les suivait pas à pas, les grondements de ma conscience irritée, m’étaient moins durs encore que ces reproches terribles, que ces humiliations accablantes, dont je me sentais couvert quand je voyais passer un honnête homme ou que j’entendais parler de la vertu.
Or, à mesure que je me voyais ainsi m’abîmer dans la boue, je m’apercevais avec épouvante que ce MOI insatiable dont j’avais fait mon dieu et à qui j’avais sacrifié tout ce que j’aimais et tout ce que je croyais, je ne l’aimais plus, je ne croyais plus en lui, et qu’il me faisait horreur !
Un seul sentiment noble m’était resté : l’honneur ; et quoique je sentisse venir l’instant où cela même aussi allait m’échapper, je m’accrochais comme un naufragé à cette épave de mon âme prête à couler bas !
Mais, toujours debout et toujours indompté, l’orgueil aussi restait insensible à tant de hontes bues, à tant d’humiliations subies : comme deux frères ennemis qui se dévorent des yeux au moment de se combattre, mon orgueil et mon honneur se mesuraient pour la lutte suprême qui devait décider de mon sort.
J’étais devant ma maison. Je sonnai, la porte s’ouvrit, je montai l’escalier, et je me retrouvai dans mon appartement. Je me laissai tomber sur une causeuse et je m’endormis du lourd sommeil de l’ivrogne.
Lorsque je me réveillai, le jour était venu, un jour blafard et sinistre. Je parcourus du regard tout ce qui m’entourait, et dans ces meubles en désordre, dans ce pêle-mêle de mille objets jetés ou entassés au hasard, je pouvais voir le tableau fidèle de ma vie. Rien n’y manquait : ni la table de travail, où les flacons et les jeux de cartes avaient remplacé les papiers et l’écritoire ; ni les viles défroques dont je m’affublais dans les nuits de carnaval ; ni la feuille de papier timbré où l’huissier avait griffonné son grimoire ; ni le lit tout bouleversé, tout souillé, à peine refroidi de ma dernière débauche ; ni l’épée rouge encore du sang de mon meilleur ami, que je venais de blesser en duel ; ni enfin, sur un meuble à côté de mon lit, la bouteille d’eau-de-vie et le verre à moitié plein, qu’un soulèvement de cœur ne m’avait pas permis d’achever.
De ces cristaux, de ces draps blancs, de ces étoffes chatoyantes, de cette épée, de cette épée surtout, je voyais s’élancer des rayons et surgir des éblouissements qui m’aveuglaient et me forçaient à détourner les yeux : mon regard, fuyant tous ces éclairs qui le blessaient comme autant de pointes aiguës, finit par s’arrêter sur le portrait de mon père.
Mon père ! Il était là, représenté debout, en grand uniforme, le corps de trois quarts, la tête de face, la main droite sur son cœur, la main gauche sur la garde de son épée ; noble et fier, énergique et un peu triste, tel enfin que l’avaient fait les évènements de sa vie et les agitations de son cœur. Par l’effet d’une illusion qu’on éprouve toujours lorsqu’on regarde un portrait, il me semblait que ses yeux ne quittaient pas les miens, et qu’il allait me parler. Je baissais la paupière, mais à l’instant une force supérieure à ma volonté me contraignait à la relever, et ce regard profond et douloureux pénétrait à chaque fois plus avant dans mon âme comme un reproche et comme un remords.
Je n’y pus tenir et, changeant de place, j’allai me jeter sur un fauteuil où j’étais placé de manière à ne plus apercevoir le portrait.
Mais alors je vis apparaître à mes yeux une image plus effrayante que celle de mon père, la mienne, qu’une glace me renvoyait !
Non, il n’est pas de spectacle plus affreux pour une créature humaine que celui de sa propre dégradation ! Cette face livide, ces lèvres contractées et blêmissantes, ces joues creuses, ces yeux cerclés de plomb et bordés de sang, ce regard fauve, ces cheveux et ces vêtements flottants et dispersés comme au souffle d’une tempête, me firent éprouver un tel mouvement d’horreur, que je me soulevai de mon siège, et, tendant le poing, je m’écriai :
– Misérable ! maudit !
Je retombai assis, et, prenant ma tête entre mes deux mains, je pleurai.
Peu à peu, à mesure que mes larmes coulaient, je sentis mon cœur se gonfler, battre enfin, comme si le cercle de fer qui l’étranglait depuis si longtemps se fût relâché. Il me sembla voir le présent se décolorer et me découvrir, dans un rêve lointain, l’image de ce que j’avais été autrefois.
De tous les châtiments de la conscience, il n’en est pas de plus cruel que ce déchirement du cœur partagé entre le mépris de soi-même et la pitié pour soi-même aussi ; mais ce qu’on ne dit pas, ce qu’on ne sait pas assez, c’est l’infinie tendresse des regrets que nous cause le souvenir de l’innocence perdue.
Je me voyais enfant, adolescent, jeune homme, homme fait ; le front radieux, le cœur léger, le sourire aux lèvres, me roulant et me baignant dans la vie, la buvant à longs traits, et tout mon cœur se fondait dans un inexprimable attendrissement. Et là, devant moi, me menaçant, me dévorant des yeux, le misérable, le maudit.
Lui !
Moi !
Moi… Était-ce donc moi, cet être odieux de qui l’aspect me faisait frissonner d’horreur et de honte, cet ennemi, ce traître, qui tant de fois m’avait trompé, m’avait entraîné, et qui, à chaque fois, m’avait forcé de me rouler avec lui dans la boue ?
Plus je le considérais, plus je creusais les lignes tourmentées et les angles aigus de ce visage ravagé par les passions, moins je me reconnaissais et moins je voulais me reconnaître.
– Non ! criais-je, tu n’es pas moi, toi que j’abhorre et qui m’assassines de tes regards furieux ! Hors la haine, qu’avons-nous de commun ? Tout ce que je désire, tu le repousses ; tout ce qui me révolte, tu l’embrasses ; tout ce que je crois, tu le nies ; tout ce que j’aime, tu le détestes ; tout ce que je veux, tu ne le veux pas ! Je n’ai pas une bonne pensée, pas un bon sentiment, que tu n’étouffes en ricanant ; quand j’hésite à faire le mal, tu me dis : – Va donc ! – et dès que je chancelle, tu me pousses et tu me fais tomber ! Assez de cette tyrannie, assez de cet accouplement qui m’enchaîne à toi ! Je veux briser cette chaîne, je veux arracher cette robe de Nessus qui me torture et qui me dévore de ses feux ! Va-t’en ! va-t’en loin de moi, gonfle-toi de tous mes vices, imprègne-toi de toute ma corruption, et va te vautrer dans l’orgie avec les réprouvés et les maudits !
Et, saisissant à deux mains ma poitrine, j’y enfonçai mes ongles comme pour en arracher le cœur…
C’en est fait, l’élan de mon désespoir vient d’accomplir un miracle : l’odieux reflet pâlit, se trouble, et bientôt je ne vois plus que la surface brillante du miroir où nulle image ne vient se réfléchir.
Je tourne la tête. Il est là, retranché dans un angle de la chambre, la tête en avant, les poings crispés. Il passe la main sur son front. Il chancelle. Il promène ses regards sur lui-même. Ses lèvres s’agitent comme pour parler et ne laissent passer qu’un vain souffle.
Mais ses yeux se tournent vers moi, un éclair de fureur s’y allume ; il me menace du poing, s’approche jusqu’à me toucher, et, me lançant un regard tout chargé de haine, il recule lentement, à pas de fantôme, jusqu’au seuil de la chambre, puis se retourne, me regarde une dernière fois, disparaît.
La porte s’est fermée. J’entends le bruit de ses pas décroître et se perdre dans la profondeur de l’escalier ; le bruit sec de ses talons résonne sur le pavé de la cour, et enfin retentit le battement d’une porte-cochère refermée avec fracas.
Que vais-je faire ?
C’est alors seulement que je commençai de réfléchir aux conséquences de l’étrange situation où je me trouvais jeté. Quelles étaient les conditions de cette séparation d’avec moi-même, de ce partage de mon être en deux moitiés, dont l’une s’en allait avec tous mes vices, tandis que l’autre demeurait seule avec mes vertus ?
Mes vertus ! Et quand je cherchais dans mon cœur ce que je pouvais appeler de ce nom, je ne trouvais rien que des aspirations vagues, que le regret stérile des biens que j’avais dédaignés. Mais où était ma foi, où était mon espérance ? À quelle œuvre allais-je vouer ma vie ? À quel visage allais-je sourire ? Sur quelle poitrine allais-je pleurer ? Eh quoi ! ne souffrirais-je plus, serais-je à l’abri des faiblesses et des malheurs de l’humanité ? Non, sans doute, car je ne serais plus alors qu’un esclave du destin, fatalement voué au bien parce que je ne pourrais plus faire le mal… Non, non, j’avais, je devais avoir quelque chose à faire en ce monde où, par un privilège unique et surnaturel, j’allais rentrer purifié de toute souillure ! Et je résolus de me mettre à l’œuvre.
Je me régénérerai ! me disais-je ; je me referai tel que la nature m’avait voulu, tel que me rêvait ma mère lorsqu’elle me berçait tout petit ; je redeviendrai ce que j’étais, je reprendrai le devoir où je l’ai laissé. Et quand j’aurai accompli cette tâche, quand j’aurai repris possession de mon estime pour moi-même, j’irai, le front haut, tendre la main à ces parents, à ces amis, dont j’ai fui l’affection et les conseils.
Mais lui, lui, que va-t-il devenir ? Vais-je l’abandonner ? Le puis-je ? Ces vices dont il est chargé, ce sont les miens ; ces vertus que je garde désormais pour moi seul, elles étaient à lui comme à moi. Si maintenant je le livre sans défense aux entraînements d’une nature fatalement vouée au mal, qui sera responsable, de lui ou de moi ?
Mais quoi ! Si ce divorce entre les deux parts de mon âme ne m’a point donné la liberté ; s’il me faut encore et toujours lutter et combattre, que m’aura-t-il servi de m’être séparé de lui ?
Et puis, si la lutte recommence, qui sera le vainqueur ?
Non, je ne lui dois rien : tant que j’ai été enchaîné à lui, je n’ai pas cessé de l’abhorrer, de le maudire comme l’auteur de tous mes maux. Je ne lui suis redevable que d’une chose : c’est d’avoir donné à ma haine assez de force pour le chasser de mon sein ; et comme sa haine était égale à celle que je lui porte, il doit être satisfait : nous sommes quittes, et encore un coup je ne lui dois rien.
Je l’oublierai. Il sera pour moi comme s’il n’avait jamais existé. Ce n’est point un ami, ce n’est point un frère : je le vois comme un spectre, comme un démon dont j’ai trop longtemps été possédé ; maintenant que me voilà délivré de lui, je redeviens moi-même et je ne le connais plus !
Sans plus tarder, à l’instant même, je me mis à l’œuvre. En un tour de main j’eus rangé mon appartement et fait disparaître tous les objets témoins des désordres de ma vie. Comme si le Ciel eût voulu se mettre de la fête, un rayon de soleil vint éclairer ma pauvre chère table où j’avais replacé mes livres, mes albums, mes lettres, ces petites affaires de bureau que nos amis nous donnent et qui restent là comme autant de gages d’affection.
Et lorsque tout eut repris sa place, lorsque j’eus reconstitué pièce à pièce cet intérieur où à chaque chose était attaché un sentiment ou un souvenir, où tout me parlait, où tout me souriait, où les absents et les oubliés se retrouvaient à leur place accoutumée comme s’ils ne l’avaient jamais eu quittée, un torrent de joie déborda de mon cœur.
Qui pourrait les décrire, ces transports d’une âme longtemps perdue et qui se retrouve enfin ? Je ne voulais pas le croire, je craignais d’être le jouet d’un rêve, j’allais palper l’un après l’autre les objets qui m’entouraient ; puis j’ouvris la fenêtre, j’écoutai les bruits de la rue, je regardai s’agiter la foule des passants et des voitures, et serrant à deux mains mon cœur que je sentais battre délicieusement, je murmurais : Je ne rêve pas !
Travailler, travailler jusqu’à ce que je me sois rendu digne du miracle qui s’est fait pour moi, voilà mon premier et mon plus pressant devoir.
Je m’assis à ma table, je me mis au travail avec tant d’ardeur, que plusieurs heures s’écoulèrent ; tout à coup, au moment où j’étais dans le feu de la composition, le jour me manqua ; je regardai à ma montre, et je vis qu’il était quatre heures : j’avais travaillé huit heures de suite.
J’allumai une lampe. En relisant ce que je venais d’écrire, je reconnus avec bonheur que je n’avais rien perdu, que mon intelligence n’était ni troublée par les secousses de ma vie de désordre, ni affaiblie par la honteuse paresse où je l’avais laissée croupir depuis si longtemps.
Je fus même très étonné de découvrir pour la première fois dans mon style une correction et une régularité dont il avait été jusque-là presque dépourvu, car c’était par la fantaisie et par une certaine originalité plus ou moins tempérante, que je m’étais fait une de ces réputations d’écrivain humoriste que le public édifie en général avec beaucoup de hâte et de faveur, parce que les humoristes l’amusent.
Ce que je venais d’écrire n’était pas du tout dans ce genre : c’était très sobre d’idées, très pur de style, et la plus saine raison s’y alliait aux sentiments les plus élevés et les plus délicats.
Voilà qui est merveilleux, me disais-je : c’est une véritable métamorphose ; si cela continue, je vais devenir un écrivain de l’école du bon sens. Qui sait même si je n’élèverai pas une nouvelle école, celle de la vertu ?
Mais une préoccupation d’un autre ordre vint suspendre le cours de ces réflexions : cette préoccupation, dont le siège n’était point dans le cerveau, mais à la région de l’épigastre, se manifestait par un malaise, et ce malaise n’était pas sans charme. Au bout de quelques minutes, il n’y avait plus à s’y méprendre, j’avais faim : pour la première fois depuis bien des années, je retrouvais mon appétit de vingt ans, et avec la santé de l’âme je voyais revenir la santé du corps.
Un premier mouvement, aussitôt réprimé, me fit prendre mes gants et mon chapeau pour aller dîner au café Anglais ; je me pardonnai en considération du repentir immédiat qui avait suivi cette mauvaise pensée, et je décidai que je me contenterais de ce qu’on pourrait trouver chez le traiteur voisin. Quelques minutes après, le portier, que j’y avais envoyé, revint suivi d’un petit patronnet porteur d’un morceau de veau à la sauce jaune et d’une douzaine de brins de salsifis en friture. Avec ces deux méchants plats, je fis un des meilleurs repas de ma vie ; et je découvris une chose dont je ne me serais jamais douté et que je recommande aux médecins et aux philosophes, c’est que la sérénité de la conscience n’est pas moins nécessaire à la digestion de l’homme qu’à la direction de sa vie.
Le couvert enlevé, je dis au portier de ne laisser monter personne, et je me renfermai à double tour pour jouir de mon bonheur à moi tout seul. Je me remis à faire l’inventaire affectueux de ce qui remplissait mon cher petit logis, et lorsque j’eus fini :
Oui, disais-je, oui, je vous suis revenu pour toujours, ô vous, témoins et gages de mes affections et de mes croyances ! Je ne vous quitterai plus, je ne vous renierai plus jamais : j’ai trop souffert loin de vous et je suis trop heureux à présent !
Je m’établis alors pour passer une bonne soirée au coin de mon feu. Je plaçai à ma portée mon livre favori, mon album, des lettres à lire ou à répondre, quelques journaux, et m’étendant avec délices sur mon vieux fauteuil de maroquin rouge, je me mis à savourer à longs traits la béatitude de ma résurrection morale.
Soit que j’eusse fait quelque faux mouvement, soit que j’eusse assez dormi, il était onze heures et demie quand je me réveillai. Je me redressai comme un ressort, et me secouai vivement pour effacer au plus tôt la trace de l’inconvenance que je venais de commettre envers moi-même.
Je me grondai bien fort de n’avoir pas eu plus de tenue dans un moment où l’enthousiasme de ma vertu renaissante aurait dû faire palpiter mon cœur, ou tout au moins me tenir les yeux ouverts. Je reconnus mes torts, je me promis de ne plus m’endormir à pareille fête, et comme il était minuit bientôt, je me mis au lit et dormis tout d’une traite jusqu’au lendemain matin à huit heures.
Il me fallut un certain temps pour me convaincre que ce qui s’était passé la veille n’était pas un rêve. Mais l’aspect nouveau qu’avait pris mon intérieur me donnait cent preuves pour une de la réalité et de la certitude de mes sensations ; mon manuscrit, ouvert sur ma table, ne pouvait d’ailleurs me laisser aucun doute ; je le relus, je le jugeai comme je l’avais jugé la veille, seulement il me sembla que la correction et la pureté y étaient poussées trop loin peut-être et qu’on éprouvait à le lire un peu de froideur et d’ennui.
Je repensai à mon sommeil de la soirée, et tout en me le reprochant encore, je dus reconnaître que l’état de fatigue où m’avaient jeté mes excès de toute sorte devait y être pour beaucoup, ce qui me soulagea d’un grand poids, car je m’inquiétais déjà d’avoir dormi si lourdement à ma première soirée de vertu.
Pendant huit jours je ne sortis pas de ma chambre. Je commençai par mettre au courant ma correspondance avec ma famille et mes amis, et leur annonçai que j’allais m’absenter pendant un mois, les priant de ne pas me répondre avant ce temps.
Je repris mon manuscrit : mais je n’étais pas en verve ; je le trouvai décidément sans nerf et sans couleur, et le laissai là pour me mettre au dessin.
Jusqu’alors le crayon noir ou le fusain avaient été mes procédés de prédilection. En revoyant quelques-uns de mes dessins, où j’avais cherché à m’inspirer de la manière de Salvator Rosa ou de Decamps, mes deux maîtres favoris, je fus vraiment étonné et – comment dirai-je ? – épouvanté de la violence et du désordre de mes compositions, comme aussi de la rudesse et de la grossièreté du faire. J’abandonnai tout cela pour essayer de rendre, par le procédé velouté du pastel, une scène angélique et suave dont j’attendais un grand effet : la Vertu protégeant l’Innocence.
Je me mis à ce travail avec une véritable émotion, une émotion presque religieuse. Je me répétais sans cesse que pour le faire dignement il fallait des mains pures, et je considérais avec bonheur mes mains en me disant :
J’achevai mon esquisse très vite et presque du premier coup. C’était encore un changement complet dans mes habitudes. Jusque-là, en effet, j’avais procédé tout autrement : je commençais toujours par trois ou quatre croquis absolument différents, tous très mauvais, et puis j’en faisais un d’un trait, sans lever le crayon, et celui-là était bon. Cette fois, au contraire, ce fut avec un calme inaltérable et une conviction sereine que je fixai le plan de ma composition.
Cependant cette vie de réclusion ne pouvait pas durer : un beau rayon de soleil, entrant dans ma chambre, me démontra de la façon la plus éclatante qu’il me fallait, sous peine de tomber malade, aller respirer un peu l’air du dehors : je sortis.
Je m’attendais à voir Paris sous un aspect nouveau : je m’en allais ouvrant de grands yeux et murmurant des phrases confuses où passaient les mots de « corruption… vice… égout… fange… écume… Babylone… Sodome… », qui me revenaient de mes lectures de Balzac.
Paris ne semblait pas s’apercevoir de ma présence ni se soucier de mes appréciations : chacun allait à ses affaires, les uns pressant le pas, les autres ayant le temps et flânant. Il y en avait de laids et de jolis, de jeunes et de vieux, les uns à pied, les autres en voiture, selon leurs moyens : les marchandes des quatre saisons poussaient leur charrette en balançant les épaules et en criant leur marchandise ; les fiacres trottinaient plus ou moins lourdement, selon qu’ils étaient à l’heure ou à la course, et les bons gros omnibus, remplis de bourgeois et de bourgeoises, circulaient lourdement parmi la cohue roulante, pareils à des aïeuls au milieu de leurs petits-enfants. J’avais beau chercher, j’avais beau évoquer l’horreur, elle ne venait pas : tout ce monde, bêtes, gens et même carrosses, avait l’air parfaitement innocent et surtout très occupé de son affaire.
Ceci dérangea un peu mon attitude et ma démarche, qui avaient quelque chose de solennel, de fatal. Je vis que je pouvais m’humaniser un peu avec ce monde bonhomme au demeurant, et que ma vertu n’y ferait pas tache autant que je me l’étais imaginé. Je continuai donc ma promenade avec simplicité, en m’étudiant à mettre dans mon allure et dans ma tenue le plus de laisser-aller possible ; je me rappelai fort à propos cette grande vérité morale, que la plus sûre marque d’une solide vertu est de croire à la vertu chez autrui et de ne pas se poser en ennemi du genre humain.
Soyons bienveillant, me disais-je, soyons bonhomme aussi !
Précisément à l’instant où je me disais cela, je me vis passer devant une glace, et je fus surpris au dernier point de la figure que je faisais. J’étais méconnaissable. Grâce à la vigueur de la jeunesse et aussi à mon tempérament de fer, ces huit jours de repos et de sagesse m’avaient transfiguré. J’avais le teint reposé, les yeux frais et brillants, il régnait dans toute ma personne un aspect de santé, un air d’ordre, qui faisaient de moi un personnage tout neuf.
Pourtant, l’avouerai-je ? je ne fus pas ravi de me voir ainsi. Il me sembla que ma figure avait perdu tout son caractère, et qu’à la place de cette image saisissante où se reflétaient les orages de ma vie, je n’avais plus qu’un de ces masques fades que colorent d’une teinte douce le blanc de l’indifférence et le rose de la santé : tranchons le mot, j’avais l’air niais. Je ne pus m’empêcher de rire.
Allons ! me dis-je, il faut me résigner, je ne suis plus un Méphistophélès ; il faut dire adieu à mes grands airs de réprouvé. Mon âme est blanche et pure comme Marguerite avant la chute ; parce que la candeur de l’innocence brille sur mon visage, est-ce une raison pour me rire au nez moi-même ?
Pourtant j’abrégeai ma promenade ; je rentrai chez moi assez triste. Je n’allumai point ma lampe, je m’assis au coin de mon feu et, tout pensif, je me mis à considérer la lueur morne d’un tison qui achevait de se consumer dans l’âtre. Au moment où il paraissait près de s’éteindre, l’écorce se détacha du bois et une flamme éclatante s’éleva, illuminant vivement la chambre ; au bout de quelques minutes la flamme s’éteignit, laissant à sa place un long tourbillon de fumée qui s’éleva lentement, et je ne vis plus qu’un point rouge dans l’ombre noire du foyer.
Je ne saurais dire ce qui se passa en moi, ni quel rapport je crus sentir entre l’état de mon cœur et cette flamme expirante ; mais je laissai tomber ma tête sur ma poitrine en me disant :
C’est fini… Plus rien.
Heureusement cela ne dura pas, et, me raidissant contre cette inexplicable défaillance, je m’infligeai une réprimande vigoureuse.
Comment ! au bout de huit jours à peine, j’en étais déjà à me lasser de la vertu, et la pureté de ma conscience, au lieu d’enivrer mon cœur de joie, l’affadissait ! Encore un peu, et j’allais regretter, Dieu me pardonne ! Me serait-il resté quelque chose de l’homme d’autrefois ?
Et je mis précipitamment ma main sur mon cœur, craignant d’y retrouver…
Non : espérant y ressaisir encore quelque chose d’oublié par Lui.
Ô misère de la conscience ! m’écriai-je ; ô vanité de la sagesse et de la vertu ! Eh quoi ! le mal est-il donc si absolument inhérent à la nature humaine que, délivrée de tous ses vices, l’âme demeure encore ingrate et rebelle ? Non, ce n’est pas possible, ce n’est pas vrai ! De quel nom l’appellerais-je, le sentiment coupable qui me ferait regretter mon abjection passée ? Lassitude ? Découragement ? Dégoût ? Honte, peut-être !
Folie criminelle : je ne me laisserai pas emporter à ce vertige d’un moment. Tout à coup il me vint une pensée :
C’est peut-être le diable qui me tente une dernière fois avant de m’abandonner ?
Mais je n’avais pas fini cette réflexion, que je fus épouvanté de ce qu’elle me révélait sur l’état de mon âme.
Le diable !… J’en suis déjà à croire au diable ! Au bout de huit jours ! Grand Dieu ! où en serai-je dans un mois ?
Il me sembla, en songeant à ce que j’avais pensé depuis ces huit jours, que mon intelligence s’était alourdie et que ma raison s’affaiblissait. Je jetai un regard de côté sur le manuscrit que je n’avais pas pu achever, sur l’esquisse que j’avais tracée avec tant d’aplomb et si peu d’inspiration ; je ne sais ce que je craignais, mais je me mis à trembler comme la feuille.
Par bonheur, en ce moment on sonnait à ma porte : Dieu soit loué ! me dis-je, je vais voir quelqu’un !
La porte s’ouvrit, et mon ami Daniel entra.
Jamais visite ne vint plus à propos : de tous mes amis, c’était le plus en état de venir à mon secours dans la situation où je me trouvais, car Daniel était la vertu même, et sa seule vue suffisait pour faire comprendre le bonheur que donne la paix de l’âme.
C’était une de ces heureuses natures dont rien ne peut troubler l’inaltérable sérénité. Jeune, beau, intelligent, avec cela riche ; doué d’une raison et d’une santé également inébranlables ; bienveillant ; toujours prêt à rendre service ; aussi dégagé des imprudences de l’enthousiasme que des entraînements de la misanthropie, il marchait devant lui dans la vie d’un pas toujours égal et toujours ferme, sans jamais s’arrêter, sans jamais reculer ; ne doutant de rien, pas même de lui, et encore moins de son bonheur, dont il se rendait compte et qu’il administrait véritablement en père de famille. Aussi quand nous parlions de lui entre nous, nous avions coutume de dire que ce bonheur-là ne finirait jamais, parce qu’il était tenu en partie double, avec trop de soin et de sagesse pour que « la maison Daniel, Félicité et Cie » pût jamais faire faillite.
Sa vie régulière avait depuis longtemps cessé de pouvoir s’accorder avec les sauts et les bonds de mon existence désordonnée : je le voyais rarement, de cent en quatre, et comme, sans être positivement indifférent, il poussait la discrétion très loin pour tout ce qui concernait autrui, il ne savait rien de la façon dont j’avais vécu pendant ces dernières années. Il était peu questionneur, n’étant nullement curieux, de sorte qu’il ne s’écartait guère au-delà des interrogations banales que l’usage commande entre amis qui se sont perdus de vue depuis quelque temps.
– Eh bien, mon cher, me dit-il, que devenez-vous ?
Il était mon camarade d’enfance, mais de sa vie il n’avait tutoyé personne.
– Mon Dieu ! lui dis-je, j’ai bien des reproches à me faire avec vous : j’aurais dû aller vous voir, mais cette vie de Paris est si dévorante…
– Je sais, je sais. Moi-même… Et puis vous travaillez beaucoup, toujours ? Dans… la Revue du Demi-Monde, n’est-ce pas ?
– Eh non ! pas comme j’aurais dû ; j’ai fait le paresseux, le dissipé ; je me suis laissé aller, aller, et, vous savez ? j’ai perdu pied.
– Vraiment ?
– Vraiment. Oh ! mais là, tout à fait.
– Et maintenant ?
– Oh ! maintenant je travaille, et j’espère réparer le temps perdu.
– Vous avez bien raison, mon cher. Voyez-vous, il faut toujours en revenir là. Moi-même j’ai parfois eu de ces moments-là dans ma vie de jeune homme, car enfin on n’est pas un saint non plus, que diable ! Eh bien, vous ne sauriez croire le charme que j’éprouve, quand il m’est arrivé de « sacrifier aux Grâces », à retrouver le calme austère et doux de mon cabinet de travail. C’est là, mon bon ami, qu’on éprouve de véritables délices à savourer le contraste entre les vaines agitations du plaisir et les jouissances vraies et pures de l’intelligence ou de l’art. Aussi ma devise est : s’amuser sagement quelquefois, travailler régulièrement toujours. Vous voyez comme je me trouve de ce régime. Mais vous-même, laissez-moi vous faire mon compliment : vous êtes superbe de santé, frais, rose ! Bien mieux que la dernière fois : vous aviez mauvaise mine tout à fait. Je n’avais pas voulu vous le dire, mais vous m’inquiétiez au point que j’en ai parlé à nos amis. Mais voyons, qu’est-ce que vous avez fait de nouveau ? Un feuilleton, un livre ? Avez-vous dessiné ?
Je ne me souciais guère de lui montrer mes dernières productions et je tentai de détourner la conversation, mais il y revenait toujours. Comme tous les travailleurs, il s’intéressait beaucoup à tout ce qui était travail. À regret, je lui fis voir mon esquisse ; il l’examina en connaisseur :
– Je vous fais mon compliment, mon cher ami. C’est parfait, c’est suave et chaste au possible. Jamais vous n’avez rien fait qui vaille cela ! À la bonne heure ! au moins, voilà une esquisse admirable : c’est la beauté de l’antique unie à la grâce du Moyen Âge. Je ne vous aurais pas cru en état de traiter si bien ce genre. Votre talent s’est métamorphosé complètement. Continuez, continuez, vous tenez le grand chemin de l’art. Sic itur ad astra ! Et le feuilleton, le livre ?
J’allai prendre d’assez mauvaise grâce mon manuscrit sur ma table, et je le lui montrai en le feuilletant avec cette nonchalance qui est, chez un auteur, le signe de la modestie vraie ou feinte. Il me le prit vivement, s’assit, s’installa d’un air empressé sur un fauteuil et se mit à lire avec attention, coupant sa lecture de mouvements de tête et de gestes arrondis qui semblaient marquer une approbation soutenue. Quand il eut fini :
– Vous n’êtes pas content de cela ? Eh bien, franchement, vous êtes difficile. C’est une chose extraordinaire comme je retrouve là les mêmes qualités que dans votre dessin : là aussi vous êtes métamorphosé ; c’est aussi beau que les plus belles pages des Martyrs ou de Paul et Virginie. Il y a là une pureté, je dirais presque une chasteté, dans la phrase… Tout cela est sobre et harmonieux. Et puis une élévation, une élévation !