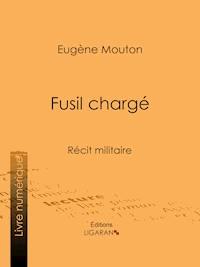Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : " A l'époque où l'escadre de l'amiral Le Prédour était devant Buenos-Aires pour régler la fameuse affaire de la Plata, je me trouvais moi-même dans cette ville, et j'y avais rencontré un de mes amis d'enfance, lieutenant de vaisseau à bord de la frégate la Junon, portant pavillon amiral et mouillée à deux lieues au large de Buenos-Aires."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’auteur a publié, en 1872 et en 1876, sous le titre de Nouvelles et Fantaisies humoristiques, deux recueils de pièces très variées. Aujourd’hui, voulant donner à cette partie de ses œuvres une forme définitive, il en fait trois volumes séparés, dans chacun desquels seront rassemblées les pièces d’un même genre.
Tout d’abord il en a détaché Le Rossignol, L’Exposition de chiens, L’Âne de Buridan et Les Mouches, pour les réunir à la Zoologie Morale ; cet ouvrage, composé de deux séries, dont la première a été publiée au mois de mai 1881 et dont la seconde vient de paraître, se compose d’une suite de fantaisies humoristiques, sentimentales et anthropologiques, à propos des bêtes ; les quatre articles ci-dessus indiqués s’y rattachaient, ou plutôt c’est la Zoologie Morale qui est venue s’y rattacher, car l’idée du livre en est sortie.
Sous le titre de Contes, la Bibliothèque-Charpentier a donné l’année dernière un volume où sont réunies les nouvelles comiques qui se trouvaient dans les deux séries de Nouvelles et Fantaisies humoristiques, plus : Le Naufrage de l’Aquarelliste ; Une soirée de Caciques ; La Lyre ; La Vénus de Milo, qui n’avaient pas encore paru en recueil, et Troc, qui était inédit. En tête est le portrait « véritable » de l’Invalide à la Tête de Bois, dessiné et gravé à l’eau-forte par l’auteur.
Le présent volume contient les nouvelles du genre pathétique ou sentimental : outre ce qui a été reproduit des deux anciennes séries, on y lira Lord Fergus et Le Coq du Clocher, qui n’avaient pas été écrits lorsque parurent ces deux séries. Le volume est orné d’une eau-forte représentant Le Canot de l’Amiral, dessiné et gravé par l’auteur.
Le troisième et dernier volume, qui est sous presse, sera intitulé Fantaisies. On y retrouvera de même les pièces analogues des deux anciens, plus treize pièces qui n’avaient pas encore été recueillies. Il sera, comme les deux autres, orné d’une eau-forte de l’auteur.
La nouvelle édition que nous offrons aujourd’hui, et qui, depuis la publication des Contes, s’est augmentée de nouvelles productions, contiendra ainsi dix-neuf pièces de plus que les Nouvelles et Fantaisies humoristiques.
L’auteur a revu et corrigé le tout avec le plus grand soin. Il ose espérer que, sous cette forme nouvelle qui y donne plus d’accent et d’unité, son œuvre justifiera peut-être un peu mieux l’excès d’indulgence qu’on a bien voulu lui montrer, et dont il exprime ici sa profonde reconnaissance.
Paris, juillet 1882.
Perfide comme l’onde !
À l’époque où l’escadre de l’amiral Le Prédour était devant Buénos-Ayres pour régler la fameuse affaire de la Plata, je me trouvais moi-même dans cette ville, et j’y avais rencontré un de mes amis d’enfance, lieutenant de vaisseau à bord de la frégate la Junon, portant pavillon amiral et mouillée à deux lieues au large de Buénos-Ayres.
Mon ami m’avait invité plusieurs fois à dîner avec lui à son bord, et diverses circonstances m’avaient jusque-là empêché d’accepter, lorsqu’un jour, c’était le 23 septembre 1851, il m’en souviendra toute ma vie, m’ayant rencontré vers une heure, il renouvela son invitation : je ne demandais pas mieux, et il fut convenu qu’à trois heures nous nous retrouverions à l’embarcadère.
Je rentrai chez moi pour prendre une valise où je mis des effets de rechange, du linge de nuit et des ustensiles de toilette : je devais coucher à bord. Je pris de plus un paletot pour me garantir du froid et un manteau imperméable pour m’abriter de la pluie.
Ainsi équipé, et après avoir mis à ma tenue tout le soin et toute la correction possibles, je consultai ma montre et je vis qu’il n’était encore que deux heures, ce qui m’impatienta comme un enfant.
Cette visite à bord d’un bâtiment de guerre était pour moi plus qu’un plaisir. Dès mon enfance, comme tant de gens qui n’ont vu la mer que dans les romans ou dans les tableaux, je m’étais passionné pour la vie maritime ; et sans la sévérité trois fois bénie des examinateurs qui me refusèrent l’entrée de l’École navale, je me serais lancé avec enthousiasme dans une carrière où, sans aucun doute, j’aurais trouvé plus d’une désillusion.
Ma traversée du Havre à Buénos-Ayres, sur un navire chargé de mules, avec quelques émigrants allemands pour toute compagnie, n’avait pas suffi pour me désenchanter. Toutes les déceptions auxquelles je m’étais heurté vingt fois le jour pendant deux mois de cette vie monotone, je les avais mises sur le compte du commerce en général, qui, me disais-je, vulgarise tout, et de notre capitaine en particulier, honnête homme, bon marin, mais qui en dehors de ces qualités n’en avait pas d’autres.
J’allais pour la première fois de ma vie mettre le pied sur un vaisseau de guerre : là je verrais, dans toute sa majesté, dans toute sa formidable poésie, cette vie maritime dont je ne connaissais que le rêve ; enfin et surtout j’allais voir de près, à leur bord, c’est-à-dire sur leur domaine et dans tout l’appareil de leur puissance, ces officiers de marine dont la dignité et la distinction suprême m’avaient toujours si vivement frappé.
Aussi avouerai-je qu’au moment de faire mon début dans ce monde à part dont les hommes m’apparaissaient revêtus d’un grand prestige, je m’inquiétais fort de ce que je pourrais dire et faire pour ne pas me montrer trop au-dessous d’eux. Même comme petite faiblesse d’amour-propre, c’eût été bien pardonnable, mais en âme et conscience je crois qu’il n’y avait là de ma part que ce rehaussement de dignité qu’on éprouve devant les personnes auxquelles on serait fier de ressembler.
C’est ainsi que le cours de mes idées, parti de cette circonstance bien vulgaire d’une invitation à dîner à bord d’un bâtiment de l’État, s’était grossi de mes souvenirs d’enfance, de mes enthousiasmes de jeunesse, de mes sentiments d’admiration pour les marins, de ma sollicitude pour mon propre personnage : ce dîner s’annonçait donc comme devant prendre dans ma vie les proportions d’un véritable évènement.
Et c’est ce qui arriva, mais autrement que je ne pensais.
Quoi qu’il en soit, toutes mes facultés, et particulièrement l’attention et la mémoire, s’étaient élevées à une intensité de puissance que je n’ai plus jamais retrouvée dans aucune autre circonstance de ma vie : c’est à cette disposition d’esprit que je crois pouvoir attribuer la précision incroyable, la lucidité singulière, de mes perceptions et de mes souvenirs au milieu de ce déchaînement inattendu d’où ma raison comme ma vie me semblent n’avoir échappé que par miracle. Après plus de vingt années, il n’est pas un détail des évènements, pas une parole, pas un geste, pas un pli de visage, des auteurs de ce drame, que je ne voie et que je n’entende comme si c’était d’hier.
Je me dirigeai vers l’embarcadère. Je vis s’avancer de loin un groupe de quatre ou cinq personnes parmi lesquelles je reconnus mon ami, et qui s’y rendaient de leur côté. Le canot de l’amiral, une embarcation toute blanche, avec seize matelots et un patron, se balançait le long du quai. Le groupe que j’avais aperçu arriva près de moi ; mon ami s’en détacha, et me prenant par la main, me présenta successivement un chirurgien, un enseigne, un aide commissaire et un aspirant ; puis il me présenta à un cinquième personnage, capitaine de frégate.
– Où est le commandant ? demanda ce dernier.
– Il arrive là-bas en causant avec le capitaine de port.
Je profitai de ce temps pour examiner mes compagnons de voyage.
Le chirurgien était un petit homme replet, avec une figure rouge, un collier de barbe roussâtre coupée très court, et l’air souriant.
L’enseigne était grand, élancé, légèrement voûté, très blanc de peau, portant longs ses cheveux et ses favoris bruns ; de grands yeux bleus lui donnaient une beauté très expressive, quoique ses traits ne fussent pas réguliers.
Le commissaire répondait assez bien à l’idée que je m’étais faite de cette classe à part dans la marine : petit, maigre, l’air spirituel et distingué, mais n’ayant pas ce je ne sais quoi de l’officier de marine.
Quant à l’aspirant, c’était un enfant de dix-huit ans au plus, beau comme le jour, blond et rose, au point qu’en toute autre circonstance on l’aurait pris pour une femme déguisée. Sur son charmant visage il y avait tant de jeunesse et de gaîté, que je ne pouvais m’empêcher de sourire en le regardant.
Le capitaine de frégate me parut devoir être, de tous les marins réunis sous mes yeux, le plus remarquable dans sa profession, à en juger par son aspect. Il était saisissant : un de ces hommes qui, par la profonde originalité de leur physionomie, échappent à toute classification connue. Tout en longueur, tout dégingandé, et ses grands os semblaient tellement disloqués qu’il ne répétait pas deux fois de suite le même geste de la même façon. Mais la tête, par son expression surhumaine, dominait et semblait maîtriser l’irrégularité du reste de la personne : l’âme y parlait si clairement, que chaque pli du visage, chaque regard, annonçait et expliquait les mouvements du corps. Je n’ai jamais vu deux yeux comme ceux-là : ils n’étaient pas du tout perçants ni brillants ; ils n’étaient ni gris, ni verts, ni noirs, ni bleus : deux antres, telle est la seule comparaison qui puisse donner une idée de la profondeur de ce regard.
Après quelques minutes d’attente, nous vîmes arriver le commandant.
– Suis-je en retard ? dit-il.
Le capitaine de frégate tira sa montre et dit :
– Trois heures juste.
– Eh bien, embarquons.
Les matelots levèrent droit leurs avirons, le commandant et le capitaine de frégate s’assirent au fond ; le chirurgien, l’enseigne et le commissaire, à droite ; mon ami, l’aspirant et moi, à gauche ; le patron se mit à la barre, on borda les avirons, et nous partîmes, glissant ou plutôt volant sur l’eau.
Le commandant, gros personnage à figure massive et digne, âgé d’une cinquantaine d’années, absolument dépourvu d’idéal, paraissait être un de ces hommes « de service » admirables pour commander en sous-ordre, mais hors d’état de s’élever au-delà d’une certaine hauteur dans les circonstances difficiles.
Le canot filait comme un trait le long de la jetée. La mer moutonnait, et plus nous avancions vers le large, plus le balancement de l’embarcation s’accentuait.
– Eh bien, me dit mon ami, commences-tu à avoir le mal de mer ?
– Pas du tout, je trouve au contraire ce bercement fort agréable, et si c’était toujours comme cela…
– Ce n’est pas toujours comme cela, me dit-il, et si tu n’as pas le cœur ferme je crains que tu ne payes ton tribut lorsque nous aurons débouqué.
– Débouqué ? qu’est-ce que c’est que ça ? répondis-je en riant.
– Dépassé l’extrémité de la jetée qui nous garantit encore du vent et des lames du large.
Nous étions près de dépasser la jetée. Le commandant se retourna vers le patron, qui était debout, et il lui dit :
– La mer est forte au large ?
– Oui, mon commandant, très forte : elle est mauvaise, mauvaise !
– Le capitaine de port m’a dit que nous allions danser. Il m’engageait même à ne pas partir, dit-il au capitaine de frégate ; mais j’ai affaire à bord ce soir : il faut absolument que je finisse mon rapport sur…
– Un rapport ! répliqua le capitaine de frégate avec une nuance d’ironie et d’amertume. Ah ! c’est différent !
Et il jeta un regard de supériorité sur son chef, puis leva la tête, examina un instant l’état du ciel, et ne dit plus mot.
Les flots grossissaient de minute en minute ; nous avancions toujours à la rame ; enfin nous allions dépasser l’extrémité de la jetée. Sur un signal du patron, les avirons furent rentrés, la voile s’éleva le long du mât et les matelots se croisèrent les bras.
– Mets ton paletot, leur dit le commandant.
Et tous se couvrirent de leur vêtement, se boutonnèrent et enfoncèrent leurs chapeaux sur leurs yeux.
Tous ces messieurs mirent leurs pardessus et je m’apprêtais à faire comme eux, lorsque le canot fit un bond si violent de l’avant à l’arrière et se coucha en même temps si fort, que je m’accrochai instinctivement au bras de mon ami.
Je reçus en même temps dans le dos un coup de mer dont une bonne quantité m’entra dans le collet, et j’entendis mon ami, qui s’était levé sans s’inquiéter de ma mésaventure, ce qui me surprit, dire à mi-voix, en regardant au large :
– Ah mon Dieu !
Et il se rassit sans paraître seulement se souvenir que j’étais là.
Le canot, changeant un peu de direction, fit un nouveau bond encore plus violent, et franchissant une lame qui me sembla haute de vingt ou trente pieds au moins, se trouva lancé au milieu d’une mer tellement épouvantable, que toutes mes idées sur ce qu’on appelle, dans les livres, une tempête, firent place à un étonnement plus grand peut-être encore que ma terreur.
Rien dans mes sensations ni dans mes souvenirs passés ne me donnait le moindre terme de comparaison auquel je pusse même essayer de rapporter mes sensations présentes. Il n’y a rien, ni dans le monde réel où j’avais vécu jusque-là, ni dans les descriptions ou les tableaux que j’avais vus, qui en donne une idée ; et cette mer elle-même, que je venais de traverser pour venir d’Europe, ne ressemblait pas plus à ce que je voyais qu’un ruisseau ne ressemble à une cataracte.
Jamais coup de théâtre ne fut plus subit et plus effrayant que celui-là : en deux bonds le canot nous avait fait sauter d’une sécurité entière à une mort certaine.
Personne ne disait mot. La tête enfoncée dans le collet, chacun s’accrochait de son mieux aux bancs ou aux bordages.
Je promenai mon regard sur les figures de mes compagnons. Le plus habile et le plus malveillant des observateurs n’aurait pu y surprendre un mouvement ou un pli. J’interrogeais leurs physionomies avec l’angoisse affreuse, mais aussi avec la clairvoyance désespérée, du condamné qui cherche à deviner son arrêt, et je ne découvrais rien de changé dans ces visages que si peu de temps auparavant je venais d’analyser avec tout le sang-froid du philosophe et toute l’aisance de l’homme du monde.
Maintenant, jeté sans transition au milieu de cette épouvantable tempête, lorsque je voyais ces montagnes d’eau s’élever, se gonfler, se ruer les unes contre les autres, s’entre-détruire, disparaître en creusant un gouffre, et de nouveau surgir encore, de plus en plus énormes, de plus en plus furieuses, je perdais par moments le sentiment de ma propre existence. Toute idée de salut, de vie même, était si absolument incompatible avec la position où nous nous trouvions, que si je n’avais pas vu devant mes yeux ces compagnons pleins de vie, je me serais cru fou.
Le commandant, sans se départir, au reste, du calme le plus parfait, se tourna à demi vers le patron en lui disant :
– Mollis un peu : le canot fatigue beaucoup.
Le patron ne bougea pas.
– Eh bien ! dit vivement le commandant, tu n’as pas entendu ?
– Faites excuse, mon commandant, j’ai entendu.
Le commandant devint tout rouge, serra les poings et ouvrit la bouche pour parler : le patron continua :
– Si vous voulez, je vais mollir : mais je connais l’embarcation, et si je fais ça, nous chavirerons.
Puis il ajouta, mais du ton le plus tranquille, avec les inflexions traînantes et cadencées de l’accent breton :
– Faut-il mollir, mon commandant ?
Et il changea de position, prêt à appuyer sur la barre.
Le commandant prit un air de dignité offensée qui se dissipa presque aussitôt, et sa pose ne pouvant se prolonger qu’à la condition de réitérer l’ordre de mollir, il feignit de s’apercevoir que le troisième bouton de son paletot était défait, et il se mit, avec une affectation puérile, à le boutonner comme si le salut du canot avait dépendu de cette importante opération. Puis il se ramassa sur lui-même, enfonça sa casquette, rabattit son capuchon par-dessus.
Mais il ne répéta point son ordre au patron, et depuis cet instant on n’entendit plus sa voix et on ne vit plus son visage.
À ce moment le capitaine de frégate se dressa tout debout, et après avoir tourné lentement la tête pour examiner l’état du ciel et de la mer, il la pencha un instant, laissa tomber un regard d’une expression indéfinissable sur le commandant, puis il se retourna, s’agenouilla à demi sur le banc en appuyant ses mains au dossier, et il regarda le patron !
Je ne pouvais voir que les yeux de celui-ci ; quant au capitaine de frégate, placé comme j’étais, je ne le voyais qu’à profil perdu.
Il était enveloppé dans un grand manteau de drap plaqué tout le long de son corps par le vent et flottant en arrière comme un vaste et lourd drapeau noir doublé de rouge. Son visage osseux et pointu, son cou blanc et maigre, s’allongeant et se dressant au-dessus de cette masse de draperies furieusement agitées, empruntaient encore un caractère plus fantastique à la silhouette aiguë d’un tricorne couvert de toile cirée dont il était coiffé. Il ne dit pas un mot au patron, mais au mouvement qu’il fit je vis qu’il le regardait de la tête aux pieds.
Je vis, oui, je vis ce long et puissant regard pénétrer dans l’âme du matelot, qui baissa les paupières, ouvrit les narines et recula la tête comme sous la poussée d’une force supérieure.
Le capitaine de frégate se rassit, ramena les plis de son manteau, et s’inclinant, parut se plonger dans une profonde méditation.
Quant au patron, soit que je ne l’eusse pas assez observé jusque-là, soit que le regard du capitaine l’eût réellement transfiguré, je ne le reconnaissais plus.
Sa cravate dénouée, sa chemise ouverte, laissaient voir sa poitrine nue, et sa gorge, où pointait cette saillie de la pomme d’Adam, caractéristique des hommes vigoureux. La bourrasque lui avait emporté son chapeau ; ses cheveux blonds cendrés flottaient au vent ; il était accroupi, une main sur la barre, l’autre crispée au bordage. Les sourcils froncés, les lèvres serrées, il tendait en avant, avec un air de menace et de défi, sa tête, dont la beauté sauvage réunissait, au plus haut point d’intensité, les traits énergiques et violents de la race bretonne. On voyait que, sous l’apparence de l’immobilité, cet homme combattait.
Tel il était, tel je l’ai revu bien souvent, dans des souvenirs presque aussi palpitants que la réalité même : hardi, fier, beau comme un demi-dieu, s’élevant et s’abaissant tour à tour avec moi sur la crête ou dans les abîmes de cette mer où nous allions nous engloutir !
L’embarcation, couchée sur le flanc du côté où je me trouvais, courait dans des sortes de vallées creusées entre deux montagnes d’eau ; lorsque nous étions au fond, les pentes, par un effet de perspective que tout le monde a pu observer lorsqu’on se trouve au bas d’un chemin très incliné, paraissaient un plan perpendiculaire, de sorte qu’il me semblait être entre deux murailles liquides dont la hauteur dépassait de beaucoup celle de nos mâts. Chaque fois que nous nous trouvions dans cette position, je croyais voir ces deux murailles s’abattre et se refermer sur nous : mais quelques secondes se passaient, nous nous trouvions portés sur la crête de la lame, et je voyais à droite et à gauche de l’embarcation deux pentes au fond desquelles se creusait un gouffre. Nous y descendions, mais beaucoup moins vite que je ne l’aurais cru.
À travers mon trouble et mon épouvante, je vis très bien que, malgré leur agitation furieuse, les mouvements des lames obéissaient à une certaine régularité, et je fus surtout frappé d’un détail particulier : c’est que ces lames si monstrueuses, si épouvantables, ne se brisaient presque pas à leur crête : lorsqu’elles venaient à se rencontrer, elles s’accumulaient plutôt et semblaient se fondre l’une dans l’autre.
Chose extraordinaire, à mesure que se succédaient les élans réguliers qui nous emportaient de terreur en terreur, de mort en mort, l’angoisse qui m’étranglait le cœur semblait se desserrer peu à peu.
Ce n’était pas que le danger me parût décroître, car plus nous avancions plus les vagues me semblaient prodigieuses, et je voyais bien que, jetés au milieu de ce bouleversement où chaque lame pouvait nous submerger, toute minute qui s’écoulait nous emportait une chance de salut et nous apportait une chance de mort. La mort, j’avais cru, dans les premiers moments, qu’elle allait nous engloutir en faisant sombrer l’embarcation. Un peu plus tard, et lorsque je me rendis compte pour la première fois de la position du canot dans le creux de la lame, j’avais pensé : Voilà le moment ! Puis lorsque, soulevé jusque sur la crête, je voyais l’abîme se creuser à côté de nous, je m’étais dit : C’est là !
Mais après un certain nombre de ces alternatives, un sentiment obscur, celui de l’espérance probablement, était venu changer en une sorte d’équilibre ce balancement entre les deux chances de mort dont la certitude me paraissait si également pareille. C’est à ce moment que je sentis se manifester en moi comme un vague désir de reprendre possession de ma raison, et comme un pressentiment que si j’y réussissais je souffrirais moins, et même, faut-il le dire ? que la mort ne me paraîtrait peut-être pas aussi absolument inévitable.
Quoi qu’il en soit il est certain que dès ce moment il s’était fait en moi un changement, et j’en eus à l’instant conscience, car je me sentais en état de parler, ce qui m’eût été impossible un moment auparavant.
Je délibérai si je devais le faire, mais je me demandais par quelles paroles, dans des circonstances aussi formidables, je pourrais rompre un silence gardé par ces hommes assis à côté de moi comme des fantômes muets. Je regardai les officiers, ils conservaient leur impassibilité ; je regardai les matelots, ils se tenaient sur leurs bancs avec l’air insouciant et la physionomie détendue d’hommes qui n’ont pour le moment rien à faire, et qui attendent…
Mon Dieu ! me dis-je en portant la main sur mes yeux, est-ce que je serais tout simplement un lâche ? Est-ce que nous ne serions pas en danger ? Mon cœur trop faible serait-il donc tellement bas au-dessous du cœur de ces hommes, que j’aie cru voir la mort là où ils ne voient peut-être qu’une série d’obstacles plus ou moins difficiles ou désagréables à franchir ?
Et de fait, en considérant avec un peu plus de sang-froid la physionomie des officiers et de l’équipage, je crus y lire plutôt l’ennui et la contrariété que l’inquiétude, ce qui me décida à adresser la parole à mon ami. Je raffermis ma voix du mieux que je pus, et je lui dis :
– Il n’y a pas de danger, n’est-ce pas ?
Il me regarda d’un air stupéfait et me dit, en baissant la voix de trois ou quatre notes sur la dernière syllabe :
– De danger !
Je baissai la tête et n’osai plus réitérer ma question.
Croirait-on, je ne puis pas le croire moi-même quand j’y pense, que cette réponse de mon ami, si claire et si terrible dans son laconisme, eut pour effet de me faire sauter sans transition à un ordre d’idées tout à fait étrangères à la situation où je me trouvais, et que, comme si j’étais sorti d’un cauchemar, j’oubliai tout et me remis à penser à la figure que j’allais faire dans la compagnie où j’étais attendu à dîner ; que je songeai à ma toilette du lendemain ; que je refis mentalement l’inventaire de mon sac de nuit ; qu’ayant cru me souvenir que j’avais oublié mon savon, je me laissai aller à des conjectures sans fin sur la manière dont je pourrais m’y prendre, sur le grade et la catégorie des personnes à qui je pourrais m’adresser, pour emprunter un morceau de savon ; que pendant plusieurs minutes je me fatiguai à chercher la solution de ce problème ?
Les rêves nous offrent des exemples de ces singulières associations entre des idées puériles ou ridicules et des évènements effrayants ou funestes. Il me semble aussi avoir lu ou entendu raconter je ne sais où que des condamnés à mort ou des hommes dans un grand danger, échappés comme par miracle, ont éprouvé les mêmes effets, qui sont évidemment le résultat de la terreur, soit qu’on les considère comme de véritables conceptions délirantes, ce que je ne crois pas, soit qu’il y faille reconnaître, et c’est ainsi que j’en juge, des espèces d’intermittences dans la faculté de souffrir : des syncopes de la douleur, dirais-je volontiers, pendant lesquelles les idées accessoires, surtout les plus récentes, se remettent en mouvement à partir du point où elles avaient été arrêtées court.
Donc je me retrouvais, ou plutôt il me semblait me revoir, en une sorte de rêve, dans l’état d’esprit où j’étais lorsque, trois quarts d’heure auparavant, je me rendais à l’embarcadère : tout ce qui s’était passé depuis m’apparaissait comme dans une optique dont j’aurais été le spectateur très désintéressé.
C’est à ce moment, ou un peu avant, peut-être, que j’entendis le commissaire dire, d’une voix qui me parut résonner comme une espèce d’harmonica lointain et très doux :
– Voilà la frégate.
Il paraît qu’à ce moment je dis à mon ami :
– Mais nous allons la couler bas !
Pour moi, je n’ai gardé aucun souvenir de ce propos. Ce que je sais, c’est qu’à ces mots : Voilà la frégate, je crus que ce bâtiment était devant nous et que nous l’accostions à l’instant, car je me levai et fus renversé sur mon ami, qui me replaça sur mon banc sans dire mot.
Je ne tardai pas à me remettre de la secousse, physique et morale tout à la fois, que m’avait donnée cette chute, et je regardai instinctivement devant nous. Du fond d’une de ces vallées creusées dans la lame, nous nous élevâmes sur la crête, et je vis alors la frégate. Nous en étions à un mille au plus.
Cette vue, sans me donner la plus faible espérance, me fit éprouver un sentiment tout nouveau. Je voyais très clairement qu’à chacun des points de l’espace qui nous séparait de la frégate il y avait pour nous les mêmes dangers à courir : mais la grande différence, et ce qui détermina en moi une réaction définitive, c’est que j’avais un point en dehors de moi où fixer ma pensée, et que, sans me faire oublier ce que ma situation avait de désespérer, cette espèce d’attache, de communication, avec un point où je voyais le salut, me rendit tout mon ressort moral.
Je regardai tour à tour, avec un peu plus d’assurance, les mâles visages des hommes dont la vie était suspendue comme la mienne aux hasards de cette affreuse tempête ; je vis le patron, toujours calme, toujours intrépide, tenant d’une main ferme cette barre dont les mouvements nous avaient jusqu’ici conduits et soutenus à travers mille morts, et surtout je vis le capitaine de frégate qui levait la tête, écartait son manteau et regardait l’heure à sa montre.
À partir de cet instant je repris définitivement possession de moi-même : je parcourus par la pensée, avec la plus grande précision, tous les incidents de la scène d’épouvante à travers laquelle nous étions emportés ; comme si mon âme se fût retournée tout d’une pièce à la façon d’un vaisseau qui vire de bord, je fixai mes yeux sur la frégate, et quoiqu’elle ne me parût guère plus grosse qu’une mouche, j’en distinguai les détails avec une netteté que le plus puissant télescope ne m’aurait pas mieux donnée.
À cette exaltation de mes facultés visuelles se joignit un autre phénomène qui en était la conséquence et qui me fit illusion presque jusqu’au bout : c’est que, comme nous faisions toujours des parcours égaux entre des lames pareilles, il me semblait que nous ne changions pas de place et que c’était la frégate qui venait à nous : seulement, par un effet de la surexcitation de ma vue, je percevais en les décuplant les développements successifs qu’elle prenait à mesure que de lame en lame nous faisions un bond de plus vers elle, de sorte que je la voyais s’avancer vers nous, non d’un mouvement uniforme, mais par saccades, et plus grande à chaque fois.
J’étais encore dans cet état de contemplation fiévreuse lorsqu’une espèce de secousse ébranla le canot, et je me trouvai à demi couvert sous la voile, qui venait de s’abaisser tout à coup. Quelqu’un me débarrassa, et en levant les yeux je vis que nous étions tout près du bâtiment, l’abordant par l’arrière, et déjà en communication avec lui par une corde qu’on nous avait jetée.
Par le temps qu’il faisait, on ne pouvait songer à débarquer par l’escalier de l’état-major : notre canot se serait brisé infailliblement contre les flancs de la frégate ; ce fut par une de ces échelles de corde suspendues dans le vide à une pièce de bois faisant saillie et appelée, je crois, un palan, que nous nous hissâmes tour à tour. Je dis nous, quoique, à vrai dire, de cette vertigineuse gymnastique je n’aie fait que les gestes, car tout en m’invitant à saisir l’échelle qui se balançait, on m’avait attaché une corde autour de la poitrine, et on me hissait pendant que je m’imaginais grimper par mes seules forces.
On m’avait fait passer le premier. Après moi, et se suivant sans interruption le long de l’échelle, mes compagnons de voyage montèrent tour à tour. Penché sur le bord du couronnement, je vis enfin le dernier matelot saisir l’échelle et grimper. Il n’était pas encore en haut que le canot, dont le mât était déjà démonté, fut soulevé de l’avant, puis de l’arrière, et s’éleva horizontalement dans l’air jusqu’aux deux palans, où il s’arrêta suspendu.
Mon ami me prit alors par la main et me dit :
– Viens changer : tu es mouillé des pieds à la tête.
Je ne m’en étais pas aperçu.
Nous descendîmes dans la chambre de mon ami. Il me serra la main, et je vis les coins de sa bouche se contracter convulsivement : mais c’était un homme de fer, et je ne crois pas qu’il ait jamais pleuré de sa vie.
– Tu viens de passer, me dit-il, par le plus incalculable des dangers qu’on puisse courir sur mer. Aucun de nous ne conçoit comment nous nous en sommes tirés, et les officiers du bord, qui nous avaient reconnus dès notre sortie de la jetée, sont encore plus épouvantés peut-être que nous-mêmes, car vingt fois ils nous ont vus disparaître entre les lames et nous ont crus perdus.
Sans le capitaine de frégate, nous sombrions quelques minutes après avoir débouqué.
En voyant l’état de la mer, dont il avait été averti par le capitaine de port, le commandant n’a pas eu peur, c’est un brave, mais il a senti le poids de sa responsabilité, et sous l’influence de ce sentiment il a commandé au patron une manœuvre dont l’exécution nous aurait perdus. Le patron, qui est un matelot incomparable, aurait certainement obéi si le capitaine de frégate n’eût pas été là : mais l’idée de faire périr avec nous cet officier pour lequel il se ferait hacher en morceaux, lui a donné le courage de résister. Le capitaine de frégate, ainsi que tu l’as remarqué peut-être, s’est levé et s’est retourné vers le patron : c’était pour raffermir celui-ci contre le trouble où l’avaient jeté l’ordre insensé du commandant et la crainte d’être puni pour désobéissance.
À partir de cet instant, c’est au patron que nous devons tout : ce qu’il a fait, c’est de couper en biais toutes les lames. Si nous en avions coupé droit ou reçu de côté une seule, non pas deux, entends-tu ? nous étions infailliblement engloutis. Et encore tout cela n’aurait servi de rien si les lames, au lieu d’être comme tu les vois, avaient été plus écumantes.
Maintenant habille-toi pendant que je vais donner quelques ordres. Tu as été rudement secoué, mon pauvre ami, mais tu t’es très bien tenu : tu m’as fait honneur, et ces messieurs, qui t’observaient beaucoup, sont étonnés du sang-froid que tu as gardé.
Il me laissa seul, et en quelques minutes j’étais séché et rhabillé de la tête aux pieds.
Alors je m’assis, je sentis mon cœur se gonfler d’une immense joie, et je fondis en larmes.
Bon ! j’ai cassé le grand ressort en voulant remonter ma belle montre neuve ! Voilà la petite bête morte, et j’ai beau tourner, l’aiguille ne marche plus.
Ô Temps ! divinité insatiable ! que ne puis-je ainsi t’arrêter dans ton cours ! Pourquoi nous emportes-tu si vite, et avec nous toutes nos amours et toutes nos espérances ? Une fois, une seule fois, laisse-moi faire un miracle : laisse-moi suspendre pour quelques instants le cours furieux de ce torrent de la vie où tu nous roules pêle-mêle avec les débris de tout ce que nous avons aimé. Laisse-moi faire plus encore, et que je puisse revoir dans un doux rêve les souvenirs du passé. Allons ! voyageur éternel, prends une minute, une seule minute, à l’infini de la durée, et donne-la-moi !
– Boûm !… boûm !… boûm !… boûm !… boûm !… boûm !… boûm !… boûm !… boûm !… boûm !… boûm !… boûm !…
Minuit ! Voilà ta réponse ! Il est minuit, tu poursuis ton vol sinistre, tu t’enfuis dans l’ombre ; et dans les dernières vibrations de la cloche, il me semble entendre comme le bruit expirant du battement de tes ailes.
Allons ! il faut dormir… Dormons !
Quelle heure est-il ? Il fait nuit noire… J’allume un flambeau.
Ah ! c’est vrai : ma montre ne marche plus. Heureusement l’horloge sonne. Il est deux heures.
Une idée ! La vieille montre qui est là dans mon secrétaire, si je la montais ?
Je la tiens.
Comme elle est grosse, épaisse et lourde ! Et cet énorme verre bombé ! Et ce cadran où les heures, par une innovation qui fit frémir tous les horlogers de l’époque, sont inscrites en chiffres arabes ! Mais cela n’est plus de mode depuis l’an 1804, ma pauvre montre, et ce qui te faisait alors si jeune et si tapageuse te rend maintenant ridicule, hélas ! comme toute chose vieillie.
Pourtant tu étais solide et consciencieusement bâtie. Tes grandes et larges roues, ton balancier vigoureux, tes ressorts élastiques et fermes, tout cela, marchant à grand bruit avec un gai tic-tac, ressemblait plutôt à un bon gros moulin qu’à une machine de précision : mais tu allais toujours, et une fois réglée tu ne te dérangeais pas comme les montres d’à présent.
Et puis tu avais ton luxe, de meilleur aloi que celui de telle montre d’aujourd’hui prétentieusement enrichie de diamants et de rubis équivoques, et dont le double boîtier n’est que de cuivre. Toi, tu es tout en or, et quel or ! à l’ancien titre, non pas au titre de notre or bâtard, où l’on met tant de cuivre, qu’on n’y peut toucher sans se salir les mains !
Ah ! c’est que, vois-tu, nous ne sommes pas comme les hommes de ton temps : il nous faut de l’or, et plutôt que de nous en passer nous en prenons le mensonge ; faute de pouvoir jouir, nous voulons rêver du moins que nous jouissons…
Allons ! je veux me rendormir. Bonsoir, ma bonne.
Je l’ai montée. La voilà partie.
– Ti-que-ti-que-ti-que-ti-que-ti-que-ti-que-ti-que-ti-que !
Pauvre vieille ! comme elle se dépêche ! comme elle trottine !… On dirait une ancienne servante, qui longtemps exilée de la maison où elle a vécu, reprend possession de ce cher ménage où chaque chose lui raconte une histoire ou lui rappelle un souvenir.
– Ti-que-ti-que-ti-que-ti-que !
Comme ces anciennes montres font du bruit ! Et pourtant ce n’est pas désagréable : ça berce…
Un silence profond. Voilà que maintenant il me semble distinguer comme une douce petite voix qui murmure près de mon lit. J’écoute, et voici ce que j’entends :
– Je suis vieille, vieille, et je sens bien que le monde ne va plus comme jadis. Je ne sais ce que j’éprouve : c’est comme un poids, une lassitude, qui m’accable. On dirait que le temps n’est plus le même qu’autrefois : il est plus ardent, plus âpre : il brûle. Que se passe-t-il donc dans ce monde où je ne me reconnais plus ? Comment porte-t-on les breloques à présent ? Où suis-je ? Quelle heure est-il ? Vais-je bien ?
Ti-que-ti-que-ti-que-ti-que !
Un moment de silence. Elle réfléchit.
– Je me souviens. J’ai vu bien des choses… tant de choses ! Tout cela a disparu… Mais j’ai dormi longtemps, et j’ai perdu le fil des histoires de ce monde.
Ah ! j’ai vu des évènements comme vous n’en verrez plus, vous autres.
Mon enfant, j’ai passé dans des batailles ou le canon fauchait les hommes comme des épis ; j’ai traversé six fois l’océan sur des vaisseaux de guerre qui donnaient la chasse à l’ennemi ; j’ai vu, sur les pontons anglais, nos prisonniers entassés comme des pourceaux, et là que d’heures d’angoisse j’ai sonnées quand, au milieu de ces longues nuits de douleur, un des compagnons de captivité de mon maître le réveillait en lui disant :
– Pardon, mon commandant, quelle heure est-il ?
L’heure où on lui annonça qu’il était libre, qu’il allait revoir sa femme et sa fille dont il était séparé depuis quatre ans, c’est moi qui l’ai marquée ! Ah ! je me souviens ! il me tira de son gousset, il me regarda un moment les yeux pleins de larmes, et il me baisa en me disant :
– Deux heures et demie ! Voilà un moment que je n’oublierai jamais !
Comme il était bon, et noble, et tendre, et délicat en toutes choses ! Pendant soixante ans dont j’ai marqué toutes les heures, il n’y a pas eu dans cette vie une mauvaise action, pas une mauvaise pensée. Je puis te le dire, moi la confidente de toutes ses actions et de toutes ses pensées.
Sais-tu comme il t’aimait ? Sais-tu combien de fois, lorsqu’il attendait l’heure d’aller te chercher à l’école, il s’est impatienté de voir mes aiguilles marcher trop lentement à son gré ?
Et dans cette affreuse maladie où tu faillis périr ! Tu ne pouvais pas le voir, tu étais en proie au plus affreux délire. D’ailleurs tu étais trop petit, tu n’aurais pas compris. Mais quelle scène !
On attendait la crise qui devait décider de ta vie.
– À midi, avait dit le médecin, il sera mort ou sauvé.
Ta mère était agenouillée au pied de ton lit ; échevelée, les mains crispées sur les couvertures, elle dévorait de ses regards brûlants ton visage injecté de sang, couvert d’une sueur froide.
Ton père me tenait d’une main : il avait posé son autre main sur la tête de ta mère. Je vois encore ce visage que la tendresse, la douleur et la fermeté, faisaient rayonner d’une majesté presque surhumaine. C’était le moment fatal ! Tu ne remuais plus ; tes joues commençaient à se marbrer de taches livides, et dans ce moment suprême on sentait bien que la vie et la mort déployaient toute leur puissance pour se combattre.
Alors, au milieu d’un silence effrayant, on n’entendit plus rien que le tic-tac de la vieille montre. Et tous deux écoutèrent, tous deux se mirent à compter le battement des secondes, comme lorsqu’on prête l’oreille dans le lointain au galop du messager, qu’on l’entend s’arrêter, descendre de cheval, qu’il monte, et qu’on peut compter ses pas !
Ah ! dans ce moment la puissance de l’âme humaine était si intense, cette main de père qui me tenait était si frémissante, qu’il me semblait sentir la vie, oui, la vie, circuler dans mes rouages !