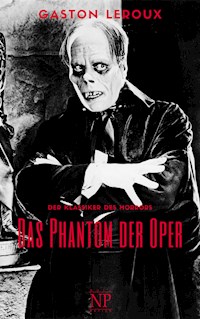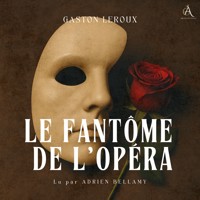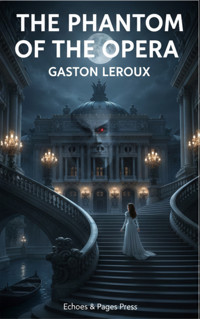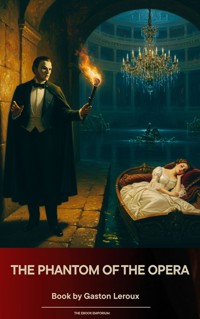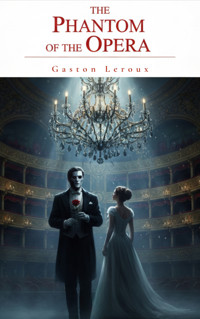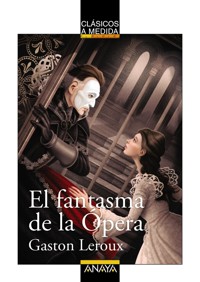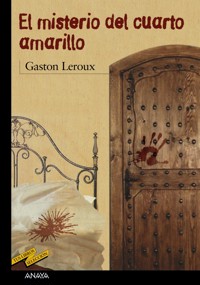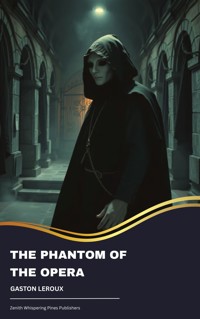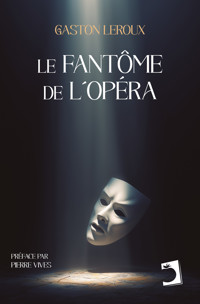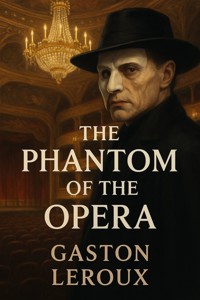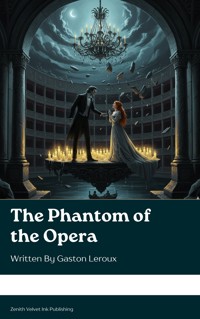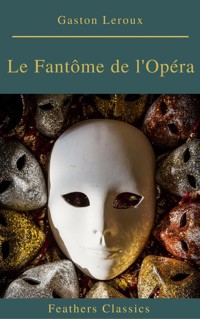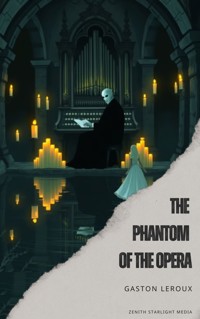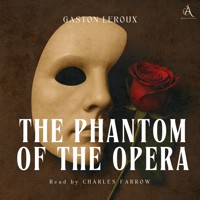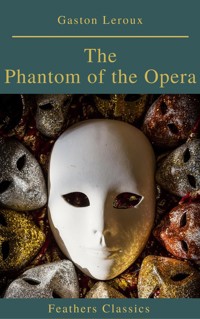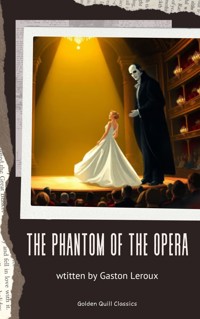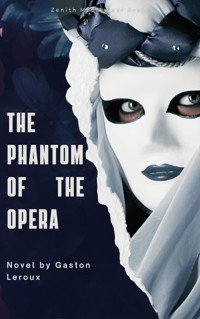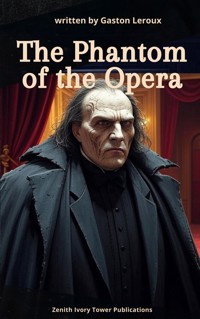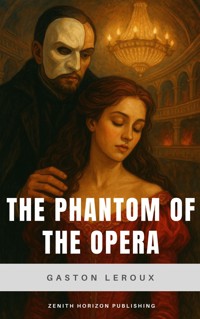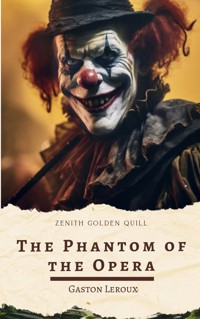Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Œuvres de la Grande Guerre
- Sprache: Französisch
Quand un jeune Français se rebelle contre l'armée allemande
Le jeune Confitou, fils d’un père français et d’une mère allemande, et plutôt enclin à suivre l’exemple de sa mère, change totalement de sentiments lorsque les Allemands arrivent. Il va même prendre les armes pour trahir sa mère et son oncle, officier allemand, et aider à la libération de son village…
Ce court roman, paru en feuilletons quotidiens, inaugure les textes « de guerre » de Leroux qui monte au front littéraire. Le thème des « atrocités allemandes » est au centre de l’œuvre.
Un roman historique rythmé qui vous replongera au coeur de la Première Guerre mondiale
EXTRAIT
— Comment va Mme Raucoux-Desmares, mon cher maître ? On ne la voit plus !
— Elle est un peu souffrante, répondit évasivement le célèbre professeur Raucoux-Desmares à la petite Mme Lavallette qu’il avait croisée dans le vestibule de son fameux institut de Saint-Rémy-en-Valois, transformé, sur son initiative, en hôpital militaire ; et il hâta le pas vers la sortie.
Il venait de passer encore une nuit blanche, car le dernier train du Nord avait laissé à Saint-Rémy une douzaine de grands blessés qui avaient dû être opérés d’urgence. Depuis trois jours il n’avait pas dormi huit heures. Enfin, il allait être cinq heures du matin ; on attendait d’autres blessés à onze heures. Il n’avait pas de temps à perdre et son repos devait être aussi précieux aux autres qu’à lui-même. C’est sans doute ce qu’il aurait désiré que la petite Mme Lavallette comprît bien ; mais elle courut derrière lui.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Gaston Leroux est né en 1868 et mort en 1927. Figure majeure du roman policier aux nuances fantastiques au XIXe siècle, Gaston Leroux commença sa carrière en tant que chroniqueur judiciaire, après s'être fait remarqué pour sa version du procès d'Auguste Vaillant. Ses succès notoires sont
Le Mystère de la Chambre Jaune avec le célèbre reporter Rouletabille, et
Le Fantôme de l'opéra. Gaston Leroux a également milité de nombreuses fois dans ses écrits contre la peine de mort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposé dans le cadre des ressources du Centre Rocambole accessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Edition électronique réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de la Grande Guerre - 1
collection dirigée par Alfu
Gaston Leroux
Confitou
1916
AARP — Centre Rocambole
Encrageédition
© 2012
ISBN 978-2-36058-906-7
Avertissement
de Philippe Nivet
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Picardie
Directeur du Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits
Pendant la Première Guerre mondiale, la diffusion de la culture de guerre passe par différents vecteurs : la presse enfantine, à l’image du journalFillette, la presse illustrée, commeL’IllustrationouLe Miroir, ou les estampes, à l’exemple de celles de Jean-Louis Forain.
Le roman populaire, souvent publié d’abord en feuilleton, participe également de cette diffusion.
Exemple notoire : dans L’Eclat d’obus, roman de Maurice Leblanc, initialement publié dans les colonnes du Journal en 47 feuilletons quotidiens à l’automne 1915, on trouve ainsi de multiples dénonciations de la « guerre à l’allemande », marquée par les violations du droit des gens : « Assassiner et espionner, c’est pour [les Allemands] des formes naturelles et permises de guerre, et d’une guerre qu’ils avaient commencée en pleine période de paix ». Guillaume II y est présenté comme « le plus grand criminel qui se pût imaginer », tandis que les actes commis par les soldats allemands lors de l’invasion y sont résumés de manière saisissante : « Partout, c’était la dévastation stupide et l’anéantissement irraisonné. Partout, l’incendie et le pillage, et la mort. Otages fusillés, femmes assassinées bêtement, pour le plaisir. Eglises, châteaux, maisons de riches et masures de pauvres, il ne restait plus rien. Les ruines elles-mêmes avaient été détruites et les cadavres torturés ».
Si son insertion, en 1923, dans la série des Arsène Lupin a donné à ce roman une audience particulière, les thématiques qu’il développe se retrouvent dans d’autres textes de Maurice Leblanc et dans ceux de la plupart des auteurs populaires du temps, depuis Gaston Leroux jusqu’à Delly, en passant par Jules Chancel ou les auteurs des brochures de la collection « Patrie », tel Gustave Le Rouge ou Léon Groc.
Encrage Edition et le Centre Rocambole (centre de ressources international fondé par l’Association des Amis du Roman Populaire) ont la judicieuse idée d’exhumer ces documents et de les republier dans cette période marquée par la célébration du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Le lecteur de ce début du XXIe siècle y verra comment étaient célébrés les soldats français, héroïques quels que soient leur âge et leur parcours antérieur, dénoncés les espions travaillant de longue date au profit de l’Allemagne et condamnées les atrocités de l’invasion. C’est toute une culture de guerre, assimilée par certains à un « bourrage de crâne », que l’on retrouve.
Préface
d’Alfu
Ce court roman de Gaston Leroux, auteur célèbre pour son Fantôme de l’Opéra — mondialement connu et souvent adapté — et surtout son personnage de Rouletabille, l’un des grands détectives français des origines, est tout à fait emblématique de notre collection dédiée aux romans populaires publiés — et le plus souvent écrits — pendant le premier conflit mondial et mettant en scène la guerre.
Destiné primitivement au Flambeau, un hebdomadaire lancé par le grand journal Le Matin mais qui disparaît très vite, Confitou est finalement intégralement publié dans le « rez-de-chaussée » du quotidien, un mois durant, du 16 janvier au 15 février 1916. Il paraît en librairie chez Lafitte en 1917.
Une seule réédition, copieusement expurgée, sera proposée en 1931 dans la collection « Gaston Leroux » éditée par la veuve de l’auteur sous le label « Editions Jeanne Gaston Leroux » — avec des illustrations de Ralph Soupault.
Et à la lecture des pages qui suivent, on comprend pourquoi une honte certaine s’est abattue sur ce texte.
Enfant de mai (18)68, Leroux a 47 ans lors de la déclaration de guerre. Le conseil de révision de La Roche-sur-Yon confirme sa réforme pour insuffisance cardiaque.
Ne pouvant combattre avec le fusil, il le fera avec la plume et sera, comme beaucoup de ses confrères écrivains populaires, l’auteur d’une littérature de guerre dont le trait principal est l’antigermanisme.
Mais bon sang ne saurait mentir et le naturel revient au galop : Gaston Leroux, éternel joueur 1, choisit là encore de jouer avec la fiction. Et il utilise un thème qui lui permet ce jeu : son personnage central est un enfant qui a un père français et une mère allemande ; il vit en France mais voit arriver chez lui des soldats allemands qui sont ses parents…
Bien sûr on ne peut pas ne pas songer à Alsace, la pièce de théâtre que Leroux a écrit en 1912 avec l’Alsacien Camille Dreyfus, et qui a été jouée au Théâtre Réjane en janvier 1913.
Le thème du patriote alsacien ayant épousé une Allemande, et qui finit par en mourir, présente des similitudes, mais la pièce est un drame.
Confitou relève plus au départ de la comédie. Le personnage principal est un enfant de 8 ans qui pense avant tout à jouer : la guerre est pour lui un spectacle. Et il y est très à l’aise puisqu’il connaît du monde dans les deux camps, parlant aussi bien le français que l’allemand.
Mais petit à petit les choses s’enveniment et la tragédie prend sa place. Il ne peut en être autrement tant sont terribles ces Allemands que l’on voit commettre les pires horreurs.
Car le trait principal du texte de Gaston Leroux est la dénonciation des atrocités allemandes.
Ce propos, qui sera repris à satiété par beaucoup d’autres auteurs du temps, doit-il nous interdire aujourd’hui la lecture de Confitou ? Certainement pas, si nous souhaitons connaître parfaitement un auteur qui reste un des plus grands feuilletonistes du vingtième siècle et aussi si nous voulons vraiment savoir ce qu’a été la Grande Guerre, y compris dans sa littérature populaire.
1 Lire à ce propos mon livre, Gaston Leroux, parcours d’une œuvre (Encrage, 1996)
1.
— Comment va Mme Raucoux-Desmares, mon cher maître ? On ne la voit plus !
— Elle est un peu souffrante, répondit évasivement le célèbre professeur Raucoux-Desmares à la petite Mme Lavallette qu’il avait croisée dans le vestibule de son fameux institut de Saint-Rémy-en-Valois, transformé, sur son initiative, en hôpital militaire ; et il hâta le pas vers la sortie.
Il venait de passer encore une nuit blanche, car le dernier train du Nord avait laissé à Saint-Rémy une douzaine de grands blessés qui avaient dû être opérés d’urgence. Depuis trois jours il n’avait pas dormi huit heures. Enfin, il allait être cinq heures du matin ; on attendait d’autres blessés à onze heures. Il n’avait pas de temps à perdre et son repos devait être aussi précieux aux autres qu’à lui-même. C’est sans doute ce qu’il aurait désiré que la petite Mme Lavallette comprît bien ; mais elle courut derrière lui.
— Mon cher maître ! mon cher maître ! Je tiens à vous dire…
—Quoi ? demanda-t-il assez brusquement en jetant un coup d’œil sévère sur la coiffe trop seyante, sur la blouse trop échancrée, sur tout ce costume coquet de la Croix-Rouge qui faisait de cette petite mondaine de province une infirmière délicieuse, mais qu’il avait de la peine à prendre au sérieux, bien qu’elle montrât un zèle infatigable.
—Mon Dieu ! mon cher maître ! comme vous avez l’air méchant, ce matin !…
Il consentit à sourire. Du reste, il trouvait toujours cette petite Mme Lavallette assez drôle, malgré la gravité des événements, et puis c’était une amie intime de la famille.
Maintenant elle hésitait.
—C’est à cause de…
—De ma femme ?
—Mais oui… pourquoi ne la voit-on plus ici ? Ces dames disaient…
Elle s’arrêta encore devant ce front redevenu hostile. Alors il l’entraîna dans un coin, lui prenant le poignet qu’elle lui abandonnait d’un air assez craintif.
—Qu’est-ce que ces dames disaient ?
—Mais rien ! seulement elles s’étonnaient…
—Allons ! Allons ! mon enfant ! Vous avez été l’amie de ma femme.
—Mais justement, je tiens à vous dire que je la suis toujours.
—Merci ! mais enfin, qu’est-ce que disaient ces dames ?
—Mais que Mme Raucoux-Desmares était une très bonne infirmière !…
—Et c’est tout ? Voyons, ma petite Valentine, vous savez que je vous aime bien…
—Oh ! mon cher maître, depuis la mort de ce pauvre Lavallette, les seules bonnes heures que j’ai vécues, je vous les dois, à votre femme et à vous, je puis le dire !
—N’exagérons rien : je vous ai toujours vue gaie, même à l’enterrement de votre mari ! Ne protestez pas ! Il ne s’agit pas de cela. Il s’agit, hélas de choses très sérieuses. Il faut être franche avec moi. Mais voilà, vous avez peut-être peur de me faire de la peine…
—Je vous jure que ces dames n’ont pas prononcé une parole qui pût vous être désagréable… Elles s’étonnaient simplement que Mme Raucoux-Desmares eût brusquement quitté son service ici !
— C’est moi qui l’en ai priée…
—On s’en doute un peu…
— Me donne-t-on tort ? Répondez-moi…
— Eh bien ! non, déclara la petite Mme Lavallette, en regardant bravement le professeur dans les yeux… Vous avez bien fait !…
—Alors, laissez-moi aller me coucher !…
Et il partit si vite qu’il oublia de serrer la main qu’elle lui tendait.
Si fatigué qu’il fût, le professeur, pour rentrer chez lui, refusa de monter dans l’auto qui l’attendait devant le perron. D’un pas solide, quoique appesanti, il traversa la cour ; et, quand il se trouva en pleine campagne, il aspira longuement la fraîcheur de l’aube. Entre ces jours et ces nuits dont la chaleur étouffante pesait sur le cœur comme une angoisse nouvelle, il n’avait que ces quelques minutes pour apprécier encore la chance incertaine de vivre.
Les nouvelles que les derniers blessés avaient données entre deux râles n’étaient ni bonnes ni mauvaises : le plus souvent obscures. On se battait au-dessus de Charleroi. La ville avait été prise, perdue, reprise quatre fois. Il n’y avait pas lieu d’être inquiet. Cependant le beau visage de Raucoux-Desmares était sombre.
Sa haute taille légèrement courbée, les deux poings dans les poches de sa vareuse, le front soucieux derrière la visière de son képi, il prit à travers champs pour gagner le faubourg campagnard où, depuis dix ans, il cachait assez jalousement son bonheur domestique. Deux kilomètres à peine le séparaient de son petit hôtel dont les toits d’ardoise luisaient là-bas, tout au bout de la plaine, entre deux bouquets de gros hêtres, sous la première caresse du soleil levant.
On avait dépassé la mi-août, et la moisson de tout ce coin de campagne, entre la rivière et les grands bois, était encore en javelles, les gerbes abandonnées sur la terre, comme si les bras avaient, tout à coup, manqué pour les ramasser. Au bout d’un champ de blé, quelques javelottes, dressées hâtivement en faisceaux, attestaient le travail interrompu, et, par la silhouette guerrière de leur alignement sur l’horizon déjà couleur de sang, rappelaient au pied de quels autres faisceaux les paysans du Valois et de toute la terre de France étaient allés dormir ou veiller.
Raucoux-Desmares suspendit sa marche pensive au milieu de la grande plaine solitaire. Lui aussi avait voulu partir malgré ses cinquante ans ; oubliant que l’on allait avoir besoin de son scalpel, il avait demandé un fusil. Il eût voulu être au premier rang.Il eût voulu être le premier mort !
Plus qu’aucun autre il estimait qu’il devait son sang à la France, et, à la vérité, Raucoux-Desmares avait, pour penser ainsi, deux bonnes raisons.
La première était que nul plus que lui n’avait contribué à désarmer son pays par ses discours toujours amis d’un compromis universel, par sa propagande pacifiste dans les congrès internationaux d’où il revenait avec des assurances de bonne volonté et des paroles de miel apportées d’outre-Rhin. Son excuse, aux yeux des autres, avait été sa sincérité aveugle, son amour profond de l’humanité, une foi dans le progrès éblouissante, qui ne lui avait point permis de voir qu’il n’était pas suivi par ceux mêmes qui l’avaient poussé sur la route trompeuse, bordée de palmes, au bout de laquelle nous allions nous heurter à quatre millions d’hommes en armes.
Quant à lui, il s’était refusé à trouver dans une aussi étourdissante confiance une atténuation à ce qu’il appelait son crime et sa bêtise. Un fusil et mourir ! Un ordre l’avait retenu à son institut de Saint-Rémy-en-Valois, c’est-à-dire à son devoir, au poste où il était susceptible de rendre le plus de services à son pays. Et, de fait, dans ce palais de la science bienfaisante, à l’édification duquel il avait consacré la plus grande partie de sa fortune, et qui avait ouvert ses salles transformées en dortoirs aux premières victimes des combats du Nord, Raucoux-Desmares venait d’avoir l’occasion de prouver l’efficacité incomparable d’un nouvel antiseptique découvert quelques semaines plus tôt, après deux années de travaux assidus. Désormais, les blessures les plus affreuses changeaient d’aspect en moins de huit jours, et les gangrènes étaient enrayées. On avait fait entendre au professeur que l’homme qui venait de remporter un tel triomphe sur la mort, dans son laboratoire, avait mieux encore à faire que d’exposer sa vie sur un champ de bataille. Il avait obéi, mais il n’avait pas été persuadé.
Nous avons dit que Raucoux-Desmares avait deux bonnes raisons pour vouloir se battre. Nous connaissons la première ; la seconde… mais suivons le professeur qui a repris sa route ; maintenant il se dirige hâtivement vers son petit hôtel champêtre ; il franchit le pont rustique jeté sur le ruisseau aux eaux claires qui borde la propriété, il traverse le pré aux herbes grasses planté de pommiers tordus ; son regard au-dessus d’un mur va chercher la fenêtre du premier étage où, dans une veille insensée, sa jeune femme, à l’ordinaire, attend, pendant des heures, sa venue. Mais ce matin, toute la maison semble avoir encore son visage de bois. Il pense, satisfait « qu’on a été plus raisonnable », et qu’on a enfin consenti à prendre quelque repos, même en son absence.
Au bout du verger, il pousse une porte, et le voilà dans la cour de derrière que la Génie Boulard, la seule domestique restée à la maison, commence de balayer en chantant — à mi-voix depuis la guerre et d’un ton toujours courroucé — ses éternelles chansons : « L’Amour est menteur, garde ton cœur… »
—Madame s’est couchée de bonne heure ?
—Pense pas, m’sieur, l’ai entendue toute la nuit qui travaillait dans la lingerie pour les blessés de m’sieur ! M’sieur a-t-il des nouvelles ?
—On ne sait encore rien, la Génie…
Il est déjà dans la maison. Il gravit l’escalier et pousse les portes du premier étage avec de grandes précautions. Le jour qui vient de naître glisse, çà et là, son rayon à travers les persiennes ; dans une petite chambre qu’il traverse sur la pointe des pieds, Raucoux-Desmares passe devant un lit d’enfant. Et soudain, il s’arrête. Craint-il de réveiller son fils ?Confitoua huit ans et dort comme un soldat de plomb. La figure de l’enfant sur l’oreiller apparaît dans une douce lumière, encadrée de longs cheveux blonds bouclés qui contribueraient à lui donner un air de fille, si le front bombé, haut et large, ne se présentait tout de suite comme la marque principale et très masculine de cette physionomie par ailleurs si délicate. Raucoux-Desmares regarde dormir son fils avec une attention surprenante. Il semble étudier son sommeil comme s’il en attendait quelque révélation. Pourquoi se penche-t-il ainsi, le front barré d’un incompréhensible souci, sur ce petit être qui repose si paisiblement ? Ce n’est certainement point le médecin qui s’inquiète devant ce jeune corps bien portant. La santé deConfitouest parfaite. S’il dort bien, il mange encore mieux. Ses lèvres fraîches ont conservé par endroits les traces des confitures qu’il adore, et qui lui ont valu son nom. Sans cette passion pour la gelée de groseilles,Confitous’appellerait Pierre, comme tout le monde — et comme son père.
Raucoux-Desmares écarte une mèche de cheveux sur le front de l’enfant, et se penche… se penche comme s’il allait l’embrasser ; mais il ne l’embrasse pas. Sans doute, au dernier moment, a-t-il eu peur de le réveiller.
Il s’en va, toujours avec les mêmes précautions. Le voilà maintenant dans la lingerie qui précède « la chambre de madame ». Il ne va pas plus loin ; une femme est là, qui dort, la tête renversée sur le dossier d’un fauteuil d’osier, un ouvrage de couture tombé de sa belle main pendante.
Alors, tout doucement, tout doucement, Raucoux-Desmares vint s’asseoir en face de ce sommeil doré par la première lumière du jour. C’était une belle femme, cette femme ; elle n’avait pas trente ans. C’était sa femme. C’était la seconde raison pour laquelle il estimait que, plus qu’aucun autre, il devait son sang à la France. C’était une Allemande…
Une Allemande ! Il l’adorait.
Cette pensée extraordinaire, inouïe, qu’il adorait,en ce moment,une Allemande, le fit soupirer comme un enfant. Elle eut un mouvementet, elle aussi, soupira.
Ah, ce sommeil n’était point profond comme celui de Confitou ! Raucoux-Desmares sentait bien que les songes ou les images qui agitaient ce sommeil-là, reliaient trop cette femme aux cauchemars de la vie réelle pour qu’il fût bien difficile de l’y faire revenir… Qu’il respirât seulement un peu fort, et elle ouvrirait les yeux, et elle se jetterait dans ses bras.
Dans ses bras… Il s’immobilisa… Il pensa. Il pensa d’abord qu’il avait bien fait de lui dire de rester à la maison. Il ne voulait pas qu’elle fût exposée à souffrir quelque sournoise insolence de la part de « ces dames » ! Que n’eussent-elles point inventé pour elle quand, la semaine précédente, elles avaient rendu la vie si dure à une Française qui faisait apprendre l’allemand à ses enfants, que la pauvre dame avait juré qu’elle ne reviendrait plus jamais à Saint-Rémy ? Cependant celle-ci était fille d’officier français, et elle avait ses frères à l’armée française, mais on ne lui pardonnait pas sa « fraülein » rendue, du reste, immédiatement à l’Allemagne, ni la supériorité qu’elle avait sur « ces dames » de parler une langue étrangère.
Quel sort donc les attendait, sa femme allemande et lui ? songeait Raucoux-Desmares, en regardant dormir celle qu’il aimait depuis dix ans ! Il s’appliquait à penser que ce n’était pas une Prussienne ; et, certes, qu’elle ne fût point cela, il ne trouvait pas cette consolation si ridicule. D’abord, jamais une Berlinoise, se disait-il, n’eût pu offrir aux yeux d’un mari, après dix ans de ménage et la maternité, dans le désordre de ce sommeil matinal, des lignes aussi pures et aussi délicates, ce teint de lait, cet ovale charmant du visage qui ne rappelait en rien le type classique de la Gretchen. Le nez et la bouche avaient une finesse toute parisienne qui ne se trouve absolument pas en Allemagne, excepté quelquefois, à Dresde, patrie des « petits saxes ». C’était une Dresdoise.
Jamais les Dresdoises, pensait-il, n’ont comploté de conquérir le monde. Berlin envoie ses femmes dans tous les bazars de l’étranger ; Dresde les garde. Et il avait dû aller chercher celle-là dans la joyeuse capitale du vieux royaume d’Auguste le Fort, après l’avoir rencontrée, bien par hasard, aux fêtes du centenaire de Kant, à Kœnigsberg, où un groupe des « Combattants de la Paix » l’avait expédié, un peu malgré lui. Tout de suite, ils s’étaient aimés, malgré la grande différence d’âge. Elle avait été très heureuse d’épouser ce Français célèbre, et lui s’était épris, tous les jours davantage, de cette belle enfant, toujours gaie, douce et sentimentale. Il pensait : tous les jours davantage… Il pensait qu’il ne l’avait jamais autant aimée… Il pensait : à cinquante ans, on aime plus qu’à quarante. Et la guerre venait d’éclater. C’était effrayant !
Déjà, depuis le 3 août, ils avaient vécu de tristes heures, mais il en redoutait de plus sombres. Ce qui s’était passé jusqu’alors n’avait fait, en somme, que resserrer les liens qui les unissaient. L’horreur de cette lutte à mort entre les deux races les avait jetés aux bras l’un de l’autre dans un désespoir qui était encore de l’amour. Comment eût-il cessé de l’aimer puisqu’elle continuait de le comprendre ? Il n’y avait pas encore eu entre eux de sujets de querelle. Elle avait admis tout de suite qu’il dût combattre au premier rang et ne l’avait point détourné de son dessein de prendre du service actif ; mais, en refermant ses beaux bras sur son Pierre, elle avait juré de ne point lui survivre ; et elle était sincère. Elle avait accordé au patriotisme fiévreux de son époux tout ce qu’il exigeait sans qu’il eût même à l’exiger ! Ainsi, il était bien entendu que le crime de la guerre avait été ourdi à Berlin, et elle s’était unie à lui pour le maudire. Elle disait : « Pourquoi te tourmentes-tu ? Je ne suis plus Allemande ; je t’ai épousée, je suis Française. » Mais elle s’appelait Freda.
La joie de Mme Raucoux-Desmares avait été grande en apprenant que l’autorité militaire maintenait son mari à Saint-Rémy-en-Valois. Ils ne se quitteraient pas ! Elle s’était donnée tout de suite à l’ambulance avec frénésie, mais quand son mari l’avait priée de rester désormais chez elle, elle n’avait fait aucune objection. Depuis, elle travaillait pour les blessés, à domicile, où elle passait son temps à attendre son Pierre.
Maintenant qu’elle était sûre qu’il n’allait pas se battre, la guerre semblait lui être devenue indifférente. Mais la pensée qu’elle se faisait des sentiments de son mari sur leur situation exceptionnelle l’exaltait ou l’abattait, tour à tour, avec une force ou une langueur singulières. Elle répétait souvent : « M’aimes-tu toujours autant ? — Plus », lui répondait-il.
Elle secouait la tête. Elle ne le croyait pas. Elle avait tort, car c’était vrai.
Or, c’était justement cela qui faisait le tourment caché de Raucoux-Desmares. Il l’aimait davantage, et cependant il la fuyait. Depuis quelques jours surtout. Il l’aimait, mais il y avait des moments où il trouvait monstrueux de l’embrasser… Il avait beau en vouloir chasser l’idée,l’idée était de plus en plus là,qu’elle était Allemande. Elle pouvait dire tout ce qu’elle voulait…elle en était…elle appartenait à la horde !…
Elle était venue de là-bas en apportant avec elle tout ce qu’une éducation allemande, tout ce que « l’esprit » allemand ne laisse jamais s’égarer : des mœurs, une certaine façon d’être et de penser qui reste toujours chez la femme allemande, même quand elle épouse un étranger, et même une certaine façon d’élever ses enfants qui n’appartient pas aux mères françaises… Horreur !… Confitou, élevé par sa mère, avait été élevé à l’allemande !…
Raucoux-Desmares, à cette pensée aiguë qui lui transperçait le cœur comme avec une lame, se souleva en gémissant. Freda eut un mouvement ; il s’arrêta. Elle tourna la tête vers le mur, sans sortir de son sommeil agité. Alors il put quitter la pièce.
Il pénétra dans la salle de billard dont il ouvrit une fenêtre ; il avait besoin d’air ; l’idée de son enfant élevé par une mère allemande l’étouffait. Que savait-il de Confitou, decette petite âme pétrie par Freda, selon sa mode ? Quelle misère ! Confitou passait la plus grande partie de ses vacances en Allemagne, choyé par des parents allemands qui l’adoraient, le gâtaient ; il retournait toujours là-bas avec joie, il en revenait avec ennui.
Confitou n’avait en France ni oncle, comme l’oncle Moritz qui lui passait tous ses caprices, et lui faisait boire de la bière, ni tante, comme la tante Lisé, qui lui mettait de la confiture dans tous ses plats.
Raucoux-Desmares se retourna, s’appuya contre le mur ; il était horriblement pâle ; Confitou ne devait pas seulement aimer les confitures, il devait aimeraussiles Allemands !
Soudain l’homme quitta le mur. Il s’avançait vers le billard qui étendait devant lui son tapis vert. Comme sur une plaine de là-bas, de petites constructions de la Forêt-Noire, achetées à Baden-Baden — Confitou avait surtout des jouets allemands, — se dressaient, s’alignaient, formant un village enfantin… et… autour de ce village, courant à l’assaut, des petits soldats de bois… et ces petits soldats, Raucoux-Desmares les connaissait bien, c’étaient des soldats allemands… Seulement… seulement le village était défendu contre les soldats de bois par des soldats de plomb et ceux-ci étaient français… Les uns et les autres étaient à peu près en forces égales… La bataille était certainement dans son plein, car, des deux côtés, il y avait des morts… beaucoup de morts…
Au premier coup d’œil, il était bien difficile de savoir qui en avait tué le plus, des Français ou des Allemands. Raucoux-Desmares, le cœur haletant, les jambes brisées par une émotion souveraine, approcha une chaise, s’assit et resta penché longtemps sur cette guerre de Lilliput. Il comptait… Ici, au coin duGasthausaux volets verts, un groupe de sept grenadiers de la garde avait été fauché… là, près duBahnhof,une douzaine de Boches gisaient pêle-mêle, les pattes de bois en l’air… il respira… Malheureusement, un peu plus loin, il découvrit seize soldats de plomb, seize exactement qui avaient dû essuyer un véritable feu de barrage… ces seize-là, avec les huit morts en plomb de la place de la Mairie, faisaient déjà à eux seuls vingt-quatre… vingt-quatre Français contre dix-neuf Allemands… Heureusement, place de l’Eglise, autour d’un canon de fer aussi grand que la cathédrale, il trouva quatre cadavres de uhlans et même quatre cadavres et demi, car il y en avait un qui n’avait plus que le buste, il est vrai, depuis longtemps… En somme, il n’y avait là ni vainqueurs ni vaincus… Raucoux-Desmares laissa tomber sa tête sur ses bras recourbés, et, terrassé par la fatigue, s’endormit.
2.
Un bain dans les eaux froides de la petite rivière avait remis instantanément Raucoux-Desmares de ses fatigues, et il se présenta au déjeuner de midi avec de l’appétit. Son humeur — en temps de paix toujours égale — n’était point hostile, car il avait eu un bon coup de téléphone de l’hôpital militaire, et un télégramme particulier, venu de Maubeuge, donnait de l’espoir pour nos armes.
Au fond, sans vouloir envisager,une catastrophe qu’il travaillait assidûment à chasser de sa pensée, l’idée seule d’une bataille perdue le faisait si cruellement souffrir qu’il se jetait complètement sur le moindre indice favorable, et qu’il faisait sien le plus pauvre raisonnement optimiste. Mais le dernier de ces raisonnements avait encore sa vertu ; et Raucoux-Desmares considérait l’optimisme comme une propreté morale nécessaire. Aussi ne perdait-il pas une occasion de le faire rayonner autour de lui. Il disait couramment que ceux qui avaient le malheur de ne pouvoir se battre avaient au moins pour devoir de ne pas dégoûter à l’avance de leur mort ceux qui allaient mourir pour eux !…
Il se laissa embrasser avec tendresse par sa femme et par Confitou, et l’on se mit à table. Il y avait du gigot. Le malheur vint de ce gigot et de Confitou.
Confitou réclama des confitures pour les mettre « dans son gigot ». Freda reprocha à Génie Boulard de n’avoir pas mis les confitures sur la table ; la Génie Boulard, qui n’était jamais à bout d’arguments, déclara qu’elle avait pensé « qu’il serait toujours temps au dessert ». Elle n’avait point l’habitude de ce service. Le valet de chambre était à la guerre. Elle ajouta : « On n’a pas idée de manger des confitures avec de la viande ! Vous finirez par y faire mal au cœur à ce petit ! »
Elle ne donnait toujours pas les confitures. Confitou, qui avait le sens des réalités, alla les chercher lui-même dans le garde-manger, et revint avec le précieux pot.
—Tiens, maman, fit-il, voilàtesconfitures.
La Génie Boulard s’en alla fâchée.
Mme Raucoux-Desmares garnit alors consciencieusement l’assiette de son fils de belle gelée de groseilles — un cadeau de la tante Lisé à son dernier voyage, — sur quoi Raucoux-Desmares dit :
—Je suis de l’avis de cette fille, ce doit être horrible, ce mélange.
—Qu’en sais-tu ? Tu n’en as jamais mangé, répondit-elle.
—Je n’en ai jamais mangé, justement, parce que j’imagine que ce doit être horrible.
—Goûtes-en une fois donc, insista-t-elle.
—Je vais t’avouer une chose, répliqua-t-il, c’est que non seulement je ne peux pas en manger, mais que je n’ai jamais pu vous voir en manger !
— Par exemple !…
—C’est comme je te le dis. Je regarde d’un autre côté, sans affectation, voilà tout !
—Dis tout de suite que nous te répugnons, fit-elle, étonnée.
Il affecta de rire :
—Tu exagères, et je n’ai pas voulu te faire de peine. Que veux-tu ? Il y a des mélanges auxquels, nous autres Français, nous ne pourrons jamais nous faire, et le gigot et la confiture est de ceux-là… je ne t’en ai jamais parlé parce que j’ai l’esprit assez large, tu le sais bien, pour laisser à chaque peuple ses mœurs, ses coutumes et ses goûts, et concevoir que nous pouvons également choquer l’étranger par certains autres côtés que nous ne soupçonnons même pas.
—Tu ne m’as jamais choquée en rien, dit-elle, et, bien que je ne puisse y toucher, je te regarde manger avec plaisir les grenouilles et les escargots, parce que je sais que tu les adores.
—Tu pleures ?
—Oui ; jamais,avant, tu ne m’aurais dit ce que tu viens de me dire : « Nous autres Français »… Je ne suis donc plus ta femme ? Et Confitou n’est-il plus ton fils ?
—Je te demande pardon, Freda, mais Confitou est si bien de mon avis que lui non plus ne peut souffrir l’horrible mélange. Il mange les confitures et laisse la viande.
Il avait pensé, par cette dernière observation, la faire rire. Elle resta mélancolique. Il constata avec effroi que les moindres paroles contribuaient à creuser, peu à peu, une fossé entre eux, où il tremblait de voir trébucher leur sincère amour. Comme, depuis quelques jours… depuis quelques jours seulement, ils n’osaient plus se parler de la guerre, ils en étaient réduits à se dire n’importe quoi. Et cela encore commençait à être une torture sans nom : dire des niaiseries, des futilités, pendant qu’on se battait là-haut !
Partout, à toutes les tables de tous les Français, on ne parlait que de cette chose formidable : la guerre, et quelle guerre ! Un conflit qui allait changer la face du monde, et qui remuait la Terre à l’égal d’un cataclysme préhistorique, qui allait anéantir des millions d’hommes comme un déluge ; et chez lui,on disait des choses sans importance !…
Raucoux-Desmares ne se rendait point compte que, depuis qu’il s’était marié, il n’avait encore jamais rien dit d’aussi « important » que son observation sur les confitures. Il ne s’en rendait point compte, parce que cela n’avait pas été dit avec réflexion, mais avec spontanéité, et dans une humeur méchante qu’il regrettait déjà, parce qu’elle avait fait pleurer sa femme, qu’il aimait. Seulement, le coup avait porté, et Freda n’avait jamais autant souffert.
Tandis qu’elle persistait dans sa mélancolie, il essayait de démêler les éléments de leur récent désaccord, pour les combattre si possible ; et cela devait être possible puisqu’il était bien entendu qu’ils s’aimeraient par-dessus tout, et que, dès la première heure dela guerre, ils s’étaient juré, quoi qu’il arrivât, un cœur fidèle. Elle le lui avait gardé et, en vérité, il trouvait indigne de lui de la faire souffrir puisqu’il n’avait rien à lui reprocher.
Les premières victoires françaises ne l’avaient point attristée.
Elle était de cet avis que l’Alsace et la Lorraine annexées étaient restées françaises, que c’étaient des pays français, et que l’Allemagne en 1871 avait commis une grande faute en arrachant ces territoires à la France. « Sans l’Alsace et la Lorraine, disait-elle, il y a beau temps que les Allemands et les Français seraient devenus les meilleurs amis du monde. Ils auraient conclu une alliance qui les aurait fait les maîtres de l’univers… Eh bien, reprenez l’Alsace et la Lorraine, car cela est juste, et quand vous les aurez, il n’y aura plus de sujet de discordeentre nous ! »
En somme, plus il y réfléchissait, et plus il trouvait « qu’elle avait été parfaite ». Elle avait su, elle, lui faire oublier, dans cette tourmente, qu’elle était Allemande ; pourquoi, tout à coup, lui, s’en était-il souvenu ?
Car c’était lui, le coupable, qui ne se confiait plus à elle comme aux premiers jours, sans qu’elle eût rien fait pour mériter un pareil châtiment. On ne parlait plus de la guerre, mais c’était lui, qui, l’avant-veille, lui avait dit assez brusquement : « Je t’en prie, attends que je t’en parle ! »
En se levant de table, avant de partir pour l’hôpital, il se disposait à embrasser sa femme avec effusion, quand il aperçut Confitou qui se nettoyait la bouche avec un cure-dents. C’était du luxe, attendu que Confitou n’avait pas mangé de viande et que, dans la circonstance, le fils unique de M. Raucoux-Desmares eût mieux fait assurément de s’abstenir ; mais Confitou aimait ainsi, de temps en temps, à faire des gestes « au-dessus de son âge », pour étonner le monde.
—Tu es ridicule, lui dit son père, et je t’ai déjà fait entendre que l’on ne se sert point d’un cure-dents de cette façon.