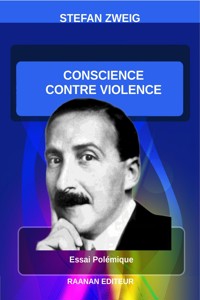
1,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Au XVIe siècle, époque de la Réforme protestante, Genève est contrôlée par Calvin qui établit une sorte de régime théocratique cohabitant avec un État soumis à la volonté de la nouvelle Église. Les Genevois se voient alors interdire les chapelets, les crucifix, et toutes sortes de règles d'austérité leur sont imposées. Le penseur Michel Servet, qui a le malheur de tomber en désaccord avec le pouvoir de Calvin, se voit attaqué en justice et rapidement condamné à mort. Il est brûlé vif en place publique. Un autre savant, Castellion, se décide alors à réhabiliter Servet : une longue et difficile lutte attend ce protestant modéré, entre l'austérité calviniste et le pouvoir de l'Inquisition catholique.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
SOMMAIRE
Introduction
L’arrivée de Calvin au pouvoir
La « discipline »
Entrée en scène de Castellion
Le cas Servet
Meurtre de Servet
Le manifeste de la tolérance
Le triomphe de la force
Série : Stefan Zweig
|13| CONSCIENCE CONTRE VIOLENCE
STEFAN ZWEIG
CONSCIENCE CONTRE VIOLENCE
ESSAI POLÉMIQUE
Jean Calvin (1509-1564)
Paris, 1936
Traducteur Alzir Hella
Raanan Éditeur
Livre 1265 | édition 1
raananediteur.com
La postérité ne pourra pas comprendre que nous ayons dû retomber dans de pareilles ténèbres après avoir connu la lumière.
Sébastien Castellion, De arte dubitandi, 1562.
Introduction
Celui qui tombeobstiné en son courage, qui, pour quelque danger de la mort voisine, ne relâche aucun point de son assurance, qui regarde encore, en rendant l’âme, son ennemi d’une vue ferme et dédaigneuse, il est battu, non pas de nous, mais de la fortune ; il est tué, non pas vaincu : les plus vaillants sont parfois les plus infortunés. Aussi y a-t-il des pertes triomphantes à l’envi des victoires…
Montaigne
« Le moucheron contre l’éléphant. » Ces mots de Sébastien Castellion que l’on trouve écrits de sa propre main dans l’exemplaire bâlois de son pamphlet contre Calvin surprennent tout d’abord et l’on est bien près de n’y voir qu’une de ces exagérations dont les humanistes étaient coutumiers. Cependant dans l’esprit de Castellion il n’y avait là ni hyperbole ni même ironie. Par cette comparaison tranchante le vaillant lutteur ne voulait que montrer à son ami Amerbach qu’il savait très bien quel adversaire formidable il affrontait en accusant publiquement Calvin d’avoir, par fanatisme, tué un homme et par là la liberté de conscience au sein de la Réforme. Dès l’instant que Castellion s’empare de sa plume comme d’une lance pour engager ce combat périlleux, il n’ignore pas l’impuissance à laquelle est vouée une attaque purement intellectuelle contre une dictature cuirassée et armée de pied en cap ; il est fixé sur la vanité de son entreprise. Comment un individu isolé et désarmé aurait-il pu vaincre un Calvin qui s’appuyait sur des milliers et des dizaines de milliers d’hommes, sans parler du formidable appareil de l’État ? Grâce à une organisation extraordinaire, Calvin avait réussi à transformer une ville entière, un État, ne comptant que des citoyens libres, en une vaste et docile machinerie, à supprimer toute liberté de pensée, toute indépendance, au profit de sa seule doctrine. Rien à Genève n’échappe à son pouvoir : le Conseil et le Consistoire, l’Université et les tribunaux, les finances et la morale, les prêtres, les écoles, les sergents, les prisons, le mot imprimé et la parole, tout est sous son contrôle, dépend moralement de lui. La doctrine calviniste est devenue la loi, et celui qui ose élever contre elle la moindre objection, le cachot, l’exil ou le bûcher, ces arguments définitifs de toute dictature, lui ont bientôt enseigné qu’à Genève une seule vérité est tolérée, dont Calvin est le prophète. Mais la force inquiétante de cet homme inquiétant déborde de beaucoup les murs de la ville ; les États fédérés suisses voient en lui le plus important des alliés politiques, le protestantisme mondial considère ce théologue incomparable, ce grand législateur comme son chef spirituel, les princes et les rois se disputent la faveur de cet homme qui a réussi à édifier, à côté de l’Église romaine, la plus puissante organisation chrétienne d’Europe. Aucun événement politique sérieux ne se passe sans qu’il en soit informé et il ne s’en accomplit pour ainsi dire pas contre sa volonté. Déjà il est devenu presque aussi dangereux d’attaquer le prédicateur de la cathédrale Saint-Pierre que l’empereur ou le pape eux-mêmes.
Et qui est son adversaire, ce Sébastien Castellion, cet idéaliste qui, au nom de la liberté de pensée, dénonce sa tyrannie et toute tyrannie intellectuelle ? Vraiment, comparé à la puissance fantastique de Calvin, c’est bien un moucheron dressé contre un éléphant ! Un individu inexistant, un zéro, du point de vue politique et, par-dessus le marché, un gueux, un pauvre diable de savant, qui nourrit péniblement sa famille en faisant des traductions et en donnant des leçons, un réfugié sans droit de cité et à plus forte raison sans droits civiques, un émigré : toujours aux époques de fanatisme l’homme resté humain est complètement seul et impuissant au milieu des zélotes en lutte les uns contre les autres. Pendant des années, frôlant la persécution et la misère, ce grand et modeste humaniste mène une existence pauvre, étroite, mais indépendante, parce que libre de toute attache à un parti ou à une secte quelconque. Ce n’est que lorsque sa conscience se révolte devant le bûcher de Servet qu’il quitte son travail pacifique et se lève pour accuser Calvin au nom de la liberté outragée. Mais son isolement loin de cesser grandit alors jusqu’à l’héroïsme. Car Castellion n’a pas derrière lui et autour de lui pour l’appuyer et le défendre, comme son adversaire, d’ailleurs plus habitué à la lutte, des partisans solidement organisés ; aucun parti, ni le catholique ni le protestant, ne le soutient, aucun prince, roi ou empereur n’étend au-dessus de sa tête, comme autrefois au-dessus de celle de Luther et d’Érasme, sa main protectrice, et même les quelques amis qui l’admirent n’osent l’encourager qu’en secret. On n’ignore pas à quel point il est dangereux de se placer ouvertement aux côtés d’un homme qui – alors que la folie du temps veut que dans tous les pays les hérétiques soient traqués comme du gibier et torturés – élève la voix avec courage en faveur de ces déshérités et opprimés et, par-delà le cas de Servet, conteste une fois pour toutes aux puissants de la terre le droit de poursuivre quelqu’un pour ses idées ; un homme qui, dans un de ces moments terribles d’obscurcissement des esprits tels que les peuples en connaissent de temps en temps, ose conserver un regard clair et humain et appeler tous ces massacres pieux, accomplis soi-disant pour l’honneur de Dieu, par leur vrai nom : assassinats, assassinats, et encore une fois assassinats ; qui, provoqué dans le sentiment le plus profond de son humanité, ne peut plus se taire et clame au ciel son désespoir devant toutes ces cruautés ! Celui qui se dresse contre les maîtres du jour doit toujours s’attendre à n’avoir que très peu de partisans, étant donné l’immortelle lâcheté des hommes : c’est ainsi que Sébastien Castellion n’eut, à l’heure décisive, personne derrière lui que son ombre et pour unique appui que le bien inaliénable de l’écrivain en lutte pour une cause sacrée : une conscience indomptable dans une âme intrépide.
Le fait que Sébastien Castellion se rendit compte dès le début que sa lutte était vouée d’avance à l’insuccès et l’entreprit néanmoins suffit pour faire à jamais un héros de ce « soldat inconnu » de la grande guerre de libération du genre humain. Rien que par le courage que revêt cette protestation passionnée d’un seul au milieu de tous contre la terreur d’alors, le combat engagé par Castellion contre Calvin devait rester mémorable. Cependant le problème que posait cette dispute déborde de beaucoup son cadre momentané. Il ne s’agit pas ici d’une question théologique étroite, d’un certain Servet, et même pas de la crise décisive qui met aux prises le protestantisme libéral et le protestantisme orthodoxe, mais d’une cause qui nous intéresse tous, d’une lutte qui, quoique sous un autre nom et sous des formes différentes, n’a jamais cessé d’exister (nostra res agitur). La théologie n’est ici rien d’autre qu’un masque temporaire et fortuit, et Castellion et Calvin eux-mêmes n’apparaissent que comme les représentants visibles d’un antagonisme invisible en même temps qu’insurmontable. Quelle que soit la façon dont on veuille appeler les pôles de ce conflit permanent, tolérance contre intolérance, liberté contre tutelle, humanité contre fanatisme, individualité contre mécanisation, conscience contre force, tous ces mots ne font qu’exprimer les deux termes d’un problème qui se pose pour chacun de nous : faut-il se prononcer pour l’humain ou le politique, pour l’ethos ou le logos, pour la personnalité ou la communauté ?
Cet antagonisme entre la liberté et l’autorité, toutes les époques, tous les peuples, tous les penseurs l’ont connu. Car la liberté est impossible sans une certaine autorité, sous peine de dégénérer en chaos, pas plus que l’autorité n’est possible sans liberté à moins de devenir tyrannie. Il est incontestable qu’il existe au fond de la nature humaine une aspiration mystérieuse à la fusion dans la communauté. Éternellement persiste en nous la vieille illusion qu’on peut trouver un système religieux, national ou social qui, équitable pour chacun, dispenserait à jamais à l’humanité l’ordre et la paix. Le grand inquisiteur du roman de Dostoïevski ne nous a-t-il pas montré avec une logique cruelle que la majorité des hommes redoutent en fait leur propre liberté ? Et il est bien vrai que, par lassitude devant l’effroyable multiplicité des problèmes, la complexité et les difficultés de la vie, la grande masse des hommes aspirent à une mécanisation du monde, à un ordre définitif, valable une fois pour toutes, qui leur éviterait tout travail de la pensée. C’est cette aspiration messianique vers un état de choses où disparaîtraient les problèmes brûlants de l’existence qui constitue le véritable ferment qui prépare la voie à tous les prophètes sociaux et religieux. Toujours, quand les idéaux d’une génération ont perdu leurs couleurs, leur feu, il suffit qu’un homme doué d’une certaine puissance de suggestion se lève et déclare péremptoirement qu’il a trouvé ou inventé la formule grâce à laquelle le monde pourra se sauver pour que des milliers et des milliers d’hommes lui apportent immédiatement leur confiance ; et il est de règle constante qu’une idéologie nouvelle – c’est sans doute en cela que réside son sens métaphysique – crée tout d’abord un idéalisme nouveau. Car celui qui apporte aux hommes une nouvelle illusion d’unité et de pureté commence par tirer d’eux les forces les plus sacrées : l’enthousiasme, l’esprit de sacrifice. Des millions d’individus sont prêts, comme par enchantement, à se laisser prendre, féconder, et même violenter, et plus ce rédempteur exige d’eux, plus ils sont prêts à lui accorder. Ce qui, hier encore, avait été leur bonheur suprême, la liberté, ils l’abandonnent par amour pour lui, pour se laisser conduire passivement ; le ruere in servitium de Tacite se vérifie une fois de plus : une véritable ivresse de solidarité les fait se précipiter dans la servitude et on les voit même vanter les verges avec lesquelles on les flagelle.
Il y a quelque chose d’exaltant malgré tout dans cette constatation que c’est toujours une idée, cette force la plus immatérielle qui soit sur terre, qui arrive à réaliser de tels miracles de suggestion, et l’on serait facilement amené à admirer et à glorifier ces grands séducteurs d’avoir réussi ainsi à transformer à l’aide de l’esprit la matière grossière. Malheureusement ces idéalistes et utopistes se démasquent presque toujours au lendemain de leur victoire comme les pires ennemis de l’intelligence. Car la puissance pousse à la toute-puissance, la victoire à l’abus de la victoire ; au lieu de se contenter d’avoir gagné à leur folie personnelle tant d’hommes prêts à vivre et même à mourir pour elle, ces conquistadors se laissent tous aller à la tentation de transformer la majorité en totalité et de vouloir aussi imposer leur dogme aux sans-parti. Ils n’ont pas assez de leurs courtisans, de leurs satellites, de leurs créatures, des éternels suiveurs de tout mouvement, ils voudraient encore que les hommes libres, les rares esprits indépendants se fissent leurs glorificateurs et leurs valets, et ils se mettent à dénoncer toute opinion divergente comme un crime d’État. Éternellement se vérifie cette malédiction de toutes les idéologies religieuses et politiques qu’elles dégénèrent en tyrannies dès qu’elles se transforment en dictatures. Mais dès qu’un homme ne se fie plus à la force immanente de sa vérité et fait appel à la violence brutale, il déclare la guerre à la liberté humaine. Quelle que soit l’idée dont il s’agisse, à partir du moment où elle recourt à la terreur pour uniformiser et réglementer d’autres convictions, elle n’est plus idéal mais brutalité. Même la plus pure vérité, quand on l’impose par la violence, devient un péché contre l’esprit.
Mais l’esprit est un élément mystérieux. Insaisissable et invisible comme l’air, il semble s’adapter docilement à toutes les formes et à toutes les formules. Et cela pousse sans cesse les natures despotiques à croire qu’on peut le comprimer, l’enfermer, le mettre en flacons. Pourtant toute pression provoque une contre-pression, et c’est précisément quand l’esprit est comprimé qu’il devient explosif : toute oppression mène tôt ou tard à la révolte. À la longue, et c’est là une éternelle consolation, l’indépendance morale de l’humanité reste indestructible. Jamais jusqu’ici on n’a réussi à imposer d’une façon dictatoriale à toute la terre une seule religion, une seule philosophie, une unique conception du monde, et jamais on n’y réussira, car l’esprit saura toujours résister à l’asservissement, toujours il refusera de penser selon des formes prescrites, de s’abaisser, de s’aplatir, de se rapetisser et de se mettre au pas. Quelle vanité, quelle simplicité, donc, de vouloir ramener la divine variété de l’existence à un dénominateur commun, de diviser l’humanité en bons et en mauvais, en croyants et en hérétiques, en citoyens obéissants et en ennemis de l’État, et ce sur la base d’un principe imposé uniquement par la violence ! Toujours il se trouvera des « conscientious objectors », des esprits indépendants pour se révolter contre une telle violation de la liberté humaine : si systématique que se soit montrée une tyrannie, si barbare qu’ait pu être une époque, cela n’a jamais empêché des individus résolus de se soustraire à l’oppression et de défendre la liberté de pensée contre les monomanes brutaux de leur seule et unique vérité.
Le XVIe siècle, qui ne fut pas moins troublé que le nôtre par ses idéologies brutales, a connu lui aussi des âmes libres et incorruptibles. Quand on lit les lettres des humanistes de cette époque, on sent toute la tristesse qu’ils éprouvaient devant un monde bouleversé par la violence, leur écœurement devant les proclamations stupides et charlatanesques des dogmatiques qui tous déclarent : « Ce que nous enseignons est vrai ; ce que nous n’enseignons pas est faux. » Quelle horreur inspirent à ces esprits éclairés les réformateurs inhumains qui se sont introduits brutalement dans leur monde et crient, l’écume aux lèvres, leurs orthodoxies violentes, quel dégoût ils ressentent devant ces Savonarole, ces Calvin et ces John Knox, qui veulent tuer la beauté sur terre et transformer le monde en une institution de morale. Avec une clairvoyance tragique les humanistes voient le fléau que ces ergoteurs furieux vont déchaîner sur l’Europe. Derrière leurs paroles emportées ils entendent déjà le cliquetis des armes et pressentent dans leur haineux déchaînement l’effroyable guerre qui vient. Mais quoique sachant la vérité, ils n’osent pas engager la lutte pour elle. Presque toujours il en est ainsi dans la vie : ceux qui savent ne sont pas ceux qui agissent et ceux qui agissent ne sont pas ceux qui savent. Dans leur solitude tragique, tous ces humanistes s’écrivent des lettres admirables et touchantes, se lamentent tristement, mais aucun n’ose affronter l’Antéchrist. De temps en temps Érasme lance de façon amusante quelques flèches de l’ombre où il se tient, Rabelais manie le fouet de la satire, le noble et sage Montaigne trouve dans ses Essais des mots éloquents, mais aucun ne tente d’intervenir sérieusement et d’empêcher une seule de ces infâmes persécutions et exécutions qui déshonorent l’humanité. À quoi bon, pensent ces hommes que leur expérience a rendus prudents, se disputer avec des fous furieux ? Dans des époques comme la nôtre, il est préférable de se tenir coi sous peine d’être soi-même une victime.
Seul de tous ces humanistes, un Français inconnu, Sébastien Castellion, engagea résolument et héroïquement la lutte, allant de lui-même au-devant de son destin. Avec héroïsme il ose élever la voix en faveur de ses compagnons poursuivis, risquant ainsi sa propre vie. Sans le moindre fanatisme, quoique menacé à chaque instant par les fanatiques, sans aucune passion, mais avec une fermeté inébranlable, il brandit telle une bannière sa profession de foi au-dessus de son époque enragée, il proclame que les idées ne s’imposent pas, qu’aucune puissance terrestre n’a le droit d’exercer une contrainte quelconque sur la conscience d’un homme. Et parce qu’il tient ce langage non pas au nom d’un parti mais au nom des lois impérissables de l’humanité, ses conceptions, ses paroles ont gardé toute leur valeur. Quand elles sont exprimées par un écrivain, les pensées humaines, même les plus générales, conservent leur force, les professions de foi humanitaires survivent aux professions de foi doctrinaires et agressives. Le courage sans exemple de cet homme devait rester exemplaire pour les générations futures. Car lorsque Castellion, en dépit de tous les théologiens du monde, appelle Servet, exécuté sur l’ordre de Calvin, une victime, quand il répond aux sophismes du même Calvin en lui jetant à la face ce mot immortel : « Brûler un homme, cela ne s’appelle pas défendre une doctrine, mais commettre un homicide », quand dans son manifeste de la tolérance il proclame une fois pour toutes (longtemps avant Locke, Hume et Voltaire, et d’une façon beaucoup plus sublime qu’eux) le droit à la liberté de pensée, cet homme risque sa vie pour ses convictions. Qu’on n’essaie pas de comparer la protestation de Castellion contre le meurtre judiciaire commis sur la personne de Michel Servet avec les protestations mille fois plus célèbres de Voltaire dans l’affaire Calas et de Zola dans l’affaire Dreyfus, car celles-ci furent loin d’atteindre à la hauteur morale de celle-là. Lorsque Voltaire engage la lutte en faveur de Calas, il vit dans un siècle déjà plus humain ; en outre, au-dessus de l’écrivain de réputation mondiale s’étend la protection des rois et des princes, de même qu’Émile Zola a derrière lui une espèce d’armée invisible, l’admiration de toute l’Europe et du monde entier. Tous deux risquent certes une partie de leur réputation et de leur tranquillité pour le sort d’un autre, mais non – différence essentielle – leur propre vie, comme Sébastien Castellion, qui, dans sa lutte pour l’humanité, a eu à souffrir de l’inhumanité furieuse et meurtrière de son siècle.
Castellion a payé pleinement et jusqu’aux dernières limites de ses forces le prix de son héroïsme. C’est un spectacle vraiment poignant que celui de cet adversaire de la violence, qui ne voulut jamais employer d’autre arme que celle de l’esprit, étranglé par la force brutale. On se rend compte une fois de plus combien vaine est la lutte engagée par un individu isolé, qui n’a pour lui que le droit contre une organisation solide. Quand une doctrine a réussi à s’emparer de l’appareil d’État et de tous ses moyens de pression, elle emploie sans hésiter la terreur : quelqu’un ose-t-il lui tenir tête, on lui coupe aussitôt la parole, et souvent même la gorge par-dessus le marché. Calvin n’a jamais répondu sérieusement à Castellion ; il a préféré le condamner au silence. On déchire, on interdit, on confisque, on brûle ses livres, on arrache contre lui, dans le canton voisin, par un chantage politique, une interdiction d’écrire, et à peine se trouve-t-il hors d’état de répondre que les satellites de Calvin commencent leur campagne de calomnies. Bientôt ce n’est plus une lutte, mais le massacre pitoyable d’un homme sans défense. Car si Castellion ne peut ni parler ni écrire, si ses livres ne peuvent sortir, Calvin dispose des presses, de la chaire, des synodes, de tout l’appareil d’État dont il use sans ménagement. On surveille les pas de Castellion, on épie ses paroles, on intercepte ses lettres. Quoi d’étonnant qu’une organisation aussi parfaite vienne finalement à bout d’un homme isolé ? Seule une mort prématurée sauve à temps Castellion de l’exil ou du bûcher. Mais la haine frénétique des dogmatiques triomphants ne s’arrête même pas devant son cadavre. Jusque dans la tombe ils le couvrent de boue, puis ils taisent son nom. Il faut que le souvenir du seul homme qui ait combattu la dictature totalitaire de son époque, et, d’une façon générale, le principe de toute dictature spirituelle, soit oublié à jamais.
Et un peu plus, ils eussent réussi tout ce qu’ils voulaient : non seulement leur oppression méthodique a arrêté l’action exercée sur son époque par ce grand humaniste, mais elle a même banni son souvenir dans la mémoire des hommes pendant des années et des années. Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux, même parmi les hommes cultivés, qui n’ont jamais lu ou entendu le nom de Sébastien Castellion. Comment en eût-il été autrement, puisque durant des décennies une censure impitoyable empêche la publication de ses principales œuvres et qu’aucun imprimeur dans le voisinage de Genève n’ose les éditer ? Lorsqu’elles paraissent enfin, longtemps après la mort de l’auteur, il est trop tard pour sa gloire. Entre-temps, d’autres ont repris les idées de Castellion, et sous d’autres noms se poursuit la lutte qu’il a engagée et où il est tombé trop tôt et presque sans qu’on le remarque. C’est le sort de certains hommes de vivre et de mourir dans l’ombre. Ceux qui sont venus après lui ont récolté la gloire de Sébastien Castellion ; aujourd’hui encore, on trouve dans tous les manuels cette affirmation erronée que Hume et Locke ont été les premiers en Europe à prêcher la tolérance, comme si le Traité des hérétiques de Castellion n’avait jamais été écrit et imprimé. Son action héroïque, sa lutte pour Servet est oubliée, oubliée sa lutte contre Calvin, le combat du « moucheron contre l’éléphant », oubliés ses ouvrages ! Un portrait incomplet dans l’édition hollandaise de ses œuvres, quelques manuscrits dans les bibliothèques suisses et hollandaises, quelques mots de reconnaissance de ses élèves, c’est tout ce qui est resté de celui que ses contemporains ont été unanimes à célébrer non seulement comme l’un des hommes les plus savants mais aussi comme l’un des esprits les plus nobles de son siècle. Quelle dette de reconnaissance n’avons-nous pas contractée à son égard ! Quelle monstrueuse injustice n’avons-nous pas à réparer !
L’histoire n’a pas le temps d’être juste. Pour elle, seul compte le succès, et encore il est rare qu’elle l’apprécie selon une mesure morale. Elle ne s’intéresse qu’aux vainqueurs et laisse les vaincus dans l’ombre. Ces « soldats inconnus » sont enfouis sans commentaire dans la tombe du grand oubli : aucune croix, aucune couronne ne célèbre leur sacrifice oublié, parce que non couronné de succès.
Mais en réalité, il n’est point d’action entreprise par pure conviction qui soit vaine, jamais un effort moral n’est complètement perdu. Même vaincus, les pionniers d’un idéal trop élevé pour leur époque ont rempli leur mission, car ce n’est qu’en se créant des témoins et en faisant des adeptes, qui vivent et meurent pour elle, qu’une idée devient vivante. Du point de vue spirituel, les mots « victoire » et « défaite » prennent un sens tout différent de celui qu’ils ont dans le langage courant ; aussi est-il nécessaire de rappeler sans cesse au monde, qui ne voit que les monuments des vainqueurs, que les véritables héros de l’humanité, ce ne sont pas ceux qui édifient leur empire éphémère sur des millions d’existences écrasées et de tombes, mais précisément ceux qui, désarmés, ont succombé devant la violence, tel Castellion dans sa lutte pour la liberté de l’esprit et le triomphe définitif des idées d’humanité.
L’arrivée de Calvin au pouvoir
Le dimanche 21 mai 1536, les bourgeois de Genève, convoqués solennellement au son des fanfares, se rassemblent sur la place publique et déclarent unanimement en levant la main, qu’à partir de ce jour ils veulent vivre « selon l’Évangile et la parole de Dieu ». C’est ainsi qu’au moyen du référendum, cette institution archidémocratique aujourd’hui encore en vigueur en Suisse, la religion réformée est introduite dans l’ancienne résidence épiscopale comme la s eule religion valable et autorisée. Il a suffi de quelques années, non seulement pour faire reculer, mais aussi détruire et extirper complètement dans la ville du Rhône la vieille foi catholique. Menacés par le peuple, les derniers prêtres, chanoines, moines et nonnes ont pris la fuite, et toutes les églises sans exception ont été débarrassées des images et autres symboles de la « superstition ». Cette journée de fête scelle le triomphe définitif du protestantisme : désormais il a non seulement la suprématie à Genève, mais encore le pouvoir exclusif.
Cette victoire totale de la religion réformée est due essentiellement à l’activité d’un homme, d’un prêtre, le révolutionnaire et terroriste Farel. Nature fanatique, front étroit, mais de granit, caractère énergique et tranchant (« Je n’ai encore jamais rencontré un homme aussi arrogant et effronté », dit de lui le doux Érasme), ce « Luther welsche » exerce une véritable dictature sur les masses. Petit, laid, la barbe rousse et les cheveux embroussaillés, Farel, avec sa voix tonnante et la fureur démesurée de sa nature violente, possède l’art, du haut de la chaire, de précipiter le peuple dans un état d’excitation fiévreuse. Comme plus tard Danton, il sait ameuter les instincts cachés de la foule et les enflammer pour la lutte décisive. Cent fois avant la victoire il a risqué sa vie, les paysans ont voulu le lapider, il a été arrêté ou traqué par toutes les autorités ; mais avec l’énergie et la volonté intransigeantes d’un homme dominé par une seule idée, il a brisé toute résistance. Comme un démon, il fait irruption avec sa garde d’assaut dans les églises au moment où le prêtre célèbre la messe et monte d’autorité à la chaire pour prêcher, dans le vacarme déchaîné par ses partisans, contre les abominations de l’Antéchrist. Il soudoie des gosses de la rue, en fait des bandes qui pénètrent dans les églises pendant le service divin, et, par leurs rires, leur caquetage, leurs cris troublent le recueillement des fidèles. Enhardi par l’accroissement de plus en plus rapide du nombre de ses partisans, il mobilise ses gardes et leur donne l’ordre de forcer les portes des cloîtres, d’arracher les saintes images des murs et de les brûler. Cette méthode de violence et de brutalité a du succès : comme toujours, une petite, mais active minorité, qui fait preuve d’audace et ne recule pas devant l’emploi de la terreur, réussit à intimider une indolente majorité. Certes les catholiques se plaignent de ces actes de violence répétés et assaillent le Conseil de leurs protestations, mais en même temps ils s’enferment résignés dans leurs demeures ; impuissant, l’évêque prend la fuite et abandonne la ville à la Réforme victorieuse.





























