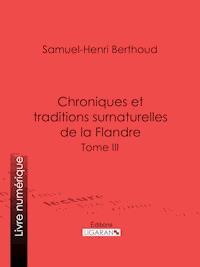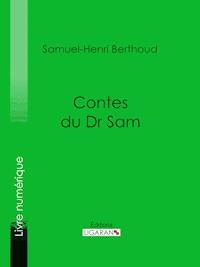
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Paris est fait de telle façon que, d'ordinaire, on peut y habiter une maison, pendant un grand nombre d'années, sans connaître les autres locataires de cette espèce de ruche humaine. La différence d'habitudes et d'occupations, et, par-dessus tout, le désir fort naturel de conserver, dans son intégrité la plus absolue, l'indépendance de la vie privée, permettent rarement que des relations s'établissent entre des personnes qui, pour demeurer sous le même toit,..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 720
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paris est fait de telle façon que, d’ordinaire, on peut y habiter une maison, pendant un grand nombre d’années, sans connaître les autres locataires de cette espèce de ruche humaine. La différence d’habitudes et d’occupations, et, par-dessus tout, le désir fort naturel de conserver, dans son intégrité la plus absolue, l’indépendance de la vie privée, permettent rarement que des relations s’établissent entre des personnes qui, pour demeurer sous le même toit, n’en ignorent pas moins, la plupart du temps, leurs noms réciproques, et se connaissent à peine de vue.
Aussi, quoique M. de Moronval, à qui m’attache une vieille et fidèle amitié, occupât depuis dix ans un appartement au-dessus de l’appartement du docteur Sam, il ne savait guère autre chose de ce voisin, sinon qu’on n’entendait jamais le moindre bruit chez lui.
La famille de M. de Moronval se compose de quatre enfants que j’ai vus naître ; ses deux filles aînées, Antoinette et Louise, touchent aujourd’hui, la première, à sa dix-huitième année, et la seconde, à sa seizième ; Étienne, leur frère, un des meilleurs élèves du collège Rollin, est de deux ans le cadet de Louise ; enfin la petite Marie compte six ans.
Madame de Moronval élève sa famille avec autant de tendresse que d’intelligence. Aussi ne peut-on se défendre d’un sentiment de respectueuse admiration quand on la voit, avec le produit assez médiocre du travail de son mari, diriger honorablement son modeste ménage et donner à ses enfants une éducation à la fois solide et brillante. On ne se douterait guère le soir, quand Antoinette et Louise font de la musique en artistes consommées, qu’elles consacrent la matinée aux soins les plus humbles et les plus laborieux du logis, et que la petite Marie elle-même, si rieuse, si jolie, si gâtée par tous, commence à devenir une couturière habile qui ourle parfaitement du gros linge, et au besoin sait faire un point de couture à celui de ses vêtements qui le demande. Une riante propreté et une bonne humeur avenante règnent constamment dans cette demeure bénie par le travail où tout se fait gaiement, alertement et avec plaisir.
Un soir de l’hiver dernier, nous nous trouvions tous réunis autour de la cheminée où brûlait un grand et bon feu. Antoinette et Louise s’occupaient de préparer le thé ; M. de Moronval donnait à Étienne quelques explications sur un passage difficile de Tite Live que ce dernier voulait traduire, et Marie se tenait assise aux pieds de sa mère, qui contemplait avec un sentiment ineffable de joie le charmant tableau placé sous ses yeux.
Tout à coup Antoinette et Marie poussèrent à la fois un cri déchirant le manche de la théière s’était brisé dans la main de la première, et l’eau bouillante, en tombant sur le pied de la seconde, l’avait cruellement brûlé.
La pauvre petite se tordait en proie à d’atroces douleurs. Le désespoir nous faisait perdre à tous la tête.
Seule, madame de Moronval, quoique pâle et tremblante, conserva son sang-froid.
– Allez vite, mon ami, chercher le médecin, dit-elle à son mari. Et se faisant apporter par ses filles du coton, elle se mit à en envelopper le pied de l’enfant.
Celle-ci, malgré ses efforts pour contenir les cris que lui arrachait la souffrance, car elle possédait un peu du courage et de l’énergie de sa mère, ne pouvait parvenir à l’étouffer : on les entendait dans toute la maison.
Tout à coup nous vîmes entrer un vieillard d’une physionomie douce et triste.
– Madame, dit-il, je viens de rencontrer dans l’escalier M. de Moronval qui courait chez son médecin ; il m’a dit l’accident arrivé à mademoiselle votre fille ; je lui ai offert mes soins. Si vous voulez bien me le permettre, je crois pouvoir la soulager.
En s’exprimant ainsi, il fendait en deux une large feuille charnue qu’il tenait à la main, en exprimait le jus sur la brûlure de Marie, et frottait ensuite doucement, avec l’intérieur de cette feuille dédoublée, la partie malade ; les plaintes de l’enfant s’apaisèrent, les larmes s’arrêtèrent dans ses yeux, et bientôt elle sourit en disant :
– Merci ! je ne souffre plus.
– On ne connaît pas assez en France l’efficacité de l’aloès médicinal contre la brûlure, dit le vieillard en continuant ses frictions.
Heureusement, j’en cultive toujours deux ou trois pieds dans mon appartement. Là ! voilà qui est parfait ! Vous n’éprouverez plus désormais la moindre souffrance, ma petite demoiselle, et vous en serez quitte pour tenir pendant quelques jours immobile sur un coussin votre pied teint en couleur orangée.
– Comment vous remercier, monsieur ? comment vous exprimer ma reconnaissance ? dit madame de Monroval en prenant affectueusement les mains du vieillard qui venait d’opérer une cure si miraculeuse.
– Je suis trop heureux, madame, d’avoir pu soulager cette charmante enfant ; veuillez me permettre maintenant de me retirer, quelqu’un m’attend chez moi…
– Vous mettrez le comble à vos bontés, n’est-ce pas, monsieur, en me permettant d’apprendre à M. de Moronval le nom de la personne à qui nous devons un si grand service ?
– Je suis votre voisin, dit-il en saluant pour sortir ; je me nomme le docteur Sam.
Quelques instants après, M. de Moronval revint avec le médecin, comme moi vieil ami de la maison. Celui-ci, en examinant le pied brûlé de Marie et en constatant les heureux résultats obtenus par l’emploi de l’aloès médicinal ou soccotrin, ne put retenir un mouvement de surprise.
– Cela tient vraiment du prodige, dit-il, et voici une preuve de plus de la difficulté avec laquelle une bonne idée fait son chemin à travers la routine et l’insouciance ! Qui de nous, excepté le docteur Sam, cultive chez soi un pied d’aloès, charmante plante grasse qui cependant produirait un aussi bon effet dans un salon, sur une étagère, que beaucoup d’autres arbrisseaux adoptés par la mode et par l’habitude ?
– Je n’avais jamais entendu parler de la propriété que possédait l’aloès de guérir les brûlures, objectai-je.
– Cette propriété, reprit le médecin, et l’histoire de sa découverte, ont produit, il y a quatre ou cinq ans, une assez vive sensation sans que, pour cela, personne songe à acheter un pied d’aloès soccotrin et à le garder chez soi en cas d’accident.
– En effet, reprit M. de Moronval, il me souvient de ce que nous dit le docteur, et les détails m’en reviennent à la mémoire.
Un jour, M. Lemon, horticulteur distingué, mort aujourd’hui, et qui habitait Belleville, se heurta à un vase d’eau bouillante qui lui brûla profondément les pieds. Il se trouvait seul : la douleur le clouait sur place et l’empêchait d’aller demander du secours. Une plante d’aloès s’épanouissait près de lui : il arracha une de ses feuilles en forme de sabre, la fendit en deux et l’appliqua sur la brûlure, pour que la sensation de fraîcheur de la plante grasse diminuât un peu les angoisses qu’il éprouvait. À sa grande surprise, à mesure qu’il oignait ses pieds du suc vert que contenait la feuille, ses pieds se teignaient en violet, et la souffrance disparaissait, pour employer une expression populaire, comme si on l’eût enlevée avec la main.
Le lendemain, il ne restait pas même de traces des ravages qu’avait faits l’eau bouillante, seulement la teinture violette persista pendant une dizaine de jours.
À quelque temps de là, M. Lemaire, professeur de botanique à Gand, renouvela sur sa cuisinière le traitement dont M. Lemon devait la découverte au hasard. Il appliqua sur le bras cruellement brûlé, de la pauvre fille un pansement fait avec des feuilles d’aloès, et il obtint les mêmes résultats que l’horticulteur de Belleville.
Enfin M. Houllet, directeur des serres du Muséum, agit de la même manière à l’égard d’un ouvrier dont un jet de vapeur transformait le dos en une vaste plaie ; la guérison s’opéra aussi rapide et aussi complète que dans les deux autres cas dont je viens de parler.
– Qu’est-ce que l’aloès ? demanda la petite Marie.
– L’aloès soccotrin, reprit son père, provient du cap de Bonne-Espérance. Charmante plante grasse que chacun peut cultiver chez soi, dans son salon ou dans sa salle à manger, il produit une jolie fleur, et ses feuilles épaisses et charnues peuvent se conserver pendant tout l’hiver au fond des caves des herboristes. On se procurerait donc toujours avec facilité un spécifique efficace, si par malheur l’insouciance et sa stupide sœur la routine n’étaient pas là toujours pour passer à côté d’un progrès ou d’une amélioration sans songer à se les approprier.
– Mais quel est donc ce docteur Sam ? demanda le médecin.
– Je n’en sais rien, répondit madame de Moronval. Je ne l’en aime pas moins de tout mon cœur pour le service qu’il nous a rendu, et je compte bien que mon mari, dès demain, ira le remercier.
– De bon cœur et en compagnie de notre ami que voici, répliqua M. de Moronval, en me désignant du doigt.
– Et puis, père, tu le prieras de venir me voir, n’est-ce pas ? demanda la petite Marie.
– Il a l’air si intelligent ! remarqua Étienne.
– Et si bon ! s’écria Louise.
– Et si triste ! ajouta Antoinette ; il faut qu’il souffre d’un grand chagrin.
– Je voudrais être à demain, conclut chacun en chœur, pour le revoir, pour le remercier…
– Et pour lui dire que nous l’aimerons tous, et que nous tâcherons de le consoler s’il a du chagrin, conclut la petite Marie.
Là-dessus on prit le thé, et l’heure habituelle de la retraite ayant sonné à la pendule, nous retournâmes chacun chez nous.
Le lendemain matin, j’étais avant onze heures chez M. de Moronval, pour l’accompagner dans sa visite chez le docteur Sam.
Nous avions choisi cette heure matinale parce que nous avions appris du concierge que celui que nous voulions voir sortait d’habitude vers midi, pour ne rentrer que le soir ; enfin, une fois six heures du soir sonnées, il ne recevait jamais personne.
Donc, à onze heures et demie nous sonnâmes à la porte du docteur Sam : Une de ces vieilles domestiques que, du premier coup d’œil, on reconnaît servir depuis longtemps leur maître, nous ouvrit et nous demanda nos noms. À peine les eut-elle transmis au docteur qu’il vint lui-même nous recevoir sur le seuil de son cabinet où il nous introduisit.
J’éprouvai une sorte d’éblouissement en entrant dans cette pièce singulière.
On ne pouvait, en effet, rien voir de plus extraordinaire. La grande pièce qui servait à la fois de cabinet et de chambre à coucher au docteur semblait un véritable musée d’ethnologie. Chacun des panneaux se trouvait couvert de panoplies des diverses parties du monde.
Sur l’un s’étalaient, artistement disposés, les armes et les costumes de l’Amérique du Nord, d’un aspect sévère, et à la fabrication desquels les peaux de bison et d’antilope contribuaient à peu près exclusivement.
En regard, l’Amérique du Sud se montrait parée de plumes aux couleurs éclatantes ; plus loin, l’Océanie apparaissait avec ses pagnes sombres, ses pagayes ciselées artistement en bois de fer, ses couronnes élégantes et légères, et son étrange bijouterie, trop souvent empruntée à des ossements humains.
Et puis c’étaient la Nouvelle-Hollande et la Tasmanie aux boucliers en bois et aux massues à peine dégrossies, l’Afrique et sa civilisation ébauchée et farouche, l’Inde somptueuse, la Chine opulente, Java et ses flèches empoisonnées.
De riches et rares pelleteries complétaient l’aspect bizarre de cet appartement, unique sans doute à Paris. Une peau d’ours blanc recouvrait le lit du docteur ; deux peaux de tigre et de lion lui servaient de rideaux ; enfin on hésitait à poser le pied sur les dépouilles d’ours gris et d’ours noirs, de panthères, de lynx, de lionnes, d’hyènes, qui recouvraient le parquet et servaient de tapis.
Tout cela n’était rien cependant à côté de deux animaux nonchalamment étendus devant la cheminée, où flambait un grand feu, et qui tournèrent la tête pour regarder les inconnus qui venaient visiter leur maître.
Le premier était un petit chien de la Havane, blanc comme la neige ; il se souleva de dessus le coussin qui lui servait de couche, nous flaira ; et, satisfait sans doute de cet examen, reprit paresseusement sa place.
L’autre y mit plus de façon : d’un seul bond il sauta du parquet sur un meuble élevé et nous regarda de ses grands yeux d’or, en faisant entendre une sorte de voix qui tenait à la fois de l’aboiement du chien et du ronflement du chat.
– Allons, mademoiselle Mine, dit le docteur en s’adressant à la jolie bête, allons ! ces messieurs sont des amis. Embrassez-les et venez ensuite vous asseoir sur mes genoux.
L’animal étrange obéit à son maître, et nous embrassa en passant ses deux petits bras autour de nos cous et en faisant entendre une sorte de psalmodie amicale.
– Mademoiselle Mine, ajouta le docteur, est un maki à front noir que j’ai ramené de Madagascar. On ne saurait, n’est-ce pas, voir une plus jolie bête, avec son museau fin et recouvert d’un véritable velours noir, ses quatre mains, sa longue queue en panache et son pelage d’un fauve foncé. Quant à son caractère, il réunit à la tendresse du chien la pétulance et les caprices du singe. Ce petit tyran trouve moyen, dans l’espace d’une même minute, de me caresser, de me gronder, et même quelquefois de me battre. Voici bientôt quatre ans que nous vivons ensemble, et je ne puis ni lire, ni écrire, ni travailler sans la permission de mademoiselle Mine.
Il en est de même pour les remontrances que je crois devoir parfois adresser à mon chien, maître Flock. Mine et lui sont souvent en guerre, et la moindre friandise donnée à l’un des deux les fait en venir aux pattes. Mais la plupart du temps, quand je les sépare, Flock me saute aux jambes et Mine au visage ; ils veulent bien se battre l’un l’autre, mais ils ne reconnaissent ce droit qu’à eux seuls exclusivement.
Le docteur, tout en nous racontant ces détails avec bonhomie, nous faisait asseoir dans d’excellents fauteuils indiens.
– Monsieur, lui dit M. de Moronval, permettez-moi de vous exprimer combien je suis touché de l’empressement avec lequel vous avez donné à ma fille des soins si bienveillants et si efficaces.
– Chacun en eût fait autant, reprit le docteur. Et comment va notre petite malade ?
– Grâce à vous, aussi bien que possible, répliquai-je. Elle demande à grands cris, pour l’embrasser, le docteur qui l’a si bien guérie.
Un nuage passa sur les traits fatigués et sur la physionomie triste de Sam ; je crus même apercevoir une larme couler sur sa joue.
– Excusez mon hésitation et ma faiblesse, dit-il ; moi aussi, j’ai été père, et aujourd’hui je suis seul au monde. Vous comprendrez donc que le mot d’enfant commence toujours par me faire mal. Mais cela ne dure pas longtemps, et je maîtrise bientôt mon émotion, ajouta-t-il en marchant à grands pas.
Il s’arrêta brusquement devant nous.
– J’irai ce soir rendre visite à mademoiselle Marie ; c’est ainsi qu’elle se nomme, n’est-ce pas ? demanda-t-il d’une voix encore émue et en s’efforçant de sourire.
M. de Moronval et moi nous lui primes chacun la main et nous la lui serrâmes avec émotion.
– Voyons, voyons, ne nous attendrissons pas, interrompit-il avec effort. Venez visiter ma collection : je l’ai recueillie presque tout entière pendant mes longs et aventureux voyages dans les diverses parties du monde. Chacun des objets qui la composent me rappelle un souvenir. Sans joie dans le présent, sans espoir dans l’avenir ; en les regardant, je revis dans le passé.
Enfin, si le passé, – ce qui parfois m’arrive, – devient trop lourd, alors je demande à Celui qui a tant souffert pour les hommes de me donner la force de supporter mes souffrances, ajouta-t-il en nous montrant un magnifique crucifix d’ivoire du seizième siècle.
Dans la vie calme, douce, laborieuse et uniforme de la famille de Moronval, le plus petit évènement prenait naturellement de grandes proportions. Je n’ai donc pas besoin de vous dire que la visite du docteur Sam, promise pour le soir, préoccupa durant la journée entière tous les esprits et produisit une sorte d’agitation fiévreuse. L’impatiente Marie, que sa brûlure condamnait à rester étendue sur une chaise longue, comptait et décomptait les heures ; Louise disposait des fleurs dans les corbeilles et sur les étagères, de façon à les faire paraître plus fraîches et plus belles ; Antoinette se hâtait de terminer une broderie au crochet dont elle voulait revêtir le dossier du fauteuil destiné au docteur ; madame de Moronval elle-même ne restait pas étrangère à l’émotion générale. Elle se disposait à sortir pour acheter du thé plus frais et quelques pâtisseries, quand j’arrivai les bras surchargés de paquets remplis de gâteaux et de petits fours. Jamais on ne reçut un accueil pareil à l’accueil que je reçus ! On me salua de trois cris joyeux, et Marie, ma favorite, voulut absolument ouvrir les sacs et voir de ses propres yeux les trésors gastronomiques qu’ils renfermaient.
Sur ces entrefaites, on servit le dîner, mais on dîna d’une façon distraite. On me permit à peine de manger, tant on m’adressa de questions sur l’appartement du docteur, sur son singe de Madagascar, si doux et si joli, sur son petit chien blanc de la Havane, sur ses belles fourrures, sur ses panoplies sauvages, sur tout enfin. Une question satisfaite, il fallait aussitôt et absolument en satisfaire une autre.
Sur ces entrefaites, sept heures et demie sonnèrent. Chacun se leva précipitamment de table, les jeunes filles firent disparaître le service, l’une rangea, l’autre balaya, et on épousseta la salle à manger, qu’il fallait traverser pour se rendre au salon. Antoinette alluma les lampes, Louise disposa les fauteuils autour de la cheminée, et elle achevait à peine que la porte s’ouvrit et que Nanette, une excellente servante depuis vingt ans au service de la famille, montra à travers la porte entrebâillée sa bonne tête parée de son plus beau bonnet à rubans, et annonça d’une voix quelque peu émue :
– Monsieur le docteur Sam,
Madame de Moronval et ses deux filles aînées firent leurs plus belles révérences au docteur ; M. de Moronval et moi nous lui serrâmes affectueusement la main : Marie, rouge comme une cerise, lui tendit les bras pour l’embrasser.
Il l’embrassa sur le front et s’assit près d’elle, dans le meilleur fauteuil du salon, qu’Antoinette lui avança. Puis il se fit un petit moment de silence, chacun hésitait à prendre la parole le premier.
Le docteur se trouvait placé de façon à ce que la lumière de la lampe tombât en plein sur son visage que caractérisait une grande expression de douceur et de mélancolie. Son front chauve, ses cheveux blancs, ses traits ravagés par les fatigues, les voyages, et sans doute plus encore par les chagrins, inspiraient tout d’abord la sympathie et la confiance.
– J’ai fait pour vous, madame, dit-il en s’adressant avec un sourire à madame de Moronval, ce que mes habitudes et mes goûts solitaires ne me permettent guère de faire.
– Aussi nous savons-vous un gré infini de votre visite, se hâta-t-elle de répondre.
– Et vous nous auriez causé un véritable chagrin, ajouta Antoinette, si vous ne nous aviez point permis de vous remercier tous du grand service que vous nous avez rendu hier, avec une grâce si parfaite et un empressement auquel nous devons la guérison de notre sœur.
– Laissons les compliments de côté, interrompit le docteur. Prenez-y bien garde ; autant je me suis montré sauvage avec vous, pendant dix ans, autant je me sens disposé aujourd’hui à devenir l’ami de votre maison. Pour les natures tristes et un peu timides comme la mienne, le premier pas coûte seul.
– Oui, s’écria Marie ; venez nous voir ! venez nous voir souvent ! venez nous voir tous les jours. Et puis vous nous amènerez quelquefois, n’est-ce pas, votre petit chien blanc et votre joli singe au visage noir, dont papa nous a déjà dit tant de merveilles ?
– Maître Flock sera charmé de faire votre connaissance, ma petite voisine ; quant à mademoiselle Mine, je craindrais qu’elle ne commit de graves désordres dans votre appartement ; elle a encore moins que son maître l’habitude de faire des visites.
– Mais le petit chien ! le petit chien ! demanda Marie avec l’impatience d’une enfant gâté.
Le docteur se leva, ouvrit la fenêtre et siffla d’une certaine façon. Un jappement lui répondit ; puis on entendit la porte de l’appartement du docteur et celle de l’appartement de M. de Moronval s’ouvrir successivement, et un petit terrier blanc comme la neige s’élança gaiement dans le salon et sauta sur les genoux du docteur, qu’il combla de caresses.
Faut-il ajouter que Marie voulut prendre aussi dans ses bras maître Flock, qui d’abord résista un peu, et qui finit toutefois par trouver de son goût la petite fille, qui le comblait de baisers et surtout de gimblettes ?
– Vous voici les meilleurs amis du monde, dit le docteur, et cette amitié me rappelle une histoire fort touchante, où le père de mon chien, maître Flock, premier du nom, joue un rôle important.
– Si vous voulez me conter cette histoire je vous embrasserai deux fois, et je vous appellerai mon bon ami, dit Marie, qui, voyant l’amitié que le docteur commençait à éprouver pour elle, se mettait déjà à en abuser un peu.
– Soit ! dit M. Sam, mais je veux être payé d’avance.
– D’avance et encore après, car je vous aime bien ! répliqua la petite fille.
– Eh bien ! je commence donc, dit-il en posant ses lèvres sur le front de Marie.
– Comment s’appelle votre histoire, docteur ?
– Nous l’appellerons, mon enfant : Deux mois de convalescence.
Il y a deux ans à peu près, par une piquante matinée encore fraîche de printemps, deux jeunes filles causaient gaiement devant une de ces grandes cheminées qu’on ne retrouve guère que dans les vieux édifices, et particulièrement dans certaines habitations champêtres des départements du nord de la France.
L’une de ces jeunes filles semblait âgée de dix-sept ans, et l’autre de douze ; l’aînée, Marguerite Daubencourt, offrait le type à la fois splendide et mignon qui caractérise la race flamande ; de magnifiques cheveux blonds, en ce moment épars sur ses épaules, touchaient presque le sol et l’enveloppaient d’un véritable manteau d’une merveilleuse beauté. La fraîcheur de son teint blanc et rose, la régularité de ses traits et l’expression douce et affectueuse de ses yeux bleus lui donnaient un charme indicible.
La plus jeune, brune, svelte, aux grands yeux noirs, à la peau bronzée, un peu maigre, comme les enfants de son âge, achevait de rattacher sur sa tête les longues tresses de ses cheveux couleur d’ébène.
– Allons ! Marthe, lui dit sa sœur, voici trop longtemps que nous jasons au coin du feu, et que nous oublions l’heure à laquelle notre mère veut que nous descendions à la salle à manger. Nous allons encore la faire attendre et mériter d’être grondées.
– Marguerite ! Marguerite ! tu seras toujours la même ! répliqua Marthe en riant. Il est à peine neuf heures et demie, et la cloche ne sonne le déjeuner qu’à dix heures.
Et elle se renfonça nonchalamment dans son fauteuil, plaça ses pieds sur les chenets, et, appelant un petit chien de la Havane qui gambadait sur un canapé, elle se mit à jouer avec lui.
– Je te le répète, toi aussi tu seras toujours la même ! reprit gaiement Marguerite : il faut que je me hâte de terminer ma toilette, car, lorsque la cloche sonnera, je te verrai encore là, méchante fille, flânant et ayant grand besoin de mon aide pour te trouver prête à temps.
Marguerite, en effet, s’assit à l’autre extrémité de la chambre devant une glace de Venise ; elle commençait à rassembler ses beaux cheveux pour les rattacher sur sa tête, quand un cri déchirant partit du coin de la cheminée. Elle se retourna vivement. Sa sœur Marthe était enveloppée de flammes ; sa jupe, imprudemment approchée du foyer, avait pris feu.
Marguerite s’élança, et entoura Marthe de ses bras pour étouffer la flamme ; soudain cette flamme s’attacha à ses longs cheveux épars
On accourut aux cris des deux jeunes filles. On trouva Marthe évanouie, mais sans brûlure sérieuse ; quant à Marguerite, ses cheveux étaient consumés, et le feu lui avait dévoré le visage.
Je vous laisse à penser de quel désespoir se sentirent frappés leur père et leur mère à la vue de cet affreux spectacle ; cependant tous les deux trouvèrent en un si terrible moment le sang-froid nécessaire pour donner les soins que réclamait l’affreuse position de leurs enfants.
Tandis que madame Daubencourt transportait sur un lit Marthe encore sans connaissance, M. Daubencourt, l’un des médecins les plus justement renommés du pays, donnait à Marguerite les premiers soins qu’exigeaient ses cruelles et profondes brûlures ; celle-ci, malgré les atroces souffrances qu’elle éprouvait, semblait surtout préoccupée de rassurer son père et sa mère.
Quant à Marthe, à peine eut-elle repris connaissance, qu’elle voulut courir près de sa sœur, et rien ne put, dès ce moment, la déterminer à la quitter d’un instant.
Vous pouvez supposer quelle triste existence pesa dès lors sur cette famille naguère calme et heureuse. On craignit longtemps pour la vie de Marguerite, et les médecins, ses confrères, que M. Daubencourt avait fait appeler dans l’espoir de s’éclairer de leurs conseils, ne partagèrent que trop les craintes du pauvre père.
Après trois semaines d’alternative d’espoir, de craintes, d’angoisses de toute nature, Marguerite était sauvée ; mais, hélas ! elle n’avait point recouvré la vue, et on craignait qu’elle ne la recouvrât jamais.
Malgré cette triste conviction, ce fut presque un jour de fête pour la famille Daubencourt que celui où Marguerite, pour la vie de laquelle on avait si longtemps tremblé, put quitter son lit, et s’approcher de la fenêtre, afin de respirer l’air tiède d’une belle matinée de printemps.
Seule, Marthe l’aida à quitter sa couche, seule, Marthe la soutint et la guida vers la fenêtre ; Marthe encore disposa les oreillers de son fauteuil, Marthe plaça des coussins sous ses pieds. – Elle n’avait point voulu, je vous l’ai dit, quitter sa sœur d’un moment pendant toute la durée de sa maladie. Malgré ce qu’on put lui dire, malgré les supplications de ses parents, elle passa les jours et les nuits dans la chambre de sa sœur, prête, à la première plainte de la malade, à se trouver auprès d’elle et à lui venir en aide. Cette enfant frivole et pétulante s’était faite, pour sa sœur, une garde-malade attentive, dévouée, infatigable et d’une patience angélique.
Aussi, quand Marguerite se sentit ranimée par le bon air pur qu’elle respirait et par les rayons du soleil qui semblaient la caresser et l’envelopper, elle chercha en tâtonnant la main de sa sœur, et lui dit :
– Ô ma chère Marthe, que je me sens bien !
Marthe, qui pleurait silencieusement en regardant Marguerite, s’efforça de donner à sa voix un peu de fermeté pour répondre ; mais elle ne put contenir ses sanglots.
Marguerite l’attira dans ses bras et posa sur son front ses lèvres à peine cicatrisées.
– Aveugle ! aveugle à cause de moi ! s’écria Marthe qui ne put réprimer plus longtemps son désespoir.
– Allons, lui dit sa sœur d’une voix faible encore, allons, Marthe, pourquoi ces vilaines pensées ? Dieu, qui m’a rappelée de la mort, me guérira de la cécité. D’ici là, toi qui m’as si bien soignée, tu seras mes yeux ; tu verras pour toi et pour moi ; ce sera une bonne raison pour ne plus nous quitter un seul jour, un seul moment, une seule minute ! À nous deux nous ne ferons plus qu’une seule.
– Ô ma sœur ! ma bonne sœur !
– N’avons-nous point déjà commencé ? n’est-ce pas toi qui récitais matin et soir, à mon chevet, les prières que nous adressions à Dieu ? N’est-ce pas toi, qui, dans mes heures de calme, et quand notre père le permettait, me lisais quelques pages d’un livre amusant ? Ce que je ne verrai pas, tu me le raconteras. Mais Flock n’est pas là ? dit-elle ! Pauvre petit chien ! lui non plus ne m’a point quittée pendant, ma maladie ! Il s’est tenu obstinément sur le pied de mon lit, et il n’a point aboyé une seule fois, comme s’il eût compris que ses aboiements pouvaient me fatiguer.
– Flock est dans le jardin, repartit Marthe, et je t’assure qu’il rattrape le temps perdu. Il court comme un fou dans les allées, sur la pelouse, et même dans les plates-bandes. Le voici qui poursuit des oiseaux jusqu’à la lisière du bois !
– Oui, j’entends ses bons petits jappements. Et, dis-moi, sœur, la feuillée commence-t-elle déjà à paraître ? Il me semble que oui. Je crois le reconnaître au murmure que produit le vent en soufflant à travers les rameaux.
– Les arbres sont déjà verts, mais d’un vert tendre et délicat qui deviendra bientôt plus accentué.
En ce moment M. Daubencourt entra.
– Comment te trouves-tu, mon enfant ? demanda-t-il en prenant dans ses mains les mains de Marguerite.
– Bien, mon père ! très bien, je vous l’assure.
M. Daubencourt interrogea le pouls de sa fille.
– En effet, dit-il, tu n’as pas le moindre symptôme de fièvre.
– Et si vous saviez avec quel plaisir j’ai croqué la bonne aile de poulet que vous m’aviez permis de manger. Ah ! père, me voici guérie !
M. Daubencourt leva un regard douloureux sur sa fille aveugle.
– Guérie ! pensa-t-il ; guérie !
– Si vous saviez, père, comme c’est bon de se sentir renaître à l’existence ! de ne plus avoir la tête embarrassée par la fièvre, de manger avec bon appétit, – de pouvoir se lever, se rasseoir, aller, venir, en liberté ! Mon père, je suis bien heureuse !
– Ma chère enfant !
– J’ai de grands projets pour demain – si vous le permettez, bien entendu. – D’abord ma mère, vous, Marthe et moi, nous irons tous les quatre à l’église, remercier Dieu de ma convalescence.
– J’espère que tu le pourras, mon enfant.
– Et puis ensuite, en compagnie de ma chère Marthe, je m’assoirai dans le jardin, au soleil et bien abritée par le grand mur du potager. Ah ! il me tarde de revoir mes beaux arbres et mes belles fleurs !
– Revoir ! ne put s’empêcher de murmurer le pauvre père.
– Eh oui, voir, répliqua-t-elle gaiement. N’ai-je pas les yeux de Marthe ? comme je le lui disais tout à l’heure.
Le lendemain matin, ce fut une grande joie dans la maison du docteur Daubencourt ; car, après une nuit excellente, sans fièvre, sans agitation, une nuit comme n’en avait point passé Marguerite depuis son fatal accident, la convalescente descendit au jardin et s’y installa dans un fauteuil.
Son père et sa mère s’assirent à côté d’elle, et Marthe se coucha à ses pieds, sur l’herbe. L’air était tiède et doux, le soleil caressant, et de tous côtés arrivaient ces vagues senteurs qu’exhalent les premières fleurs du printemps. Les oiseaux volaient çà et là, jetant des cris joyeux, et venaient jusqu’auprès de la famille réunie, ramasser des brins d’herbe et des débris de laine et de coton pour garnir leurs nids, qu’ils commençaient à édifier, les uns au sommet des grands arbres, les autres dans l’épaisseur des buissons.
À l’âge de Marthe, on ne saurait demeurer longtemps en place. Aussi la jeune fille ne tarda point à se lever doucement et à se diriger vers la prairie qui touchait au jardin, et qui s’étendait jusqu’à un petit bois. Personne ne s’aperçut de son départ, si ce n’est toutefois maître Flock, le petit chien blanc de la Havane, qui commençait, lui aussi, à trouver bien longue une immobilité de dix minutes.
Marthe et Flock se mirent donc à courir tous les deux dans la prairie, d’où leur arrivée fit s’envoler des nuages de papillons et d’insectes.
Après avoir couru et gambadé quelques instants comme une chevrette mise tout à coup en liberté, après avoir respiré à pleins poumons la fraîcheur du grand air dont elle se trouvait depuis si longtemps privée, Marthe se mit à cueillir les plus belles des fleurs des champs, qui s’épanouissaient, tantôt au milieu même de la prairie, tantôt sur la lisière du bois, ou au bord d’un ruisseau. Puis, toujours suivie de Flock, qui gambadait sur ses talons, elle revint sans bruit et déposa doucement sa moisson parfumée dans les mains de Marguerite.
Le visage de la jeune aveugle devint radieux ; elle respira avec délice l’odeur des fleurs ; elle les prit une à une ; elle les caressa de ses doigts amaigris.
– Merci ! Marthe, dit-elle, merci ! que tu me fais de plaisir ! Ô les belles fleurs ! Je suis sûre que je reconnaîtrai plusieurs d’entre elles rien qu’au toucher, rien qu’en sentant leurs parfums. Ah ! voici une marguerite ! Cette petite branche est de l’aubépine, et celle-ci, mon père, dont la feuille est si bizarrement découpée ?
– C’est le gouet ou pied-de-veau, mon enfant.
– Le gouet, oui, c’est bien cela, père. Je me rappelle qu’au printemps dernier, un matin que j’étais sortie de bonne heure, avec toi, pour visiter un pauvre malade, au hameau voisin, tu me montras, contre un buisson, un gouet dont les feuilles lisses, d’un vert foncé, tachées de noir, attiraient mon attention. Ses fleurs, d’un blanc sale, devaient bientôt produire, me dis-tu, des baies écarlates. Toutes les parties de cette plante, ajoutas-tu, contiennent un suc laiteux, de saveur âcre et piquante, et cependant sa racine peut au besoin fournir un aliment. Parmentier, à qui l’on doit l’importation de la pomme de terre en Europe, recommandait la racine du gouet comme une nourriture saine.
– En certains pays, ajouta M. Daubencourt, on sert le gouet sur les meilleures tables. Les Romains, qui se connaissaient en gastronomie, le faisaient venir à grands frais d’Alexandrie, et Lucullus, le premier, l’acclimata dans ses jardins de Rome. Enfin, réduite en poudre, cette même racine produit un excellent dentifrice ; elle rend, en outre, de la force au vin devenu trop faible, et, dissoute dans de l’eau tiède, elle mousse et remplace jusqu’à un certain point le savon.
– Et l’aubépine, père, et l’aubépine jouit-elle aussi de propriétés utiles ?
– Les médecins russes l’emploient pour combattre les rhumatismes. Elle jouait un grand rôle dans les fêtes nuptiales de l’antiquité. Les fiancées se couronnaient de ces fleurs. Il n’y a pas bien longtemps que, dans le midi de la France et surtout à Bordeaux, on suspendait, au printemps, au milieu de certaines rues, d’immenses couronnes d’aubépine qu’on éclairait, le soir, avec des verres de couleur. Enfin, dans les Pyrénées, aux bords des champs, on plante toujours une petite croix entourée d’aubépine pour obtenir de belles récoltes.
– La jolie coutume !
– L’aubépine est, dans ces contrées, à la fois le symbole de la candeur et de la charité. On raconte que, vers les premiers temps du christianisme, un paysan tomba malade et ne put ni labourer ni ensemencer ses champs. Des voisins résolurent de lui venir en aide et s’associèrent pour labourer et ensemencer la terre du pauvre homme, qui serait, sans cela, restée en jachère. Ils se mirent donc bravement à l’œuvre, et, en deux jours, tout se trouva en bon état. Or, comme ils terminaient leur besogne charitable, ils remarquèrent trois enfants inconnus dans le village et qui, vêtus de blanc et la tête couronnée de fleurs, plantaient de distance en distance, sur la lisière des champs de tous les travailleurs, des croix de bois entourées de branches d’aubépine.
Tandis qu’on s’étonnait de leur présence, du soin qu’ils prenaient et des motifs qui leur faisaient accomplir cette besogne, ils déployèrent tout à coup de grandes ailes et s’envolèrent dans le ciel en faisant entendre des cantiques.
Or, il se fit que tous les champs marqués par eux d’une croix produisirent une récolte double : de là, la coutume dont je t’ai parlé.
– Et la marguerite, mon père ?
– La marguerite pourrait passer pour le symbole de la fidélité, car elle est la dernière fleur à disparaître quand l’hiver sévit, et la première à reparaître quand le printemps revient. Souvent même elle résiste aux rigueurs de la mauvaise saison, et ne cesse de montrer ses pétales d’or entourés d’une couronne blanche, que lorsque les gelées la flétrissent.
– Ah ! père, dit Marthe, qui écoutait attentivement, je sais, moi, une histoire sur la marguerite.
– Eh bien ! dis-la-nous, mon enfant.
– C’est ma nourrice qui me l’a contée, il y a bien longtemps, mais elle était si belle que je ne l’ai jamais oubliée.
– Nous t’écoutons, petite sœur.
– Eh bien ! pendant que les Romains poursuivaient et mettaient à mort les chrétiens de nos pays, saint Druon dit un jour, à sa sœur sainte Olle : « – Sœur, voici les jours de la persécution qui arrivent. Moi, qui suis prêtre, je dois mourir à mon poste, et, sans reculer d’un pas, attendre le martyre. Mais toi, mon enfant, tu ne peux t’exposer avec les religieuses que tu diriges dans la voie du Seigneur, aux supplices dont ils ne tarderaient point à torturer votre pieux essaim. Tu vas donc quitter cette contrée avec tes compagnes et chercher un asile où vous puissiez prier Dieu en paix. »
Sainte Olle résista longtemps ; mais il lui fallut, à la fin, obéir aux volontés de saint Druon, qui était à la fois son frère et son évêque.
Au bout d’un an, la persécution avait cessé et le bon prélat aurait bien voulu revoir sa sœur. Or, la chose n’était point facile, car il ne savait en quel pays celle-ci s’était réfugiée ; mais, plein de confiance pans le bon Dieu, il se mit à marcher tout droit devant lui, au hasard et en priant.
Quoiqu’on fût à la fin de l’automne, il ne tarda point à remarquer qu’à mesure qu’il marchait des touffes de petites fleurs blanches semblaient sortir de terre.
Il se mit donc à suivre le sentier indiqué par ces fleurs, et, après neuf jours de marche, il arriva dans un lieu désert, tout plein de grottes et de cavernes, dans lesquelles s’étaient réfugiées sa sœur et les saintes filles ses compagnes. C’est depuis ce temps que les marguerites fleurissent en toutes saisons.
– Tu viens de nous raconter, mon enfant, une de ces charmantes et naïves histoires que nos pères aimaient à imaginer sur tous les objets qui les entouraient. Ces légendes, qu’on se transmettait de bouche en bouche, de génération en génération, suppléaient à la poésie écrite et la valaient bien, peut-être. Mais, pendant que nous devisons là, voici le vent qui fraîchit et le ciel qui se couvre un peu ; Marguerite, donne le bras à ta sœur, et rentrons au salon.
– Oui, mon père, mais je ne veux pas me séparer de mes belles fleurs.
– Non, certes, mon enfant. Nous les placerons dans un vase plein d’eau, près de ton fauteuil, et, à mesure que tu les y déposeras, si tu le désires, je te les nommerai, et je te dirai ce que je sais d’elles.
– Oh ! que vous êtes bon, mon père.
Ils se levèrent tous et rentrèrent dans le salon, maître Flock en tête.
Cette première sortie, tout en ranimant Marguerite et en fortifiant sa convalescence, n’avait point laissé que de la fatiguer un peu ; elle se coucha plutôt qu’elle ne s’assit dans un de ces grands canapés du dix-huitième siècle où l’on se trouve si bien. Sa famille la crut assoupie, et Marthe fit signe du doigt à chacun pour qu’on se tût et qu’on ne troublât point le sommeil de sa sœur.
Mais, au bout de quelques instants, Marguerite releva la tête.
– Suis-je donc seule ? demanda-t-elle avec un sentiment de frayeur.
– Non, ma chère Marguerite, s’empressa de répondre Marthe en lui prenant la main. Mon père, ma mère, moi et même maître Flock nous te tenons compagnie.
En entendant prononcer son nom, le petit chien, comme s’il eût voulu constater sa présence, se mit à japper, et d’un seul bond s’élança sur le canapé ; Marguerite le flatta de la main.
– Je suis une ingrate, dit-elle ; je me disais : Ils me croient endormie et ils se sont éloignés… Hélas ! on ne peut plus distinguer quand je dors ou quand je veille !
Des larmes vinrent aux yeux de Marthe.
– Ma sœur ! oh ! que mon imprudence et ton dévouement te coûtent cher !
– Allons, dit Marguerite en souriant, voilà que tu pleures maintenant ! ne suis-je pas heureuse, bien heureuse auprès de vous tous ?… Et mes fleurs, mes belles fleurs que tu m’as cueillies, où sont-elles ?
Marthe approcha de sa sœur le bouquet de fleurs champêtres.
Marguerite prit le bouquet dans ses mains et respira longuement ses parfums, en saisissant du bout des lèvres une fleur d’un rouge pourpre. Certaines des feuilles de cette fleur, longues, étroites, nerveuses et pointues, se pressaient contre la base de la tige ; les autres l’enveloppaient dans sa longueur.
– Prends garde, mon enfant ! s’écria M. Daubencourt en se levant avec précipitation pour écarter la fleur des lèvres de Marguerite : prends garde ! cette plante est un poison !
Marthe, effrayée, se jeta sur la fleur, l’arracha des mains de sa sœur et la lança sur le parquet pour la fouler aux pieds.
– Contente-toi, lui dit sa mère, de la placer dans un autre vase. Tu vois combien elle est jolie !
– Ta mère a raison, ma fille ; bornons-nous à la mettre dans l’impossibilité de nuire. Tu l’as cueillie au bord de l’eau. Elle se nomme le glaïeul, et elle a servi longtemps à commettre bien des crimes. Sa racine agit à la manière de l’opium, et produit à la fois de la stupeur et des hallucinations. Tu as vu et recueilli près d’elle le cresson des prés, que voici. Il est aussi bon que le glaïeul est méchant ; car le cresson, en quelques jours, guérit nos marins d’une maladie produite par un trop long usage des aliments salés, et qu’on nomme le scorbut. Le frère du cresson, le sisymbre amphibie, fournit un excellent comestible ; l’herbe de Sainte-Barbe, l’erosymum, raffermit les gencives, et l’iris, que je te montre, est le lis des lieux humides et leur souveraine.
Car Dieu a assigné à chaque plante une espèce particulière de sol. À l’une il faut les bords de l’eau, comme à l’iris et comme aux cressons ; aux autres il faut ces eaux elles-mêmes, témoin le nénuphar, dont la fleur ressemble à une coupe d’or qui surnage à la surface des étangs, et le rubanier, dont la longue tige flottante mesure plus de trente à trente-cinq centimètres ; il ressemble à un des beaux rubans richement teintés auxquels il emprunte son nom.
Les pieds des murs et leurs crêtes, les endroits humides ou secs, la terre légère ou la terre compacte, le sable et les interstices des pierres ont chacun leurs plantes spéciales. Il y a des plantes parasites, qui ne vivent que parmi les plantes cultivées et à leurs dépens, comme certains chardons, la dauphinelle ou le pied d’alouette, dont les fleurs forment un véritable bouquet, et la fumeterre, qui emprunte son non (fumée de terre) du goût âcre et amer, semblable à celui de la suie, que ses feuilles laissent sur les lèvres. Une espèce de fumeterre – et c’est la plus commune – ne cesse pas, durant huit mois de l’année, de produire des fleurs blanchâtres. Ces fleurs sont douées de la bienfaisante propriété de rétablir la transpiration chez les malades, et de rendre aux estomacs faibles de la vigueur. Vous voyez qu’elles ressemblent à ces bourrus bienfaisants qui, tout en n’épargnant pas au besoin l’amertume et la brusquerie, n’en rendent pas moins de grands services.
– Je connais de ces bourrus-là, dit madame Daubencourt en souriant et en frappant avec affection sur l’épaule de son mari.
– La chose est possible ! répliqua sur le même ton gai et tendre M. Daubencourt. Cependant, est-ce bien toujours la faute des bourrus quand ils bourrent ? ceux qui vivent avec eux n’ont-ils jamais rien à s’en reprocher ? ne justifient-ils point parfois une boutade et un mouvement de mauvaise humeur ?
– La chose est possible, répondrai-je à mon tour. Mais quelle est cette plante d’une tige peu élevée et dont les feuilles, qui s’alternent, sont profondément découpées et ressemblent à des ailes ? Quel joli bleu teint sa fleur !
– Il est assez singulier qu’elle se trouve dans ce bouquet, car elle ne fleurit ordinairement que vers la fin de mai, et pousse dans les champs. Elle provient de quelque graine égarée et emportée au hasard par les vents ; c’est la nigelle, qu’on nomme encore cheveux de Vénus.
« Le chimiste Lamouroux à découvert qu’en infusant les graines de la nigelle dans de l’alcool, on en obtenait une liqueur qui possédait le parfum des fraises ; l’hiver, elle permet ainsi aux maîtresses de maison prévoyante, de confectionner, à peu de frais, d’excellentes crèmes à l’essence de fraises. En Orient, on l’emploie à un usage singulier et dont voici l’origine :
Le sultan Achmet II avait une fille unique, nommée Aïchah, qu’il idolâtrait et qui possédait les talents les plus recherchés parmi les musulmans. Personne ne savait mieux qu’elle chanter en se couvrant à demi la bouche de ses mains peintes en jaune par le henneh ; elle jouait à ravir du derbouckah, sorte de tambourin en terre cuite, et ressemblant beaucoup à un pot sans fond ; enfin elle dansait comme une houri. Mais par malheur sa taille était svelte et souple ; et ce qu’on eût regardé en Europe comme une rare beauté passait aux yeux du sultan, de sa fille et de tout le harem pour une sorte de difformité. Les Orientaux ne prisent chez les femmes qu’un énorme embonpoint.
Un soir que le sultan, à l’exemple de son aïeul Aroun-al-Raschid, parcourait les rues, de Bagdad, rêvant aux affaires de l’État et à la déplorable maigreur de sa fille, il fit rencontre d’un derviche qui lui cria :
– Commandeur des croyants, je sais ce qui cause ta tristesse, et je t’en apporte le remède.
Achmet, fort mécontent de se savoir reconnu dans sa promenade nocturne, fit signe au derviche d’approcher.
– Écoute, lui dit-il, si tu me dis ce qui me préoccupe, je te donnerai une bourse ; si tu trouves moyen de m’ôter le motif de cette préoccupation, je t’en donnerai mille ; si tu te trompes, je te ferai trancher la tête.
– J’accepte, répondit hardiment le derviche.
– Alors, parle ! et parle vite.
– Il y a dans le jardin de ta joie une fleur que tu ne trouves pas assez épanouie.
Le sultan resta émerveillé de la perspicacité avec laquelle le derviche devinait sa pensée, et de la délicatesse avec laquelle il désignait sa fille Aïchah.
– Voici la bourse que je t’ai promise. Peux-tu et veux-tu gagner les mille autres ?
– Il y a des services qu’on ne paye point avec de l’or, répliqua le derviche. D’ailleurs, que veux-tu que fasse de ton or un pauvre religieux tout entier au culte d’Allah ?
– Que désires-tu en échange de ce que je te demande ?
– Ton serment de m’accorder ce que je requerrai de toi, après le miracle opéré.
– Soit, je te le jure par Mahomet.
Le derviche tira, de dessous le haïck en guenilles qui lui servait de manteau, un sac rempli d’une farine brunâtre.
– Voici, lui dit-il, ce que tu me demandes. Fais façonner avec cette farine des pastilles dont la perle de ta maison mangera sept fois par jour, pendant sept semaines. Adieu, dans trois mois je reviendrai te sommer de tenir ton serment. Donne-moi l’anneau que tu portes à ton doigt, pour que je puisse arriver jusqu’à toi quand je le voudrai.
Trois mois après, en effet, la belle Aïchah possédait l’embonpoint qu’elle désirait tant, et ne se sentait pas de joie de dépasser en obésité les plus grosses personnes de Bagdad.
Un matin, le sultan vit arriver dans son palais le derviche.
– Sois le bienvenu, lui cria Achmet dès qu’il le vit ; je t’ai juré de te donner ce que tu me demanderais, et puisque tu as tenu ta promesse, je tiendrai la mienne.
– Donne-moi donc pour épouse la fleur qui me doit sa beauté.
Le sultan pâlit et fronça le sourcil. Puis, après un moment de réflexion :
– Les noces se célébreront ce soir même, dit-il.
– Et en sortant de la mosquée un de tes bourreaux m’abattra la tête d’un coup de son sabre. Voilà ta pensée, sultan ! Eh bien, apprends quel gendre tu perds !
Et jetant le haïck qui l’enveloppait, il montra au sultan déconcerté le visage d’un génie resplendissant comme le soleil, et disparut.
Le sultan passa en prière la journée et la nuit pour apaiser la colère du génie, et promit deux mille bourses d’or à celui qui lui dirait de quelle graine provenait la farine à laquelle Aïchah devait son embonpoint. Personne ne put le découvrir ; on pensa néanmoins que c’était de la graine de nigelle, appelée en Orient obésode.
Quoi qu’il en soit, les Orientaux saupoudrent de farine de nigelle leurs pains et leurs gâteaux ; enfin, ils la broient et la réduisent en poudre pour en fabriquer, à l’instar du génie, des pastilles contre la maigreur. »
– Voilà une histoire bien singulière, mon père, dit Marguerite… J’aurais bien besoin d’un peu de pastille de nigelle, ajouta-t-elle, en montrant ses mains amaigries par la maladie.
– Il vaut mieux demander cela à l’air pur de la campagne.
– Et à votre tendresse à tous ! interrompit-elle.
Et, s’appuyant affectueusement sur le bras de Marthe, elle se leva pour passer dans la salle à manger, car la cloche venait d’annoncer que le dîner était servi.
La santé de Marguerite, grâce aux soins dont l’entourait sa famille et à la sollicitude de tous les instants que sa sœur Marthe lui prodiguait avec un dévouement au-dessus de son âge, mit à se rétablir une promptitude qui tenait du prodige. Ses forces reparurent ; les traces que le feu avait imprimées sur ses joues commencèrent à pâlir, et, à voir ses beaux yeux, un étranger n’eût pu supposer qu’elle était privée de la vue.
Chaque matin, appuyée sur le bras de Marthe, elle sortait de bonne heure pour faire une longue promenade ; grâce à l’exercice salutaire qu’elle y prenait, elle en revenait toujours mieux portante et plus gaie. Marthe trouvait moyen, à chaque instant, d’amener le sourire sur les lèvres de sa sœur et de l’intéresser en lui racontant tout ce qu’elle voyait.
Une fois, par exemple, qu’elles atteignaient les limites du parc de leur père, elles se sentirent fatiguées et s’assirent sur le gazon, au bord d’une fontaine limpide, large de plus de deux mètres, et qui fermait de ses rives plantureuses et de ses eaux transparentes cette partie de la propriété. Les oiseaux chantaient dans les arbres, ou ramassaient çà et là des brindilles pour construire leurs nids ; les insectes qui foisonnaient dans l’herbe faisaient entendre leurs cris que dominait l’étrange et strident appel du grillon. Maître Flock, le nez au vent, courait de tous côtés, tantôt poursuivant un beau lézard vert qui lui échappait en grimpant agilement sur un tronc d’arbre, tantôt chassant une abeille qui, loin de refuser le combat, volait et bourdonnait autour du petit chien, le menaçait, s’abattait à ras de son museau, s’enfuyait, revenait, le harcelait, et finissait par s’élever dans les airs et par disparaître, sans tenir compte des jappements irrités du terrier en miniature.
Tout à coup, Marthe prit la main de sa sœur et lui dit à voix basse : – Si tu savais, Marguerite, quelle belle épinoche je vois nager dans la fontaine, là, presqu’à nos pieds ! Elle va, elle vient, elle s’agite, elle recueille de tous côtés des débris de plantes et de brins d’herbe qu’elle apporte dans sa bouche, pour les déposer au fond d’une petite anse grande comme les deux mains et profonde de cinquante centimètres. Sœur, je ne puis en croire mes yeux ! elle enlace ces herbes les unes aux autres avec une promptitude et une adresse que lui envierait un vannier de profession.
– Que tu es heureuse de voir cela ! chère petite sœur.
– L’intelligent poisson a façonné une sorte de natte. Mais il s’aperçoit que l’eau, si doucement qu’elle coule dans l’endroit où il édifie son œuvre, entraîne doucement ce mignon tapis à la dérive, et parfois même le soulève à la surface. Elle réfléchit quelques secondes avec un désappointement visible. Que va-t-elle faire ? elle part comme un trait ! Où va-t-elle ? La voici qui revient déjà ! elle est chargée d’un cailloux presque aussi gros que sa tête, et que peuvent à peine tenir ses larges mâchoires.
Elle dépose la pierre en plein milieu du tissu végétal. Elle s’en va encore. Autre pierre qu’elle rapporte ! Sept voyages, autant de cailloux ! Aussi, comme le tapis est bien lesté. Il ne bouge plus ; il se trouve installé avec une solidité à toute épreuve. Cependant, par surcroît de précautions, l’architecte à nageoires remplit de sable sa gueule et le souffle sur la natte, qui s’en trouve peu à peu à demi recouverte.
– Pourquoi le pauvre petit poisson se donne-t-il tant de mal ? Regarde toujours, Marthe, il serait bien curieux de le savoir.
– L’épinoche contemple ce qu’elle a fait. À juger par le frétillement de sa queue et par les mouvements de ses nageoires, elle paraît satisfaite de son ouvrage… Elle se met à l’œuvre avec plus d’activité encore, elle glisse lentement sur les herbes enlacées ; elle les lisse à l’aide de son ventre armé de deux épines plates, comme un maçon le ferait avec sa truelle… Non ! je ne me trompe pas ! elle frotte chaque nœud du tissu des mucosités qui recouvrent son corps, comme le corps de tous les poissons, et qui les rendent si glissants quand on veut les saisir.
– Voilà donc la natte terminée et devenue imperméable ; mais que compte-t-elle faire de cette natte ?
– Les fondations de l’édifice mystérieux sont achevées. Elle s’assure de leur solidité en agitant avec une extrême agilité ses nageoires de devant, pour produire dans l’eau de petits remous qu’elle dirige vers son œuvre. Deux ou trois brins d’herbe ne résistent pas à cette épreuve, et font mine de se détacher ; elle les renfonce au moyen de son museau ; elle les tasse, elle les englue. Rien ne bouge plus, à présent ! Les remous restent sans action ; aussi combien elle est contente ! Elle tourne autour de la natte, elle la regarde de ses gros yeux ; elle semble vraiment s’applaudir.
– Pauvre petite bête, qu’elle m’intéresse !
– Je commence à comprendre ce qu’elle veut faire. Mais je peux à peine en croire ce que je vois. C’est un plancher qu’elle a construit et c’est une habitation, un nid qu’elle va placer sur ces fondations. Oui, avec une activité plus fébrile que jamais, elle rassemble encore des matériaux végétaux ; mais, cette fois, elle les choisit plus solides. Elle rapporte des racines, des fétus de paille, des petits bâtons, et elle les fiche dans l’épaisseur de la natte. Quelle adresse et quelle persévérance elle y met !… Quelque chose ne va pas à son gré… elle le démolit courageusement ; elle travaille à nouveaux frais, elle rejette les brins qui ne lui conviennent pas ; elle va en chercher d’autres. Que de voyages ! que d’essais !… Enfin elle termine son enclos ! Non ! elle ne l’a pas terminé ; il y manque encore la toiture !
– La toiture ? Marthe, es-tu bien sûre de ce que tu dis là ? tes yeux ne te trompent-ils point ?
– Non, ma sœur, non ! elle se sert, pour cette toiture, de matériaux légers, souples, lisses, et qu’elle encolle au préalable. Ils forment un véritable feutrage végétal. Seulement elle a soin de ménager, au milieu, un trou rond par lequel elle entre souvent la tête pour s’assurer que les parois ne s’écartent point, qu’elles ne manquent point de solidité, et qu’elles fournissent un passage commode.
Enfin, elle couvre les bords de cette couverture d’une couche épaisse du ciment gélatineux qui suinte de son corps, et dont elle s’est déjà servie plusieurs fois. Si tu savais comme les bords reluisent au soleil ! On dirait un anneau de cristal.
En ce moment maître Flock, qui dormait profondément aux pieds de ses maîtresses, leva la tête, dressa les oreilles, et courut en aboyant et en gambadant au-devant de madame Daubencourt, qui venait, un peu inquiète, chercher ses filles. L’épinoche et son nid préoccupaient tellement les deux sœurs, qu’elles n’avaient point pris garde à la cloche du déjeuner, dont les tintements répétés les conviaient à rentrer.
Marguerite raconta à son père ce qu’elle et Marthe avaient vu au bord de l’eau. On convint que, vers le soir, quand une légère pluie qui tombait cesserait, on visiterait de nouveau les constructions de l’épinoche.
En effet, vers quatre heures, Marthe ramena Marguerite près de la fontaine, et montra à son père et à sa mère le joli nid du poisson.
Marthe eut d’abord quelque peine à reconnaître son ouvrière du matin. Celle-ci avait changé son costume grisâtre de travailleuse pour se revêtir des couleurs les plus riches et les plus éclatantes. L’or, l’opale, nuancés de mille façons radieuses, se jouaient sur sa robe, aux rayons du soleil, et formaient des reflets dignes des feux du plus pur diamant. Elle nageait coquettement devant son nid, se pavanait, faisait la belle, et parfois nageait sur le dos, comme pour montrer la belle teinte orangée qui colorait sa poitrine. On eût dit un ouvrier, le dimanche, libre, heureux, en habits de fête, et n’ayant plus qu’à s’amuser et à se reposer.
Le lendemain, Marthe raconta à sa sœur que non seulement l’ouverture du nid se trouvait rétrécie de façon à ce que l’épinoche elle-même pût à peine y pénétrer en s’y glissant ; mais encore que le poisson, qui avait repris son costume de travail, fortifiait son habitation en la recouvrant de pierres, qu’il choisissait avec beaucoup de soin, dont quelques-unes dépassaient en grosseur plus de la moitié de son corps, et que, certes, on ne l’aurait point cru capable de soulever et de transporter.
Cette besogne terminée, elle se mit en faction devant le nid.
Jamais sentinelle ne se montra plus sévère sur sa consigne ; il fallait que tous les importuns passassent au large, s’ils ne voulaient point voir le factionnaire se ruer sur eux, dresser les épines qu’il porte sur son dos, et qui valent au petit poisson le nom d’épinoche. Lui résistait-on, ou voulait-on déjouer ses précautions, l’œil en feu, il frappait l’eau de sa queue, il courait sus à l’ennemi, saisissait dans sa gueule les nageoires de l’un d’eux, en arrachait des lambeaux, et ne tenait point compte des blessures que lui-même recevait parfois.
Marguerite, qui ne voyait pourtant point, hélas ! les scènes de combats qui se passaient sous ses yeux, ne tarda point à deviner, par les récits de sa sœur, quel trésor renfermait le nid de l’épinoche, et ce qu’elle défendait si valeureusement : c’était les œufs qu’elle y avait pondus.