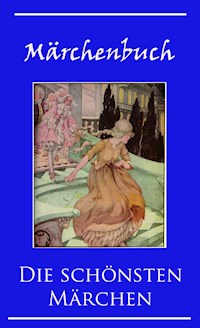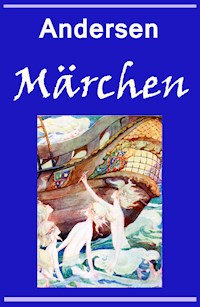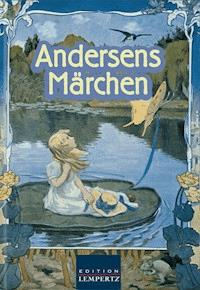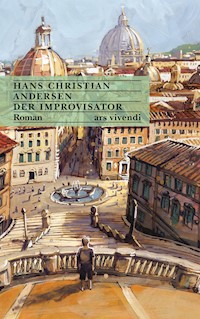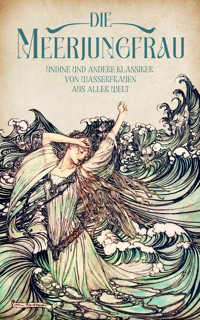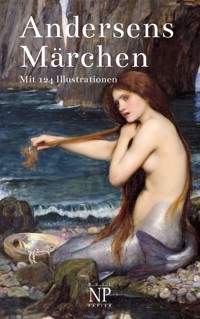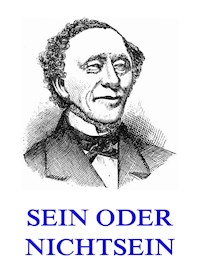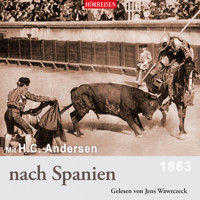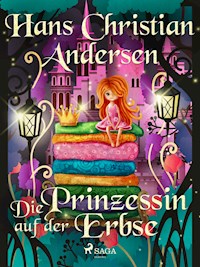Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
ANDERSEN, HANS CHRISTIAN : Contes merveilleux : L'Ombre - Le Papillon - Papotages d'enfants - La Pâquerette - La Petite Fille aux allumettes - La Petite Poucette - La Petite Sirène - La Plume et l'encrier - La Princesse au petit pois - La Princesse et le porcher - Quelque Chose - La Reine des neiges - Une Rose de la tombe d'Homère - Le Rossignol et l'Empereur - Le Sapin ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’ombre
Un jour, un savant homme des pays froids arriva dans une contrée du Sud ; il s’était réjoui d’avance de pouvoir admirer à son aise les beautés de la nature que développe dans ces régions un climat fortuné ; mais quelle déception l’attendait ! Il lui fallut rester toute la journée comme prisonnier à la maison, fenêtres fermées ; et encore était-on bien accablé ; personne ne bougeait ; on aurait dit que tout le monde dormait dans la maison, ou qu’elle était déserte. Tout le jour, le soleil dardait ses flammes sur la terrasse qui formait le toit ; l’air était lourd, on se serait cru dans une fournaise : c’était insupportable.
Le savant homme des pays froids était jeune et robuste ; mais sous ce soleil torride, son corps se desséchait et maigrissait à vue d’œil ; son ombre même se rétrécit et rapetissa, et elle ne reprenait de la vie et de la force que lorsque le soleil avait disparu. C’était un plaisir alors de voir, dès qu’on apportait la lumière dans la chambre, cette pauvre ombre se détirer, et s’étendre le long de la muraille.
Le savant homme à ce moment se sentait aussi revivre ; il se promenait dans sa chambre pour ranimer ses jambes engourdies et allait sur son balcon admirer le firmament étoilé. Sur tous ces balcons, il voyait apparaître des gens qui venaient respirer l’air frais. La rue aussi commençait à s’animer ; les bourgeois s’installaient devant leurs portes ; des milliers de lumières scintillaient de toutes parts.
Il n’y avait qu’une maison où continuât à régner un complet silence ; c’était celle en face de la demeure du savant étranger. Elle n’était pas inhabitée cependant ; sur le balcon verdissaient et fleurissaient de belles plantes ; il fallait que quelqu’un les arrosât, le soleil sans cela les aurait aussitôt desséchées.
La soirée s’avançait ; voilà que la fenêtre du balcon s’entrouvrit un peu ; la chambre resta sombre ; de l’intérieur arrivèrent de doux sons d’une musique que le savant étranger trouva délicieuse, ravissante. Il alla demander à son propriétaire quelles étaient les personnes qui demeuraient en face ; le brave homme lui répondit qu’il n’en savait rien.
Une nuit, le savant étranger s’éveilla ; il avait, le soir, laissé la fenêtre de son balcon ouverte ; il regarda de ce côté et il crut apercevoir une lueur extraordinaire rayonner du balcon de la maison d’en face : les fleurs paraissaient briller comme de magnifiques flammes de couleur, et au milieu d’elles se tenait une jeune fille d’une beauté merveilleuse ; elle semblait un être éthéré, tout de feu.
Un autre soir, le savant étranger reposait sur son balcon ; derrière lui, dans la chambre, brûlait une lumière, et, chose naturelle, il en résultait que son Ombre apparaissait sur la muraille de la maison d’en face ; l’étranger remua, l’Ombre bougea également et la voilà qui se trouve entre les fleurs du balcon d’en face.
– Je crois, dit le savant étranger, que mon Ombre est en ce moment le seul être vivant de cette mystérieuse maison. Tiens, la fenêtre du balcon est de nouveau entrouverte. Une idée ! Si mon Ombre avait assez d’esprit pour entrer voir ce qui se passe à l’intérieur et venir me le redire … Oui, continua-t-il, en s’adressant par plaisanterie à l’Ombre, fais-moi donc le plaisir d’entrer là. Cela te va-t-il ? Et en même temps, il fit un mouvement de tête que l’Ombre répéta comme si elle disait : « oui. »
– Eh bien, c’est cela, reprit-il ; mais ne t’oublie pas et reviens me trouver. À ces mots, il se leva, rentra dans la chambre et laissa retomber le rideau.
Alors, si quelqu’un s’était trouvé là, il aurait vu distinctement l’Ombre pénétrer lestement par la fenêtre d’en face et disparaître dans l’intérieur.
Le lendemain, comme il ne faisait plus si chaud, le savant étranger sortit. Le ciel était couvert de nuages ; mais voilà qu’ils se dissipent, le soleil reparaît.
– Qu’est cela ? s’écrie l’étranger qui venait de se retourner pour considérer un monument. Mais c’est affreux ! Comment, je n’ai plus mon Ombre ! Elle m’a pris au mot ; elle m’a quitté hier soir. Que vais-je devenir ?
Le soir, il se remit sur son balcon, la lumière derrière lui ; il se dressa de tout son haut, se baissa jusque par terre, fit mille contorsions ; puis il appela hum hum, et pstt, pstt ; l’Ombre ne reparut pas.
Décidément, ce n’était pas gai. Mais dans les pays chauds, la végétation est bien puissante ; tout y pousse et prospère à merveille, et au bout de huit jours, l’étranger aperçut, à la lueur de sa lampe, un petit filet d’ombre derrière lui. »Quelle chance ! se dit-il. La racine était restée. »
La nouvelle ombre grandit assez vite ; au bout de trois semaines, l’étranger s’enhardit à se montrer de jour en public, et lorsqu’il repartit pour le Nord, sa patrie, on ne remarquait plus chez lui rien d’extraordinaire.
De retour dans son pays, le savant homme écrivit des livres sur les vérités qu’il avait découvertes et sur ce qu’il avait vu dans ce monde méridional.
Un soir qu’il était dans sa chambre à méditer, il entend frapper doucement à sa porte. »Entrez ! » dit-il. Personne ne vint. Alors, il alla ouvrir lui-même la porte, et devant lui se trouva un homme d’une extrême maigreur ; mais il était habillé à la dernière mode : ce devait être un personnage de distinction.
– À qui ai-je l’honneur de parler ? dit le savant.
– Oui, je le pensais bien, que vous ne me reconnaîtriez pas, répondit l’autre. Je ne suis pas bien gros, j’ai cependant maintenant un corps véritable. Vous continuez à ne point me remettre ? Mais, je suis votre ancienne Ombre. Depuis que je vous ai quitté, acquis une belle fortune. C’est ce qui me permettra de me racheter du servage où je me trouve toujours vis-à-vis de vous.
– Non, permettez que je revienne de ma surprise, s’écria le savant. Voyons, vous ne vous moquez pas de moi ?
– Du tout, répondit l’Ombre. Mon histoire n’est pas de celles qui se passent tous les jours. Lorsque vous m’avez autorisée à vous quitter, j’en ai profité comme vous le savez. Cependant, au milieu de mon bonheur, j’ai éprouvé le désir de vous revoir encore une fois avant votre mort, ainsi que ce pays. Je sais que vous avez une nouvelle ombre. Ai-je à lui payer quelque chose parce qu’elle remplit mon service, et à vous combien devrai-je si je veux me racheter ?
– Comment, c’est vraiment toi ? dit le savant. Jamais je n’aurais eu l’idée qu’on pouvait retrouver son Ombre sous la forme d’un être humain.
– Pardon si j’insiste, reprit l’Ombre. Quelle somme ai-je à vous verser pour que vous renonciez à l’autorité que vous avez toujours sur moi ?
– Laisse donc ces sornettes, dit le savant. Comment peut-il être question d’argent entre nous. Je t’affranchis et je te fais libre comme l’air. Je suis enchanté d’apprendre que tu as si bien fait ton chemin dans ce monde. Seulement je te prie d’une chose ; raconte-moi tes aventures depuis le moment où tu t’es faufilée par la fenêtre du balcon dans la maison en face de celle que nous habitions.
– Je veux bien vous en faire le récit, dit l’Ombre ; mais promettez-moi de n’en rien révéler, de ne pas apprendre aux gens que je n’ai été qu’un être impalpable. Il me peut venir l’idée de me marier, et je ne tiens pas à ce qu’on me suppose sans consistance.
– C’est entendu, dit le savant.
Avant de commencer, l’Ombre s’installa à son aise. Elle était toute vêtue de noir, ses vêtements étaient du drap le plus fin, ses bottes en vernis ; elle portait un chapeau à claque, dont par un ressort on pouvait faire une simple galette : on venait d’inventer ce genre de coiffure, qui n’était encore d’usage que dans la plus haute société.
Elle s’assit et posa ses bottes vernies sur la tête de la nouvelle ombre qui lui avait succédé et qui se tenait comme un fidèle caniche aux pieds du savant ; celle-ci ne parut pas ressentir l’humiliation et ne bougea pas, voulant écouter attentivement comment la première s’y était prise pour se dégager de son esclavage.
– Vous ignorez encore, commença l’Ombre parvenue, qui demeurait dans la fameuse maison d’en face, qui vous intriguait là-bas dans les pays chauds. C’était ce qu’il y a de plus sublime au monde : la Poésie en personne. Je ne restai que trois semaines auprès d’elle, et j’appris dans ces quelques jours sur les secrets de l’univers et le cours du monde plus que si j’avais vécu autre part trois mille ans. Et aujourd’hui je puis dire sans craindre d’être mis à l’épreuve : je sais tout, j’ai tout vu.
– La Poésie ! s’écria le savant. Comment n’y ai-je pas pensé ? Mais oui, dans les grandes villes, elle vit dans l’isolement, toute solitaire ; bien peu s’intéressent à elle. Je ne l’ai aperçue qu’un instant, et encore n’étais-je qu’à moitié éveillé. Elle se tenait sur le balcon ; autour d’elle une auréole brillait comme une de nos aurores boréales ; elle était au milieu d’un parterre de fleurs qu’on aurait prises pour des flammes. Mais continue, continue : donc tu entras par la fenêtre du balcon, et alors …
– Je me trouvai dans une antichambre où régnait comme une sorte de crépuscule ; la porte qui était ouverte donnait sur une longue enfilade de superbes appartements qui communiquaient tous ensemble ; la lumière y était éblouissante, et m’aurait infailliblement tuée si je m’y étais aventurée. Mais provenant de vous, j’avais suffisamment de votre sagesse pour rester à l’abri et tout observer de mon petit coin. Dans le fond je vis la Poésie, assise sur son trône.
– Et ensuite ? interrompit le savant. Ne me fais pas languir.
– Je vous l’ai déjà dit, reprit l’Ombre, j’ai vu défiler devant moi tout ce qui existe : le passé et une partie de l’avenir. Mais, par parenthèse, je vous demanderai s’il n’est pas convenable que vous cessiez de me tutoyer. J’en fais l’observation, non par orgueil, mais en raison de ma science maintenant si supérieure à la vôtre, et surtout à cause de ma situation de fortune, chose qui ici-bas règle partout les relations de société.
– Vous avez parfaitement raison, dit le savant. Excusez-moi de ne pas y avoir songé de moi-même. Mais continuez, je vous prie.
– Je ne puis, reprit l’Ombre, que vous répéter : j’ai tout vu et je sais tout.
– Mais enfin, dit le savant, ces magnifiques appartements, comment étaient-ils ? Était-ce comme un temple sacré ? ou bien s’y serait-on cru sous le ciel étoilé ? ou bien encore dans une forêt mystérieuse ? Ce sont là les lieux où nous aimons à supposer que demeure la Poésie.
– Maintenant que j’ai tout vu et que je connais tout, dit l’Ombre, il m’est pénible d’entrer dans les menus détails.
– Apprenez-moi au moins, dit le savant, si dans ces splendides salles vous avez aperçu les dieux des temps antiques, les héros des âges passés ? Les sylphides, les gentilles elfes n’y dansaient-elles pas des rondes ?
– Vous ne voulez donc pas comprendre que je ne puis vous en dire plus. Si vous aviez été à ma place, dans ce séjour enchanté, vous seriez passé à l’état d’être supérieur à l’homme ; moi qui n’étais qu’une ombre, j’ai avancé jusqu’à la condition d’homme. Or le propre de l’humanité c’est de faire l’important, c’est de se prévaloir à l’excès de ses avantages. Donc il est tout naturel qu’ayant tout vu, je ne vous communique rien de ma science.
J’ai d’autant plus de raison de montrer quelque hauteur, qu’étant dans l’antichambre du palais, j’ai saisi la ressemblance de mon être intime avec la Poésie : tous deux nous sommes des reflets.
« Lorsque, devenue homme, j’abandonnai la demeure de la Poésie, vous aviez quitté la ville. Je me trouvai un matin, dans les rues, richement habillée comme un prince. D’abord, l’étrangeté de ma nouvelle situation me fit un singulier effet ; et je me blottis tout le jour dans le coin d’une ruelle écartée.
« Le soir je parcourus les rues au clair de lune : je grimpai tout en haut des murailles, jusqu’au faite des toits et je regardai dans les maisons, à travers les fenêtres des beaux salons et des humbles mansardes. Personne ne se défilait de moi, et je découvris toutes les vilaines choses que disent et que font les hommes quand ils se croient à l’abri de tout regard observateur. »Si j’avais mis dans une gazette toutes les noirceurs, les indignités, les intrigues, que je découvrais, on n’aurait plus lu que ce journal dans tout l’univers. Mais quels ennemis cela m’aurait procurés ! Je préférai profiter de ma clairvoyance, et je fis par lettre particulière connaître aux gens que je savais leurs méfaits. Partout où je passais, on vivait dans des transes terribles ; on me détestait comme la mort, mais en face on me choyait, on me faisait fête, on m’accablait de magnifiques cadeaux et d’honneurs. Les académiciens me nommaient un des leurs, les tailleurs m’habillaient pour rien, les fournisseurs me donnaient ce qu’ils avaient de mieux pour m’obliger à taire leurs fraudes ; les financiers me bourraient d’or ; les femmes disaient qu’on ne pouvait imaginer un plus bel homme que moi. Je me laissais faire, c’est ainsi que je suis devenue le personnage que vous voyez.
« Maintenant je vous quitte pour aller à mes affaires. Au revoir. Voici ma carte. Je demeure du côté du soleil ; quand il pleut, vous me trouverez toujours chez moi. Mais je vous préviens que je pars demain pour faire mon tour du globe.
L’Ombre s’en fut. Le savant resta absorbé dans ses réflexions sur cette étrange aventure. Des années se passèrent. Un beau jour l’Ombre reparut.
– Comment allez-vous ? dit-elle.
– Pas trop bien, dit le savant. J’écris de mon mieux sur le Vrai, le Beau et le Bien ; mais mes livres n’intéressent presque personne, et j’ai la faiblesse de m’en affecter. Vous me voyez tout désespéré.
– Ce n’est guère mon cas, dit l’Ombre. Voyez comme j’engraisse et comme j’ai bonne mine. C’est là le vrai but de la vie ; vous ne savez pas prendre le monde tel qu’il est, et exploiter ses défauts. Cela vous ferait du bien de voyager un peu. Justement, je vais repartir pour un autre continent : voulez-vous m’accompagner ? je vous défraierai de tout ; nous aurons un train de grands seigneurs. Mais il y a une condition. Vous savez, je n’ai pas d’ombre, moi : eh bien, vous remplirez cet emploi auprès de moi.
– C’est trop fort ce que vous me proposez là, dit le savant ; c’est presque de l’impudence. Comment, je vous ai affranchie, sans rien vous demander, et vous voulez faire de moi votre esclave ?
– C’est le cours de ce monde, répondit l’Ombre. Il y a des hauts et des bas : les maîtres deviennent des valets ; et quand les valets commandent, ils font les tyrans. Vous ne voulez pas accepter ; à votre aise !
L’Ombre repartit de nouveau.
Le pauvre savant alla de mal en pis ; les peines et les chagrins vinrent le harceler. Moins que jamais on faisait attention à ce qu’il écrivait sur le Vrai, le Beau et le Bien. Il finit par tomber malade.
– Mais comme vous maigrissez, lui dit-on, vous avez l’air d’une ombre !
Ces mots involontairement cruels firent tressaillir l’infortuné savant.
– Il vous faut aller aux eaux, lui dit l’Ombre qui revint lui faire une visite. Il n’y a pas d’autre remède pour votre santé. Vous avez dans le temps refusé l’offre que je vous faisais de vous prendre pour mon ombre. Je vous la réitère en raison de nos anciennes relations. C’est moi qui paye les frais de voyage ; je suis aussi obligée d’aller aux eaux afin de faire pousser ma barbe qui ne veut pas croître suffisamment pour que j’aie l’air de dignité qui convient à ma position. Donc vous serez mon compagnon. Vous écrirez la relation de nos pérégrinations. Soyez cette fois raisonnable et ne repoussez pas ma proposition.
Le savant, pressé par la nécessité, fit taire sa fierté et ils partirent. L’Ombre avait toujours la place d’honneur ; selon le soleil, le savant avait à virer et à tourner, de façon à bien figurer une ombre. Cela ne le peinait ni ne l’affectait même pas ; il avait très bon cœur, il était très doux et aimable et il se disait que si cette fantaisie faisait plaisir à l’Ombre, autant valait la satisfaire. Un jour il lui dit :
– Maintenant que nous voilà redevenus intimes comme autrefois, ne serait-il pas mieux de nous tutoyer de nouveau ?
–Votre proposition est très flatteuse, répondit l’Ombre d’un air pincé qui convenait à sa qualité de maître ; mais comprenez bien ceci que je vais vous dire en toute franchise. Je me sentirais tout bouleversé, si vous veniez me tutoyer de nouveau ; cela me rappellerait trop mon ancienne position subalterne. Mais je veux bien, moi, vous tutoyer : de la sorte votre désir sera accompli au moins à moitié.
Et ainsi fut fait. Le brave savant ne protesta pas.
« Il paraît que c’est le cours du monde », se dit-il, et il n’y pensa plus.
Ils s’installèrent dans une ville d’eaux où il y avait beaucoup d’étrangers de distinction, et entre autres la fille d’un roi, merveilleusement belle ; elle était venue pour se faire guérir d’une grave maladie : sa vue était trop perçante ; elle voyait les choses trop distinctement et cela lui enlevait toute illusion.
Elle remarqua que le seigneur nouvellement arrivé n’était pas un seigneur ordinaire.
« On prétend qu’il est ici, se dit-elle, pour que les eaux fassent croître sa barbe ; moi je sais à quoi m’en tenir sur son infirmité, c’est qu’il ne projette pas d’ombre. »
Sa curiosité était vivement éveillée, et à la promenade elle se fit aussitôt présenter le seigneur étranger. En sa qualité de fille d’un puissant roi, elle n’était pas habituée à user de circonlocutions ; aussi dit-elle à brûle-pourpoint : – Je connais votre maladie ; vous souffrez de ne pas avoir d’ombre.
– Vos paroles me remplissent de joie, répondit l’Ombre, elles me prouvent que Votre Altesse Royale est sur la voie de guérison et que votre vue commence à se troubler et à vous abuser. Loin de ne pas avoir d’ombre, j’en ai une tout extraordinaire ; c’est dans ma nature de rechercher tout ce qui est particulier, et je ne me suis pas contentée d’une de ces ombres comme en ont les hommes en général. J’ai pour ombre un homme en chair et en os ; qui plus est, de même que souvent on donne à ses domestiques pour leur livrée un drap plus fin que celui qu’on porte soi-même, j’ai tant fait que cet être a lui-même une ombre. Cela m’est revenu bien cher ; mais encore une fois je raffole de ce qui est rare.
– Que me dites-vous là ? s’écria la princesse. 0h ! bonheur, mes yeux commencent à me tromper ! Ces eaux sont vraiment admirables.
Ils se séparèrent avec les plus grands saluts.
« Je pourrais cesser ma cure, se dit-elle ; mais je veux encore rester quelque temps. Ce prince m’intéresse beaucoup … »
Le soir, dans la grande salle de bal, la fille du roi et l’Ombre firent un tour de danse. Elle était légère comme une plume ; mais lui était léger comme l’air ; jamais elle n’avait rencontré un pareil danseur. Elle lui dit quel était le royaume de son père ; l’Ombre connaissait le pays, l’ayant visité dans le temps. La princesse alors en était absente. L’Ombre s’était amusée, selon son ordinaire, à grimper aux murs du palais du roi et à regarder par les fenêtres, par les ouvertures des rideaux et même par le trou des serrures ; elle avait appris une foule de petits secrets de la cour, auxquels, en causant avec la princesse, elle fit de fines allusions.
« Que d’esprit et de tact il a, ce jeune et galant prince ! » se dit la princesse, et elle se sentit un grand penchant pour lui. L’Ombre s’en aperçut redoubla d’amabilité. À la troisième danse, la princesse fut sur le point de lui avouer que son cœur était touché ; mais elle avait un fond de raison et pensait à son royaume ; elle se dit :
« Ce prince est fort spirituel, sa conversation est très intéressante, c’est fort bien ; il danse divinement, c’est encore mieux. Mais, pour qu’il puisse m’aider à gouverner mes millions de sujets, il faudrait aussi qu’il eût de solides connaissances : c’est très important ; aussi vais-je lui faire subir un petit examen. »
Et elle lui adressa une question si extraordinairement difficile, qu’elle-même n’aurait pas été en état d’y répondre. L’Ombre fit une légère moue.
– Vous ne connaissez pas la solution ? dit-elle d’un air désappointé.
– Ce n’est pas cela, dit l’Ombre ; seulement je suis un peu déconcertée parce que vous n’avez pas cru devoir m’interroger sur une matière un peu plus ardue. Quant à cette question, je connais la réponse depuis ma première jeunesse, au point que mon ombre, qui se tient là-bas, pourrait vous en dire la solution.
– Votre ombre ! s’écria la princesse, mais ce serait un phénomène unique.
– Je ne l’assure pas entièrement, dit l’Ombre, mais je crois qu’il en est ainsi. Toute ma vie je me suis occupée de science et il est naturel que mon ombre tienne de moi. Seulement, en raison même des connaissances qu’elle a pu acquérir, elle ne manque pas d’orgueil et elle a la prétention d’être traitée comme un être humain véritable. Je me permettrai de prier votre Altesse Royale de tolérer sa manie, afin qu’elle reste de bonne humeur et réponde convenablement.
– Rien de plus juste, dit la princesse.
Elle alla trouver le savant, qui se tenait contre la porte, et elle causa avec lui du soleil et de la lune, des profondeurs des cieux et des entrailles de la terre ; elle l’interrogea sur les nations des contrées les plus éloignées. Il ne resta pas court une seule fois, et il apprit à la princesse les choses les plus intéressantes.
« Celui qui a une ombre aussi savante, se dit-elle, doit être un véritable phénix. Ce sera une bénédiction pour mon peuple, que je le choisisse pour partager mon trône : ma résolution est prise. »
Elle fit connaître ses intentions à l’Ombre, qui les accueillit avec une grâce et une dignité parfaites. Il fut convenu que la chose serait tenue secrète, jusqu’au moment où l’on serait de retour dans le royaume de la princesse.
– C’est cela, dit l’Ombre, nous ne laisserons rien deviner à personne, pas même à mon ombre.
Elle avait ses raisons particulières pour prendre cette précaution.
– Écoute bien, mon ami, dit l’Ombre à son ancien maître le savant. Je suis arrivée au comble de la puissance et de la richesse et je pense à faire ta fortune. Tu habiteras avec moi le palais du roi et tu auras cent mille écus par an. Mais, prends en bien note, tu passeras plus que jamais pour mon ombre, et tu ne révéleras à personne que tu as toujours été un homme.
– Non, je ne veux pas tremper dans cette fourberie. À moi il serait égal d’être votre inférieur, mais je ne veux pas que vous trompiez tout un peuple et la fille du roi par-dessus le marché. Je dirai tout ; que je suis un homme, que vous n’êtes qu’une ombre vêtue d’habits d’homme, un reflet, une chimère.
– Personne ne te croira, dit l’Ombre. Calme-toi, ou j’appelle la garde.
– Je m’en vais trouver la princesse, dit le savant, et tout lui révéler.
– J’y serai avant toi, dit l’Ombre, car tu vas aller tout droit en prison.
La garde arriva et obéit à celui qui était connu comme le fiancé de la fille du roi. Le pauvre savant fut jeté dans un noir cachot.
– Tu trembles, dit la princesse lorsqu’elle vit entrer l’Ombre. Qu’est-il arrivé ?
– Je viens d’assister à un spectacle navrant, répondit l’Ombre. Pense donc, mon ombre a été prise de folie. Voilà ce que c’est ! À ma suite elle s’est toujours occupée de hautes sciences, et la tête lui aura tourné. Ne s’imagine-t-elle pas qu’elle a toujours été homme ? Mais il y a plus : elle prétend que je ne suis que son ombre !
– C’est épouvantable ! s’écria la princesse. Elle est enfermée, n’est-ce pas ?
– Oui certes, dit l’Ombre. Je crains bien qu’elle ne se remette jamais.
– Pauvre ombre ! dit la princesse. Elle doit être fort malheureuse : un être aussi mobile qui se trouve claquemuré dans une étroite cellule ! Ce serait probablement lui rendre un grand service que de la délivrer de son petit souffle de vie. Et puis dans ce temps de révolutions, où l’on voit les peuples toujours s’intéresser à ceux que nous autres souverains sommes censés persécuter, il est peut-être sage de se débarrasser d’elle en secret.
– Cela me semble bien dur cependant, dit l’Ombre d’un air contrit et en soupirant ; elle m’a servie si fidèlement !
– J’apprécie tes scrupules, dit la princesse, et je reconnais une fois de plus combien tu as un noble caractère. Mais ceux qui sont chargés d’une couronne ne peuvent pas écouter leur cœur. Donc je m’en tiendrai à ce que j’ai pensé.
Le soir, toute la ville fut illuminée splendidement ; à chaque seconde retentissait un coup de canon. Les cris de joie du peuple se mêlaient aux boum boum. C’était magnifique. Un superbe feu d’artifice fut tiré devant le palais, et la fille du roi et son époux vinrent sur le balcon recevoir les acclamations.
Le bruit étourdissant de la fête ne troubla pas le pauvre savant ; il était déjà mis à mort et enterré.
Le papillon
Le papillon veut se marier et, comme vous le pensez bien, il prétend choisir une fleur jolie entre toutes les fleurs. Elles sont en grand nombre et le choix dans une telle quantité est embarrassant. Le papillon vole tout droit vers les pâquerettes. C’est une petite fleur que les Français nomment aussi marguerite. Lorsque les amoureux arrachent ses feuilles, à chaque feuille arrachée ils demandent :
– M’aime-t-il ou m’aime-t-elle un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout ? La réponse de la dernière feuille est la bonne. Le papillon l’interroge :
– Chère dame Marguerite, dit-il, vous êtes la plus avisée de toutes les fleurs. Dites-moi, je vous prie, si je dois épouser celle-ci ou celle-là.
La marguerite ne daigna pas lui répondre. Elle était mécontente de ce qu’il l’avait appelée dame, alors qu’elle était encore demoiselle, ce qui n’est pas du tout la même chose. Il renouvela deux fois sa question, et, lorsqu’il vit qu’elle gardait le silence, il partit pour aller faire sa cour ailleurs. On était aux premiers jours du printemps. Les crocus et les perce-neige fleurissaient à l’entour.
– Jolies, charmantes fleurettes ! dit le papillon, mais elles ont encore un peu trop la tournure de pensionnaires. Comme les très jeunes gens, il regardait de préférence les personnes plus âgées que lui.
Il s’envola vers les anémones ; il les trouva un peu trop amères à son goût. Les violettes lui parurent trop sentimentales. La fleur de tilleul était trop petite et, de plus, elle avait une trop nombreuse parenté. La fleur de pommier rivalisait avec la rose, mais elle s’ouvrait aujourd’hui pour périr demain, et tombait au premier souffle du vent ; un mariage avec un être si délicat durerait trop peu de temps. La fleur des pois lui plut entre toutes ; elle est blanche et rouge, fraîche et gracieuse ; elle a beaucoup de distinction et, en même temps, elle est bonne ménagère et ne dédaigne pas les soins domestiques. Il allait lui adresser sa demande, lorsqu’il aperçut près d’elle une cosse à l’extrémité de laquelle pendait une fleur desséchée :
– Qu’est-ce cela ? fit-il.
– C’est ma sœur, répondit Fleur des Pois.
– Vraiment, et vous serez un jour comme cela ! s’écria le papillon qui s’enfuit.
Le chèvrefeuille penchait ses branches en dehors d’une haie ; il y avait là une quantité de filles toutes pareilles, avec de longues figures au teint jaune.
– À coup sûr, pensa le papillon, il était impossible d’aimer cela.
Le printemps passa, et l’été après le printemps. On était à l’automne, et le papillon n’avait pu se décider encore. Les fleurs étalaient maintenant leurs robes les plus éclatantes ; en vain, car elles n’avaient plus le parfum de la jeunesse. C’est surtout à ce frais parfum que sont sensibles les cœurs qui ne sont plus jeunes ; et il y en avait fort peu, il faut l’avouer, dans les dahlias et dans les chrysanthèmes. Aussi le papillon se tourna-t-il en dernier recours vers la menthe. Cette plante ne fleurit pas, mais on peut dire qu’elle est fleur tout entière, tant elle est parfumée de la tête au pied ; chacune de ses feuilles vaut une fleur, pour les senteurs qu’elle répand dans l’air. »C’est ce qu’il me faut, se dit le papillon ; je l’épouse. » Et il fit sa déclaration.
La menthe demeura silencieuse et guindée, en l’écoutant. À la fin elle dit :
– Je vous offre mon amitié, s’il vous plaît, mais rien de plus. Je suis vieille, et vous n’êtes plus jeune. Nous pouvons fort bien vivre l’un pour l’autre ; mais quant à nous marier … sachons à notre âge éviter le ridicule.
C’est ainsi qu’il arriva que le papillon n’épousa personne. Il avait été trop long à faire son choix, et c’est une mauvaise méthode. Il devint donc ce que nous appelons un vieux garçon.
L’automne touchait à sa fin ; le temps était sombre, et il pleuvait. Le vent froid soufflait sur le dos des vieux saules au point de les faire craquer. Il n’était pas bon vraiment de se trouver dehors par ce temps-là ; aussi le papillon ne vivait-il plus en plein air. Il avait par fortune rencontré un asile, une chambre bien chauffée où régnait la température de l’été. Il y eût pu vivre assez bien, mais il se dit : « Ce n’est pas tout de vivre ; encore faut-il la liberté, un rayon de soleil et une petite fleur. » Il vola vers la fenêtre et se heurta à la vitre. On l’aperçut, on l’admira, on le captura et on le ficha dans la boîte aux curiosités. » Me voici sur une tige comme les fleurs, se dit le papillon. Certainement, ce n’est pas très agréable ; mais enfin on est casé : cela ressemble au mariage. » Il se consolait jusqu’à un certain point avec cette pensée. »C’est une pauvre consolation », murmurèrent railleusement quelques plantes qui étaient là dans des pots pour égayer la chambre. » Il n’y a rien à attendre de ces plantes bien installées dans leurs pots, se dit le papillon ; elles sont trop à leur aise pour être humaines. »
Papotages d’enfants
Dans la maison d’un marchand, de nombreux enfants se réunirent un jour, des enfants de familles riches, des enfants de familles nobles. Monsieur le marchand avait réussi ; c’était un homme érudit puisque jadis, il était entré à l’Université. Son père qui avait commencé comme simple commerçant, mais honnête et entreprenant, lui avait fait lire des livres. Son commerce rapportait bien et le marchand faisait encore multiplier cette richesse. Il avait aussi bon cœur et la tête bien en place, mais de cela on parlait bien moins souvent que de sa grosse fortune. Se réunissaient chez lui des gens nobles, comme on dit, par leur titre, mais aussi par leur esprit, certains même par les deux à la fois mais d’autres ni par l’un ni par l’autre. En ce moment, une petite soirée d’enfants y avait lieu, on entendait des enfants papoter ; et les enfants n’y vont pas par quatre chemins. Il y avait par exemple une petite fille très mignonne mais terriblement prétentieuse ; c’étaient ses domestiques qui le lui avaient appris, pas ses parents qui étaient bien trop raisonnables pour cela. Son père était majordome, c’était une haute fonction et elle le savait bien.
– Je suis une enfant de majordome, se vantait-elle.
Elle pouvait aussi bien être la fille des Tartempion, on ne choisit pas ses parents. Elle raconta aux autres qu’elle était « noble » et affirma que celui qui n’était pas bien né n’arriverait jamais à rien dans la vie. On pouvait travailler avec assiduité, si l’on n’est pas bien né on n’arrivera à rien.
– Et ceux dont les noms se terminent par sen, proclama-t-elle, ne pourront jamais réussir dans la vie. Devant tous ces sen et sen, il n’y a plus que poser ses mains sur les hanches et s’en tenir bien à l’écart !
Et aussitôt elle posa ses jolies petites mains à sa taille, les coudes bien pointus pour montrer aux autres comment il fallait traiter ces gens-là. Quels jolis bras avait-elle ! Une petite fille très charmante !
Or, la fille de monsieur le Marchand se mit en colère. C’est que son père s’appelait Madsen et c’est aussi, hélas ! un nom en sen ; elle se gonfla et déclara avec fierté :
– Seulement mon père peut acheter pour cent écus d’or de friandises et les jeter dans la rue ! Et pas le tien !
– Ce n’est rien, mon père à moi, se vanta la fillette d’un rédacteur, peut mettre ton père et ton père et tous les pères dans le journal ! Tout le monde a peur de lui, dit maman, car c’est mon père qui dirige le journal.
Et elle leva son petit nez comme si elle était une vraie princesse qui doit pointer son nez en l’air.
Par la porte entrouverte, un garçon pauvre regardait. Il était d’une famille si pauvre qu’il n’avait même pas le droit d’entrer dans la chambre. Il avait aidé la cuisinière à faire tourner la broche et, en récompense, on l’autorisait à présent à se placer pour un petit moment derrière la porte pour regarder ces enfants nobles, pour voir comme ils s’amusaient bien ; c’était un grand honneur pour lui.
– Oh, si je pouvais être l’un d’eux ! soupira-t-il.
Puis il entendit ce qu’il s’y disait et cela suffit à lui faire baisser la tête. Chez lui, on n’avait pas un écu au fond du bahut, et on ne pouvait pas se permettre d’acheter les journaux et encore moins d’y écrire. Et le pire de tout : le nom de son père, et donc le sien aussi, se terminait par sen, il n’arriverait donc jamais à rien dans la vie. Quelle triste affaire ! On ne pouvait pourtant pas dire qu’il n’était pas né, pas cela, il était bel et bien né, sinon il ne serait pas là.
Quelle soirée !
Quelques années plus tard, les enfants devinrent adultes. Une magnifique maison fut construite dans la ville. Dans cette maison, il y avait plein d’objets somptueux, tout le monde voulait les voir, même des gens qui n’habitaient pas la ville, venaient pour les regarder. Devinez à quel enfant de notre histoire appartenait cette maison ? Et bien, la réponse est facile … ou plutôt pas si facile que ça. Elle appartenait au pauvre garçon, parce qu’il était quand même devenu quelqu’un bien que son nom se terminât en sen, il s’appelait Thorvaldsen. Et les trois autres enfants ? Ces enfants remplis d’orgueil pour leur titre, l’argent ou l’esprit ? Ils n’avaient rien à s’envier les uns aux autres, ils étaient égaux … et comme ils avaient un bon fond, ils devinrent de bons et braves adultes. Et ce qu’ils avaient pensé et dit autrefois n’était que … papotage d’enfants.
La pâquerette
Écoutez bien cette petite histoire.
À la campagne, près de la grande route, était située une gentille maisonnette que vous avez sans doute remarquée vous-même. Sur le devant se trouve un petit jardin avec des fleurs et une palissade verte ; non loin de là, sur le bord du fossé, au milieu de l’herbe épaisse, fleurissait une petite pâquerette. Grâce au soleil qui la chauffait de ses rayons aussi bien que les grandes et riches fleurs du jardin, elle s’épanouissait d’heure en heure. Un beau matin, entièrement ouverte, avec ses petites feuilles blanches et brillantes, elle ressemblait à un soleil en miniature entouré de ses rayons. Qu’on l’aperçût dans l’herbe et qu’on la regardât comme une pauvre fleur insignifiante, elle s’en inquiétait peu. Elle était contente, aspirait avec délices la chaleur du soleil, et écoutait le chant de l’alouette qui s’élevait dans les airs.
Ainsi, la petite pâquerette était heureuse comme par un jour de fête, et cependant c’était un lundi. Pendant que les enfants, assis sur les bancs de l’école, apprenaient leurs leçons, elle, assise sur sa tige verte, apprenait par la beauté de la nature la bonté de Dieu, et il lui semblait que tout ce qu’elle ressentait en silence, la petite alouette l’exprimait parfaitement par ses chansons joyeuses. Aussi regarda-t-elle avec une sorte de respect l’heureux oiseau qui chantait et volait, mais elle n’éprouva aucun regret de ne pouvoir en faire autant.
« Je vois et j’entends, pensa-t-elle ; le soleil me réchauffe et le vent m’embrasse. Oh ! j’aurais tort de me plaindre. »
En dedans de la palissade se trouvaient une quantité de fleurs roides et distinguées ; moins elles avaient de parfum, plus elles se redressaient. Les pivoines se gonflaient pour paraître plus grosses que les roses : mais ce n’est pas la grosseur qui fait la rose. Les tulipes brillaient par la beauté de leurs couleurs et se pavanaient avec prétention ; elles ne daignaient pas jeter un regard sur la petite pâquerette, tandis que la pauvrette les admirait en disant : « Comme elles sont riches et belles ! Sans doute le superbe oiseau va les visiter. Dieu merci, je pourrai assister à ce beau spectacle. »
Et au même instant, l’alouette dirigea son vol, non pas vers les pivoines et les tulipes, mais vers le gazon, auprès de la pauvre pâquerette, qui, effrayée de joie, ne savait plus que penser.
Le petit oiseau se mit à sautiller autour d’elle en chantant : « Comme l’herbe est moelleuse ! Oh ! la charmante petite fleur au cœur d’or et à la robe d’argent ! »
On ne peut se faire une idée du bonheur de la petite fleur. L’oiseau l’embrassa de son bec, chanta encore devant elle, puis il remonta dans l’azur du ciel. Pendant plus d’un quart d’heure, la pâquerette ne put se remettre de son émotion. À moitié honteuse, mais ravie au fond du cœur, elle regarda les autres fleurs dans le jardin. Témoins de l’honneur qu’on lui avait rendu, elles devaient bien comprendre sa joie ; mais les tulipes se tenaient encore plus roides qu’auparavant ; leur figure rouge et pointue exprimait leur dépit. Les pivoines avaient la tête toute gonflée. Quelle chance pour la pauvre pâquerette qu’elles ne pussent parler ! Elles lui auraient dit bien des choses désagréables. La petite fleur s’en aperçut et s’attrista de leur mauvaise humeur.
Quelques moments après, une jeune fille armée d’un grand couteau affilé et brillant entra dans le jardin, s’approcha des tulipes et les coupa l’une après l’autre.
– Quel malheur ! dit la petite pâquerette en soupirant ; voilà qui est affreux ; c’en est fait d’elles.