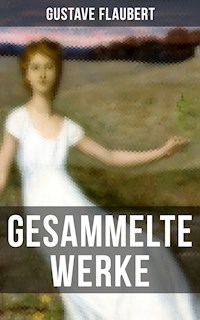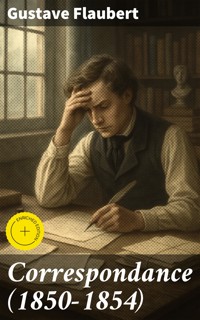
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
La "Correspondance" de Gustave Flaubert, couvrant la période de 1850 à 1854, est une oeuvre marquante qui révèle non seulement la plume acérée de l'auteur, mais aussi son processus créatif. À travers des lettres adressées à diverses personnalités de son époque, cette correspondance se distingue par son style littéraire profond et introspectif. Flaubert y explore des thèmes tels que la passion littéraire, la quête du beau et ses réflexions sur l'art, tout en fournissant un aperçu de son quotidien. Cette période est également celle de la rédaction de son opus majeur, "Madame Bovary", rendant la correspondance d'autant plus précieuse pour comprendre son évolution artistique et ses aspirations. Gustave Flaubert, né en 1821 à Rouen, est l'une des figures emblématiques du réalisme littéraire. Son éducation rigoureuse, sa passion pour la littérature et son goût pour la réflexion critique ont nourri sa vocation d'écrivain. Son fameux souci du mot juste et sa recherche de la perfection s'illustrent dans ces lettres, où il partage ouvertement ses doutes et ses joies, témoignant d'une humanité profonde qui transcende le simple statut d'auteur. En recommandant "Correspondance", le lecteur est invité à plonger dans l'intimité de Flaubert. Ces lettres ne sont pas seulement des échanges épistolaires, mais un véritable trésor d'idées et de sentiments qui enrichissent notre compréhension du parcours artistique de l'écrivain. Ce livre offre une perspective unique sur la pensée d'un des plus grands romanciers français, invitant à une réflexion sur l'écriture et sur la vie elle-même. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction approfondie décrit les caractéristiques unifiantes, les thèmes ou les évolutions stylistiques de ces œuvres sélectionnées. - La Biographie de l'auteur met en lumière les jalons personnels et les influences littéraires qui marquent l'ensemble de son œuvre. - Une section dédiée au Contexte historique situe les œuvres dans leur époque, évoquant courants sociaux, tendances culturelles и événements clés qui ont influencé leur création. - Un court Synopsis (Sélection) offre un aperçu accessible des textes inclus, aidant le lecteur à comprendre les intrigues et les idées principales sans révéler les retournements cruciaux. - Une Analyse unifiée étudie les motifs récurrents et les marques stylistiques à travers la collection, tout en soulignant les forces propres à chaque texte. - Des questions de réflexion vous invitent à approfondir le message global de l'auteur, à établir des liens entre les différentes œuvres et à les replacer dans des contextes modernes. - Enfin, nos Citations mémorables soigneusement choisies synthétisent les lignes et points critiques, servant de repères pour les thèmes centraux de la collection.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Correspondance (1850-1854)
Table des matières
Introduction
Cette collection, intitulée Correspondance (1850-1854), rassemble cinq volumes annuels de lettres de Gustave Flaubert et propose un parcours continu à travers un moment décisif de sa vie et de son œuvre. En réunissant ces écrits, on restitue la cohérence d’une période charnière qui va de la fin du grand voyage à l’Orient au retrait studieux de Croisset. L’objectif est double : offrir un document de première main sur la fabrique d’un style et de projets littéraires en gestation, et rendre lisible, dans le temps, la manière dont l’auteur articule sa pensée de l’art, ses exigences formelles et sa relation au monde contemporain.
Les textes ici présentés relèvent du genre épistolaire. Ce sont des lettres adressées à des proches, à des amis et à des interlocuteurs du milieu littéraire, où s’entrelacent confidences personnelles, considérations esthétiques et notations de travail. Loin d’un traité, la correspondance met en scène une pensée en mouvement, circonstanciée et parfois contradictoire, dont la vérité tient à l’instant de l’échange. Elle montre comment Flaubert, hors de la fiction, met à l’épreuve ses idées sur la phrase, le rythme, la documentation et la publication, tout en rendant compte des exigences concrètes qui rythment son quotidien d’écrivain.
La composition chronologique 1850-1854 permet d’éclairer la continuité d’une trajectoire. Le volume 1850 consigne l’achèvement d’un long périple et ses retentissements intérieurs. Celui de 1851 marque le retour à Croisset et l’entrée dans un cycle de labeur intense, où s’esquisse la mise en chantier d’un roman majeur. Les volumes 1852, 1853 et 1854 suivent pas à pas l’approfondissement d’une méthode, la consolidation d’un idéal stylistique et la confrontation aux réalités matérielles de la vie littéraire. Ensemble, ils forment un récit parallèle à l’œuvre publiée, un atelier ouvert où l’écrivain se définit et se corrige.
En 1850, l’écriture des lettres prolonge l’expérience du voyage en observations concrètes, notations de paysage, portraits saisis sur le vif et retours sur soi. On y perçoit une curiosité soutenue pour les mœurs, les langues, les gestes et les lieux. La correspondance de cette année met à nu une faculté d’attention qui deviendra la matrice de la prose narrative, sans jamais quitter la singularité du témoignage personnel. S’y dessine un rapport au réel fait d’exigence et de distance, apte à transformer l’impression immédiate en matériau, et à éprouver, sur le terrain, une éthique de regard.
Le volume 1851 ouvre la séquence du retrait volontaire, du travail réglé et de la discipline. Le retour à Croisset coïncide avec la décision d’organiser la vie autour de l’écriture, de la lecture et de la réécriture. Les lettres y rapportent le rythme de l’atelier, l’importance des sources, la patience accordée à chaque phrase. À travers elles, se lit la volonté de concevoir un roman en cours, sans en dévoiler la trame, tout en fixant les principes d’une prose impersonnelle, ferme et musicale. Cette année marque l’ajustement méthodique entre idéal esthétique et contraintes quotidiennes.
En 1852, la correspondance témoigne d’une persévérance qui supporte la lenteur et l’incertitude propres au travail littéraire. Elle détaille les étapes d’élaboration, les retours en arrière, la recherche d’un équilibre syntaxique et rythmique. L’écrivain précise la valeur du document, la valeur de la lecture et la nécessité d’ordonner les matériaux avant d’écrire. Parallèlement, se profilent les échanges avec le cercle amical et la résonance des premières lectures privées. S’y fait jour une conscience aiguë du temps de l’art, distinct du temps social, qui installe l’auteur dans une forme d’ascèse réfléchie.
Le volume 1853 prolonge cette montée en exigence et met en relief la tension entre solitude du travail et injonctions du monde. La lettre devient l’espace où l’auteur mesure la distance entre Croisset et la capitale, entre retraite et circulation des idées. Elle consigne les hésitations, les reprises, la fatigue parfois, mais aussi la joie d’une page tenue, d’une période équilibrée. Les préoccupations matérielles, indissociables de la pratique, y trouvent place, sans jamais supplanter l’ambition artistique. Se dégage alors une dramaturgie du labeur, dont chaque envoi postal constitue un acte et un jalon.
En 1854, la correspondance atteint une maturité qui conjugue confiance et scrupule. Flaubert y formule avec netteté le pacte qu’il passe avec sa prose : précision lexicale, exactitude des images, justesse des transitions. La lettre sert d’essai, de banc d’épreuve et de manifeste implicite. Elle enregistre les effets d’une documentation accrue, la nécessité d’un regard froid sur les sentiments, et l’attention portée à la composition d’ensemble. Un horizon d’œuvre se dessine, sans divulguer de scénarios, mais en asseyant des principes dont la portée rejaillira sur l’ensemble de la production future.
Au fil de ces cinq années, des thèmes unificateurs émergent. L’opposition entre le tumulte du monde et l’atelier silencieux organise la vie de l’écrivain. La correspondance examine la relation entre vérité des faits et vérité de la forme, l’autorité du style et la fidélité au réel. Elle fait affleurer une éthique du travail qui refuse le relâchement, préfère la lenteur féconde, et soumet chaque page à un contrôle serré. Des motifs reviennent, tels que la solitude, l’amitié, le voyage, la lecture comme discipline, autant d’axes qui donnent à cette collection une continuité intérieure remarquable.
Ces lettres révèlent aussi une poétique. Le phrasé s’y construit avec une attention quasi musicale, les images sont pesées, les notations concrètes prennent valeur d’exemples. La prose épistolaire, parfois familière, peut se tendre, devenir objective, ironique ou méditative. Se dessine une pratique de la langue où l’ellipse côtoie l’amplification, où la phrase se refuse à l’à-peu-près. En montrant la fabrique du style au quotidien, la correspondance offre le contrechamp de l’œuvre publiée et aide à comprendre comment s’organisent les rapports entre observation, documentation, invention et découpe narrative.
La valeur de cette Correspondance (1850-1854) est également historique et culturelle. Elle documente les conditions matérielles de l’écrivain au milieu du XIXe siècle, les rythmes de la poste, les temporalités de la lecture et de l’écriture, le dialogue avec le milieu littéraire. Elle met en relation les scènes de la vie ordinaire et la pratique d’un art qui s’enseigne à lui-même ses propres lois. Elle éclaire la position de Flaubert dans son époque, sans chercher l’anecdote, mais en montrant la cohérence d’une exigence qui se veut indépendante des modes et des circonstances.
La portée de ces volumes tient enfin à leur contribution à l’intelligence de l’œuvre entière de Flaubert. On y perçoit la genèse et la maturation d’un roman en cours d’écriture, sans divulguer ses péripéties, et l’élaboration d’un style appelé à marquer durablement la prose française. La correspondance n’est pas un supplément, mais une part organique d’un corpus où se répondent l’art poétique, la pratique et la vie. Elle offre au lecteur contemporain une boussole pour lire les livres, en plaçant l’exigence de forme au centre de l’expérience littéraire, là où l’auteur l’a toujours voulue.
Biographie de l’auteur
Gustave Flaubert (1821–1880) est une figure majeure du roman français du XIXe siècle, souvent associé au réalisme, bien qu’il ait refusé les étiquettes. Son exigence formelle, son idéal d’impersonnalité et la quête du mot juste ont profondément marqué la prose moderne. Sa Correspondance offre un accès direct à l’atelier de l’écrivain. Les volumes 1850 à 1854, rassemblés dans cette collection, couvrent des années charnières où s’achèvent les voyages, s’amorce la rédaction de Madame Bovary et se fixe une méthode de travail d’une rigueur exceptionnelle. On y suit la formation d’une esthétique qui influencera durablement la littérature européenne.
Formé d’abord au droit à Paris, Flaubert abandonne cette voie à la suite d’une maladie et se consacre entièrement à l’écriture, se retirant à Croisset, près de Rouen. Il fréquente des amis écrivains comme Louis Bouilhet et Maxime Du Camp, dont l’échange intellectuel nourrit ses ambitions littéraires. Sa culture classique, son intérêt pour l’histoire et une sensibilité héritée du romantisme le conduisent à rechercher une prose impersonnelle, sculptée et musicale. Dans les lettres de ces années, il expose des principes de composition, insiste sur la patience, la documentation et la distance narrative, et pose les bases d’une poétique de la précision.
Le voyage en Orient (1849–1851), entrepris avec Maxime Du Camp, marque une étape décisive. Les lettres de 1850 consignent observations, paysages et mœurs, avec une attention soutenue au détail concret et aux rythmes de la vie quotidienne. Cette expérience élargit son horizon esthétique et affine son sens du pittoresque sans sacrifier la rigueur descriptive. Elle nourrit sa réflexion sur la relation entre document, imaginaire et style. On perçoit, à travers cette Correspondance, comment le regard de l’écrivain se forme sur le terrain: la vision doit être exacte, mais transfigurée par le travail de la phrase, dans une tension constante entre réalité et forme.
De retour en France, Flaubert s’attelle, à partir de 1851, à Madame Bovary. Les lettres de 1851 à 1854 montrent l’installation d’une discipline stricte: journées de travail réglées, relectures à haute voix, refus de l’improvisation. L’échange épistolaire, notamment avec Louise Colet, sert de laboratoire critique où il précise l’impersonnalité du narrateur, l’importance du rythme et la nécessité d’un vocabulaire exact. À Croisset, il se coupe du tumulte pour se consacrer à la phrase. La Correspondance révèle autant l’élan que la résistance: l’enthousiasme initial se heurte à la lenteur acceptée comme condition d’une exactitude supérieure.
Cette maturation débouche sur la publication de Madame Bovary en feuilleton, puis en volume, et sur le procès de 1857 pour atteinte aux mœurs, qui s’achève par l’acquittement. La reconnaissance publique s’accroît, mais Flaubert maintient sa priorité: la forme avant tout. Les lettres antérieures de 1852 à 1854 laissaient déjà prévoir ce cap, en reliant l’éthique du travail d’écriture à la responsabilité esthétique. Elles témoignent de sa vigilance à l’égard des facilités narratives et de son exigence envers les descriptions, la progression des scènes et la cohérence stylistique, marquant une étape décisive dans la constitution d’un art romanesque fondé sur la précision et la tenue.
Après ce premier succès, Flaubert poursuit une œuvre de grande diversité: Salammbô, L’Éducation sentimentale, la version définitive de La Tentation de saint Antoine, puis Trois contes et l’entreprise de Bouvard et Pécuchet. Sans détailler ces textes, on peut souligner la continuité d’une même poétique: documentation serrée, montage rigoureux, distance du narrateur. La Correspondance, dont les volumes 1850–1854 montrent la genèse, demeure le fil rouge de ses positions esthétiques et de ses méthodes. On y voit l’écrivain définir la finalité du style, mesurer la difficulté de chaque page et affirmer l’indépendance de l’art face aux pressions du goût ou de l’actualité.
Flaubert meurt en 1880, laissant une œuvre qui a profondément influencé les romanciers naturalistes et au-delà. Sa défense de l’impersonnalité, sa recherche d’une prose exacte et musicale, et son sens du montage scénique ont façonné la modernité narrative. Aujourd’hui encore, ses livres et ses lettres servent de référence aux écrivains et aux lecteurs soucieux de forme. Les volumes de Correspondance 1850–1854, en éclairant ses méthodes durant des années clés, constituent un observatoire privilégié: on y comprend la patience, la rigueur et l’ambition esthétique qui ont fait de Flaubert une conscience majeure du roman.
Contexte historique
La collection Correspondance (1850-1854) couvre une période charnière de la vie et de l’esthétique de Gustave Flaubert, entre la fin de son grand voyage en Orient, l’installation méthodique à Croisset et la genèse de Madame Bovary. Ces années voient la France passer de la Seconde République au Second Empire, avec des transformations politiques, sociales et techniques rapides. Les lettres montrent un écrivain qui consolide sa doctrine du style et son exigence d’impersonnalité, tout en observant la montée d’une bourgeoisie provinciale façonnée par l’industrialisation. Elles documentent aussi les mutations du champ littéraire, du roman en feuilleton au réalisme naissant, et l’intensité de ses échanges avec proches et correspondants.
En 1850, Flaubert se trouve encore en voyage avec Maxime Du Camp, parcourant l’Égypte, la Nubie, la Palestine et la Syrie. Le contexte de ces lettres est celui d’une exploration savante et sensible, nourrie par l’archéologie et les antiquités, mais aussi par la modernité technique qui gagne le Proche-Orient. Du Camp pratique la photographie, et publiera en 1852 un album pionnier illustrant le voyage. Flaubert décrit sites et populations avec une attention documentaire qui annonce son exigence future de précision. Ces échanges témoignent d’un dialogue entre héritage antique, répertoires orientalistes en vogue et observation directe, sans rompre avec les débats européens sur l’Orient.
Les lettres orientales s’inscrivent dans un contexte politique dense: l’Égypte postérieure à Méhémet Ali poursuit, de façon parfois discontinue, des réformes administratives et techniques; l’Empire ottoman négocie les influences européennes. Les consuls et savants français, ainsi que des équipes de fouilles, forment un milieu où circulent savoirs et images. Des découvertes comme celles d’Auguste Mariette au Sérapéum de Saqqarah au début des années 1850 alimentent l’intérêt pour l’Antiquité. Flaubert, de passage dans ces espaces, confronte les stéréotypes du pittoresque aux réalités des lieux, et ses missives reflètent la tension entre curiosité érudite, modernisation inégale et enjeux géopolitiques naissants.
Le retour en France, vers 1851, ramène Flaubert à Croisset, près de Rouen, dans la maison familiale au bord de la Seine. Ses lettres dessinent l’organisation d’un atelier d’écriture fondé sur la régularité, l’isolement relatif et la relecture incessante. Il vit auprès de sa mère et reste attentif au cercle amical de Rouen et de Paris, tout en gardant une distance avec le monde mondain. Croisset devient un topos épistolaire: lieu d’ascèse, de documentation et d’épreuves formelles, où la prose se forge au rythme d’un travail quotidien, précisément daté et décrit, qui replace la création dans la durée et la contrainte méthodique.
Au début des années 1850, le débat esthétique oppose encore les héritiers du romantisme à des partisans d’un art plus objectif. Flaubert, en dialogue épistolaire avec Louise Colet et Louis Bouilhet, y affirme une poétique de l’impersonnalité, la recherche du mot juste et le refus de l’éloquence facile. Le réalisme pictural de Courbet, remarqué au Salon de 1850-1851, et les prises de position critiques qui suivront annoncent un climat favorable à l’observation des mœurs. Sans publier encore de roman, Flaubert fixe, dans ses lettres, des principes exigeants: exactitude, neutralité apparente de la voix narrative, précision des registres techniques et sociaux.
Le cadre politique immédiat est celui de la Seconde République, fragilisée par les crises de 1848-1849. La loi du 31 mai 1850 restreint le suffrage universel masculin et accentue les clivages. Flaubert, sans être militant, exprime souvent dans sa correspondance une méfiance envers les facilités rhétoriques de la politique et de la presse. Le ton satirique envers les opinions à la mode renseigne sur un désenchantement partagé par une partie des élites lettrées. À l’arrière-plan, l’auteur observe le rapport entre agitation publique et conformisme social, un matériau qu’il transformera en étude scrupuleuse des discours et des comportements.
Le coup d’État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, puis la proclamation de l’Empire en 1852, installent un régime autoritaire. Les lois de 1852 encadrent plus strictement la presse et la vie publique; de nombreuses figures d’opposition s’exilent, dont Victor Hugo. Pour les écrivains, le contexte favorise le repli sur des formes moins explicitement politiques, ou l’usage de cadres fictionnels précis. Dans ses lettres, Flaubert revendique l’autonomie de l’art face aux mots d’ordre. Le durcissement du contrôle des imprimés et de la morale publique préfigure les scrutins et les procès littéraires de la décennie, dont ses échanges mesurent indirectement la pression.
La loi Falloux de 1850 élargit la place de l’Église dans l’enseignement secondaire, reconfigurant le débat sur l’instruction, la morale et l’autorité. Dans la France des petites villes et des campagnes, l’encadrement religieux et les sociabilités paroissiales restent forts. Les lettres de Flaubert évoquent des notables, des institutions locales, des rituels et des fêtes, cernant un milieu où convictions religieuses, ambitions bourgeoises et aspirations individuelles coexistent. Sans polémique ouvertement doctrinale, l’écrivain observe ces cadres normatifs, utiles à sa peinture des mœurs provinciales, et se documente pour restituer avec exactitude la langue et les usages des différents milieux.
L’industrialisation et les réseaux bouleversent la Normandie de Flaubert. Le chemin de fer relie Paris à Rouen et au Havre depuis les années 1840, facilitant déplacements et échanges; la Seine, animée par la navigation à vapeur, dynamise le port de Rouen. Le télégraphe électrique relie progressivement les grandes villes au début des années 1850. Les lettres montrent la logistique concrète des voyages entre Croisset et Paris, la gestion du temps, et l’empreinte des technologies sur la vie quotidienne. Cette mobilité accrue nourrit l’attention de Flaubert aux vitesses nouvelles, aux circulations de nouvelles et d’objets, et à l’uniformisation lente des pratiques urbaines et provinciales.
L’arrière-plan scientifique et médical compte pour beaucoup. Fils d’un chirurgien de l’Hôtel-Dieu de Rouen, Flaubert lit des traités, manuels et dictionnaires spécialisés afin de garantir l’exactitude terminologique. Les années 1850 voient la consolidation professionnelle des médecins de province, l’essor de la presse médicale, la standardisation des pharmacopées. Dans ses lettres, l’écrivain mentionne recherches et vérifications auprès de praticiens et de bibliothèques. Cette attention technique n’a rien d’anecdotique: elle sert un projet d’écriture qui refuse le vague et entend inscrire les gestes, les objets et les procédures dans leur cadre réaliste, tel qu’il est attesté par les sources.
Le paysage éditorial se transforme avec la montée de la presse à bon marché, issue des innovations des années 1830-1840 (abonnement, publicité) et devenue décisive sous le Second Empire. Les feuilletons popularisent le roman; les revues littéraires stabilisent des publics nationaux. Flaubert, hostile à la hâte journalistique, privilégie la lenteur de la composition; mais ses lettres révèlent une connaissance précise des circuits de publication, des contraintes de la censure et des attentes morales des périodiques. La perspective d’une parution en revue, qui se concrétisera plus tard, est déjà envisagée dans un contexte où réputation, prudence et exactitude sont indissociables.
Les transformations économiques accélèrent l’ascension des classes moyennes. La création du Crédit Mobilier en 1852 symbolise l’expansion du crédit et des entreprises de travaux publics; les réseaux ferroviaires s’étendent; les commerces modernisent leurs méthodes. Ces mutations reconfigurent les imaginaires de réussite et de confort, jusque dans les bourgs normands. Flaubert observe, dans ses lettres, le langage des notables, des commerçants et des professions libérales, matériaux d’une future ethnographie des désirs et des frustrations. Sans donner dans le pamphlet, il traque les lieux communs, les rêveries d’ascension sociale et les illusions entretenues par la publicité et la nouveauté technique.
À partir de 1853, Paris change d’échelle avec la nomination du préfet Haussmann et le lancement des grands travaux. Même si Flaubert réside surtout à Croisset, ses séjours parisiens l’exposent à une capitale en recomposition: nouvelles percées, chantiers, spéculations. Les lettres confrontent ce tumulte à la lenteur provinciale, contraste structurant de son imaginaire réaliste. Le clivage capitale/province, déjà vif sous la Monarchie de Juillet, devient un fait social total des années 1850. Il nourrit l’examen des postures, des accents et des attentes, et impose à l’écrivain une cartographie précise des milieux, indispensable à l’économie de son œuvre en cours.
Les années 1853-1854 sont aussi marquées par la guerre de Crimée, à laquelle la France participe aux côtés du Royaume-Uni et de l’Empire ottoman contre la Russie. Mobilisations, nouvelles militaires et élans patriotiques occupent la presse. Dans le même temps, une nouvelle vague de choléra frappe la France en 1854, rappelant la vulnérabilité sanitaire des villes et campagnes. Les lettres de Flaubert signalent l’omniprésence de ces événements dans le quotidien des correspondants. Cet arrière-plan de guerre et d’épidémie intensifie, par contraste, son parti de retranchement esthétique: travailler, vérifier, écrire juste, loin du vacarme et des simplifications.
La sociabilité littéraire structure fortement ces années. Louis Bouilhet, poète et ami, agit en conseiller critique, lisant et commentant. Maxime Du Camp, passé au journalisme et aux voyages, relie Flaubert aux circuits éditoriaux. Louise Colet, poétesse plusieurs fois couronnée par l’Académie française dans les années 1840-1850, entretient avec lui un échange intense où se débattent morale, ambition et technique. Ces correspondances croisées documentent le fonctionnement des revues, des salons et des jurys, ainsi que les conditions matérielles de l’écriture. Elles éclairent comment l’exigence artistique de Flaubert se confronte aux temporalités et aux codes du champ littéraire.
Entre 1851 et 1854, Flaubert s’attelle à Madame Bovary, entreprise de longue haleine. Les lettres détaillent lenteurs, reprises, enquêtes et vérifications: topographie normande, professions, pratiques commerciales, cadres juridiques du mariage et de la dette, terminologie médicale. Il fréquente bibliothèques et témoins, et lit le Code civil et des manuels professionnels pour garantir l’exactitude des procédures. Sa méthode, qui inclut la lecture à voix haute pour éprouver la cadence des phrases, vise une prose sans scories. Cet effort s’inscrit dans un climat où la précision factuelle est aussi un bouclier contre la censure morale et le procès d’invraisemblance.
Sur le plan intellectuel, les années 1851-1854 voient se diffuser un positivisme ambitieux, nourri, entre autres, par les publications d’Auguste Comte. Le lexique de l’observation, des faits et des lois sociales imprègne les milieux lettrés. Sans se rallier à un système, Flaubert adopte une rigueur d’enquête qui, dans ses lettres, prend la forme d’un scrupule constant: ne rien avancer sans document, ne rien décrire sans source. Cette éthique de la vérification dialogue avec le réalisme pictural contemporain et avec les enquêtes sociales de la presse, mais s’en distingue par l’aspiration à l’impersonnalité et à l’autonomie du style littéraire, dégagé des démonstrations explicites.
Synopsis (Sélection)
CORRESPONDANCE DE GUSTAVE FLAUBERT
Réunissant cinq années d’échanges, ces lettres dessinent le laboratoire d’un écrivain obsédé par la justesse de la phrase et par la cohérence de l’œuvre. On y suit un regard ironique et lucide sur la société, équilibré par une fidélité aux amitiés et par une éthique du travail implacable. De 1850 à 1854, se confirme une esthétique de la précision et de la distance, avec un ton allant de la verve satirique à une gravité méditative.
1850
Ces lettres posent les fondations d’une exigence stylistique qui deviendra centrale: refus du lieu commun, quête du mot exact et discipline de l’écriture. L’observation attentive des êtres et des milieux nourrit une réflexion sur la solitude nécessaire au travail. Le ton alterne entre enthousiasme combatif et scepticisme, révélant un tempérament partagé entre retrait et curiosité.
1851
La correspondance insiste sur la méthode et la patience, détaillant le rapport entre plan, rythme et vérité du détail. Elle expose la tension constante entre l’idéal d’art et les contingences de la vie, avec une ironie qui protège d’un pathos facile. Le style s’affûte, plus objectif et plus nerveux, au service d’une prose sans complaisance.
1852
On voit s’intensifier l’intransigeance esthétique, avec une critique des facilités et une attention presque musicale aux cadences de la phrase. Les lettres deviennent un atelier théorique où s’articulent impassibilité, précision et refus de l’emphase. Le ton est plus tranchant, mais traversé d’une mélancolie lucide sur la peine et la durée de l’effort.
1853
La réflexion s’élargit vers une satire plus amère des illusions collectives, compensée par un humour sec et une autodérision maîtrisée. La méthode de travail se radicalise: réécriture, patience, exactitude et souci prosodique. Le climat moral est celui d’un désenchantement actif, où la rigueur sert de réponse éthique.
1854
Ces lettres donnent un sentiment d’aboutissement provisoire: l’art y est défini comme endurance, justesse et effacement des facilités expressives. Les échanges mêlent froideur analytique et chaleur des fidélités, en cherchant la tenue plutôt que l’éclat. Elles cristallisent des thèmes récurrents — distance, précision, ironie — qui stabilisent désormais la voix.
Correspondance (1850-1854)
DEUXIÈME SÉRIE
(1850-1854)
PARIS
G. CHARPENTIER ET Cie, ÉDITEURS
11, RUE D E GRENELLE, 11
1889
CORRESPONDANCEDEGUSTAVE FLAUBERT
1850
A Parain.
De la Quarantaine de Rhodes. Dimanche6octobre1850.
Vous avez bien tort, mon vieux solide, de ne pas[1q] m’écrire plus souvent, car je vous assure que vos lettres sont pour moi de vraies parties de plaisir. La dernière m’a fait bien rire, et ce que vous me dites de toutes vos connaissances ne m’a pas médiocrement amusé. Il y aurait là-dessus de quoi causer longuement[2q] au coin du feu, le nez sous le manteau de la cheminée et les pieds dans nos pantoufles. C’est ce que je me promets bien de faire à mon retour. Quelle bosse de soufflet nous nous donnerons! Il faudra lui faire ajouter un ressort.
Il parait que le jeune Bouilhet se livre un peu à l’immoralité en mon absence. Vous le voyez trop souvent. C’est vous qui démoralisez ce jeune homme. Si j’étais sa mère, je lui interdirais votre société. Il n’y a rien de pire pour la jeunesse que la fréquentation des vieillards débauchés. Néanmoins, continuez, mes bons vieux, à boire le petit verre à ma santé quand vous vous trouvez ensemble. Pochardez-vous même en mon honneur. Je vous excuse d’avance. Quant à l’Hôtel-Dieu, ça ne va pas fort, dit-on, avec le nouveau ménage. Il n’y a là-dedans rien qui m’étonne. Quel bonheur ce sera pour moi de voir de mes yeux ce jeune homme établi et père de famille! La maison ne périra donc pas, il y aura un rejeton qui fleurira dans le comptoir. Les laines s’en réjouiront et les registres auront un maître. Avez-vous réfléchi quelquefois, cher vieux compagnon, à toute la sérénité des imbéciles? La bêtise est quelque chose d’inébranlable, rien ne l’attaque sans se briser contre elle[4q]. Elle est de la nature du granit, dure et résistante. A Alexandrie, un certain Thompson, de Sunderland, a, sur la colonne de Pompée, écrit son nom en[3q] lettres de six pieds de haut. Cela se lit à un quart de lieue de distance. Il n’y a pas moyen de voir la colonne sans voir le nom de Thompson, et par conséquent sans penser à Thompson. Ce crétin s’est incorporé au monument et le perpétue avec lui. Que dis-je? Il l’écrase par la splendeur de ses lettres gigantesques. N’est-ce pas très fort de forcer les voyageurs futurs à penser à soi et à se souvenir de vous? Tous les imbéciles sont plus ou moins des Thompson de Sunderland. Combien dans la vie n’en rencontre-t-on pas à ses plus belles places et sur ses angles les plus purs? Et puis c’est qu’ils nous enfoncent toujours; ils sont si nombreux, ils sont si heureux, ils reviennent si souvent, ils ont si bonne santé! En voyage on en rencontre beaucoup, et déjà nous en avons dans notre souvenir une jolie collection, mais comme ils passent vite, ils amusent. Ce n’est pas comme dans la vie ordinaire où ils finissent par vous rendre féroce.
Nous sommes venus ici de Beyrouth sur le bateau à vapeur autrichien avec Hartim-Bey, ex-premier ministre d’Abbas-Pacha[18q]. C’est une de nos anciennes connaissances d’Égypte que nous avons renouée dimanche dernier, au dîner du Consul général. Il a fui à temps d’Alexandrie; on venait pour l’empoigner de force de la part du Pacha, qui probablement allait lui faire prendre quelque funeste tasse de café. Il s’est réfugié à bord du paquebot français pour Beyrouth, et de Beyrouth il gagne Constantinople, où il va aller dénoncer son maître et tâcher de le faire sauter, ce qui est possible. Pendant trois jours passés ensemble à bord, nous avons beaucoup causé, ou plutôt il nous a beaucoup parlé, nous flairant gens de plume, et que par la suite nous pourrions lui être utiles, et puis peut-être aussi parce que nous sommes des particuliers très aimables. Rien n’est plus respecté en Orient que l’homme maniant la plume[5q]. Effendi (homme qui sait lire) est un titre d’honneur. Maxime en ce moment rédige sur cette affaire un bout de note pour Paris; c’est une nouvelle politique assez grave. Quant à moi, je deviens paresseux comme un curé[6q]. Je ne suis bon qu’à cheval ou en bateau. Tout travail maintenant m’assomme, je deviens là-dessus très oriental; il faut espérer que je changerai au retour[20q]. A propos de curé, puisque ce mot m’est venu au bec[7q] (de ma plume), j’en ai diablement vu en Syrie et en Palestine. Nous avons vu des capucins, des carmélites, etc. Nous avons étudié de près cette fameuse question des Druses et des Maronites dont on a fait tant de bruit en France, et qui est bien une des plus belles blagues du monde.
Nous avions le cœur gros quand nous sommes partis de Beyrouth. Nous avons vécu là d’une belle vie de vagabond pendant deux mois.
Il faut vous dire que nous ne portons plus de chaussettes dans nos bottes. Nous avons reconnu que c’était une économie de blanchissage et que ça nous faisait plus frais aux pieds. La saison pourtant se refroidit. Nous couchons encore à la belle étoile, mais avec des vêtements de drap. Depuis le mois de janvier dernier, nous n’avons pas reçu une goutte de pluie, mais nous allons en avoir à Constantinople.
Je vous ai bien regretté il y a aujourd’hui quinze jours, c’était à Eiden, au beau milieu du Liban, à trois heures des cèdres. Nous avons dîné chez le sheik du pays. Pour aller dans la salle où nous avons été reçus, nous avons traversé une foule (le mot est littéral) de quarante à cinquante domestiques. Aussitôt que nous avons été assis sur les divans, on nous a parfumés avec de l’encens, après quoi on nous a aspergés avec de l’eau de fleur d’oranger. Un domestique suivait, portant une longue serviette à franges pour vous essuyer les mains. Le maître de la maison, jeune homme de24ans environ, portait sur les épaules un manteau brodé d’or, et tout autour de la tête un turban de soie rouge à petites étoiles d’or serrées les unes près des autres. Il y avait bien une trentaine de plats à table, pour quatre personnes que nous étions. Afin de faire honneur à tant d’honneurs, j’ai mangé de telle sorte que si je n’ai pas eu d’indigestion le soir, c’est que j’ai un rude estomac. C’est du reste une grande impolitesse à ces gens-là que de refuser. A Kosseir, sur les bords de la mer Rouge, dans une circonstance semblable, Maxime a manqué crever d’indigestion.
Adieu, mon bon vieux père Parain, ne faites pas trop de polissonneries avec Bouilhet. Écrivez-moi souvent, et recevez de ma part la meilleure embrassade que jamais neveu ait donnée à son oncle, ou ami à son ami. A vous du fond du cœur.
A sa mère.
Constantinople, 14novembre1850.
Il y a beaucoup de choses du monde que, dans ta candeur, tu ignores, pauvre vieille. Moi qui deviens un très grand moraliste et qui, d’ailleurs, me suis toujours plongé à corps perdu dans ce genre d’études, j’ai soulevé pas mal de coins de rideau qui cachaient des turpitudes sans nombre. On apprend aux femmes à mentir d’une façon infâme. L’apprentissage dure toute leur vie depuis la première femme de chambre qu’on leur donne jusqu’au dernier amant qui leur survient, chacun s’ingère à les rendre canailles et après on crie contre elles: le puritanisme, la bégueulerie, la bigotterie, le système du renfermé, de l’étroit, a dénaturé et perd dans sa fleur les plus charmantes créations du bon Dieu. J’ai peur du corset moral, voilà tout[8q]. Les premières impressions ne s’effacent pas, tu le sais. Nous portons en nous notre passé; pendant toute notre vie, nous nous sentons de la nourrice. Quand je m’analyse, je trouve en moi encore fraîche et avec toutes leurs influences (modifiées il est vrai par les combinaisons de leur rencontre) la place du père Langlois, celle du père Mignot, celle de don Quichotte et de mes songeries d’enfant dans le jardin à côté de la fenêtre de l’amphithéâtre. Je me résume: prends quelqu’un pour lui apprendre l’anglais et les premiers éléments généraux. Mêle-toi de tout cela le plus que tu pourras toi-même, et surveille le caractère et le bon sens (je donne au mot l’acception la plus large) de la personne.
Je te parlais tout à l’heure d’observation morale, je n’aurais jamais soupçonné combien ce côté est abondant en voyage. On s’y frotte à tant d’hommes différents que véritablement on finit par connaître un peu le monde (à force de le parcourir). La terre est couverte de balles splendides[9q]. Le voyage a des mines de comique immenses et inexploitées[10q]. Je ne sais pourquoi personne jusqu’à présent n’a fait cette remarque qui me paraît bien naturelle. Et puis, c’est qu’on se déboutonne si vite, on vous fait des confidences si étranges! Un homme voyage depuis un an et ne trouve personne à qui parler; il vous rencontre un soir dans un hôtel ou sous une tente; on parle d’abord politique, puis on cause de Paris, puis le bouchon sort tout doucement, le vin s’épanche et en deux heures voilà qu’on vide le reste jusqu’au fond ou à peu près. Le lendemain, on se sépare, et l’on ne reverra jamais son ami intime de la veille au soir; il y a même à cela souvent des mélancolies singulières. Nous avons visité le vieux sérail et les mosquées. Le sérail ne signifie pas grand’chose. Ce sont d’admirables appartements dans le plus beau point de vue du monde peut-être, mais ornés et meublés dans un goût déplorable. Toutes les vieilles rocamboles d’Europe dont on ne veut plus on les repasse aux Turcs qui donnent là-dedans avec la naïveté du barbare. A part la salle du Trône, merveilleuse c’est le mot, tout le reste est de la petite musique.
J’ai vu les derviches hurleurs. J’y étais très préparé par tout ce que j’avais déjà vu au Caire, aussi n’en ai-je été nullement étonné. Jeudi prochain nous y retournerons. Il se passera des choses gentilles, on se passera dans le corps un tas d’instruments de supplice que nous avons vus accrochés aux murs. Mais je trouve que l’on ne vante pas assez les tourneurs. Rien n’est plus gracieux que de voir valser tous ces hommes avec leurs grands jupons plissés et leur figure extatique levée au ciel. Ils tournent sans s’arrêter pendant une heure environ. Un d’eux nous a affirmé que, s’il ne fallait pas tenir ses bras au-dessus de sa tête, il est capable de tourner pendant six heures de suite. Celui-là nous fait de temps à autre des visites. Nous lui donnons une bouteille d’eau-de-vie qu’il boit très bien en sa qualité de musulman.
A Louis Bouilhet.
Constantinople, 14novembre1850.
Si je pouvais t’écrire tout ce que je réfléchis à propos de mon voyage, c’est-à-dire que si je retrouvais quand je prends la plume les choses qui me passent dans la tête et qui me font dire, à part moi, je lui écrirai ça, tu aurais vraiment peut-être des lettres amusantes. Mais, cela s’en va aussitôt que j’ouvre mon carton. N’importe, au hasard de la fourchette, comme ça viendra.
D’abord de Constantinople, où je suis arrivé hier matin, je ne te dirai rien aujourd’hui, à savoir seulement que j’ai été frappé de cette idée de Fourier: qu’elle serait plus tard la capitale de la terre. C’est réellement énorme comme humanité. Ce sentiment d’écrasement que tu as éprouvé à ton entrée à Paris, c’est ici qu’il vous pénètre en coudoyant tant d’hommes inconnus depuis le Persan et l’Indien jusqu’à l’Américain et l’Anglais, tant d’individualités séparées dont l’addition formidable aplatit la vôtre. Et puis, c’est immense. On est perdu dans les rues, on ne voit ni le commencement ni la fin. Les cimetières sont des forêts au milieu de la ville. Du haut de la tour de Galata, on voit toutes les maisons et toutes les mosquées (à côté et parmi le Bosphore et la Corne-d’Or pleins de vaisseaux), les maisons peuvent être comparées aussi à des navires; ce qui fait une flotte immobilé dont les minarets seraient les mâts des vaisseaux de haut bord (phrase un peu entortillée, passons).
J’aurai demain ton nom Loue Bouilhette (prononciation turque) écrit sur papier bleu en lettres d’or. C’est un cadeau que je destine à orner ta chambre. Cela te rappellera, quand tu le regarderas tout seul, que je t’ai beaucoup mêlé à mon voyage. En sortant de chez les «malins»(écrivains) où nous avions discuté le papier, l’ornementation. et le prix de ladite pancarte, nous avons été donner à manger aux pigeons de la mosquée de Bajazet. Ils vivent dans la cour de la mosquée, par centaines. C’est une œuvre pie que de leur jeter du grain. Quand on arrive, ils s’abattent sur les dalles de tous les côtés de la mosquée, des corniches, des toits, des chapiteaux des colonnes. Le port a aussi ses oiseaux familiers. Au milieu des navires et des caïques on voit les cormorans voler ou qui se reposent sur les flots. Sur les toits des maisons il y a des nids de cigognes, abandonnés l’hiver. Dans les cimetières les chèvres et les ânes broutent tranquillement, et la nuit les femmes turques y donnent des rendez-vous aux soldats.
Le cimetière est une des belles choses de l’Orient[19q]. Il n’a pas ce caractère profondément agaçant que je trouve chez nous à ce genre d’établissement; point de mur, point de fossé, point de séparation ni de clôture quelconque. Ça se trouve à propos de rien dans la campagne ou dans une ville, tout à coup et partout, comme la mort elle-même, à côté de la vie et sans qu’on y prenne garde. On traverse un cimetière comme on traverse un bazar. Toutes les tombes sont pareilles, elles ne diffèrent que par l’ancienneté. Seulement à mesure qu’elles vieillissent, elles s’enfouissent et disparaissent, comme fait le souvenir qu’on a des morts. Les cyprès plantés en ces lieux sont gigantesques. Ça donne au site un jour vert plein de tranquillité. A propos de sites c’est à Constantinople véritablement que l’on peut dire: Un site! ah! quel tableau!
Où en es-tu avec la muse? je m’attendais ici à trouver une lettre de toi et quelque chose en vers y inclus. Que devient la Chine? que lis-tu? Comme j’ai envie de te voir!
Quant à moi, littérairement parlant, je ne sais où j’en suis. Je me sens quelquefois anéanti (le mot est faible), d’autres fois le style «limbique»(à l’état de limbe et de fluide impondérable) passe et circule en moi avec des chaleurs enivrantes[12q]. Puis ça retombe. Je médite très peu, je rêvasse occasionnellement[11q]. Mon genre d’observation est surtout moral. Je n’aurais jamais soupçonné ce côté au voyage. Le côté psychologique, humain, comique y est abondant. On rencontre des balles splendides, des existences gorge-pigeon très chatoyantes à l’œil, fort variées comme loques et broderies, riches de saletés, de déchirures et de galons. Et au fond toujours cette vieille canaillerie immuable et inébranlable. C’est là la base. Ah! comme il vous en passe sous les yeux!
De temps à autre dans les villes j’ouvre un journal. Il me semble que nous allons rondement. Nous dansons non pas sur un volcan, mais sur la planche d’une latrine qui m’a l’air passablement pourrie. L’idée d’étudier la question me préoccupe. A mon retour j’ai envie de m’enfoncer dans les socialistes et de faire sous la forme théâtrale quelque chose de très brutal, de très farce, et d’impartial bien entendu. J’ai le mot sur le bout de ma langue et la couleur au bout des doigts. Beaucoup de sujets plus nets comme plan n’ont pas tant d’empressement à venir que celui-là.
A propos de sujets j’en ai trois qui ne sont peut-être que le même et ça m’embête considérablement. 1o Une nuit de Don Juan à laquelle j’ai pensé au lazaret de Rhodes. 2o L’histoire d’Anubis, la femme qui veut se faire aimer par le Dieu. C’est la plus haute, mais elle a des difficultés atroces. 3o Mon roman flamand de la jeune fille qui meurt vierge et mystique entre son père et sa mère, dans une petite ville de province, au fond d’un jardin planté de choux et de quenouilles, au bord d’une rivière grande comme l’eau de Robec. Ce qui me turlupine c’est la parenté d’idées entre ces trois plans: Dans le premier, l’amour inassouvissable sous les deux formes de l’amour terrestre et de l’amour mystique. Dans le second, même histoire, mais on se donne et l’amour terrestre est moins élevé en ce qu’il est plus précis. Dans le troisième ils sont réunis dans la même personne, et l’un mène à l’autre, seulement mon héroïne crève d’exaltation religieuse après avoir connu l’exaltation des sens. Hélas! il me semble que lorsqu’on dissèque si bien les enfants à naître on n’est pas assez monté pour les créer. Ma netteté métaphysique me donne des terreurs. Il faut pourtant que j’en revienne. J’ai besoin de me donner ma mesure à moi-même. Je veux pour vivre tranquille avoir mon opinion sur mon compte, opinion arrêtée et qui me réglera dans l’emploi de mes forces. Il me faut connaître la qualité de mon terrain et ses limites avant de me mettre au labourage. J’éprouve, par rapport à mon état littéraire intérieur, ce que tout le monde, à notre âge, éprouve un peu par rapport à la vie sociale: «Je sens le besoin de m’établir.»
A Smyrne, par un temps de pluie qui nous empêchait de sortir, j’ai pris au cabinet de lecture «Arthur» d’Eugène Sue. Il y a de quoi en vomir, ça n’a pas de nom. Il faut lire ça pour prendre en pitié l’argent, le succès et le public. La littérature a mal à la poitrine. Elle crache, elle bavache, elle a des vésicatoires qu’elle couvre de taffetas pommadés, et elle s’est tant brossé la tête qu’elle en a perdu tous ses cheveux. Il faudrait des Christs de l’Art pour guérir ce lépreux.
En revenir à l’antique, c’est déjà fait, au moyen âge, c’est déjà fait. Reste le présent. Mais la base tremble, où donc appuyer les fondements? La vitalité et partant la durée est à ce prix pourtant. Tout cela m’inquiète tellement que j’en suis venu à ne plus aimer qu’on m’en parle; j’en suis irrité parfois comme un galérien libéré qui entend causer système pénitentiaire, avec Maxime surtout, qui n’y va pas de main morte et qui n’est pas un gaillard encourageant; et j’ai rudement besoin d’être encouragé. D’un autre côté ma vanité n’est pas encore résignée à n’avoir que des prix d’encouragement.
Je m’en vais relire toute l’Iliade[13q]. Dans une quinzaine nous ferons un petit voyage en Troade. Au mois de janvier nous serons en Grèce. Je bisque d’être si ignorant. Ah! si je savais le grec au moins et j’y ai perdu tant de temps!
La sérénité m’abandonne!
Celui qui, voyageant, conserve de soi la même estime qu’il avait dans son cabinet en se regardant tous les jours dans sa glace, est un bien grand homme ou un bien robuste imbécile. Je ne sais pourquoi, mais je deviens très humble.
En passant devant Abydos j’ai beaucoup pensé à Byron. C’est là son Orient, l’Orient turc, l’Orient du sabre recourbé, du costume albanais et de la fenêtre grillée donnant sur des flots bleus. J’aime mieux l’Orient cuit du Bédouin et du désert, les profondeurs vermeilles de l’Afrique, le crocodile, le chameau, la girafe.
Je regrette de ne pas aller en Perse (l’argent! l’argent[14q]!), je rêve des voyages d’Asie, aller en Chine par terre, des impossibilités, les Indes ou la Californie qui m’excite toujours sous le rapport humain. D’autres fois je me prends de tendresses à en pleurer en songeant à mon cabinet de Croisset, à nos dimanches. Ah! comme je regretterai mon voyage et comme je le referai et comme je me redirai l’éternel monologue: «Imbécile, tu n’as pas assez joui.»
Pourquoi la mort de Balzac m’a-t-elle vivement affecté[15q]? Quand meurt un homme que l’on admire on est toujours triste. On espérait le connaître plus tard et s’en faire aimer. Oui, c’était un homme fort et qui avait crânement compris son temps. Lui qui avait si bien étudié les femmes, il est mort dès qu’il a été marié et quand la société qu’il savait a commencé son dénouement. Avec Louis-Philippe s’est en allé quelque chose qui ne reviendra pas. Il faut maintenant d’autres musettes.
Pourquoi ai-je une envie mélancolique de retourner en Égypte et de remonter le Nil et de revoir Ruchouk Hanem?…. C’est égal, j’ai passé là une soirée comme on en passe peu dans la vie. Du reste je l’ai bien sentie. T’ai-je regretté! pauvre vieux!
Il me semble que je ne te dis rien de bien intéressant. Je vais me coucher et demain je te parlerai un peu de mon voyage, ça sera plus amusant pour toi que mon éternel moi dont je suis bougrement las.
A Parain.
24novembre1850.
En attendant que je reçoive la lettre annoncée par ma mère et dans laquelle vous devez me raconter une anecdote curieuse sur le jeune Bezet, je réponds bien vite, cher oncle, à la vôtre que j’ai reçue par le dernier courrier.
Que voulez-vous que je vous dise, cher vieux compagnon? Quand je serai revenu à Croisset comme nous arrangerons ensemble toutes les babioles que je rapporte. Échignerons-nous la muraille, hein? Quel abus de la vrille!
Ah! vieux polisson de père Parain, si vous étiez ici vous ouvririez de grands yeux à voir dans les rues les femmes. Elles se font voiturer dans des espèces de vieux carrosses suspendus et dorés à l’extérieur comme des tabatières. Là-dedans, couchées sur des divans comme dans leur maison (la voiture quelquefois est close par des rideaux de soie), on peut les contempler tout à son aise. Elles ont sur la figure un voile transparent à travers lequel on voit le rouge de leurs lèvres peintes et l’arc de leurs sourcils noirs. Dans l’intervalle du voile, entre le front et les joues, paraissent leurs yeux qui brûlent à regarder, et qui dardent sur vous d’aplomb leurs prunelles fixes. De loin, ce voile que l’on ne distingue pas leur donne une pâleur étrange, qui vous arrête sur les talons saisi d’étonnement et d’admiration. Elles ont l’air de fantômes. A travers les voiles qui retombent sur leurs mains brillent leurs bagues de diamants, et songer, miséricorde, que dans dix ans elles seront en chapeau et en corset! qu’elles imiteront leurs maris qui se font habiller à l’européenne, portent des bottes et des redingotes!
Souvent en vous promenant en canot avec moi vous preniez instinctivement la chaîne. Si vous alliez en caïque sur le Bosphore je ne sais à quoi vous vous accrocheriez. Figurez-vous des barques de vingt-cinq à trente-cinq pieds de long sur deux et demi tout au plus de large, pointues comme des aiguilles à l’avant et à l’arrière. On y peut tenir deux dedans. On s’accroupit au fond et il faut rester complètement immobile de peur de chavirer. Les deux rameurs, en chemise de soie, se servent de rames dont la partie comprise entre le tollet et la poignée a un renflement énorme pour faire contre-poids. Quand on est dans une semblable embarcation, que la mer est calme et que les caidjis sont bons, on vole sur l’eau.
Le port de Constantinople est plein d’oiseaux. Vous savez que les Musulmans ne les tuent jamais. Il y a des bandes de goélands qui nagent entre les navires. Les pigeons perchent sur les cordages des navires et de là s’envolent pour aller se poser sur les minarets,
Vous ne sauriez croire, mon vieux, combien nous pensons à vous et combien nous vous regrettons, ici particulièrement. Vous seriez capable d’y passer le reste de votre vie. Une fois entré dans les bazars vous n’en sortiriez plus. Toutes les boutiques sont ouvertes, on s’asseoit sur le bord, on prend la pipe du marchand et on cause avec lui. On peut y revenir vingt jours de suite sans rien acheter. Quand un marchand n’a pas ce que vous désirez il se lève de dessus son tapis et vous mène chez un voisin. Mais quand il s’agit du prix il faut, règle générale, commencer par rabattre les deux tiers. On se dispute pendant une heure, il jure par sa tête, par sa barbe, par tous les prophètes et enfin vous finissez par avoir votre marchandise avec50, 60ou75p.100de rabais. Les Persans particulièrement sont d’infâmes gueux. Avec leur bonnet pointu et leur grand nez ils ont des balles de gredin très amusantes. Stephany, notre drogman, a une rage de Perse et de Persans incroyable; partout où il en rencontre il s’arrête à causer avec eux.
A sa mère.
Constantinople, 4décembre1850.
Sais-tu que tu finirais, chère vieille, par me donner une vanité démesurée, moi qui assiste à la décroissance successive de cette qualité qu’on ne me refuse généralement point. Tu me fais tant de compliments sur mes lettres que je crois que l’amour maternel t’aveugle tout à fait.
Je suis curieux de voir ce que tu auras décidé relativement à ton voyage d’Italie et si tu emmèneras la petite. Écris-moi à Athènes. Nous ne savons au juste quand nous partons de Constantinople, mais ce sera probablement d’ici à une quinzaine. Nous nous ruinons dans les villes, tout notre voyage de Rhodes et d’Asie-Mineure nous a moins coûté que douze jours passés à Smyrne où nous n’avons pourtant rien acheté. Mais la vie européenne est exorbitante. Deux piastres, Madame! deux piastres! (dix sols!) pour laver un col de chemise, ainsi du reste. D’Athènes nous filerons probablement sur Patras après avoir vu de la Grèce ce que nos moyens nous permettront et ils ne nous permettront pas grand’chose, et à Patras nous nous embarquerons pour Brindisi d’où nous irons par terre jusqu’à Naples. Tel est notre plan. Sinon il faudrait retourner à Malte, y faire cinq jours de quarantaine et quatre de libre pratique, et de Malte se rembarquer pour Naples, ce qui serait peu amusant, surtout pour Maxime qui redoute la mer. Quant à moi j’y suis crâne. C’est avec l’équitation un talent que j’ai acquis en voyage, car je suis maintenant «aussi bon homme de cheval que de pied» comme M. de Montluc. Autre talent: j’entends très bien l’italien, il y a du moins peu de choses qui m’échappent quand on ne le parle pas trop vite; pour ce qui est de le parler, je baragouine quelques mots. Mais ce qui me désole, c’est le grec; leur s. n. d. D. de prononciation est telle, que je reconnais à peine un mot sur mille. Le grec moderne est tellement mêlé de slave, de turc et d’italien que l’ancien s’y noie et ajoutez à cela leurs polissonnes de lettres sifflées et avalées! A Athènes je serai moins ébouriffé, on y parle plus littérairement.
En fait de haute littérature, nous avons rencontré ici M. de Saulcy, membre de l’Institut et directeur du Musée d’artillerie, qui voyage avec Édouard Delessert, le fils de l’ancien préfet de police, et toute une bande qui les accompagne. Dès le début, grande familiarité, on retranche le monsieur, questions de la plus franche obscénité, plaisanteries, bons mots, esprit français dans toute sa grâce. Nous leur avons conseillé de ne pas aller dans le Hauran où infailliblement ils se seraient fait casser leurs gueules. Je crois que c’est un service que nous leur avons rendu là. Dès le lendemain nous étions devenus tellement amis que M. de Saulcy me tapait sur le ventre en me disant: «Ah! mon vieux Flaubert.» M. de Saulcy est celui qui a trouvé le moyen de lire le cunéiforme.
Nous dînons après-demain à l’ambassade chez le général. Ce brave général néglige la tenue diplomatique, dans l’intimité il donne de grands coups de poing dans le dos de Maxime en l’appelant sacré farceur.
Je viens de me promener à cheval tout seul avec Stephany pendant trois heures. Il faisait très froid. Le ciel est pâle comme en France. Nous avons galopé sur des landes à travers champs. J’ai rejoint les eaux douces d’Europe où dans l’été les belles dames d’ici viennent marcher sur l’herbe avec leurs bottes de maroquin jaune. Il y avait à la place de promeneurs un troupeau de moutons qui broutait et les feuilles jaunies des sycomores tombaient au pied des arbres dans le palais d’été du grand sultan. Je suis revenu par Eyerb. Une mosquée est enfermée dans un jardin qui est plein de tombes drapées et enguirlandées de feuillage et de lierres. J’ai traversé l’interminable quartier juif et le Phanar, quartier des descendants des anciens empereurs Grecs. Puis par le grand pont de bois et le petit champ des morts de Pera je suis rentré à l’hôtel.
Je ne sais que rapporter au père Parain et mon embarras est tel que je ne lui rapporte rien. Il choisira dans mes affaires à moi ce qui lui plaira le mieux. Pour le commun des amis nous avons des pantoufles, des pipes, des chapelets, toutes choses qui font beaucoup d’effet et qui ne coûtent pas cher. Devenons-nous canailles, hein? Les voyages instruisent la jeunesse.
A la même.
Constantinople, 15décembre1850.
A quand ma noce? me demandes-tu à propos du mariage de E., à quand? a jamais, je l’espère. Autant qu’un homme peut répondre de ce qu’il fera, je réponds ici de la négative. Le contact du monde auquel je me suis énormément frotté depuis quatorze mois me fait de plus en plus rentrer dans ma coquille. Le père Parain, qui prétend que les voyages changent, ’se trompe; quant à moi, tel je suis parti, tel je reviendrai, seulement avec quelques cheveux de moins sur la tête et beaucoup de paysages de plus dedans. Voilà tout. Pour ce qui est de mes dispositions morales, je garde les mêmes jusqu’à nouvel ordre; et puis s’il fallait dire là-dessus le fond de ma pensée et que le mot n’eût pas l’air trop présomptueux, je dirais je suis trop vieux pour changer. J’ai passé l’âge, quand on a vécu comme moi d’une vie toute intime pleine d’analyses turbulentes et de fougues contenues, quand on s’est tant excité soi-même et calmé tour à tour, et qu’on a employé toute sa jeunesse à se faire manœuvrer l’âme comme un cavalier fait de son cheval, qu’il force à galoper à travers champs, à coups d’éperon, à marcher à petits pas, à sauter les fossés, à courir au trot et à l’amble, le tout rien que pour s’amuser et en savoir plus; eh bien, veux-je dire, si on ne s’est pas cassé le cou dès le début il y a de grandes chances pour qu’on ne se le casse pas plus tard. Moi aussi, je suis établi, en ce sens que j’ai trouvé mon assiette, comme centre de gravité. Je ne présume pas qu’aucune secousse intérieure puisse me faire changer de place et tomber par terre. Le mariage serait pour moi une apostasie qui m’épouvante. La mort d’Alfred n’a pas effacé le souvenir de l’irritation que cela m’a causée. Ç’a été comme pour les gens dévots la nouvelle d’un grand scandale donné par un évêque. Quand on veut, petit ou grand, se mêler des œuvres du bon Dieu, il faut commencer, rien que sous le rapport de l’hygiène, par se mettre dans une position à n’en être pas la dupe. Tu peindras le vin, l’amour, les femmes, la gloire, à condition, mon bonhomme, que tu ne seras ni ivrogne, ni amant, ni mari, ni tourlourou. Mêlé à la vie, on la voit mal, on en souffre ou on en jouit trop. L’artiste selon moi est une monstruosité, quelque chose hors nature, tous les malheurs dont la Providence l’accable lui viennent de l’entêtement qu’il a à nier cet axiome; il en souffre et en fait souffrir. Qu’on interroge là-dessus les femmes qui ont aimé des poètes et les hommes qui ont aimé des actrices. Or (c’est la conclusion) je suis résigné à vivre comme j’ai vécu, seul, avec une foule de grands hommes qui me tiennent lieu de cercle, avec ma peau d’ours, étant un ours moi-même, etc. Je me fiche du monde, de l’avenir, du qu’en dira-t-on, d’un établissement quelconque, et même de la renommée littéraire, qui m’a jadis fait passer tant de nuits blanches à la rêver. Voilà comme je suis, tel est mon caractère