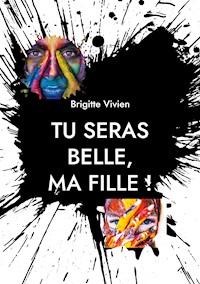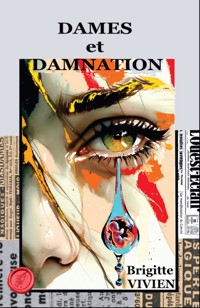
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encre Rouge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ces femmes enceintes, ces femmes de coeur, ces filles de cul, filles à soldats, cette jeune fille trop jeune pour enfanter d’un enfant dont le père est mort à la guerre, cette fille de ferme abusée, violée, cette mère épuisée par une famille trop nombreuse, cette femme seule, trompée, quittée, cette femme émancipée,éprise de liberté ou cette jeune fille de bonne famille ayant fauté, trainée, par souci d’honorabilité, chez la « tricoteuse», «la Dame de Pique», la faiseuse d’anges Marie-Louise les a rencontrées, aidées, abusées, sauvées ou perdues…» Un roman, ode à l’acceptation sans soumission, à la révolte, à la vie, à la liberté de choisir….
À PROPOS DE L'AUTRICE
Professeur d’Arts-Plastiques à la retraite,
Brigitte Vivien a deux passions : L’Art et la Littérature.
Elle a toujours écrit, sans éditer, même lorsqu’elle exposait ses œuvres d’art.
En plus de sa formation littéraire et de plasticienne, les voyages sont une source d’inspiration, comme peut l’être le littoral normand où elle vit.
Ses romans, au style sans concession, incisif, souvent sensuel ou drôle, entrainent le lecteur vers des contrées lointaines.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brigitte Vivien
Dames
et
Damnation
À toutes les filles.
À toutes les femmes.
À tous les hommes qui les aiment.
À ceux qui ne les aiment pas.
À l’enfant.
Avant-Propos
Le titre évocateur et ambigu de ce livre « DAMES et DAMNATION » évoque toutes les femmes qui s’interrogent sur la grossesse et l’avortement dans le passé, le présent et l’avenir.
Beaucoup d’entre elles ont fait appel aux services (ou auraient pu le faire) d’avorteuses comme Marie-Louise Lempérière, surnommée ici « La Dame de Pique. Marie-Louise, épouse Giraud faisait partie de cette catégorie féminine « Faiseuse d’anges ». Son tort fut de rêver d’une existence meilleure en usant et abusant de moyens illicites, de vivre dans une époque tumultueuse, sous un régime, celui de Vichy, considérant ses actes comme un crime contre la sûreté de l’État, ayant choisi de combler le trou démographique dû à l’hécatombe de la guerre de 1914-1918. Elle n’était pas la seule, des hommes pratiquaient également l’avortement. On les nommait aussi « Faiseurs d’anges ». Il fallait relancer la natalité. L’homme du peuple, alternativement tâcheron ou chair à canon, avait pour rôle de servir son pays et de remplir le ventre des femmes.
Ces femmes enceintes, ces femmes de cœur, ces filles de cul, filles à soldats, cette jeune fille trop jeune pour enfanter d’un enfant dont le père est mort à la guerre, cette fille de ferme abusée, violée, cette mère épuisée par une famille trop nombreuse, cette femme seule, trompée, quittée, cette femme émancipée, éprise de liberté ou cette jeune fille de bonne famille ayant fauté, trainée chez la « tricoteuse » par souci d’honorabilité, la faiseuse d’anges les a rencontrées, aidées, abusées, sauvées ou perdues.
Cet ouvrage basé sur des faits réels, retrace de façon à la fois réaliste et romancée le parcours dramatique de ces femmes évoluant dans une époque tourmentée.
« La préoccupation sexuelle est à la base de toute l'activité de l'esprit. »
Paul Eluard
Préface
La très jolie expression « Faiseuse d’anges » apparait au XIXe siècle, évidemment plus belle et élogieuse que « avorteuse », « matrone » et « tricoteuse », des termes employés plus vulgairement, en référence à ces femmes, que l’on n’appelait pas encore sage-femmes, qui pratiquaient l'avortement de manière clandestine et complètement illégale.
Le terme "Anges", est une allusion à la mythologie et à la disparition du fœtus semblable à l’ange, un être purement spirituel. Ces fœtus ou petits êtres considérés comme purs et innocents, une fois décédés, rejoignaient alors naturellement, dans les croyances populaires et religieuses, le paradis pour y devenir des anges.
D’après l’étymologie, le terme, « Ortare » signifie naître et « ortus » né. Le préfixe privatif « ab » correspond alors à la notion d’expulsion accidentelle ou provoquée du produit de la conception, avant qu'il ne soit viable, d’où le terme, avorter. Avec l'adjectif abortif, on retrouve le " b » qui a été remplacé par " v " dans les autres termes, pilule abortive : pilule dite aussi pilule du lendemain qui a été expérimentée, puis, plus ou moins abandonnée, et qui permettait une contraception après l'acte sexuel et non avant comme la pilule contraceptive classique.
L’avorton est un animal né avant terme, d'où le sens figuré, péjoratif de petit, mal fait, laid, non fini.
S’il faut retracer en raccourcis l’historique de cette problématique de l’avortement, qui remonte à la nuit des temps, il est établi que, dès le XVIe avant J.C, le papyrus Ebers, un des plus anciens traités médicaux connus, contient des prescriptions pour faire avorter les femmes.
Or, à peu près à la même époque, en Mésopotamie antique, le « Code de Hammurabi », daté d’environ 1750 av. J.-C. interdit l’avortement. Des politiques ont donc tenté de contrôler la fécondité dès l’Antiquité notamment chez les Hébreux.
Dans la Grèce classique et la Rome antique, l’avortement est une pratique réprouvée, car elle prive le père de son droit de disposer de sa progéniture comme il l’entend, mais le silphium (une plante médicinale aujourd’hui disparue) est utilisé comme contraceptif.
Au Moyen-Âge, la majorité des Églises chrétiennes condamnent l’avortement, mais la sanction est différente selon la pratique avant ou après l’animation du fœtus. La date de l’apparition de l’âme fait d’ailleurs l’objet d’un débat théologique. Au XIIe siècle, les théologiens chrétiens optent pour une animation différenciée entre garçons et filles. L’apparition d’une âme chez les fœtus masculins à 40 jours et à 80 jours pour les filles. On est très loin du débat autour de la guerre des genres ! La gent féminine sera malgré tout, très heureuse d’apprendre qu’elle possède une âme ! Encore faut-il qu’elle ait une conception religieuse !
Au XIIIe siècle, Guillaume de Salicet, moine dominicain et auteur de traités de médecine et de chirurgie, reconnaît que cet acte n’est pas recommandé par la loi, mais « qu’il est cependant nécessaire pour le bon fonctionnement de la science médicale, à cause du danger qu’une grossesse pourrait produire chez une femme en mauvaise santé, faible, ou qui est trop jeune. »
En 1532, Charles Quint édicte La Lex Carolina qui fixe l’animation du fœtus, au moment où la mère perçoit ses mouvements. Cependant, le pape Sixte Quint condamne formellement l’avortement, quel qu’en soit le terme.
En 1556, l’édit d’Henri II punit l’avortement, resté en vigueur jusqu’à la Révolution.
En 1609, cette question de l’avortement est abordée, notamment par Louise Bourgeois, « La Boursier », disciple d’Ambroise Paré, auteure d’un ouvrage d’obstétrique, sage-femme de Marie de Médicis.
Après plusieurs années de discussions, c’est en 1852, que l’Académie reconnait enfin le droit à l’interruption de grossesse thérapeutique. La question de l’avortement dû à une grossesse non désirée reste lettre morte.
Le 26 décembre 1910, dans un éditorial paru à la Une du Matin et intitulé « Pour les innocents », plusieurs sommités médicales, préoccupées par la dépopulation qui menace la France, condamnent l’avortement qu’ils considèrent responsable de « la démoralisation publique ». « C’est un crime social, quelquefois passionnel mais toujours un crime ».
À contrario, dans La Dépêche du 2 janvier 1911, le docteur Toulouse considère que la naissance est bien le facteur déterminant la vie. « La mère en se faisant avorter, ne commet donc pas un crime à l’égard de son enfant en germe, bien que l’acte soit blessant à l’égard de la morale collective actuelle ». Néanmoins, il reconnaît que la gestation est une obligation d’utilité générale pour les femmes, qui serait symétrique à l’obligation militaire de l’homme, sauf en cas d’inaptitude à la maternité. La décision est entre les mains du médecin, qui est le seul compétent pour « délivrer prématurément une femme dont la vie est mise en péril par une grossesse vicieuse ». Dans ces conditions, le dernier recours offert aux femmes souhaitant interrompre leur grossesse sans raison médicale serait d’agir en dehors du cadre légal.
En 1920, l’Union soviétique devient le premier pays à légaliser l’avortement, grâce à Lénine. Staline l’interdit à nouveau en 1936 mais il est rétabli dans l’urgence en 1955 pour lutter contre la mortalité natale entraînée par les avortements clandestins.
Le 27 mars 1923, l’article 317 du code pénal de 1810, fait de l’avortement en France, un délit, afin de mieux poursuivre les avortées et avorteurs.
Depuis les années 1930, de nombreux pays (Pologne, Turquie, Danemark, Suède, Islande et Mexique) autorisent l’avortement thérapeutique lorsqu’il peut sauver la vie de la femme, ou en cas de viol ou de malformation du fœtus tandis que la pilule anticonceptionnelle est mise au point aux États-Unis.
La loi de 1939 promulgue le Code de la famille et renforce la répression. Des sections spéciales de policiers sont chargées de traquer les « faiseuses d’anges ». Dans la Revue de l'Alliance Nationale contre la Dépopulation, en 1939, on peut lire :
« Les avorteurs tuent un petit français sur trois. Ceux qui les protègent trahissent la France au profit de l’étranger. Quel châtiment méritent-ils ? »
Le débat s’articule autour d’une problématique récurrente : « Un embryon est-il un être disposant d’une existence individuelle qui doit être protégée contre le meurtre comme l’enfant ? »
En 1941, les faiseuses et faiseurs d’anges risquent d’être déférés devant le tribunal d’État.
En 1942, l’avortement est considéré comme crime d’État. Jusqu’à la Libération, on ne compte pas moins de 15 000 condamnations à des peines diverses.
En France, la promulgation de la loi Neuwirth du 28 décembre 1967, qui remplace celle du 31 juillet 1920, légalise la pilule. C’est un véritable levier d’émancipation pour la condition féminine.
Au début des années 1970, des féministes américaines développent la méthode de Karman qui permet d’avorter de manière sécuritaire.
Le 15 avril 1971, « Le Nouvel Observateur » publie le « Manifeste des 343 salopes « dans lequel 343 femmes, personnalités du spectacle, de la littérature et de la politique, déclarent avoir avorté. En juillet de la même année, l’avocate Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir créent l’association « Choisir », pour défendre les personnes accusées d’avortement.
En 1972, l’avortement est toujours un délit, mais le viol n’est pas un crime. En octobre, Gisèle Halimi fait acquitter une jeune fille de 17 ans qui a avorté après un viol.
Le 5 février 1973, dans un manifeste publié par « Le Nouvel Observateur » et « Le Monde », 331 médecins revendiquent avoir pratiqué des avortements et se déclarent pour la liberté de l’interruption de grossesse.
Le 17 janvier 1975, l'avortement est légalisé par la loi Veil, rétablissant la neutralité morale et juridique de l'acte.
« La plupart d’entre vous le sentent, qui savent qu’on ne peut empêcher les avortements clandestins et qu’on ne peut non plus appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ses rigueurs. »
Le terme technique officiel est « Interruption Volontaire de Grossesse » d’où l’abréviation IVG. L'usage de cette expression s'explique à partir de deux considérations qui différencient nettement les deux interruptions. La première met l’accent sur le caractère volontaire, c’est-à-dire, le choix de l’IVG d’une femme. La seconde souligne que l'avortement peut être accidentel. La locution de " fausse couche "est alors employée dans le langage courant.
Lorsque l’on explore des questions soulevées au sein des archives judiciaires, apparait cette problématique des avortements qui concerne davantage des gens ordinaires, aux vies difficiles, révélant des relations de pouvoir des hommes et des femmes, dans la vie quotidienne. Afin de tenter de contrôler un tant soit peu leur vie intime, les voix des femmes sont essentielles, en agissant pour leur propre compte. Au début du XXe siècle, on estime à plus de 500000 le nombre d’avortements clandestins et à 300 le nombre de décès accidentels en France. Avortement et contraception sont interdits dès 1920 où toute propagande anticonceptionnelle est condamnable. Le législateur souhaite ainsi faire face à la saignée démographique engendrée par la guerre de 14-18.
À la Libération, l’arsenal législatif répressif n’est pas remis en question, avec ses conséquences de décès ou de mutilations provoqués par les avortements clandestins. Les procès ont lieu contre les avortées jusque dans les années 1970. Cette période répressive qui cause la mort de beaucoup de femmes, ne prend fin qu’avec la loi Neuwirth en 1967, autorisant la contraception et la loi Veil autorisant l’IVG en 1975.
En 1973, aux USA, l’arrêt Roe v. Wade établit que les femmes enceintes peuvent obtenir un avortement durant les trois premiers mois de grossesse. Cependant les États ont la possibilité d’instaurer des restrictions au deuxième trimestre et de les interdire presque entièrement au troisième.
En 2022, la révocation de l’arrêt Wade remet en question le droit à l’avortement et l’interdit dans 13 états. Désormais, chaque État est libre de réguler l’accès à l’avortement comme il le souhaite.
Cadre médical et juridique
L’avortement se définit comme l’interruption avant son terme du processus de gestation, autrement dit du développement qui commence à la conception par la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde formant ainsi un œuf, qui se poursuit par la croissance de l’embryon, puis d’un fœtus. Une interruption volontaire de grossesse (IVG) consiste à interrompre une grossesse par la prise d’un médicament (IVG médicamenteuse) ou par une aspiration (IVG chirurgicale). Dans le droit moderne, l’embryon et le fœtus ne sont pas des personnes juridiques. Le nouveau-né n’acquiert généralement sa personnalité juridique qu’à la naissance. Avant sa naissance, il n’est donc pas une personne mais comme un “objet juridique”, qui peut toutefois être éventuellement porteur de droits privés ou publics.
Gabriel Roche-Galard
Maitre de conférences, Directeur de thèse
Chapitre I
Par cette nuit limpide et douce, le croissant effilé de la lune déclinait doucement vers la côte. Dans le ciel indigo, de frêles lueurs roses flottaient et les étoiles minuscules s’éteignaient là-bas, au-dessus de la mer. L’aube approchait.
Andrée marchait d’un pas incertain. Elle portait son ventre rond de quatre mois, comme un sac de pommes de terre. Pourtant il n’était pas très gros mais par ce geste, la jeune fille chétive avait l’impression de protéger le petit qui poussait en elle.
Elle traversa le bourg le plus vite possible. Après l’église, derrière une fenêtre, elle crut voir un rideau de la maison Le Goupil s’écarter à son passage et vite retomber. Sûrement la commère du quartier, la mère Rosette. Le geste immédiat de resserrer son manteau fut dérisoire. Il ne protégerait pas la jeune engrossée, des commérages.
Plus loin, à la sortie du village, elle trébucha et sa robe s’accrocha alors aux ronces qui bordaient le chemin cahoteux. Elle portait pourtant ses escarpins à talons du dimanche. Ces chaussures lui faisaient ordinairement la démarche élégante. Les autres mocassins étaient pour les tâches quotidiennes de la maison et pour sa place d’apprentie chez un cafetier d’Isigny. Elle ne s’y rendait plus depuis que ses parents connaissaient son état. Son inquiétude était telle qu’elle tremblait de tout son corps et elle vacillait en pensant à ce qu’elle devait endurer.
Ce jour-là, les rayons tardaient à percer la brume qui enveloppait la Vire. Andrée devinait à travers les nappes blanchâtres, l’incendie qui couvait au loin, comme un tableau de Claude Monet. Elle pensa aussitôt à cette jolie toile intitulée « Impression Soleil levant », admirée dans un livre de la maîtresse, quand elle fréquentait encore l’école. Elle sourit.
Cet instant de bonheur absolu fut trop fugace. La réalité l’arracha à cette sensation de douceur infinie car une douleur intense au creux de son ventre lui déchira les entrailles. Elle étouffa un cri.
Andrée venait de Neuilly-la-Forêt pour tenter de retrouver Raoul, le garçon de ferme. Il passait le plus clair de son dimanche à Isigny où elle finirait bien par le dénicher. Sûrement dans un café du port où il avait ses habitudes comme beaucoup d’hommes de son âge.
Ce n’était pas comme elle, partie très tôt, en cachette de ses parents. Andrée n’avait jamais vu le père Ferdinand aussi furieux quand il comprît son état. Elle avait beau dissimuler ses rondeurs, c’était méconnaitre l’œil inquisiteur de son père. La mère Berthe, elle, ne disait rien bien qu’elle eût compris l’état de sa fille dès le début, alors que la jeune fille n’en savait rien encore. Les femmes ont le chic pour déceler la grosseur qui pousse en elles.
⸺ La petiote, à seize ans, ça ne devait pas arriver ! Tu as fauté ! Malgré toutes les mises en garde. Tu déshonores ta famille !
Ferdinand, employé très honorable aux chemins de fer de l'État, oubliait de souligner les souffrances de sa femme, la pauvre Berthe, douce, conciliante, bienveillante jusqu’à la servitude, soumise à son mari après son père, comme on le lui avait appris dès l’enfance. Il évitait de parler des insultes après les beuveries entre hommes, les fins de battage, lors des moissons où il prêtait la main aux cousins dans les villages environnants. Il omit d’évoquer les misères de la pauvre femme condamnée à ne plus enfanter. Comme il pleurait alors, devant le voisinage déplorant l’accident de sa chère épouse, bousculée par une cariole. Quelle misère, disait-il, elle ne pourrait plus lui donner un fils. Et maintenant, la honte s’abattait sur lui avec sa propre fille engrossée par un va-nu-pieds.
⸺ Mais père, je n’y suis pour rien. On m’a prise, violentée sur le chemin, à mon retour du travail.
La jeune Andrée ayant attrapé un poussin de haie, n’avait plus que ses beaux yeux clairs pour larmoyer. Mais rien n’y fît pour apitoyer le respectable employé des chemins de fer et sa mère quasiment muette, d’autant qu’Andrée soutenait ignorer le nom de celui qui l’avait déflorée.
⸺ Plus question de faire la bacouette avec ton ventre plein. Tu ne sors plus. J’ai trop honte.
Berthe, qui n’était pas si sotte avait parcouru chez ses grands-parents, commerçants dans l’Eure, plusieurs journaux de la fin du siècle précédent, faisant la réclame de certains remèdes pour tous les maux. Dans la presse féminine, de nombreuses publicités vantaient les propriétés de médicaments miracles censés régler, les retards et suppressions des époques, comme « Les perles magiques ». Toutes sortes de pilules et potions abortives qui garantissaient ce que la loi interdisait : une interruption de grossesse indolore et rapide.
Berthe se souvenait d’un article de La Lanterne qui évoquait le procès de Marie-Constance Thomas au surnom évocateur de « Mort-aux-gosses » ou « l’avorteuse des Batignolles ». Elle avait été condamnée en 1891 à douze ans de travaux forcés pour avoir fait avorter « près de quatre cents jeunes femmes, en l’espace de dix mois » - voire quatre mille. Mais Berthe ne croyait pas aux vertus des plantes de bonne femme, « bone fame », de bonne renommée, ni aux panacées des colporteurs.
Sortant enfin de son silence, Berthe s’approcha de son mari et glissa à son oreille quelques mots. Andrée retint une phrase, à travers ses larmes.
⸺ …Ne t’inquiète pas, je vais trouver une solution…
Vêtue de sa robe fleurie qui lui comprimait le ventre, elle allait, vaillante et seule au cœur des vallonnements herbeux qui découpaient la campagne. Après six kilomètres, fatiguée, Andrée atteignait péniblement en frôlant les murs, les rues du bourg d’Isigny qui s’éveillait.
Elle songea à ses parents qui ne l’avaient pas entendue sortir par la porte de l’arrière-cuisine. S’ils l’avaient surprise, ils auraient bien été capables de l’attacher pour sauvegarder leur honneur. En se pressant, elle serait rentrée pour dix heures. Elle avait laissé sous la soupente ses vêtements quotidiens pour se changer rapidement, à son retour. Ils croiraient qu’elle revenait du puits avec ses seaux d’eau. Elle avait pris soin d’en remplir un à ras-bord, la veille.
Elle s’en félicita mais le cœur lourd, elle traversait parfois les rigoles en courant pour éviter la rencontre de gens susceptibles de la reconnaitre. Son foulard gris dissimulait son visage encore juvénile parsemé de petites taches de rousseur qui donnaient à sa frimousse un air coquin. Mais sa candeur, elle l’avait perdue, remplacée par un air grave et triste qui ne la quittait plus. La dernière fois qu’elle avait aperçu Raoul, elle avait cru discerner dans son visage d’homme mûr, un sourire malin qui semblait dire :
⸺ Dis donc, la donzelle, facile à culbuter !
Mais, c’était impossible. Elle ne devrait pas imaginer le pire. Raoul ne pouvait être mauvais. Raoul, ce garçon de ferme robuste et solide, aux traits marqués par le travail, sous le soleil de Normandie, parfois ardent et les rigueurs de l’hiver. Ses cheveux, d'un brun sombre, étaient toujours en bataille, encadrant un visage buriné par les ans. Andrée était toujours impressionnée par sa carrure imposante qui témoignait des années passées à soulever des sacs de grain, à labourer les champs et à soigner les animaux des fermes où il faisait ses corvées. Ses bras musclés étaient striés de veines saillantes, résultat de journées interminables passées à trimer sans relâche. Malgré la fatigue visible sur son visage, Raoul portait toujours un sourire qu’elle trouvait sincère, illuminant son visage et dégageant une chaleur humaine qu’Andrée ne trouvait pas à la maison. Peut-être que son père avait raison quand il lui reprochait d’être trop jolie ?
Elle n’aurait pas dû retrousser ses jupons et ôter ses bas pour traverser le ruisseau. Cette vision aura donné des idées au commis qui l’observait souvent lorsqu’elle quittait le bourg et prenait un raccourci à travers champs. Les hommes étaient ainsi. Ils ne savaient pas se retenir.
La Claudette, de cinq ans son ainée, qui n’avait pas froid aux yeux ni aux fesses, lui avait raconté des choses là-dessus. En fait, il suffisait d’observer les porcs ou les boucs pour comprendre. D’après elle qui en connaissait un rayon, les mâles étaient tous les mêmes, bâtis de la même façon, guidés par leur membre viril. À croire que leur cerveau s’était localisé tout en bas. Comme Andrée riait à ce moment-là et comme elle aimerait se confier désormais à la Claudette. Elle, au moins, elle saurait la conseiller. Mais elle était montée à Cherbourg depuis trois longues années pour faire des ménages et du repassage dans une maison de maître.
Avant tout, Andrée devait apprendre la situation à Raoul. Après avoir arpenté quelques quartiers d’Isigny, Andrée le trouva enfin, assis avec deux autres gars à la terrasse du débit « Le rosier », Elle l’observa d’abord discrètement à l’angle d’un immeuble. Il était vêtu simplement, avec ses habits usés. Elle reconnut son éternelle salopette, tâchée de boue et de sueur. À croire qu’il affichait ouvertement, avec une certaine fierté, une allure authentique et rustique. Sa casquette en toile, jadis de couleur bleue, désormais délavée par les éléments, couvrait sa tête. Andrée hésita un instant avant de se décider à lui faire signe. L’un des hommes l’aperçut en premier. Il leva le menton vers Raoul. Juste un regard flou vers elle. Surpris mais indifférent, celui-ci haussa les épaules. Elle insista en réitérant son geste. De mauvaise grâce, Raoul écarta sa chaise avec brusquerie, sous les quolibets des deux autres. Il s'avança vers elle d'un pas mesuré, chaque mouvement empreint d'une assurance tranquille mais son regard disait tout sans prononcer un mot, un regard à la fois intense et dur.
⸺ Qu’est-ce que tu me veux de si bon matin ? C’est-y un problème à la maison ?
Très vite, Andrée attrapa la manche de sa chemise et le tira sous un porche.
⸺ Raoul, mes parents ont compris pour nous.
Le jeune homme se frottait la joue mal rasée avant de demander avec froideur :
⸺ Quoi… pour nous ?
Andrée se rapprocha de lui doucement mais Raoul repoussa d’une main ferme la jeune fille qui retenait ses larmes en regrettant l’absence de Claudette. Si elle était à sa place, avec quelle aisance, elle alignerait les phrases !
⸺ Je… Je viens pour te dire…Enfin…
⸺ Alors, quoi ? Accouche !
Les mots sont si cruels parfois ! Un sanglot remonta de sa gorge enveloppée d’un châle. Raoul, impatient, tourna son regard vers ses copains toujours attablés. Andrée annonça dans un souffle :
⸺ J’attends un enfant.
Le visage rougeaud de Raoul se crispa. Ses yeux sombres semblaient noircir davantage tandis que sa peau hâlée pâlissait. Sa bouche, surmontée d’une fine moustache, esquissa une moue avant de se détendre pour ricaner.
⸺ Ah ! C’est normal quand on va voir le loup ! Résultat : Un moussaillon dans la cale ! Voyez-vous ça !
Il avait crié en se tournant vers ses amis aux aguets qui riaient en lui faisant signe pour qu’il revienne. D’un geste obscène, il ouvrit le manteau d’Andrée et donna deux petites tapes sur son ventre.
Effarée et honteuse, la jeune fille voulait dissimuler le rouge qui colorait ses joues et, la voix éteinte, presque suppliante, elle réussit à jeter ces mots dans un râle, en serrant la main de l’homme qui la rejetait :
⸺ C’est toi le père. Personne d’autre ne m’a touchée.
Le ricanement devint rictus de dégoût.