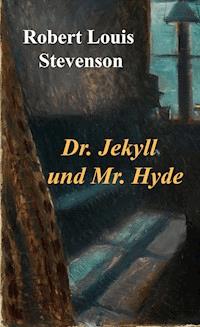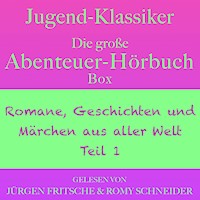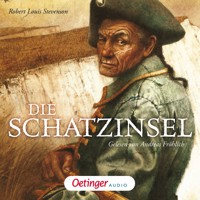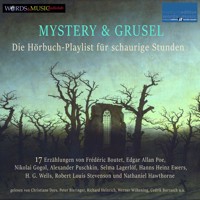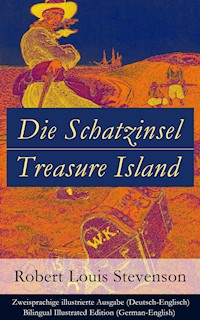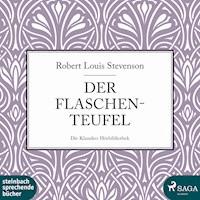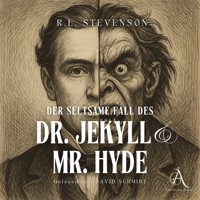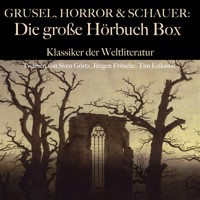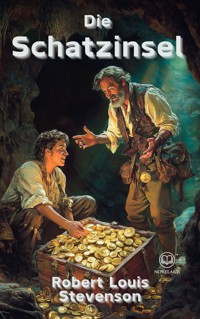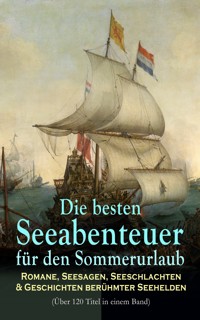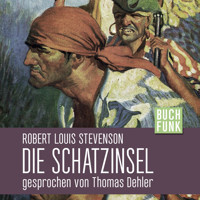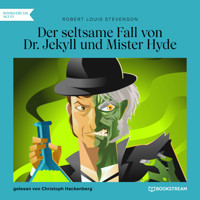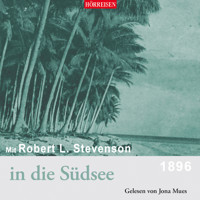Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Depuis près de dix ans, ma santé allait déclinant ; et vers l'époque où j'entrepris mon voyage, je me croyais arrivé à l'épilogue de ma vie, sans plus rien à attendre que la garde-malade et le croque-mort. On me suggéra de tenter les Mers du Sud ; et je ne m'opposai pas à visiter comme un spectre et traverser comme un colis les paysages qui m'avaient attiré jeune et bien portant."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Ce climat, ces déplacements fréquents, ces atterrissages à l’aube, des îles nouvelles pointant hors de la brume matinale, de nouveaux ports ceints de forêts, les alarmes passagères et répétées des grains et du ressac, l’intérêt pris à la vie indigène, – toute l’histoire de ma vie m’est plus chère que n’importe quel poème. »
(D’une lettre de R.-L. Stevenson.)
Sous une marque éditoriale justement estimée, une traduction de Dans les Mers Sud a déjà paru en 1920.
Et voici que la Sirène publie les Marquises et les Paumotus et les Gilberts, dont l’ensemble constitue précisément ce même ouvrage.
Qu’est-ce qui donne de l’à-propos à la publication de nos deux volumes ?
La méconnaissance de l’admirable texte de Stevenson par la traduction antérieure.
Méconnaissance telle, que l’on se demande si la bonne foi du signataire ne s’est pas laissé surprendre ; si, confiant en quelque collaborateur présomptueux (le vrai coupable), il n’a pas reçu des mains de celui-ci une version opérée à la force du dictionnaire, – version qui, mise en un français suffisant, a pu, à la faveur de ce vernis faire illusion à la maison éditrice.
Prenons-y, au hasard, une quinzaine de pages consécutives, 121-135 (elles correspondent aux pages 197-221 de notre présent volume, les Marquises et les Paumotus) et notons seulement les erreurs un peu grosses.
Stevenson nous promène à sa suite parmi les atolls ou récifs de corail. Ce mot n’évoque à l’insoucieux traducteur aucune idée précise, comme on verra à l’examen des deux colonnes suivantes.
Dira-t-on qu’il s’agit d’un cas particulier, qu’en dehors de l’atoll, le traducteur incriminé peut être au courant des termes nautiques, de la navigation et des voyages en général, et nous offrir sur ces sujets encore assez de pages supportables ?
Hélas ! là aussi il est fertile en contresens. Clichés vagues, périphrases quelconques remplaçant les expressions nettes ou techniques de Stevenson. Il ignore que l’habitacle est une sorte de boîte à couvercle de verre, renfermant le compas de route et munie d’une lampe, – et il écrit, pompeusement mais fort peu vraisemblablement pour quiconque a jamais mis le pied sur un navire : « Les feux de l’habitacle déjà ternis par l’éclat du jour » pour : la lampe de l’habitacle, pâlie dans l’éclat du jour. Il écrit sans sourciller : « le parapet » du navire, voulant parler des « lisses » ; – « toises », au lieu de « brasses », seule mesure usitée en matière de sondages ; – « du côté du port » (!), pour « bâbord » ; – « contre le vent », pour « au vent, vers le vent » ; – « un débarcadère à gradins », pour « des quais d’accostage » ; – « démanteler », pour « démâter » ; – « le vent était favorable », pour « nous avions le vent largue » ; – « Terre en avant ! » pour « La terre devant ! » ; – « routes fixes », pour « estime » ; – « contourner », pour « longer »… Le terme technique « light airs » (légère brise) est imperturbablement traduit : « l’air était léger ». Quand le Casco « laisse porter », on veut nous faire croire qu’il « s’éloigne ». « Dépasser une île, parcourir huit milles d’eau libre et donner presque à sec sur la suivante » devient : « contourner une île, faire huit milles en mer et filer à toute vitesse vers l’île prochaine. » Et si Stevenson aperçoit la terre « non seulement par le bossoir de bâbord, mais droit sur l’avant », on lui fait dire : « J’aperçois la terre, non à l’horizon, mais juste devant nous. »
Lorsque la traduction d’un terme nautique rebute par trop le translateur, il conserve prudemment le mot anglais pour suppléer à l’insuffisance de son lexique (ex. « le banc du cockpit »), – ou plus simplement il le supprime : alors il nous apprend que le capitaine « mit le Casco à l’ancre, s’assit à l’arrière » ; mais, dans Stevenson, ce capitaine fit davantage : « il mit à la cape, en faisant jeter le loch de moment à autre, et resta sur la lisse de poupe… »
Même en dehors des termes techniques, les inadvertances et les contresens fourmillent :
Veut-on que l’expérience porte sur un autre passage, toujours pris au hasard, de la traduction qui nous a ménagé ces surprises ? Soit ! et ne soyons pas vétilleux.
Tant d’exemples, dont le nombre croîtrait à l’infini, sont-ils concluants et une traduction nouvelle était-elle opportune ? C’est probable, et la voici.
La traduction antérieure se déclare, sur sa couverture, LA SEULE AUTORISÉE.(Autorisée par qui ?) Cette formule, qui se veut intimidante, n’a pas de signification perceptible, attendu qu’il s’agit d’un ouvrage qui, en matière de traduction, est tombé en France dans le domaine public, aux termes de la loi anglaise.
Plus clairement, nous écrirons sur la traduction Théo Varlet : LA SEULE EXACTE.
LA SIRÈNE.
Le Casco était une goélette élancée, de quatre-vingt-quinze pieds de longueur, jaugeant soixante-dix tonneaux, destinée à naviguer dans les eaux de Californie, bien qu’elle eût fait une fois déjà le voyage de Tahiti. Ses lignes étaient très gracieuses, et ses mâts élevés, ses voiles blanches, son pont aux cuivres étincelants lui donnaient une parfaite élégance d’oiseau reposant sur la mer. Le meuble de son salon, très luxueux, était de soie et de velours aux couleurs vives, car on avait dépensé sans compter pour l’aménager. Toutefois, son « poste » laissait à désirer, son unique pompe était d’un calibre tout à fait insuffisant, la voilure avant était comprise en vue de la course et non pour une croisière, et, bien que les mâts fussent encore en bon état, ils n’auraient pu résister à une bourrasque.
Le navire fut affrété, et on hâta les préparatifs. Le propriétaire, le DrMerritt, Californien millionnaire et excentrique, montra d’abord peu de bonne volonté, et, avant de l’avoir vu, se défiait beaucoup de Stevenson. Celui-ci était en très mauvaise santé et empirait chaque jour, car San-Francisco ne lui convenait pas. L’affaire faisait long feu, lorsque sa femme s’aperçut quele DrMerritt désirait le connaître. Dès la première entrevue, les difficultés s’évanouirent. « Je marche, à présent, pour le yacht, dit le docteur. J’avais lu des choses sur Stevenson dans les journaux, et me le figurais comme un sauteur, alors que c’est un homme simple, sensé, et qui connaît ce dont il parle tout aussi bien que moi. »
En même temps que le yacht, sur la demande du propriétaire, on engagea volontiers son commandant, le capitaine Otis, qui connaissait bien le Casco, et le coq, un Chinois qui se faisait passer pour Japonais. Ils n’eurent aucune raison de regretter le premier choix, car le capitaine se montra un marin hardi et habile ; et bien qu’il manifestât, au début du voyage, un suprême mépris pour ses patrons, il fut, à la fin, leur excellent ami. Du reste, on trouve son portrait dans le Naufrageur, de Stevenson. Un équipage de quatre matelots de pont, « trois Suédois et l’inévitable Finlandais », fut engagé par le capitaine, plus quatre autres, qui s’avérèrent bientôt des « légistes de mer ». Un reporter, qui tentait de se faire embarquer, fut évincé, et on eut beaucoup de peine à refuser de prendre à bord un Adventiste-du-Septième-Jour qui parcourut, par la suite, toutes les Mers du Sud avec un équipage de ses co-sectaires.
… Il fallut ensuite fixer la destination du Casco. On hésita entre deux groupes d’îles considérablement distants : les Galapagos et les Marquises. Mais, après discussion ces dernièresfurent choisies. Et ce fut ainsi que Stevenson alla aux Marquises.
… Durant les trois années suivantes, Stevenson vagabonda sur toute l’étendue du Pacifique, passant la plus grande partie son temps aux îles Hawaii, puis aux Gilberts, à Tahiti et à Samoa, sa future demeure. Durant cette période, il visita, bien qu’un peu hâtivement, presque chaque groupe d’importance dans le Pacifique oriental et central.
… Des gens qui vivent au coin de leur feu ont peine à imaginer les différences qui séparent les îles visitées au cours d’une seule croisière sur un même océan. Peut-être se ferait-on une idée vague et générale de la diversité des aventures de Stevenson, en se figurant une visite rapide aux îles de Sardaigne, de Sicile, de Majorque et de Ténériffe, puis un nouveau départ pour Jersey et les îles d’Or, et, pour finir, un coup d’œil fugitif aux Indes occidentales.
GRAHAM BALFOUR.
(VIE DE R.-L. STEVENSON.)
Depuis près de dix ans, ma santé allait déclinant ; et vers l’époque où j’entrepris mon voyage, je me croyais arrivé à l’épilogue de ma vie, sans plus rien à attendre que la garde-malade et le croque-mort. On me suggéra de tenter les Mers du Sud ; et je ne m’opposai pas à visiter comme un spectre et traverser comme un colis les paysages qui m’avaient attiré jeune et bien portant. J’affrétai donc le yacht-goélette du Dr Merritt, le Casco, jaugeant soixante-quatorze tonnes, partis de San-Francisco vers la fin juin 1888, visitai les îles orientales de l’Océanie, et m’arrêtai, au début de l’année suivante, à Honolulu. Faute de courage pour retourner à mon ancienne vie et à ma chambre de malade, je repris la mer sur une goélette marchande, l’Equator, d’un peu plus de soixante-dix tonneaux, passai quatre mois parmi les atolls (ou îles de corail) de l’archipel Gilbert, et atteignis Samoa vers la fin de 89. À cette époque, la reconnaissance et l’habitude commençaient de m’attacher aux Îles ; j’avais recouvré la force de vivre, noué des amitiés, découvert de nouveaux intérêts ; le temps de mes voyages avait passé comme un rêve féerique : je décidai donc de rester. J’ai entrepris la rédaction de ces pages en mer, au cours d’une troisième croisière sur le vapeur marchand Janet Nicholl. Les jours qui me seront accordés, je les passerai là où j’ai trouvé la vie plus agréable et l’homme plus intéressant ; les haches de mes domestiques noirs sont en train de déblayer le terrain de ma future maison ; et c’est du plus lointain des mers que désormais je m’adresse à mes lecteurs.
Que j’aie ainsi infirmé l’opinion du héros de Lord Tennyson, est moins extravagant qu’il ne le paraît. Bien peu des hommes venus aux Îles les quittent : ils grisonnent où ils ont débarqué, et les palmes et l’alizé les éventent jusqu’à leur mort. Peut-être caressent-ils jusqu’au bout le désir d’une visite au pays ; mais celle-ci a lieu rarement, est plus rarement goûtée, et encore plus rarement réitérée. Aucune partie du monde n’exerce plus puissant attrait sur le visiteur, et la tâche que je m’assigne est de communiquer aux touristes en chambre quelque idée de cette séduction, de décrire la vie, en mer et à terre, de plusieurs centaines de mille individus, quelques-uns de notre sang et parlant notre langue, tous nos contemporains, et pourtant aussi lointains de pensée et d’usages que Rob Roy ou Barberousse, les Apôtres ou les Césars.
La première sensation ne se retrouve jamais. Le premier amour, le premier lever de soleil, la première île de la Mer du Sud, sont des souvenirs à part, auxquels s’attache une virginité d’émotion. Le 28 juillet 1888, la lune était couchée depuis une heure, il était quatre heures du matin. À l’est, une lueur irradiante annonçait le jour ; au-dessus de la ligne d’horizon, la brume matinale s’amassait déjà, noire comme de l’encre. Nous avons tous lu avec quelle soudaineté vient et disparaît le jour, sous les basses latitudes : c’est un point sur lequel concordent le touriste scientifique et le sentimental, et qui a inspiré de savoureuses poésies. Cette promptitude, évidemment, varie avec la saison ; mais voici un cas exactement noté. Bien que l’aube s’ébauchât ainsi dès quatre heures, le soleil ne fut pas levé avant six, et à cinq et demie seulement, on discerna l’île attendue, parmi les nuages de l’horizon. Huit degrés de latitude sud, et deux heures pour la venue du jour. L’intervalle se passa sur le pont, dans le silence de l’attente, l’émotion coutumière de l’atterrissage accentuée par l’étrangeté des rives dont nous approchions alors. Peu à peu elles prenaient forme dans l’obscurité atténuée. Uahuna, étagée sous un sommet tronqué, apparut la première à tribord ; presque par le travers s’élevait notre destination, Nuka-hiva, couverte de nuages, et plus au sud, les premiers rayons du soleil éclairaient les aiguilles de Ua-pu. Celles-ci pointaient sur la ligne d’horizon, et, telles les tours d’une église élégante et colossale, elles arboraient là, dans l’étincelante clarté du matin, l’enseigne appropriée à un monde de merveilles.
Personne à bord du Casco qui eût mis le pied sur les Îles, ou connût, sauf par hasard, un mot d’aucune langue insulaire ; et ce fut avec quelque chose peut-être du même plaisir anxieux dont frémissait le cœur des découvreurs, que nous approchâmes de ces bords problématiques. Le rivage s’élançait en pics et en ravins ascendants ; il retombait en falaises et en éperons ; sa couleur passait par cinquante modulations d’une gamme perle, rose et olive ; et il était couronné de nuages opalescents. Les teintes vaguement répandues décevaient le regard : les ombres des nuages se confondaient avec les reliefs de la montagne, et l’île et son inconsistant baldaquin s’éclairaient devant nous comme une masse unique. Il n’y avait ni balise, ni fumée de ville à attendre, ni bateau-pilote. Quelque part, dans cette pâle fantasmagorie de falaises et de nuages, se cachait notre port, et quelque part, à l’est de ce point, – le seul repère signalé, un certain promontoire, appelé indifféremment cap Adam et Ève, ou cap Jack et Jane, reconnaissable à deux figures colossales, grossières statues naturelles. C’est elles qu’il nous fallait découvrir, c’est elles qu’on cherchait de tous les yeux, de toutes les lunettes, en discutant les cartes. Le soleil était au zénith et la terre toute proche lorsque nous les aperçûmes. Pour un navire arrivant du nord, comme le Casco, elles présentaient en effet le détail le moins caractéristique d’une côte saisissante : le ressac jaillissant les enveloppait par la base ; des mornes étranges, sévères, empanachés, s’élevaient par derrière, et Jack et Jane – ou Adam et Ève – ne ressortaient guère parmi les brisants plus qu’une couple de verrues.
Nous laissâmes porter le long de la côte. Sur tribord retentissaient les explosions du ressac ; des oiseaux volaient en pêchant sous la proue ; nul autre bruit ou signe de vie, humaine ou animale, sur tout ce côté de l’île. Aidé par son élan et par la brise mourante, le Casco rasa des falaises, découvrit une crique où se montrait une plage avec quelques arbres verts, et la dépassa, piquant dans la houle. Les arbres, de notre distance, auraient pu être des noisetiers ; la plage, une plage d’Europe, dominée par des montagnes modelées en petit d’après les Alpes et revêtues de bois d’une taille guère plus élevée que notre bruyère d’Écosse. De nouveau, la falaise s’entrebâilla, mais cette fois avec une entrée plus profonde, et le Casco, serrant le vent, se glissa dans la baie d’Anaho. Le cocotier, cette girafe végétale, si gracieusement dégingandé, si exotique pour un œil européen, se pressait en foule sur la plage et grimpait en festons sur les pentes abruptes des montagnes. Des hauteurs âpres et nues enserraient des deux côtés la baie, que fermait vers l’intérieur un entassement de collines éboulées. Dans chaque crevasse de cette barrière, la forêt trouvait un asile, juchée et nichée comme des oiseaux dans une ruine, et, tout au haut, sa verdure émoussait les lames de rasoir des crêtes.
Sous les accores de l’est, notre goélette, ici privée de toute brise, avançait toujours, car, une fois lancée, la gracieuse créature semblait se mouvoir d’elle-même. À terre, tout proche, s’élevaient les bêlements de jeunes agneaux ; un oiseau chantait sur les pentes ; le parfum du sol et de cent fruits ou fleurs flottait à notre rencontre ; puis une ou deux maisons apparurent, haut situées sur la croupe des collines, l’une même entourée d’un semblant de jardin. Ces habitations très en vue, ce bout de culture étaient, nous devions l’apprendre, un indice du passage des blancs, et nous aurions pu côtoyer cent autres îles sans y trouver l’équivalent. Ce fut ensuite que nous découvrîmes le village indigène, situé (selon la coutume générale) tout contre une courbe de la plage, tout contre un bois de palmiers, et, par devant, la mer grondait et blanchissait sur la concavité d’un arc de brisants. Car le cocotier et l’insulaire aiment tous deux et avoisinent le ressac. « Le corail croît, le palmier pousse, mais l’homme s’en va, » dit le mélancolique proverbe tahitien, mais tous trois, aussi longtemps qu’ils durent, sont les co-occupants de la plage. Le repère du mouillage était un évent dans les rochers, près de l’angle nord-est de la baie. Tout juste à notre intention, l’évent crachait. La goélette tourna sur sa quille ; l’ancre plongea. Cela fit un petit bruit, mais un grand évènement : car mon âme est descendue avec cette amarre en des profondeurs d’où le cabestan ne pourra l’extraire ni le plongeur la repêcher ; et nous sommes, depuis cette heure, moi et plusieurs de mes compagnons de bord, les prisonniers des îles de Vivien.
Avant même que l’ancre eût plongé, une pirogue pagayait déjà, du village vers nous. Elle contenait deux hommes : un blanc, un brun au visage tatoué de lignes bleues ; l’un et l’autre en d’immaculés costumes blancs d’Européens : l’agent du comptoir, Mr Regler, et le chef indigène, Taïpi-kikino. « Capitaine, est-il permis de monter à bord ? » furent les premiers mots que nous entendîmes sur les Îles. Les pirogues se succédèrent, si bien que le navire regorgea d’hommes athlétiques hauts de six pieds, à tous les degrés de déshabillé : les uns en chemise, d’autres en pagne, l’un avec un mouchoir imparfaitement ajusté ; certains – les plus considérables – tatoués de la tête aux pieds en dessins terribles ; quelques-uns barbarement armés d’un couteau ; et un, qui m’est resté dans la mémoire pour son animalité, accroupi sur les cuisses dans une pirogue, suçant une orange et la recrachant à droite et à gauche avec une vivacité simiesque. Tous parlaient et nous ne comprenions pas un mot ; tous s’efforçaient de trafiquer avec nous qui n’avions aucune intention de trafic, ou nous offraient des curiosités de l’île, à des prix évidemment absurdes. Pas un mot de bienvenue, aucune démonstration de politesse, nulle autre main tendue que celles du chef et de Mr Regler. Comme nous persistions à refuser les objets offerts, ils se plaignirent, hautement et grossièrement ; et l’un, le loustic de la bande, railla notre avarice au milieu de rires sarcastiques. Entre autres plaisanteries irritées : « Il est rudement joli, leur bateau, dit-il, mais ils n’ont pas d’argent à bord ! » J’éprouvais, je l’avoue, une vive répulsion et même de la crainte. Le navire était manifestement en leur pouvoir ; nous avions des femmes à bord ; je ne savais rien de mes hôtes, sinon qu’ils étaient cannibales ; l’Annuaire (ma seule autorité) était plein de recommandations inquiètes ; et quant à l’agent, dont la présence eût dû me rassurer, est-ce que, dans le Pacifique, les blancs n’étaient pas les habituels instigateurs et complices des attentats indigènes ? En lisant cet aveu, notre excellent ami, Mr Regler, ne pourra s’empêcher de sourire.
Dans le courant de la journée, tandis que j’écrivais mon journal, la cabine était de bout en bout pleine de Marquesans ; trois générations à peau brune, assis jambes croisées sur le parquet, me considéraient en silence avec des yeux embarrassants. Les yeux de tous les Polynésiens sont grands, lumineux et touchants, comme ceux des animaux et de certains Italiens. Une sorte de désespoir m’envahit, d’être ainsi sans remède bloqué dans un coin de ma cabine par cette foule muette ; une sorte de rage aussi, à songer qu’ils étaient hors de portée du langage articulé, comme des animaux à fourrure, ou des sourds de naissance, ou les habitants d’une autre planète.
Traverser la Manche, c’est, pour un garçon de douze ans, changer de cieux ; traverser l’Atlantique, pour un homme de vingt-quatre, c’est à peine modifier son régime. Mais je venais de m’échapper hors de l’ombre de l’Empire romain, dont les monuments dominent nos berceaux, dont les lois et les lettres mettent partout autour de nous contraintes et prohibitions. J’allais voir maintenant quels hommes peuvent être ceux-là dont les pères n’ont jamais étudié Virgile, jamais été conquis par Jules César, jamais été régis par la sagesse de Gaius et Papinien. Du même coup, j’avais dépassé cette zone confortable de langues apparentées, où il est si aisé de remédier à l’anathème de Babel. Mes nouveaux semblables restaient devant moi muets comme des peintures. Il me semblait que, dans mes voyages, toute relation humaine allait être supprimée et qu’une fois retourné chez moi (car à cette époque je projetais encore d’y retourner), mes souvenirs ne seraient qu’un livre d’images sans texte. Bien plus, je mettais en doute que mes voyages dussent beaucoup se prolonger. Peut-être une prompte fin leur était-elle destinée ; peut-être celui-là (mon ami futur, Kauauni) muettement assis parmi les autres, en qui je discernais un homme d’autorité allait-il bondir sur ses cuisses, avec un strident appel ; et le navire serait emporté d’une ruée, et tous les gens du bord égorgés et mis en cuisine.
Rien ne pouvait être plus naturel que ces appréhensions, mais rien de moins fondé. Depuis, en parcourant les Îles, je n’eus plus jamais réception si menaçante ; et d’en rencontrer une pareille aujourd’hui, m’alarmerait sans doute davantage et me surprendrait dix fois plus. La majorité des Polynésiens sont de relations faciles, francs, passionnés d’égards, avides de la moindre affection, tels des chiens aimables et caressants ; et même ces Marquesans, si récemment et imparfaitement rédimés de leur barbarie sanguinaire, devaient tous devenir nos intimes et, l’un d’eux au moins, pleurer notre départ avec sincérité.
L’obstacle des langues était un de ceux que je surévaluais le plus. Les dialectes polynésiens sont faciles à apprendre, quoique difficiles à parler avec élégance. Ils ont d’ailleurs beaucoup d’analogie entre eux, et quiconque a une teinture de l’un peut aborder les autres avec chance de succès.
Non seulement le polynésien est facile, mais les interprètes foisonnent. Missionnaires, agents commerciaux, blancs qui vivent sur la générosité indigène, se rencontrent presque dans chaque île ou village. À leur défaut, bien des naturels ont glané quelques mots d’anglais ; et, dans la zone française (mais moins communément) beaucoup de Polynésiens sont familiarisés avec ce franco-anglais ou pidgin courant appelé dans l’Ouest « Beach-la-Mar ». L’anglais encore s’apprend dans les écoles de Hawaii, et grâce à la multiplicité des navires britanniques et à la proximité des États-Unis d’une part, et de nos colonies de l’autre, on peut d’ores et déjà le considérer comme la langue du Pacifique. Ainsi, par exemple, j’ai rencontré à Majuro un jeune garçon de l’île Marshall qui parlait un anglais excellent ; il l’avait appris au comptoir allemand de Jaluit, et ne savait cependant pas un mot d’allemand. Au dire d’un gendarme qui avait fait l’école à Rapa-iti, les enfants, qui ont beaucoup de difficulté ou de répugnance à apprendre le français, attrapent l’anglais au long des chemins et comme par hasard. Sur l’un des atolls les moins fréquentés des Carolines, mon ami, M. Benjamin Hird, eut la surprise de trouver des enfants qui parlaient anglais en jouant au cricket sur la plage. C’est en anglais que notre équipage de la Janet Nicholl, assortiment de noirs de diverses îles mélanésiennes, s’entretenait avec tous les insulaires rencontrés au cours du voyage ; c’est toujours en anglais qu’ils se transmettaient les ordres, et parfois même échangeaient des plaisanteries, sur le gaillard d’avant. Mais ce qui peut-être m’a frappé plus que tout, c’est un mot que je surpris sous la véranda du tribunal, à Nouméa. Les débats étaient clos, – il s’agissait d’une simiesque femme indigène inculpée d’infanticide. – et l’auditoire fumait des cigarettes en attendant le verdict. Une aimable dame française, anxieuse et presque en larmes, brûlait de voir acquitter la prisonnière, et se proclamait disposée à l’engager comme bonne d’enfants. Ses voisins se récriaient : la femme, disaient-ils, était une sauvagesse, et ne parlait pas la langue. « Mais vous savez, répliqua la belle sentimentale, ils apprennent si vite l’anglais ! ».
Mais ce n’est pas le tout de pouvoir converser avec les gens. Au début de mes relations avec les indigènes, deux circonstances me vinrent en aide. D’abord, j’étais le montreur du Casco. Le navire lui-même, ses lignes élégantes, sa haute mâture, le pont immaculé, le mobilier rouge du salon, avec les ors, les blancs, et les miroirs multipliants de la petite cabine, nous amenaient cent visiteurs. Les hommes toisaient les dimensions avec leurs bras, comme leurs pères toisaient les navires de Cook ; les femmes déclaraient les cabines plus jolies qu’une église ; de bondissantes Junons ne se lassaient pas de s’asseoir dans les fauteuils et de contempler dans les miroirs leurs douces images ; enfin, j’ai vu une dame relever son vêtement, et, avec des exclamations émerveillées et ravies, frotter son séant à nu sur les coussins de velours. Les biscuits, la confiture et le sirop complétaient la réception, et, comme dans les salons d’Europe, l’album à photographies passait de mains en mains. Ce banal recueil des costumes et des physionomies de tous les jours s’était transformé, après trois semaines de navigation, en un musée prestigieux de splendeurs lointaines. Dans la cabine dépaysée, on contemplait, on montrait du doigt, avec une excitation et une surprise ingénues, ces visages étrangers et ces vêtements barbares. Beaucoup reconnaissaient Sa Majesté, et j’ai vu des sujets français baiser sa photographie. Le capitaine Speedy – en costume de guerre abyssin, supposé être l’uniforme de l’armée britannique – recueillit maintes approbations ; et les effigies de M. Andrew Lang furent admirées aux Marquises. Voilà une retraite pour lui, quand il sera las du Middlesex et d’Homère.
Il me fut peut-être encore plus important d’avoir, durant ma jeunesse, fréquenté nos Écossais des Highlands et des Îles. À peine s’est-il écoulé plus d’un siècle depuis que ce peuple subissait la même transition convulsive que les Marquesans d’aujourd’hui. Dans les deux cas, une autorité étrangère imposée de force, les clans désarmés, les chefs déposés, de nouveaux usages introduits, et surtout la mode de regarder l’argent comme moyen et objet de l’existence. L’ère commerciale, dans les deux cas, succédant d’un bond à un âge de guerres extérieures et de communisme patriarcal. Prohibition, chez les uns de la pratique favorite du tatouage, chez les autres d’un costume favori. Des deux côtés, une haute friandise supprimée : le bœuf, qu’il ravissait sous le couvert de la nuit aux pâturages du Lowland, refusé au Highlander amateur
de viande ; le « cochon-long », qu’il razziait sur le village voisin, refusé au Canaque mangeur d’hommes. Les murmures, la secrète fermentation, les craintes et les ressentiments, les alarmes et conseils soudains des chefs marque-sans, me rappelaient continuellement les jours de Lovat et de Struan. L’hospitalité, le tact, de bonnes manières naturelles, un point d’honneur chatouilleux sont des qualités communes aux deux races ; commune aux deux langues la manie de supprimer les consonnes médianes. Voici un tableau de deux mots polynésiens très répandus :
L’élision des consonnes médianes, si nette dans ces exemples marquesans, n’est pas moins habituelle au gaélique et chez les Écossais du Lowland. Fait encore plus étrange, le son polynésien dominant, cette aspiration figurée par une apostrophe, qui est si souvent la pierre tombale d’une consonne morte, s’entend aujourd’hui même en Écosse. Quand un Écossais prononce water, better, ou bottle : « wa’er, be’er, bo’le » l’aspiration est la même exactement ; et je crois pouvoir aller plus loin, et dire que si une telle population était isolée, et que ce défaut de prononciation devînt la règle, il apparaîtrait sans doute comme le premier stade de la transmutation du t en k, qui est la maladie des langues polynésiennes. D’ailleurs, les Marquesans ont une tendance à mener une vraie guerre d’extermination contre les consonnes, ou au moins la lettre l, si commune. Un hiatus enchante les oreilles polynésiennes : l’oreille même d’un étranger s’accoutume bientôt à ces lacunes barbares ; mais c’est le marquesan seul qui possède des noms comme Haaii et Paaaeua, où chaque voyelle se prononce distinctement.