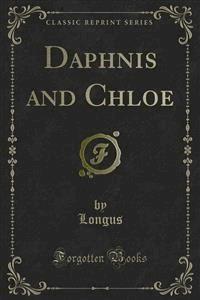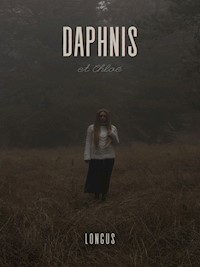
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Daphnis a quinze ans et Chloé treize lorsque le dieu Amour, apparaissant à Lamon et Dryas en rêve, scelle des sentiments entre les deux enfants trouvés. Alors que Daphnis et Chloé gardent les troupeaux de leurs parents adoptifs, Daphnis tombe un jour dans un trou en poursuivant un bouc.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daphnis et Chloé
Daphnis et ChloéPRÉFACE DU TRADUCTEURLIVRE PREMIERLIVRE SECONDLIVRE TROISIÈMELIVRE QUATRIÈMEPage de copyrightDaphnis et Chloé
Longus
PRÉFACE DU TRADUCTEUR
LES PASTORALES DE LONGUS ou DAPHNIS ET CHLOÉ
Traduction de J. Amyot
Revue, corrigée, complétée par Paul-Louis Courier, vigneron, membre de la Légion d’honneur, ci-devant canonnier à cheval chez H. L. Mermod, Lausanne
La version faite par Amyot des Pastorales de Longus, bien que remplie d’agrément, comme tout le monde sait, est incomplète et inexacte ; non qu’il ait eu dessein de s’écarter en rien du texte de l’auteur, mais c’est que d’abord il n’eut point l’ouvrage grec entier, dont il n’y avait en ce temps-là que des copies fort mutilées. Car tous les anciens manuscrits de Longus ont des lacunes et des fautes considérables, et ce n’est que depuis peu qu’en en comparant plusieurs, on est parvenu à suppléer l’un par l’autre et à donner de cet auteur un texte lisible. Puis Amyot, lorsqu’il entreprit cette traduction, qui fut de ses premiers ouvrages, n’étoit pas aussi habile qu’il le devint dans la suite, et cela se voit en beaucoup d’endroits où il ne rend point le sens de l’auteur, partout assez clair et facile, faute de l’avoir entendu. Il y a aussi des passages qu’il a entendus et n’a point voulu traduire. Enfin, il a fait ce travail avec une grande négligence, et tombe à tous coups dans des fautes que le moindre degré d’attention lui eut épargnées.
De sorte qu’à vrai dire il s’en faut de beaucoup qu’Amyot n’ait donné en français le roman de Longus ; car ce qu’il en a omis exprès, ou pour ne l’avoir point trouvé dans son manuscrit, avec ce qu’il a mal rendu par erreur ou autrement, fait en somme plus de la moitié du texte de l’auteur, dont sa version ne représente que certaines parties, des phrases, des morceaux bien traduits parmi beaucoup de contre-sens, et quelques passages rendus avec tant de grâce et de précision qu’il ne se peut rien de mieux. Aussi s’est-on appliqué à conserver avec soin dans cette nouvelle traduction jusqu’aux moindres traits d’Amyot conformes à l’original, en suppléant le reste d’après le texte tel que nous l’avons aujourd’hui, et il semble que c’étoit là tout ce qui se pouvoit faire. Car de vouloir dire en d’autres termes ce qu’il avoit si heureusement exprimé dans sa traduction, cela n’eut pas été raisonnable, non plus que d’y respecter ces longues traînées de langage, comme dit Montaigne, dans lesquelles, croyant développer la pensée de son auteur, car il n’eut jamais d’autre but, il dit quelquefois tout le contraire, ou même ne dit rien du tout. Si quelques personnes toutefois n’approuvent pas qu’on ose toucher à cette version, depuis si longtemps admirée comme un modèle de grâce et de naïveté, on les prie de considérer que, telle qu’Amyot l’a donnée, personne ne la lit maintenant.
Le Longus d’Amyot, imprimé une seule fois il y a plus de deux siècles, n’a reparu depuis qu’avec une foule de corrections et de pages entières de suppléments, ouvrage des nouveaux éditeurs, qui, pour en remplir les lacunes et remédier aux contre-sens les plus palpables d’Amyot, se sont aidés comme ils ont pu d’une foible version latine, et ainsi ont fait quelque chose qui n’est ni Longus ni Amyot. C’est là ce qu’on lit aujourd’hui. Le projet n’est donc pas nouveau de retoucher la version d’Amyot ; et si on le passe à ceux-là qui n’ont pu avoir nulle idée de l’original, en fera-t-on un crime à quelqu’un qui, voyant les fautes d’Amyot changées plutôt que corrigées par ses éditeurs, aura entrepris de rétablir dans cette traduction, avec le vrai sens de l’auteur, les belles et naïves expressions de son interprète ? Un ouvrage, une composition, une œuvre créée ne se peut finir ni retoucher que par celui qui l’a conçue ; mais il n’en va pas ainsi d’une traduction, quelque belle qu’elle soit ; et cette Vénus qu’Apelle laissa imparfaite, on auroit pu la terminer, si c’eût été une copie, et la corriger même d’après l’original.
Nous ne savons rien de l’auteur de ce petit roman : son nom même n’est pas bien connu. On le trouve diversement écrit en tête des vieux exemplaires, et il n’en est fait nulle mention dans les notices que Suidus et Photius nous ont laissées de beaucoup d’anciens écrivains : silence d’autant plus surprenant qu’ils n’ont pas négligé de nommer les froids imitateurs de Longus, tels qu’Achilles Tatius et Xénophon d’Éphèse.
Ceux-ci contrefaisant son style, copiant toutes ses phrases et ses façons de dire, témoignent assez en quelle estime il étoit de leur temps. On n’imite guère que ce qui est généralement approuvé. Nicétas Eugénianus, dont l’ouvrage se trouve dans quelques bibliothèques, n’a presque fait que mettre en vers la prose de Longus. Mais le plus malheureux de tous ceux qui ont tenté de s’approprier son langage et ses expressions, c’est Eumath ius, l’auteur du roman des Amours d’Ismène et d’Isménias. Quant à Héliodore, ce qu’il a de commun avec notre auteur se réduit à quelques traits qu’ils ont pu puiser aux mêmes sources, et ne suffit pas pour prouver que l’un d’eux ait imité l’autre. Quoi qu’il en soit, on voit que le style de Longus a servi de modèle à la plupart de ceux qui ont écrit en grec de ces sortes de fables que nous appelons romans. Il avoit lui-même imité d’autres écrivains plus anciens. On ne peut douter qu’il n’ait pris des poètes érotiques, qui étoient en nombre infini, et de la nouvelle Comédie, ainsi qu’on l’appeloit, la disposition de son sujet, et beaucoup de détails, dont même quelques-uns se reconnoissent encore dans les fragments de Ménandre et des autres comiques. Il a su choisir avec goût et unir habilement tous ces matériaux, pour en composer un récit où la grâce de l’expression et la naïveté des peintures se font admirer dans l’extrême simplicité du sujet. Aussi aura-t-on peine à croire qu’un tel ouvrage ait pu paroître au milieu de la barbarie du siècle de Théodose, ou même plus tard, comme quelques savants l’ont conjecturé.
LIVRE PREMIER
En l’île de Lesbos, chassant dans un bois consacré aux Nymphes, je vis la plus belle chose que j’aie vue en ma vie, une image peinte, une histoire d’amour. Le parc, de soi-même, étoit beau ; fleurs n’y manquoient, arbres épais, fraîche fontaine qui nourrissoit et les arbres et les fleurs ; mais la peinture, plus plaisante encore que tout le reste, étoit d’un sujet amoureux et de merveilleux artifice ; tellement que plusieurs, même étrangers, qui en avoient ouï parler, venoient là dévots aux Nymphes, et curieux de voir cette peinture. Femmes s’y voyoient accouchant, autres enveloppant de langes des enfants, de petits poupards exposés à la merci de fortune, bêtes qui les nourrissoient, pâtres qui les enlevoient, jeunes gens unis par amour, des pirates en mer, des ennemis à terre qui couroient le pays, avec bien d’autres choses, et toutes amoureuses, lesquelles je regardai en si grand plaisir et les trouvai si belles, qu’il me prit envie de les coucher par écrit. Si cherchai quelqu’un qui me les donnât à entendre par le menu ; et ayant le tout entendu, en composai ces quatre livres, que je dédie comme une offrande à Amour, aux Nymphes et à Pan, espérant que le conte en sera agréable à plusieurs manières de gens ; pour ce qu’il peut servir à guérir le malade, consoler le dolent, remettre en mémoire de ses amours celui qui autrefois aura été amoureux, et instruire celui qui ne l’aura encore point été. Car jamais ne fut ni ne sera qui se puisse tenir d’aimer, tant qu’il y aura beauté au monde, et que les yeux regarderont.
Nous-mêmes, veuille le Dieu que sages puissions ici parler des autres !
Mitylène est ville de Lesbos, belle et grande, coupée de canaux par l’eau de la mer qui flue dedans et tout à l’entour, ornée de ponts de pierre blanche et polie ; à voir, vous diriez non une ville, mais comme un amas de petites îles. Environ huit ou neuf lieues loin de cette ville de Mitylène, un riche homme avoit une terre : plus bel héritage n’étoit en toute la contrée ; bois remplis de gibier, coteaux revêtus de vignes, champs à porter froment, pâturages pour le bétail, et le tout au long de la marine, où le flot lavoit une plage étendue de sable fin.
En cette terre un chevrier nommé Lamon, gardant son troupeau, trouva un petit enfant qu’une de ses chèvres allaitoit, et voici la manière comment. Il y avoit un hallier fort épais de ronces et d’épines, tout couvert par-dessus de lierre, et au-dessous, la terre feutrée d’herbe menue et délicate, sur laquelle étoit le petit enfant gisant. Là s’encouroit cette chèvre, de sorte que bien souvent on ne savoit ce qu’elle devenoit, et abandonnant son chevreau, se tenoit auprès de l’enfant. Pitié vint à Lamon du chevreau délaissé. Un jour il prend garde par où elle alloit ; sur le chaud du midi, la suivant à la trace, il voit comme elle entroit sous le hallier doucement et passoit ses pattes tout beau par-dessus l’enfant, peur de lui faire mal ; et l’enfant prenoit à belles mains son pis comme si c’eût été mamelle de nourrice.
Surpris, ainsi qu’on peut penser, il approche, et trouve que c’étoit un petit garçon, beau, bien fait, et en plus riche maillot que convenir ne sembloit à tel abandon ; car il étoit enveloppé d’un mantelet de pourpre avec une agrafe d’or, près de lui avoit un petit couteau à manche d’ivoire.
Si fut entre deux d’emporter ces enseignes de reconnoissance, sans autrement se soucier de l’enfant ; puis ayant honte de ne se montrer du moins aussi humain que sa chèvre, quand la nuit fut venue il prend tout, et les joyaux, et l’enfant, et la chèvre qu’il conduisit à sa femme Myrtale, laquelle, ébahie, s’écria si à cette heure les chèvres faisoient de petits garçons ? et Lamon lui conta tout, comme il l’avoit trouvé gisant et la chèvre le nourrissant, et comment il avoit eu honte de le laisser périr. Elle fut bien d’avis que vraiment il ne l’avoit pas dû faire ; et tous deux d’accord de l’élever, ils serrèrent ce qui s’étoit trouvé quant et lui, disant partout qu’il est à eux, et afin que le nom même sentit mieux son pasteur, l’appelèrent Daphnis.
À quelque deux ans de là, un berger des environs, qui avoit nom Dryas, vit une toute pareille chose et trouva semblable aventure. Un antre étoit en ce canton, qu’on appeloit l’antre des Nymphes, grande et grosse roche creuse par le dedans, toute ronde par le dehors, et dedans y avoit les figures des Nymphes, taillées de pierre, les pieds sans chaussure, les bras nus jusques aux épaules, les cheveux épars autour du col, ceintes sur les reins, toutes ayant le visage riant et la contenance telle comme si elles eussent ballé ensemble.
Du milieu de la roche et du plus creux de l’antre sourdoit une fontaine, dont l’eau, qui s’épandoit en forme de bassin, nourrissoit là au-devant une herbe fraîche et touffue, et s’écouloit à travers le beau pré verdoyant.
On voyoit attachés au roc force seilles à traire le lait, force flûtes et chalumeaux, offrandes des anciens pasteurs.
En cette caverne une brebis, qui naguères avoit agnelé, alloit si souvent, que le berger la crut perdue plus d’une fois. La voulant châtier, afin qu’elle demeurât au troupeau, comme devant, à paître avec les autres, il coupe un scion de franc osier, dont il fit un collet en manière de lacs courant, et s’en venoit pour l’attraper au creux du rocher. Mais quand il y fut, il trouva autre chose : il voit la brebis donner son pis à un enfant, avec amour et douceur telles que mère autrement n’eût su faire ; et l’enfant, de sa petite bouche belle et nette, pour ce que la brebis lui léchoit le visage après qu’étoit saoul de teter, prenoit sans un seul cri puis l’un puis l’autre bout du pis, de grand appétit. Cet enfant étoit une fille, et avec elle aussi, pour marques à la pouvoir un jour connoître, on avoit laissé une coiffe de réseau d’or, des patins dorés et des chaussettes brodées d’or.
Dryas estimant cette rencontre venir expressément des Dieux, et instruit à la pitié par l’exemple de sa brebis, enlève l’enfant dans ses bras, met les joyaux dans son bissac, non sans faire prière aux Nymphes qu’à bonne heure pût-il élever leur pauvre petite suppliante ; puis, quand vint l’heure de remener son troupeau au tect, retournant au lieu de sa demeurance champêtre, conte à sa femme ce qu’il avoit vu, lui montre ce qu’il avoit trouvé, disant qu’elle ne feroit que bien si elle vouloit de là en avant tenir cet enfant pour sa fille, et comme sienne la nourrir, sans rien dire de telle aventure.
Napé, c’étoit le nom de la bergère, Napé, de ce moment, fut mère à la petite créature et tant l’aima qu’elle paroissoit proprement jalouse de surpasser en cela sa brebis, qui toujours l’allaitoit de son pis : et pour mieux faire croire qu’elle fût sienne, lui donna aussi un nom pastoral, la nommant Chloé.
Ces deux enfants en peu de temps devinrent grands, et d’une beauté qui sembloit autre que rustique. Et sur le point que l’un fut parvenu à l’âge de quinze ans, et l’autre de deux moins, Lamon et Dryas en une même nuit songèrent tous deux un tel songe. Il leur fut avis que les Nymphes, celles-là mêmes de l’antre où étoit cette fontaine, et où Dryas avoit trouvé la petite fille, livroient Daphnis et Chloé aux mains d’un jeune garçonnet fort vif et beau à merveille, qui avoit des ailes aux épaules, portoit un petit arc et de petites flèches, et les ayant touchés tous deux d’une même flèche, commandoit à l’un paître de là en avant les chèvres, et à l’autre les brebis. Telle vision aux bons pasteurs présageant le sort à venir de leurs nourrissons, bien leur fâchoit qu’ils fussent aussi destinés à garder les bêtes. Car jusque-là ils avoient cru que les marques trouvées quant et eux leur promettoient meilleure fortune, et aussi les avoient élevés plus délicatement qu’on ne fait les enfants des bergers, leur faisant apprendre les lettres, et tout le bien et honneur qui se pouvoit en un lieu champêtre ; si résolurent toutefois d’obéir aux Dieux touchant l’état de ceux qui par leur providence avoient été sauvés, et, après avoir communiqué leurs songes ensemble, et sacrifié en la caverne à ce jeune garçonnet qui avoit des ailes aux épaules (car ils n’en eussent su dire le nom), les envoyèrent aux champs, leur enseignant toutes choses que bergers doivent savoir, comment il faut faire paître les bêtes avant midi, et comment après que le chaud est passé ; à quelle heure convient les mener boire, à quelle heure les ramener au tect ; à quoi il est besoin user de la houlette, à quoi de la voix seulement.
Eux prirent cette charge avec autant de joie comme si c’eût été quelque grande seigneurie, et aimoient leurs chèvres et brebis trop plus affectueusement que n’est la coutume des bergers, pour ce qu’elle se sentoit tenue de la vie à une brebis, et lui de sa part se souvenoit qu’une chèvre l’avoit nourri.
Or étoit-il lors environ le commencement du printemps, que toutes fleurs sont en vigueur, celles des bois, celles des prés, et celles des montagnes. Aussi jà commençoit à s’ouïr par les champs bourdonnement d’abeilles, gazouillement d’oiseaux, bêlement d’agneaux nouveau-nés. Les troupeaux bondissoient sur les collines, les mouches à miel murmuroient par les prairies, les oiseaux faisoient resonner les buissons de leur chant.
Toutes choses adonc faisant bien leur devoir de s’égayer à la saison nouvelle, eux aussi, tendres, jeunes d’âge, se mirent à imiter ce qu’ils entendoient et voyoient. Car entendant chanter les oiseaux, ils chantoient ; voyant bondir les agneaux, ils sautoient à l’envi ; et, comme les abeilles, alloient cueillant des fleurs, dont ils jetoient les unes dans leur sein, et des autres arrangeoient des chapelets pour les Nymphes ; et toujours se tenoient ensemble, toute besogne faisoient en commun, paissant leurs troupeaux l’un près de l’autre.
Souventefois Daphnis alloit faire revenir les brebis de Chloé, qui s’étoient un peu loin écartées du troupeau ; souvent Chloé retenoit les chèvres trop hardies voulant monter au plus haut des rochers droits et coupés ; quelquefois l’un tout seul gardoit les deux troupeaux, pendant le temps que l’autre vaquoit à quelque jeu. Leurs jeux étoient jeux de bergers et d’enfants. Elle, s’en allant dès le matin cueillir quelque part du menu jonc, en faisoit une cage à cigale, et cependant ne se soucioit aucunement de son troupeau ; lui d’autre côté ayant coupé des roseaux, en pertuisoit les jointures, puis les colloit ensemble avec de la cire molle, et s’apprenoit à en jouer bien souvent jusques à la nuit. Quelquefois ils partageoient ensemble leur lait ou leur vin, et de tous vivres qu’ils avoient portés du logis se faisoient part l’un à l’autre. Bref, on eût plutôt vu les brebis dispersées paissant chacune à part, que l’un de l’autre séparés Daphnis et Chloé.
Or, parmi tels jeux enfantins, Amour leur voulut donner du souci. En ces quartiers y avoit une louve, laquelle ayant naguères louveté, ravissoit des autres troupeaux de la proie à foison, dont elle nourrissoit ses louveteaux ; et pour ce, gens assemblés des villages d’alentour faisoient la nuit des fosses d’une brasse de largeur et quatre de profondeur, et la terre qu’ils en tiroient, non toute, mais la plupart, l’épandoient au loin ; puis étendant sur l’ouverture des verges longues et grêles, les couvroient en semant par-dessus le demeurant de la terre, afin que la place parût toute plaine et unie comme devant ; en sorte que s’il n’eût passé par-dessus qu’un lièvre en courant, il eût rompu les verges, qui étoient, par manière de dire, plus foibles que brins de paille, et lors eût-on bien vu que ce n’étoit point terre ferme, mais une feinte seulement.
Ayant fait plusieurs telles fosses en la montagne et en la plaine, ils ne purent prendre la louve, car elle sentit l’embûche ; mais furent cause que plusieurs chèvres et brebis périrent, et presque Daphnis lui-même par tel inconvénient
Deux boucs s’échauffèrent de jalousie à cosser l’un contre l’autre, et si rudement se heurtèrent que la corne de l’un fut rompue ; de quoi sentant grande douleur celui qui étoit écorné, se mit en bramant à fuir, et le victorieux à le poursuivre, sans le vouloir laisser en paix. Daphnis fut marri de voir ce bouc mutilé de sa corne ; et, se courrouçant à l’autre, qui encore n’étoit content de l’avoir ainsi laidement accoutré, si prend en son poing sa houlette et s’en court après ce poursuivant. De cette façon le bouc fuyant les coups, et lui le poursuivant en courroux, guères ne regardoient devant eux ; et tous deux tombèrent dans un de ces pièges, le bouc le premier et Daphnis après, ce qui l’engarda de se faire mal, pour ce que le bouc soutint sa chute. Or au fond de cette fosse, il attendoit si quelqu’un viendroit point l’en retirer et pleuroit.
Chloé ayant de loin vu son accident, accourt, et voyant qu’il étoit en vie, s’en va vite appeler au secours un bouvier de là auprès. Le bouvier vint : il eût bien voulu avoir une corde à lui tendre, mais ils n’en purent trouver brin.