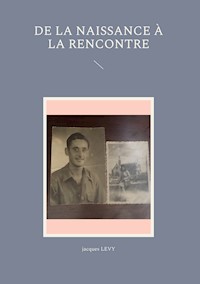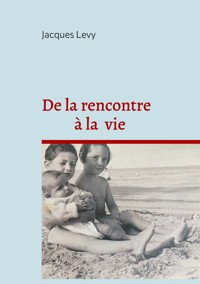
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Des origines à la naissance
- Sprache: Französisch
Après les deux premiers tomes de cette saga familiale, "Des origines à la naissance" et "De la naissance à la rencontre", voici : De la rencontre à la vie Ce récit romancé retrace la rencontre de Roger Lévy et d'Emma Einhorn dont seront issus Fanny, Jacques et Michèle. Cette période couvre les années 1946 à 1954. Les personnages et les évènements de cette époque pas si lointaine pour les lecteurs de ma génération mais oh combien reculée pour la jeunesse d'aujourd'hui, sont dépeints avec justesse et réalisme. Cette époque de la reconstruction de la France après le cataclysme de la Deuxième Guerre mondiale, rude et difficile, apparait comme bien lointaine par rapport au confort dans lequel baigne la génération actuelle. La petite histoire familiale des années 1950 est enveloppée dans la Grande histoire de notre pays.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EN HOMMAGE AUX FAMILLES
LEVY & EINHORN
DU MÊME AUTEUR
DES ORIGINES À LA NAISSANCE
DE LA NAISSANCE À LA RENCONTRE
TABLE DES MATIÉRES
CHAPITRE I Emma et Roger, la rencontre
CHAPITRE II Emma, la punition
CHAPITRE III Roger, la surprise
CHAPITRE IV Roger et Emma, ensemble
CHAPITREV Roger, de La Rochelle à Angoumême
CHAPITRE VI Roger à Angoulême
CHAPITRE VII Les préparatifs du mariage
CHAPITRE VIII Le mariage
CHAPITRE IX Les premiers pas du commerçant
CHAPITRE X La rue Chabrefy
CHAPITRE XI Le voyage en Algérie
CHAPITRE XII Un décès
CHAPITRE XIII La première naissance, Fanny
CHAPITRE XIV L’entre deux
CHAPITRE XV La deuxième naissance, Jacques
CHAPITRE XVI Le couple et ses deux enfants
CHAPITRE XVII La troisième naissance, Michèle
POST-SCRIPTUM
ÉPILOGUE
CHAPITRE I
EMMA et ROGER LA RENCONTRE
Nous sommes le 25 août 1946, aux environs de dix-sept heures. Emma Einhorn et Roger Lévy, qui ne se connaissent ni d’Ève ni d’Adam, terminent un paso-doble endiablé. La scène se déroule au dancing du casino de La Rochelle, la préfecture d’un département de la côte Atlantique, la Charente Maritime. Au terme d’une courte conversation, les deux jeunes gens découvrent avec stupéfaction qu’ils sont, l’un comme l’autre, de religion israélite.
Le 8 mai de l’année 1945, la Deuxième Guerre mondiale vient de se terminer en Europe. Le Reich allemand est vaincu. Par la grâce de ce terrible conflit, le plus barbare de toute l’histoire de l’humanité, et par le plus pur des hasards, Emma et Roger se retrouvent face à face aujourd’hui.
Revenons un petit peu en arrière.
En 1939, Herch ou Hermann, dont le prénom a été francisé pour être remplacé par Armand, et Fanny Einhorn, les parents d’Emma, tiennent boutique de tissus dans la ville de Forbach. Cette cité minière se trouve à l’extrême Est de la France, pratiquement sur la frontière avec l’Allemagne. Emma court sur ses dix-huit ans. En compagnie de ses cinq frères et sœurs, elle coule des jours heureux dans ce petit coin tranquille de la Lorraine.
Au mois de septembre, l’Allemagne hitlérienne envahit la Pologne. La France ne peut plus reculer. Afin d’honorer ses engagements, la mort dans l’âme, notre pays déclare la guerre au dictateur nazi. La famille Einhorn, comme toute la population civile de Forbach, se voit contrainte, par ordre du gouvernement, de se réfugier à Angoulême, la préfecture du département de la Charente. La défaite cuisante de l’armée française et l’occupation de notre pays par une horde de barbares obligent cette famille, du fait de son appartenance à la religion juive, à fuir et à se cacher durant cinq longues années. Une fois la paix revenue, Emma et ses parents retrouvent Angoulême. Sans véritable profession, elle se met au service de Juliette, sa sœur aînée.
En 1940, Juliette épouse Robert Mallat, un artisan fourreur charentais de religion catholique. Rapidement, elle met au monde Danielle, et, se sentant protégée par son mari, elle ne cherche pas à fuir les Allemands. Mal lui en a pris, car en 1942, après une horrible rafle, elle se retrouve internée au camp de Drancy, l’antichambre d’Auschwitz. Par miracle et surtout grâce à de solides relations, Robert, in extremis, réussit l’exploit de l’extraire des griffes des criminels nazis. Pour plus de sécurité, Juliette passera le reste de la guerre cachée dans la campagne charentaise.
Au mois de septembre 1944, Angoulême est libérée. Juliette a la bosse du commerce, et les affaires de la maison Mallat reprennent. Les manteaux de fourrure se vendent bien, et Annette, son deuxième enfant, apparaît. Ne pouvant être au four et au moulin, la fille aînée d’Armand Einhorn fait donc appel à Emma, sa jeune sœur, pour s’occuper de sa maisonnée.
Au mois d’août 1946, après un rude hiver de travail, Robert Mallat décide d’offrir des vacances au bord de la mer à sa petite famille. Il opte pour La Rochelle, distante d’une centaine de kilomètres. Emma, afin de s’occuper de l’intendance, fait partie des bagages. Sa sœur, dotée d’un caractère autoritaire, lui mène la vie dure. Elle n’a droit qu’à une seule après-midi de congé par semaine, le dimanche.
Emma adore la musique et la danse. Les 18 et 25 août 1946, le casino de La Rochelle organise un bal gratuit pour les jeunes filles. Emma saute sur l’aubaine, et c’est ainsi qu’elle se retrouve face à Roger.
En 1939, Roger Lévy coule des jours heureux à Alger, alors préfecture française du département d’Algérie. Jacob, son père, est déjà gravement malade des suites d’un gazage datant de la Première Guerre mondiale, tandis que Camille, sa mère, a passé toute sa vie dans les langes, avec pas moins de neuf enfants. Dès l’âge de quatorze ans, Roger, faute d’argent, et malgré avoir brillamment obtenu son certificat d’études, est obligé de travailler. Comme son père, il exerce la profession de peintre en bâtiment.
Après la défaite de la France, un gouvernement pétainiste franchement antisémite s’installe à Alger. La famille Lévy, du fait de son appartenance à la religion juive subit bien des brimades et des humiliations. Toutefois, leur sort n’est tout de même pas comparable à celui de leurs coreligionnaires installés en Europe, qui sont massacrés par millions.
En 1942, après le débarquement des troupes américaines à Alger, l’espoir renaît pour les Juifs.
Au mois de janvier 1943, Roger Lévy est mobilisé dans l’armée française d’Afrique, et il participe alors à la campagne de Tunisie.
Au mois d’octobre 1944, le soldat Lévy, âgé de vingt-quatre ans, quitte son Algérie natale. Il découvre alors la France métropolitaine. Il débarque en Provence sous les ordres du général de Lattre de Tassigny, et il est affecté au sein du quatrième régiment de zouaves.
Au début de l’année 1945, alors que Paris et une grande partie de la France sont libérés, il subsiste à l’ouest du pays quelques poches de résistance. Les deux principales se situent dans le département de la Charente Maritime, à Royan et à La Rochelle. Le général de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire, juge cette situation inadmissible. De plus, pour son prestige, il lui faut absolument une victoire française !
En janvier et avril 1945, Royan est écrasée sous les bombes anglaises et américaines. La ville est anéantie. Roger fait partie des combattants qui, de haute lutte, reprennent à la Wehrmacht les ruines fumantes de cette cité martyre. La Rochelle, grâce à une habile négociation, s’en tire mieux et échappe à la destruction. Au mois de mai, lors de l’armistice, les troupes allemandes qui occupent la préfecture de la Charente Maritime se rendent sans combattre aux Forces françaises libres. Le quatrième zouave y prend alors ses quartiers.
Au mois de janvier 1946, le soldat Lévy est démobilisé. Il décide de rester à La Rochelle, où il reprend le métier de peintre en bâtiment qu’il exerçait à Alger avant la guerre. Le travail ne manque pas et il se fait rapidement embaucher par l’entreprise de Monsieur Courtois. Le dimanche, Roger aime danser, et aussi rencontrer de jolies filles. C’est ainsi qu’il se retrouve, au mois d’août, au dancing du casino face à Emma.
Les dernières notes du paso-doble sont à peine terminées, que le jeune homme, venant d’apprendre que la jeune femme devant lui est de religion israélite, déclare d’une voix tremblante : « Moi aussi je suis Juif. Mon véritable nom, c’est Roger Martin Lévy. »
Les hostilités sont terminées en Europe depuis un peu plus d’une année, et le monde horrifié a découvert les atrocités commises par les nazis dans les camps de concentration. Les survivants juifs sont traumatisés, et ils le resteront d’ailleurs encore pendant des décennies. À présent, par crainte de l’antisémitisme, beaucoup n’osent pas avouer leur religion. En effet, le poison est toujours présent dans la société française. Même si certains Juifs ont été cachés pendant la guerre par des Français courageux au grand cœur, ils ne peuvent pas oublier tous ces miliciens pro-nazi, ni les nombreux fonctionnaires de police qui ont participé activement aux rafles. Si beaucoup s’apitoient sur le sort des Israélites pendant la guerre, il y en a toujours pour faire des réflexions telles que :
« Après tout, ils l’ont bien cherché ! » Ou bien : « Ils sont tous riches à millions, ça leur a pas fait de mal ! »
De surcroît, les événements qui se sont déroulés le mois dernier dans la ville polonaise de Kielce, située à cent soixante-dix kilomètres au sud de Varsovie, ne sont pas faits pour rassurer la Communauté juive, bien au contraire. Pendant l’été 1946, environ deux cents Juifs, pour la plupart des rescapés des camps de concentration nazis y vivent. Beaucoup sont en attente de partir pour la Palestine, le futur État d’Israël.
Le 1er juillet, un petit garçon polonais âgé de huit ans disparaît. Lorsqu’il revient chez ses parents au bout de trois jours, pour ne pas se faire gronder, il prétend avoir été enlevé et désigne un Juif à la vindicte populaire. Le prétexte est bon pour un nouveau pogrom, c’est-à-dire un déferlement de haine et de violence gratuite contre la population israélite. Dans un premier temps les policiers arrêtent la personne incriminée, bien sûr à tort, et l’armée fait irruption, tirant sur des groupes de Juifs. L’après-midi, ce sont des ouvriers d’une usine voisine, qui, tenus au courant de la fausse rumeur, se livrent à un terrible massacre, sans que la police et les autorités ne daignent bouger le plus petit doigt. À la fin de la journée, on dénombre quarante-deux morts et quatre-vingts blessés, toutes victimes innocentes de l’antisémitisme, même après la révélation de la Shoah et de ses six millions de martyrs. Le mensonge de l’enfant ne sera établi que bien plus tard.
Pendant ce même mois de juillet 1946, un autre événement met le peuple juif sur le devant de la scène internationale. Dès avant la guerre, des tensions grandissent entre les Juifs, les Arabes, et la Grande-Bretagne, qui est la puissance détentrice de la tutelle sur la Palestine. Les Anglais ont obtenu ce mandat en 1923, ce territoire appartenant auparavant à l’Empire ottoman. Des incidents, souvent meurtriers, se multiplient après la chute du Troisième Reich et la volonté légitime des Israélites de constituer une nation sur une partie de ce pays. Les Britanniques, ne voulant pas se mettre à dos les Arabes, essaient tant bien que mal de maintenir le statut quo, en particulier en stoppant l’immigration des rescapés de l’holocauste, mais en vain. À présent, les rôles sont inversés, et les Juifs ne se laissent plus faire.
Menahem Begin est à la tête d’une organisation combattante sioniste nommée Irgoun. L’ennemi est alors l’armée anglaise. Le 22 juillet, les habitants de Jérusalem entendent une énorme déflagration. Une aile entière de l’hôtel King David, qui abrite le quartier général des forces britanniques, explose. On retire des décombres quatre-vingt-douze cadavres. Cet attentat est un des éléments qui précipitent le départ des troupes anglaises. Trente années plus tard, Menahem Begin, le dur à cuire, l’homme qui s’est battu les armes à la main sur tous les fronts depuis 1943, sera élu Premier ministre de l’État d’Israël.
Ainsi Roger, lorsque, pour une raison ou une autre, doit décliner son identité, il commet simplement un mensonge par omission, en énonçant ses deux prénoms, Roger Martin. Il prétend donc s’appeler Roger de son prénom, et Martin de son patronyme. Divulguer à n’importe qui le nom de Lévy le cataloguerait immédiatement comme Israélite.
Mais aujourd’hui, il a en face de lui une belle jeune fille qui vient de lui avouer son appartenance au Peuple élu. La vérité sort alors tout naturellement de sa bouche : « Moi aussi, je suis Juif. »
Roger Lévy et Emma Einhorn se regardent avec une rare intensité. Cupidon vient d’envoyer sa petite flèche au plus profond de leurs deux cœurs.
Déjà, l’orchestre attaque une valse. Le mot valse vient de l’allemand « Walzer », qui signifie « tourner en rond ». Cette danse a gagné ses lettres de noblesse dans les années 1780 à Vienne, en Autriche, avant de se répandre dans tous les pays d’Europe. Aujourd’hui, le pianiste, un élégant jeune homme à l’abondante chevelure blonde, entame, en solo, les premières notes du « beau Danube bleu » de Johann Strauss. Les premiers couples se forment et prennent possession du plancher. Roger hésite quelques secondes, puis il enlace fermement sa cavalière. La jeune femme, au contact de la main de Roger tressaille. Puis, c’est un tourbillon. Emma, sous l’emprise de son cavalier, virevolte, alternativement à droite et à gauche. Leurs deux bustes se frôlent, mais ne se touchent pas. Lorsque les doigts du pianiste s’immobilisent sur la dernière mesure, Roger, emporté par son élan, se fige brusquement. Emma, surprise, glisse sur le parquet verni et il faut toute la dextérité de son partenaire pour la retenir. Il la relève avec douceur et il pense son visage vers elle. « Ça va, Mademoiselle ? » chuchote-t-il, et, sans attendre la réponse, il pose chastement ses lèvres à la base de son cou. Emma se redresse en faisant mine d’être courroucée. Elle ouvre en grand ses yeux vert amande, puis elle s’écrie : « Mais enfin, Monsieur ! »
Aussitôt, le visage du « Monsieur » prend une couleur rouge cramoisie, et il bredouille maladroitement quelques mots d’excuse. C’est alors que l’accordéoniste entre en scène. Un tonnerre d’applaudissements jaillit de la salle lorsque les danseurs reconnaissent le morceau joué par le musicien. C’est la chanson « Maria », interprétée normalement par Tino Rossi, le célèbre chanteur corse. La mélodie débute par ces mots :
« Maria quand je vois tes yeux pour moi la vie est plus belle et tout est merveilleux… » Emma esquisse alors un petit sourire, et Roger comprend que Tino lui a sauvé la vie. Nos deux jeunes gens s’embarquent aussitôt dans un tango langoureux, et souhaitent en secret que l’instrument à clavier et à vent ne s’arrête jamais. Cependant, tout a une fin, même les meilleures choses. Au bout de trois minutes et dix secondes de bonheur, les dernières paroles de la chanson jaillissent : « Maria, nous ferons nous deux jusqu’au jour le plus beau des rêves d’amour. » De nouveau, toute la salle applaudit. Roger tente à nouveau sa chance.
« Mademoiselle Emma, vous êtes pour moi comme la Maria de la chanson. Vos beaux yeux verts me rendent la vie plus belle… »
Emma éclate de rire.
« Arrêtez, Monsieur, vous vous moquez de moi ! »
« Accepteriez-vous que je vous offre un verre ? » interroge Roger, l’air subitement sérieux.
Emma hésite, puis finalement elle ne refuse pas l’invitation.
« Qu’est-ce que je risque, » se dit-elle. « Après tout, il ne va pas me manger, et je ne suis pas en chocolat. »
Attenante à la salle de danse, une jolie terrasse bien ombragée, avec vue sur la mer, fait office de buvette. À l’horizon, on peut distinguer les contours de l’île de Ré. Emma et Roger prennent place, l’un en face de l’autre, autour d’une table de bistrot ronde dont le pied en fonte de couleur noir est surmonté par un élégant plateau en marbre. Émile, le garçon, un grand brun à l’allure dynamique s’approche et prend la commande. Pour Emma ce sera une limonade avec un peu de sirop de menthe, tandis que Roger pense pouvoir étancher sa soif avec un demi de bière pression. Roger, un peu timide, ne sait comment entamer la conversation. Enfin, il se lance, avec cette question d’une banalité affligeante : « Vous venez souvent ici ? »
« Avec dimanche dernier, c’est seulement la deuxième fois, et parce que c’est gratuit pour les filles. Voyez-vous, Monsieur, je n’ai pas beaucoup d’argent et je travaille toute la semaine, » répond Emma.
Émile, avec une efficacité surprenante, est déjà de retour, empêchant Roger de prendre la parole. Après un rapide coup de torchon sur la table, il dépose les boissons, avec l’addition bien en évidence. Roger sort de la poche intérieure de sa veste en lin un portefeuille usagé en cuir marron qu’il avait reçu en cadeau à l’occasion de sa Bar-mitsvah à l’âge de treize ans et un jour. Il en sort négligemment un billet de cent francs et lance à Émile un royal : « Gardez tout ! »
Ce dernier remercie et s’éclipse. Roger peut donc poursuivre.
« Il me semble, à entendre votre charmant accent, que vous êtes peut-être d’origine étrangère. »
Emma explique alors les origines polonaises de son père et alsaciennes de sa mère.
« À la maison, avec mes parents, on parlait surtout le yiddish, mais pendant la guerre, on a bien fait attention à n’utiliser que le français. Avant 1939, j’ai vécu en Allemagne et en Lorraine, à Forbach. Mais vous aussi, Monsieur, vous avez un drôle d’accent. »
Roger explique alors à son tour les origines algériennes de sa famille.
« Mais attention, nous ne sommes pas des Arabes ! Nous sommes des Français, grâce à un décret qui date de 1870. Ainsi, tous les Juifs d’Algérie ont obtenu la nationalité française. »
Sur ces entrefaites, tous deux, tenaillés par la soif, vident d’un trait la moitié de leur verre.
C’est Emma qui relance la discussion.
« Et que faites-vous de beau à La Rochelle ? »
En deux temps et trois mouvements, chacun connaît presque tout de l’autre. Roger se présente comme le libérateur de la France, et Emma comme une malheureuse victime du régime nazi.
Le libérateur se sent tout à fait prêt à consoler la pauvre victime, et propose pour cela de retourner sur la piste. Emma et Roger terminent leur boisson jusqu’à la dernière goutte, puis ils s’engouffrent, tout émoustillés, dans la salle de danse. Justement, l’accordéoniste amorce un morceau célèbre depuis l’année 1938, la « java bleue ». Aussitôt les couples envahissent, mais de façon tout à fait pacifique, le plancher ciré. Emma et Roger ne sont pas en reste, et ils tourbillonnent en mesure, les yeux dans les yeux. À la fin du dernier accord, Emma, essoufflée, jette un œil à la pendule accrochée à un mur de la salle. Horreur, il est déjà plus de dix-huit heures ! Sachant qu’elle a une bonne vingtaine de minutes de marche pour regagner l’appartement loué par Robert, son beau-frère, elle sait, d’ores et déjà, qu’elle va être en retard. Si Robert est plutôt bon enfant, Juliette, sa sœur, est une vraie « peau de vache » !
« Si je ne suis pas rentrée à dix-huit heures trente, je vais me faire appeler « Simone », » se lamente-t-elle.
Roger, qui n’a jamais entendu parler de cette Simone, comprend tout de même qu’il y a urgence pour sa cavalière, et que celle-ci doit rentrer dare dare à la maison.
« Allons-y ! » lance Roger, d’un ton énergique.
« Monsieur, vous n’y pensez pas, et si ma sœur nous voyait ? » proteste Emma.
« Ne vous inquiétez pas, je ferai bien attention de m’arrêter un peu avant votre domicile, » répond Roger d’un ton maintenant rassurant.
Sans attendre, ils prennent la route. Au bout d’une centaine de mètres, arrivé à l’extrémité de l’avenue du Mail, pratiquement au niveau de la plage de la Concurrence, Roger prend le bras d’Emma. Celle-ci ne bronche pas, mais, faute à ses talons hauts, elle a du mal à le suivre. Emma, du haut de son petit mètre et cinquante-cinq centimètres, use de cet artifice à chacune de ses sorties afin d’essayer de paraître un peu plus grande. Mais, face au mètre soixante-seize de Roger, la différence est encore flagrante. Le jeune homme doit ralentir son pas, car Emma doit à présent trottiner pour se maintenir à son niveau. Le couple passe devant la tour de la Lanterne, le phare de style gothique qui domine le port, puis il emprunte à toute vitesse la rue sur les Murs, avant d’arriver en vue de la tour de la Chaîne, la forteresse chargée autrefois de défendre la cité. Bras dessus, bras dessous, les voilà maintenant sur le cours des Dames, appelé ainsi en souvenir des femmes de marins qui venaient à cet endroit attendre le retour de leurs époux. À leur droite apparaît le quai Duperré, qu’il leur faut parcourir entièrement afin d’arriver au lieu de villégiature de la famille Mallat. L’appartement se situe au croisement du quai Maubec. En passant devant la façade nord de la « Grosse Horloge », Emma jette un œil craintif : La petite aiguille est figée sur le chiffre sept, tandis que la grande fonce à toute allure en direction du chiffre neuf.
« Après-tout, engueulade pour engueulade, on n’est plus désormais à un quart d’heure près, » se dit-elle pour se réconforter. « Autant profiter jusqu’au bout de la présence de ce beau jeune homme. »
Et il est vrai que Roger est ce qu’on appelle un beau garçon. Il est de bonne taille, avec les épaules larges et la silhouette élancée. Voilà pour l’aspect général. Quant au visage, peu de reproches également sont à lui faire. Ses épais cheveux noirs ondulés coiffés en arrière laissent la place à un large front, son nez régulier est bien dessiné, son sourire charmeur est rehaussé d’une petite moustache fine et bien taillée, et ses grands yeux marron clair lui lancent des éclairs de braise. Finalement, Emma ressent une certaine fierté d’être suspendu à son bras. Elle scrute le regard des femmes qui les croisent, et il lui semble discerner dans leurs yeux une pointe de jalousie, ce dont elle s’accommode fort bien. Elle est toujours fidèle à sa maxime, qui date des terribles années de guerre qu’elle a vécues : « Il vaut mieux faire envie que pitié. »
Arrivée à une cinquantaine de mètres de son logement, Emma se fige brusquement. Elle aperçoit à la fenêtre du premier étage la frimousse d’une petite fille. Danielle, sa nièce âgée de bientôt cinq ans regarde en sa direction ! Par miracle, la porte cochère d’une belle demeure bourgeoise se trouve sur son chemin, grande ouverte. Elle y entraîne Roger afin de se soustraire à la vue de l’enfant. Surpris, le jeune homme prend cela pour une invitation. Emma positionne son index verticalement au milieu de ses lèvres, desquelles sort la syllabe chut… Roger, ignorant ce geste, se penche lentement vers elle, et l’embrasse délicatement sur la commissure de ces mêmes lèvres. Emma ne proteste pas, au contraire, elle esquisse un léger sourire. Ne pouvant en rester là, les deux jeunes gens se laissent aller à un baiser plus fougueux. Leurs langues se frôlent. Emma ressent une excitation inhabituelle, surtout lorsqu’elle a la sensation qu’une masse de plus en plus dure s’écrase contre son ventre. À bout de souffle, elle repousse Roger.
« Il faut absolument que je rentre. »
« Quand est-ce que je peux vous revoir ? »
Et là, le monde s’écroule devant Emma. Elle a complètement oublié la date de son départ, qui est prévu pour le lendemain. Elle parvient à bafouiller :
« Écoutez, Monsieur, je dois partir demain matin pour Angoulême. »
« Donnez-moi votre adresse là-bas, » lui répond Roger après un court instant de réflexion.
« Mais pour quoi faire ? »
Devant l’insistance de Roger, Emma s’exécute.
« J’habite chez mon père, Armand Einhorn, à Angoulême, au premier étage du numéro huit de la rue Chabrefy. »
Roger veut l’embrasser à nouveau, mais Emma se dégage, et elle s’enfuit sans se retourner.
« À quoi bon, ce garçon est un beau parleur, je ne le reverrai jamais plus, » se dit-elle en s’engouffrant à l’intérieur de son immeuble. « Tout ce que je vais gagner, c’est une bonne dispute de la part de Juliette. »
Emma n’a pas tort. À peine a-t-elle franchi la porte de l’appartement, que sa sœur apparaît, les deux poings sur les hanches. Juliette est, à quelque chose près, de la même taille qu’Emma, peut-être même un poil plus petite, mais elle essaie tout de même de la toiser de haut.
« C’est à cette heure-ci que tu rentres ? » hurle-t-elle de sa voix aiguë.
« Excuse-moi, Juliette, je n’ai pas fait attention… »
« Menteuse, Danielle t’a vue ! Elle m’a dit que tu étais avec un homme d’allure bizarre, très brun. Tu n’es qu’une traînée ! Et d’abord, qui c’était, cet homme ? »
Emma, décontenancée, commence par rougir et par bafouiller quelques mots inaudibles, puis elle se reprend. Piquée au vif, elle se redresse de dix bons centimètres, et lance au visage de sa sœur cette phrase qui lui sort de je ne sais quelle partie de son cerveau encore embrumé par sa rencontre.
« Cet homme, si tu veux le savoir, il s’appelle Monsieur Lévy, et il m’a demandé en mariage, » invente-t-elle de toutes pièces.
Juliette reste coite, comme si la foudre l’avait frappée. Toutefois, elle se ressaisit rapidement, traite sa sœur de folle, et lui demande de s’occuper du repas du soir. Emma s’exécute docilement, et pour l’instant tout rentre dans l’ordre. Après que la famille Mallat eut rapidement dîné, elle se rassasie avec les restes, c’est-à-dire une part d’omelette aux pommes de terre et trois sardines grillées qui se battent en duel au fond de la poêle. Lorsqu’elle nettoie le garde-manger, elle y découvre, oublié dans un coin, un morceau de camembert bien coulant. Elle l’étale sur un croûton de pain, et se régale en l’engloutissant d’une seule bouchée.
Cette journée mémorable se termine, et Emma va se coucher, la tête pleine d’étoiles, mais le cœur plein de remords. Comment dorénavant se sortir de ce gros mensonge, car c’est sûr, elle ne reverra plus jamais le beau Roger. C’est évidemment impossible, puisqu’elle part de La Rochelle le lendemain.
« Et cette demande en mariage, mais comment ai-je pu inventer ça ? Espérons que Juliette n’y pense plus, et surtout qu’elle ne dira rien ni à maman, ni à papa, » rumine-t-elle.
C’est que les parents Einhorn ne sont pas des gens commodes. Il faut dire qu’à cette époque, lorsqu’elle n’est pas mariée, une jeune femme, même âgée de vingt-cinq ans, doit respecter certaines règles. En 1946, s’afficher toute seule avec un homme, de surcroît inconnu de la famille, est une chose proscrite par les bonnes mœurs.
CHAPITRE II
EMMA, LA PUNITION
Le lundi 26 août au matin, tout le monde est sur le pont, prêt à partir. Emma s’est levée pratiquement à l’aube afin d’effectuer le grand ménage et rendre l’appartement de location nickel chrome. Pour Juliette et Robert Mallat les vacances du mois d’août sont terminées, et le magasin de fourrure doit ouvrir dès le lendemain. C’est le moment de préparer la saison d’hiver. Juliette, qui se charge de la partie commerciale a déjà programmé son voyage à Paris, prévu pour la première semaine de septembre. Armand, son père, étant lui aussi commerçant, lui a répété maintes et maintes fois les bases du métier :
« Pour bien vendre, il s’agit tout d’abord de bien acheter. »
Juliette applique cette règle à la lettre. Pas fainéante pour un sou, elle se lève à l’aube afin de se rendre à la gare d’Angoulême. Au bout d’un trajet de près de cinq heures qui la mène à Paris, elle saute dans le premier métro venu pour descendre à la station du Sentier. Parvenue rue d’Aboukir, il ne lui reste plus qu’à discuter pied à pied avec ses fournisseurs. Et marchander, çà, elle sait faire. Après avoir choisi les plus belles peaux, elle sort de son sac à main une liasse de billets de mille francs qu’elle agite devant le nez du grossiste.
« Je n’en ai pas un de plus, et si vous n’êtes pas d’accord sur mon prix, je vais chez votre concurrent au bout de la rue, » menace-t-elle en se dirigeant déjà vers la sortie du magasin.
À ce petit jeu-là, Juliette gagne à tous les coups. Le soir, elle rentre fourbue, mais avec la satisfaction du devoir accompli. Elle sait que trois jours plus tard, la marchandise sera livrée, rubis sur l’ongle, au numéro trois de la rue Marengo.
Robert s’occupe quant à lui de la partie technique. Dès son plus jeune âge, son père lui a inculqué le métier de fourreur. À présent, il n’a pas son pareil pour assembler des peaux d’animaux tannées, teintées et transformées en fourrure afin de confectionner manteaux et pelisses très prisées par ces dames de la "haute société" d’Angoulême.
La fortune des Mallat a débuté en janvier 1946 par un gros coup de chance. Juliette, avec son habileté coutumière, a su flairer la bonne affaire lorsqu’elle a appris que le directeur de la banque contiguë à son petit magasin, désirait s’agrandir. Elle a pu ainsi troquer, sans bourse délier, son petit local de la place Bouillaud, très mal placé, par un autre, celui-là idéalement situé au numéro trois de la rue Marengo, la principale artère commerçante d’Angoulême.
« Le Renard bleu » est devenu en quelques mois une adresse incontournable, où l’on peut croiser Madame la préfète, Madame la femme du Commissaire de police, Madame Denis, l’épouse du maire de la ville, ou bien encore de grandes bourgeoises, mariées à de riches industriels. Angoulême est alors le siège de nombreuses entreprises importantes. Parmi elles, on trouve celle de Monsieur Leroy, fondateur des usines du même nom, qui fabriquent des moteurs électriques dans le quartier de Sillac. De son côté, installée dans le quartier de Saint Cybard, la famille Bardou a fait de la préfecture de la Charente la capitale du papier à cigarette. Toutes ces femmes adorent se retrouver dans des soirées mondaines, habillées de vison, d’hermine ou d’astrakan.
Emma, après trois semaines passées à La Rochelle, retrouve avec un peu de tristesse sa bonne ville d’Angoulême et son petit train-train quotidien. Tôt le matin, elle quitte le domicile de ses parents situé au numéro huit de la rue Chabrefy, juste derrière le Palais de justice. C’est un taudis qui se trouve au premier étage d’un méchant immeuble à la façade grisâtre. Il appartient à une certaine Madame Gauthier, une riche bourgeoise propriétaire de plusieurs logements. Certes, le loyer est modeste, mais il ne faut espérer aucuns travaux d’amélioration, et, vu la crise du logement, mieux vaut ne pas faire la fine bouche.
La famille Einhorn loue ce modeste deux-pièces sans confort avec water-closet au fond d’une cour lugubre, depuis son arrivée à Angoulême, au mois de septembre 1939. En juin 1940, la Wehrmacht envahit la ville, et, deux années plus tard, en août 1942, les nazis se montrent chaque jour plus menaçants envers la population juive. Armand et Fanny, les parents, accompagnés de leurs filles Emma, Sophie et Lina parviennent, grâce à l’aide précieuse de Robert Mallat, leur gendre, à franchir clandestinement la ligne de démarcation et à se réfugier en zone dite libre. Malheureusement, cette partie de la France sera elle aussi rapidement occupée, et durant les deux années suivantes, ils devront vivre cachés, de façon misérable, avec toujours la peur au ventre de se faire dénoncer. En septembre 1944, après le départ des troupes allemandes vaincues, ils retrouvent leur modeste logement.
En ce vendredi 30 août 1946, veille de Chabbat, Emma part donc vers sept heures et trente minutes du matin en direction du numéro treize de la rue d’Iéna, la vaste et confortable maison où habitent Juliette et Robert Mallat, respectivement sa sœur et son beau-frère. Sans forcer l’allure, il ne lui faut pas plus d’un quart d’heure pour longer la rue Ludovic Trarieux, prendre à gauche la rue des Postes, puis tourner à droite et traverser la place Bouillaud. Il ne lui reste plus ensuite qu’à franchir la place du Parc et l’avenue des Maréchaux, légèrement avant le théâtre, afin d’arriver rue d’Iéna. Sa destination se trouve sur sa droite. Cette demeure bourgeoise est située dans un quartier chic qui abrite des cabinets de médecins, dentistes, avocats ou autres notaires. Emma possédant la clef, elle ouvre discrètement la porte d’entrée qui donne sur un long couloir pavé de grands carreaux noirs et blancs. Elle se dirige vers la première pièce sur sa droite et atterrit dans la cuisine, où Juliette et Robert terminent tranquillement leur petit-déjeuner, alors que leurs deux filles, Danielle et Annette, dorment encore dans leur chambre du premier étage.
Contre vents et marées, Emma est toujours de bonne humeur. Même quand cela ne va pas, son moral reste d’acier.
« Ya pire, » se plaît-elle à répéter. Ainsi, avec son sourire habituel, elle souhaite un bon appétit à sa sœur et à son beau-frère, et leur fait en passant une bise sur la joue droite, puis sur la joue gauche. Jetant un coup d’œil en direction de l’évier encombré des plats du dîner de la veille, elle se met en devoir de faire la vaisselle. Robert termine son bol de café au lait en avalant une dernière tranche de pain beurré et se dirige vers l’arrière de la maison, où est garée son automobile. Depuis quelques jours il entend un drôle de bruit au niveau de la roue avant gauche. Peut-être un joint de cardan ? En tout cas il veut en avoir le cœur net, et il décide de conduire sa Traction Avant au garage Citroën. Juliette termine de se préparer avec soin, car elle se fait une règle d’être impeccable de la tête aux pieds. En toutes circonstances, il faut qu’elle fasse bonne figure face à sa clientèle huppée. C’est cela aussi, une des bases du commerce. Avant de partir à son magasin, une fois la dernière couche de rouge à lèvres appliquée, Juliette annonce à sa sœur qu’elle assistera au repas du Chabbat avec ses parents.
« Robert gardera les enfants. Quant à moi, j’emporterai la viande, du hareng fumé, et une bouteille de vin, » lance-t-elle avec une certaine fierté.
En 1946, les tickets de rationnement sont toujours en vigueur et se procurer de la nourriture n’est pas toujours une chose aisée. Pourtant, pour la famille Mallat qui dispose de l’argent et de relations haut placées, souvent, comme par miracle, les difficultés s’aplanissent. Il faudra attendre jusqu’en 1949 pour disposer librement de certaines denrées telles le café, le sucre ou bien l’essence.
Emma passe sa matinée du vendredi à faire le ménage « en grand », puis à lever, faire la toilette, habiller et nourrir ses nièces. Pour terminer, elle doit préparer le déjeuner des Mallat. Après la sieste des enfants, pendant laquelle elle s’accorde un peu de repos, c’est l’heure de leur promenade.
Emma installe Annette dans son landau et prend Danielle par la main. Le trio ainsi formé traverse la place du Parc, prend à droite au niveau de la statue Carnot et longe le rempart Desaix. Face à celui-ci, baignés de soleil, s’élèvent les hôtels particuliers des Angoumoisins les plus fortunés. Avec leurs toitures impeccables en ardoise, leurs élégantes façades blondes agrémentées de grands balcons d’où la vue est imprenable sur la Charente qui coule tranquillement plusieurs centaines de mètres en contrebas, Emma pense qu’il ferait bon de vivre ici. Mais il faut vite oublier, elle ne fait pas partie de ce monde-là. Bientôt, se dresse la silhouette massive de la cathédrale Saint-Pierre, édifice imposant de style roman dont la construction remonte au douzième siècle. Il faut enfin traverser un grand carrefour avec précaution, car les chauffards ne manquent pas, pour accéder, par l’entrée du boulevard Wilson, au « Jardin Vert ».
Ce jardin s’étale sur plus de quatre hectares sous les remparts de la ville. En 1865, pour mettre en valeur la situation exceptionnelle de ce site, la municipalité fait appel à Louis Ferdinand Fisher, un architecte paysagiste de renom. Il crée un espace romantique animé par des allées sinueuses et ponctué de petits pavillons, comme le pavillon aux volatiles, ou le pavillon aux biches. Ce bel endroit est ponctué de rocailles, de plusieurs bassins où se prélassent une cohorte de poissons rouges, ainsi que d’une rivière artificielle enjambée par de pittoresques petits ponts en bois. On y trouve aussi un charmant kiosque à musique, et en 1934, un théâtre de la Nature ainsi qu’une fontaine Wallace complètent les ornementations attractives du parc. Cette fontaine à boire en fonte est bâtie sur le modèle de celle offerte par sir Wallace à la ville de Paris.
Emma se dirige d’emblée vers le lieu préféré de Danielle, le bac à sable. Elle s’assied sur un banc et peut ainsi tranquillement surveiller sa nièce qui, en compagnie d’autres petites filles, s’amuse à construire des châteaux de sable. Son esprit vagabonde, et au fil des jours, le souvenir du beau jeune homme qu’elle a rencontré au casino commence à s’estomper. Il n’est pas loin de seize heures lorsque Emma prend la décision de rentrer à la maison. Danielle rouspète bien un peu, mais la perspective d’un bon goûter la ramène à la raison. Au détour d’une allée, elle s’effraie devant la parade d’un énorme paon qui lui barre le chemin. Afin de séduire sa femelle, le superbe volatile fait la roue et installe ses impressionnantes plumes bleues en éventail en poussant son fameux cri « hé han ! ». Emma tape du pied sur le sol deux ou trois fois, ce qui fait tout de suite déguerpir l’animal.
Pour le retour, Emma change d’itinéraire. Après avoir escaladé un raidillon sinueux, le petit groupe franchit un portail qui les amène sur une vaste place bordée de marronniers centenaires. Là s’élève le Lycée de Beaulieu, un bâtiment sévère d’architecture néoclassique, créé au XVIe siècle par François Ier. Emma ne peut évidemment pas s’imaginer que Jacques, son futur fils qui verra le jour trois ans plus tard, y fera toute sa scolarité. La jeune femme, la petite fille et le bébé sillonnent de bout en bout la rue de Beaulieu, interminable, pour arriver au centre-ville par la place du Mûrier. La rue des Postes, à droite un petit raccourci par la rue d’Arcole, la place du Parc, et les voilà arrivées rue d’Iéna. Danielle a droit à son « quatre heures », constitué par deux carrés de chocolat noir de la marque Menier, accompagnés par deux biscuits au beurre mis au point à Nantes par Monsieur Lefèvre-Utile. Ils sont commercialisés sous le nom de « Petit-Beurre LU », comme les initiales de son patronyme. Annette a droit à son biberon « Robert », inventé au siècle dernier par un certain Édouard Robert. Et si aujourd’hui encore on parle de « gros roberts » pour qualifier certains attributs féminins particulièrement volumineux et souvent appréciés par la plupart des hommes, on le doit à ce brave inventeur. Emma, pour tromper sa faim, se contente d’une tranche de pain sur laquelle elle étale une fine couche de margarine.
L’heure du Chabbat approchant, Juliette débarque un petit peu plus tôt qu’à son habitude. Auparavant, elle a pris bien soin de préparer un copieux dîner pour son mari, qui ne souhaite pas participer, chez ses beaux-parents, au rituel juif du repas du vendredi soir. Pas le moins du monde par antisémitisme, car, sans son coup de main décisif en 1942, la famille Einhorn ne serait peut-être pas actuellement en vie, mais tout simplement parce que, issu d’une famille catholique pratiquante, toutes ces prières et ces coutumes du peuple juif le mettent mal à l’aise.
Juliette arrive donc devant le numéro huit de la rue Chabrefy légèrement en avance, à vingt heures tapantes. L’heure de l’allumage des bougies, fixée par le rabbinat de Bordeaux selon un calcul savant, est fixée en ce 30 août exactement vingt-six minutes plus tard. Il faut procéder à ce rituel au plus tard dix-huit minutes avant le coucher du soleil.
Afin d’accéder à l’appartement de ses parents, Juliette doit tout d’abord ouvrir la porte en bois toute gondolée de l’immeuble, traverser un couloir obscur, et enfin escalader dans la pénombre un escalier poussiéreux. Elle pénètre alors dans une pièce relativement grande qui sert principalement de chambre à coucher aux cinq membres de la famille Einhorn. Près d’une fenêtre en demi-lune, assis dans un fauteuil usagé, Armand, le père, lit avec attention un exemplaire de « la Charente Libre », le journal local crée à la libération en septembre 1944. L’article parle de politique, et plus précisément du général de Gaulle qui, depuis la fin de la guerre, était à la tête du gouvernement provisoire de la France. Or, le 20 janvier 1946, suite à un profond désaccord avec les ministres communistes, il démissionne. Actuellement, Georges Bidault, l’homme qui a présidé le Conseil national de la résistance durant les heures sombres de l’occupation, dirige les affaires de l’État.
Armand, âgé maintenant d’un peu plus de soixante ans, a pas mal bourlingué durant sa chienne de vie. Originaire de Pologne, et voulant émigrer aux États-Unis, il s’est finalement arrêté à Strasbourg, où il a rencontré le grand amour. Happé par la Première Guerre mondiale, il est enrôlé de force dans l’Armée française. Après s’être bien battu, il a connu, depuis le début de l’année 1915 jusqu’au 11 novembre 1918 le pire camp de prisonniers en Allemagne. Deux décennies plus tard, du fait de sa religion, il a dû fuir et se cacher durant les cinq années terribles du deuxième conflit mondial. Maintenant, pour survivre, il exerce le métier de commerçant en vêtements sur les foires et marchés de la région d’Angoulême.
Les quatre autres occupants du logement sont toutes de sexe féminin. Elles sont actuellement réunies dans la deuxième pièce, qui fait office de cuisine et de salle à manger. Fanny, la mère de famille, est assise sur une chaise rempaillée. Elle a les traits fatigués, sans nul doute à cause des épreuves qu’elle a traversées pendant sa vie. Elle n’a que cinquante-sept ans, mais en paraît facilement dix de plus. Elle a enfanté à neuf reprises. Elle a hélas subi le deuil d’un fils en bas âge, et, par la suite, en 1933, dans les années de crise, elle a dû se séparer de deux filles que la famille ne pouvait plus nourrir. Et puis la guerre est arrivée, avec son lot de privations. Souffrant d’une insuffisance cardiaque, privée de soins et en manque de nourriture, son état de santé s’est progressivement aggravé. L’hiver 1943, particulièrement rigoureux, lui a porté le coup de grâce. Traquée par les nazis, la famille a été contrainte de se réfugier dans une grange ouverte aux quatre vents. Elle a subi les affres de la faim et du froid jusqu’à l’arrivée tant attendue des Américains au mois d’août 1944. À présent, son rôle se réduit aux petites tâches ménagères, bien aidé en cela par ses trois filles, Emma, Sophie et Lina.
Sophie, née trois ans après Emma, est sans nul doute, depuis son plus jeune âge, la chouchoute de sa mère. Lina, la petite dernière, arrive à présent tout juste à sa majorité, fixée à l’époque à vingt et un ans. Malheureusement, depuis sa naissance, elle a un problème à l’œil gauche, dont la paupière reste à moitié fermée. Ces trois jeunes femmes, toujours célibataires, aimeraient bien se trouver un mari, mais elles sont isolées à Angoulême, ce petit bourg de province où il n’est pas facile de trouver le moindre Juif à l’horizon. Si pendant la guerre, Juliette, la fille aînée a obtenu de ses parents l’autorisation d’épouser un « goy », en ce qui concerne les trois autres, le mariage mixte est hors de question.
Après avoir embrassé son père, Juliette, telle une tornade, fait irruption dans la cuisine. La vilaine table est camouflée par la belle nappe blanche du Chabbat, sur laquelle trône la « hallah ». Ce pain confectionné à la maison, moelleux à souhait, est comparable à de la brioche. Il est servi lors de tous les repas de fête. Juliette dépose un panier rempli de victuailles et Sophie, la plus curieuse, s’empresse d’en examiner le contenu.
Émoustillé par les bonnes odeurs de cuisine, tout le monde se réunit autour de la table. Armand et Fanny sont heureux de se retrouver en compagnie de leurs quatre filles, mais leur esprit vagabonde également en direction des absents. Tout d’abord ils pensent à Maurice et à Simon, leurs deux fils, qui sont retournés à Forbach, la ville où ils vivaient avant la guerre. Et puis surtout personne ne peut oublier Rosa et Ida. Afin de fuir la misère, suite à la crise mondiale des années trente, Armand avait envoyé ses deux filles chez son frère, en Autriche. Disparues à tout jamais à cause de la cruauté d’un dictateur fou, elles font partie des six millions de Juifs assassinés par les nazis.
La cérémonie du Chabbat débute par le Kiddouche, qui est une prière traditionnelle énoncée par le chef de famille. Le Chabbat, moment crucial dans la religion d’Abraham, est présenté comme un trait d’union entre l’humain et le divin.
« Souviens-toi du jour de repos, pour le sanctifier. Car en six jours l’Éternel, ton Dieu, a fait les cieux, la terre et la mer et il s’est reposé le septième jour. »
Armand tient à la main un verre rempli de vin rouge, qui, en principe, devrait être kasher. Dans les faits, depuis la guerre, et surtout à Angoulême, où la communauté juive est pratiquement inexistante, la famille Einhorn a beaucoup de mal à respecter toutes les recommandations du Chabbat. Tout d’abord il est très difficile de se procurer de la nourriture kasher, et il n’existe aucune synagogue à moins de cent kilomètres à la ronde. Juliette Mallat, quant à elle, ne peut se permettre de ne pas travailler le samedi, ce jour étant celui où la fréquentation de son magasin est la meilleure. Donc, il faut bien s’accommoder.
Aujourd’hui, Juliette a emporté un vin de la région de Bordeaux, un « Pauillac ». Ce délicieux breuvage lui a été offert lors d’un dîner par Madame Michelet, l’épouse d’un jeune médecin qui projette d’ouvrir un laboratoire d’analyses médicales rue du Château, en face des jardins de l’Hôtel de ville d’Angoulême. Pour débuter le repas, Lina s’est occupé de la soupe au poulet, de loin le plat préféré de Fanny. Ensuite viennent les harengs apportés par Juliette. Ceux-ci sont délicatement fumés, recouverts d’oignons, bien gras, soyeux et savoureux. Cette recette importée de Pologne est le régal d’Armand. Afin de digérer ces deux premiers plats, une pause est faite, pendant laquelle le chef de famille récite une prière, remerciant D. pour cette excellente nourriture. Il s’ensuit un moment rare en cette période de rationnement, l’arrivée sur la table, toujours grâce à Juliette, d’une grande assiette de viande. Des boulettes de viande hachée, accompagnée de « Tzimmes », qui se composent de carottes, de navets et de pommes cuites, sont prêtes a être dévorées par les convives.
Fanny commence à servir son mari, lorsque Juliette prend la parole. Avec un méchant sourire en coin, elle dévoile alors le pot aux roses.
« Dimanche dernier, Emma était avec un homme ! » annonce-telle, en insistant sur ce dernier mot, homme, et en le prononçant particulièrement fort.
C’est comme un coup de tonnerre. La stupeur règne autour de la table, à tel point qu’Armand manque de s’étrangler avec le premier morceau de boulettes qu’il s’apprêtait à déguster. Non sans mal, il parvient à reprendre ses esprits.
« C’est qui, cet homme ? » gronde-t-il en direction d’Emma.
« Mais, papa, Juliette se trompe, » tente de se justifier l’accusée.
« Menteuse ! Tu n’es qu’une menteuse ! Danielle t’a vue avec un homme, grand, brun. Je suis sûr que c’est un Arabe ! » explose Juliette.
« Mais non, c’est un J… » tente de répondre Emma avant d’être interrompue brutalement par son père.
Il lui ordonne de sortir de table sur-le-champ, de quitter les lieux et de passer le reste du repas dans la petite cour lugubre qui donne accès à des cabinets malodorants. Il n’y a qu’une chaise mal rempaillée pour servir de refuge à la malheureuse.
« Quand je pense que je n’ai même pas pu goûter à un seul morceau de viande ! » se lamente-t-elle.
Il est vingt et une heure et trente minutes lorsque Juliette quitte le logement de ses parents. Après avoir englouti l’apfelstrüdel, le délicieux gâteau aux pommes préparé par Sophie, il a fallu se plier à la tradition du « Birkzat Hamazon ». Armand s’empare du « Siddour », le livre de prière juive, et il commence par fredonner le chant « Tsour Michélo », une mélodie entraînante reprise en chœur par toute la tablée. Puis il récite les quatre bénédictions qui témoignent du remerciement pour la nourriture et l’abondance de bonté que nous recevons de D. Après un temps qui semble interminable à Juliette, Armand prononce enfin la dernière phrase :
« Ado-naï Yevarekh Ete Amo Vachalom »
Sans plus attendre, Juliette se lève, embrasse tout le monde et s’éclipse. Sur le palier, elle aperçoit sa malheureuse sœur qui ronge son frein dans la cour, maintenant dans la pénombre. Elle lui lance simplement un bref :
« Demain, je n’ai pas besoin de toi. Les parents de Robert viennent à la maison pour garder les petits. » Puis elle dévale prudemment les escaliers.
Sur un signe de son père, Lina se lève à son tour et va chercher Emma. Comme si de rien n’était, elle rentre dans la cuisine et demande à son père s’il reste une part de strüdel. Armand est prêt à céder, mais, devant le regard sévère de Fanny, il se doit de rester inflexible.
« Tu vas filer dans ton lit, et je ne veux plus jamais entendre parler de cet Arabe, » aboie la mère de famille.
« Mais, mom (maman en yiddish) il n’est pas arabe, » se défend Emma.
« Écoute ta mère et file au lit ! » tranche Armand, sur un ton qui ne demande pas de réponse.
Il n’y a plus qu’à obtempérer.
Le lendemain, samedi 31 août, est un jour qui restera dans les annales de la mémoire d’Emma. Toujours punie, elle prépare en compagnie de sa mère le déjeuner du Chabbat, qui est principalement constitué des restes du repas de la veille.
En début d’après-midi, comme à son habitude, Armand, revêtu de ses plus beaux habits, file à l’anglaise pour une petite promenade en ville, tandis que Sophie et Lina ont l’autorisation de prendre l’air au « Jardin Vert ». La malheureuse Emma, quant à elle, est de corvée de vaisselle, avec interdiction de sortir.
Fanny, toujours fatiguée, s’étend sur son lit, pendant que sa fille bade aux mouches en regardant par la fenêtre les passants qui passent. Elle les envie, car, en cette belle journée de fin d’été, ils ont l’air heureux de déambuler rue Ludovic Trarieux et plus loin rue des Postes.
Il est environ quinze heures et trente minutes lorsqu’elle entend des bruits sourds résonner plus bas, sur le trottoir de la rue Chabrefy, qu’elle ne peut apercevoir.
CHAPITRE III
ROGER, LA SURPRISE
En ce dimanche 25 août au soir, Roger à la tête dans les étoiles. Après avoir raccompagné Emma, il décide de faire un grand tour à pied, tout au long des quais de La Rochelle. Il traverse d’un bon pas la place de Verdun, avant de regagner sagement son domicile, au numéro cinq de l’impasse du Minage. Il se prépare un dîner frugal, à base de pain, d’un morceau de fromage et d’une pomme. Il se met au lit de bonne heure, sachant qu’il doit reprendre le travail tôt le lendemain matin. Cependant, le sommeil tarde à venir. Les mêmes idées font le tour des milliards de neurones qui constituent son cerveau. Et toujours revient la même question, lancinante.
« Comment vais-je pouvoir retrouver Emma ? »
Il la revoit dans ses rêves. Une jeune femme petite, mais à la taille fine, aux cheveux noirs épais, avec des yeux en amande d’une couleur vert émeraude, et surtout une bouche pulpeuse dont il se souvient du goût délicieux lors de leur unique baiser. Enfin, pour terminer il se souvient aussi de son nez un peu fort, mais qui donne du caractère à son visage. Roger garde également en mémoire sa silhouette pétillante, pleine de vie, laissant deviner une poitrine abondante et des jambes fuselées. Au matin, c’est décidé. En fin de semaine, il partira pour Angoulême.
Avant d’embaucher chez Alfred Courtois, son patron, il fait un détour par la gare afin de se renseigner sur les horaires de train en partance vers la préfecture de la Charente samedi prochain. Normalement, un Juif ne doit pas voyager le jour du Chabbat, mais Roger ne suit pas les préceptes de la religion à la lettre, loin de là. Le guichetier, un petit homme chauve à lunettes revêtu d’une blouse grise lui indique les différentes heures de départ. Celui de onze heures trente lui convient parfaitement, et pour être certain d’avoir une place, il achète son billet sur-le-champ.
Sa semaine de travail lui semble interminable. Son patron lui fait à présent entièrement confiance, et Roger gère pratiquement tout seul les chantiers que lui confient ses clients. En ce moment, il s’attaque à la façade d’une maison bourgeoise située rue Aufredy, à deux pas de la rue Pernelle, où se trouve l’atelier d’Alfred Courtois.
Vendredi en fin d’après-midi, alors que Roger s’apprête à débaucher, Jean Chaillou arrive, les deux mains dans les poches. Les deux hommes se connaissent depuis le 20 janvier 1943, jour de leur incorporation dans l’armée française. Chaillou est marin pêcheur sur le port de La Rochelle. C’est un résistant de la première heure, dès l’arrivée des Allemands dans sa ville, en 1940. Trois ans plus tard, démasqué par la Gestapo, il doit fuir son pays et parvient à rejoindre l’armée de la France libre à Alger, sous les ordres du Général de Gaulle. Roger et Jean ont reçu ensemble le baptême du feu lors de la campagne de Tunisie, avant de se retrouver à la libération de La Rochelle. Depuis lors, les deux copains sont devenus comme cul et chemise.
Chaillou boite légèrement, et il porte encore sur son visage les stigmates d’un choc entre une voiture automobile et sa robuste carcasse. En effet, dimanche dernier, passablement éméché, et sans plus regarder ni à droite, ni à gauche, il a traversé le chemin des Remparts au moment du passage d’un roadster Triumph Dolomite modèle 1938. Rien de grave, mais cet événement aurait pu changer le cours de la vie de Roger. Ce dernier, se trouvant sur les lieux à ce moment-là, a dû s’occuper de son ami, notamment l’accompagner à l’hôpital, et sa rencontre avec Emma a bien failli ne pas avoir eu lieu. Enfin, finalement, tout est rentré dans l’ordre.
« Alors, Roger, c’est l’heure de la débauche, tu viens boire un coup ? C’est ma tournée, pour te remercier de ton aide dimanche dernier, » harangue Jean.
Roger préfère refuser, car il sait comment se termine la tournée des bars avec son ami, et il ne veut surtout pas avoir la gueule de bois le lendemain matin. Devant l’incompréhension de ce dernier, Roger se sent obligé de lui fournir des explications.
« Tu sais, Jean, j’ai fait une rencontre formidable dimanche dernier. Une femme… incroyable ! » lui avoue-t-il.
Et il lui raconte par le menu sa rencontre avec Emma. Chaillou compatit, mais il insiste fortement.
« Allez, Roger, un dernier verre ! Tu vas pas laisser tomber ton vieux copain pour une gonzesse ! J’te promets, un seul verre, parole d’ivrogne ! »
Roger ne peut pas faire autrement que d’accepter, et à contrecœur il suit Jean. Fier comme un paon, ce dernier se dirige vers une voiture automobile, une Renault prima quatre année 1933 qu’il vient d’acquérir depuis peu. Elle affiche plus de cent mille kilomètres au compteur, mais elle roule. Ce véhicule, comme beaucoup d’autres, a été conçu par Louis Renault, inventeur de génie, pilote de course et chef d’entreprise. Accusé de collaboration avec l’ennemi, il finira sa vie en prison en 1944, tandis que son empire industriel sera nationalisé.