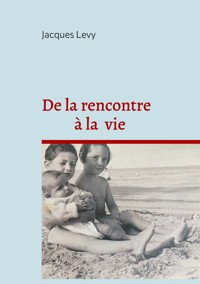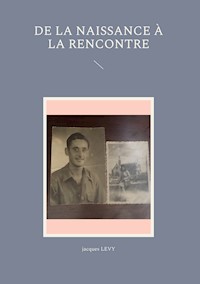
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Des origines à la naissance
- Sprache: Französisch
Le deuxième tome de cette saga familiale débute par la naissance des deux parents de l'auteur, Jacques Lévy. Pharmacien, il a exercé sa profession durant plus de 40 ans à Saint-Just-Luzac, charmant village de Charente Maritime. Il a également tenu les rennes de cette commune en tant que maire au moment où le monde est entré dans le troisième millénaire. Emma Einhorn est née en 1921 à Karlsruhe, en Allemagne. Roger Lévy est né en 1920 à Alger, alors préfecture du département français d'Algérie. La deuxième guerre mondiale et la religion israélite des deux héros de cette histoire romancée ne seront pas étrangères à leur rencontre, qui marque le terme de ce récit palpitant. La petite histoire est enveloppée par la Grande histoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE DES MATIERES
PREMIERE PARTIE
Chapitre I Karlsruhe, 21 juillet 1921
Chapitre II La montée du fascisme
Chapitre III A nous deux, Forbach
Chapitre IV La rue Houchard
Chapitre V Le grand jour
Chapitre VI Une joie, un drame
Chapittre VII L’anniversaire
Chapitre VI1I 1933, l’année charnière
Chapitre IX Le déchirement
Chapitre X Avant la guerre
Chapitre XI C’est la guerre
Chapitre XII La rencontre, Roger
DEUXIEME PARTIE
Chapitre I Alger, 6 juin 1920
Chapitre II Le certificat d’études
Chapitre III L’apprentissage
Chapitre IV De l’adolescence à l’âge adulte
Chapitre V La défaite, 1940
Chapitre VI Le gouvernement de Vichy
Chapitre VII 1942, le débarquement
Chapitre VIII 1943, la mobilisation
Chapitre IX La guerre, la vraie
Chapitre X Tunis, Bizerte, Sfax
Chapitre XI Le débarquement en Provence
Chapitre XII La rencontre, Emma
À la mémoire de ma maman : EMMA
PREMIÈRE PARTIE
DE KARLSRUHE À LA ROCHELLE
CHAPITRE I
KARLSRUHE, 21 JUILLET 1921
Le 21 juillet 1921, à seize heures vingt et une minutes plus trente secondes, Armand grimpe quatre à quatre les soixante marches du vieil escalier de l’immeuble situé au numéro vingt de la rue Hebel Strasse. La scène se passe à quelques encablures du centre historique de la ville allemande de Karlsruhe.
Une fois arrivé au quatrième étage, il tombe nez à nez avec Frida Kaufman. La femme de son patron lui maintient grande ouverte la porte de son appartement.
Armand pénètre comme un fou dans la chambre. Il est à bout de souffle.
Fanny, son épouse, est allongée sur le lit.
Livide mais rayonnante de joie, elle tient dans ses petits bras menus un nouveau-né âgé d’une minute tout au plus. Du premier coup d’œil au bon endroit de son corps minuscule, le père comprend que l’enfant est de sexe féminin.
"Eh bien, ce sera Emma Einhorn ! " s’exclama-t-il avec un large sourire, avant de se précipiter vers sa femme et son enfant, le sixième déjà, pour les couvrir tous deux de gros baisers.
En ce chaud jeudi matin de juillet, Armand avait, comme à son habitude, tenu le stand de savons de son patron, Nathaniel Kaufman, sur la Marktplatz de la capitale du Bade-Wurtemberg.
Les clients étant fort peu nombreux ce jour-là, il décida de remballer vers les quatorze heures quinze. Une fois sa marchandise remisée Bismarck Strasse, il croisa son camarade de travail et de surcroît son meilleur ami, David Kaufman, le cousin du patron. Inquiet sur l’état de santé de son épouse, Armand lui indiqua son souhait de rentrer à la maison au plus vite. En chemin, au numéro cinq de la Karl-Friedrich Strasse, toute proche de la synagogue orthodoxe qu’il fréquentait, la vitrine d’une librairie avait retenu son attention.
Un livre, avec une belle couverture, bien alléchante, qui montrait le joli visage d’une femme souriante, trônait au beau milieu de l’étalage.
" Emma Bovary" par l’auteur Gustave Flaubert. Éditions Michel Lévy frères.
C’est surtout le nom des éditeurs qui interpella Armand.
"Tiens, tiens, " pensa-t-il, "Décidément, les Juifs sont bien présents partout !"
Pour la petite histoire, Michel et son frère Kalmus, dit Calmann, sont les fils d’un simple colporteur juif alsacien, Simon Lévy, venu s’installer à Paris en 1825. En 1836, dans le deuxième arrondissement de la capitale, les deux frères ont ensuite fondé une des plus célèbres maisons d’édition de l’époque, maison qui perdure d’ailleurs jusqu’à aujourd’hui.
(Calmann Lévy)
Sarah Goldman, la sage-femme grâce à laquelle l’accouchement s’était bien déroulé, intervient à temps afin que la bien nommée Emma ne meure pas étouffée sous les étreintes de son père.
Une heure plus tard, une fois son travail accompli, Sarah prit congé, laissant le relais à Frida, trop heureuse de pouvoir s’occuper de la nouvelle née.
La pauvre femme, dans l’incapacité de mettre au monde le moindre enfant, se consolait comme elle le pouvait en aidant bénévolement les mères de famille de son entourage.
Ce n’était pourtant pas faute d’avoir moult fois fait l’amour avec son mari, Nathaniel, une force de la nature. Et même dans toutes les positions, comme celles réputées les plus favorables à la fécondation ! En désespoir de cause, le couple avait consulté à maintes reprises le médecin gynécologue du meilleur hôpital de la ville, celui situé Diakonissen Strasse.
Le docteur Salman avait fini par faire comprendre à Frida que, dans l’état actuel de la science, la malformation de son utérus rendait tout espoir de grossesse impossible.
" C’est la volonté de Dieu ! " avait-il lâché au couple Kaufman, à bout d’arguments.
Aussi, depuis l’arrivée de la maisonnée Einhorn à Karlsruhe six mois plus tôt, Frida avait jeté son dévolu sur Fanny et surtout sur ses cinq rejetons. Si Maurice, Rosa et Juliette, âgés respectivement de dix, sept et six ans étaient déjà relativement sortis d’affaires, les deux derniers, Ida et Simon réclamaient encore beaucoup de soins.
En effet, Armand n’avait guère chômé.
Les deux derniers nés n’avaient que dix mois d’écart ! Ida n’avait pas encore deux ans, que Simon bouclait tout juste sa première année de vie.
Et aujourd’hui, voilà qu’Emma faisait son entrée en ce monde incertain !
L’armistice entre l’Allemagne et les Alliés, principalement les Français et les Anglais, était signé depuis maintenant presque trois ans, mettant fin à la plus grande des boucheries que l’humanité ait jamais connue. Armand en savait quelque chose.
Il avait souffert et risqué sa vie dans les tranchées avec les poilus français pendant près de six mois, avant de pourrir durant le reste de la guerre au fin fond d’un infâme camp de prisonniers allemands dans la région d’Erfurt.
Travail de forçat, malnutrition et mauvais soins furent alors son lot quotidien pendant près de quatre longues années.
L’armistice du 11 novembre 1918, suivi du traité de paix signé en grande pompe dans la galerie des Glaces du château de Versailles le 28 juin 1919 avait mis un terme définitif aux hostilités.
Ce traité mettait l’Allemagne à genoux, et, sans le savoir, il jetait les bases d’un nouveau conflit, encore plus meurtrier, qui se déroulerait vingt ans plus tard.
Mais cela, bien malin était celui qui aurait pu le deviner !
Les conditions imposées par les Alliés au pays vaincu étaient terribles. L’Allemagne est amputée de quinze pour cent de son territoire, dont bien sûr l’Alsace et la Lorraine. Son empire colonial est confisqué, et de nombreuses sanctions sont prises contre l’armée, qui sera pratiquement démantelée. Mais surtout, le montant des réparations à payer est colossal ! On parle de cent trente-deux milliards de marks or, qui correspondraient à plus de quarante-sept mille tonnes d’or !
Au cours d’aujourd’hui, cela équivaudrait à environ mille quatre cents milliards d’euros, autrement dit une somme quasiment impossible à rembourser.
Et pourtant, au bout d’un siècle, l’Allemagne finira par payer cette dette.
D’autre part, ce 21 juillet 1921 a vu se dérouler à des milliers de kilomètres de Karlsruhe, plus précisément à l’extrême nord-est du Maroc, un fait historique qui changera la face du monde un demi-siècle plus tard.
Je veux parler ici de la décolonisation.
En effet, pour la première fois, une révolte des "indigènes" musulmans intégristes contre la puissance colonisatrice, en l’occurrence l’Espagne, a abouti à l’établissement d’une république islamiste.
Nous sommes près de la ville d’Anoual, dans la région du Rif marocain.
Le gouvernement espagnol du roi Alphonse XIII a envoyé un contingent fort de vingt mille soldats afin de pacifier cette contrée sauvage et montagneuse proche de la frontière algérienne.
Mohamed Abdelkrim, un chef de guerre de la région, particulièrement habile et supérieurement intelligent, ne l’entend pas de cette oreille. Il réussit à fédérer un grand nombre de tribus rebelles, qui, en ce 21 juillet, fondent sur la ville, créant la débandade parmi les troupes espagnoles.
Le général Manuel Silvestre, un fier militaire à la moustache conquérante, extrêmement courageux, blessé grièvement à de nombreuses reprises durant sa carrière, hésite.
Finalement il ordonne la retraite. Les soldats espagnols fuient dans la plus grande confusion, c’est un massacre. Lorsqu’il mesure l’ampleur du désastre, le général retourne dans sa tente et se suicide.
Il avait seulement quarante-neuf ans.
Les combattants d’Abdelkrim laissent sur le terrain plus de dix mille morts espagnols, font sept cents prisonniers dont la plupart seront torturés et décapités. Mais l’histoire ne se termine pas là.
Humiliés, les Espagnols vont réagir. Cependant la reconquête du Rif ne s’achèvera que cinq longues années plus tard, et encore grâce à l’appui des troupes françaises.
La répression sera féroce.
Pour la première fois, des armes chimiques, notamment le gaz dit "moutarde", seront utilisées pour exterminer des populations entières de villageois.
Beaucoup plus tard, le Che Guevara à Cuba, Mao Zedong en Chine, et Hô Chi Minh au Vietnam s’inspireront des techniques de guérilla mises au point par Abdelkrim. Celui-ci sera finalement contraint à la reddition le 30 mai 1926, submergé par les cent soixante mille hommes du contingent franco espagnol, soutenu par une artillerie et une aviation omniprésente.
Ce 21 juillet 1921 a vu aussi la fin de l’insurrection qui a éclaté en Silésie, et plus précisément à Katowice, ville où Armand a vu le jour. Allemands et Polonais se disputaient cette région riche en charbon et minerai de fer. Finalement, la Société des Nations décidera d’intervenir en faveur de la Pologne. Dix-huit ans plus tard, un certain Adolf Hitler en décidera autrement, et ce sera le début de la Deuxième Guerre mondiale.
Emma était à cent mille lieues de ces préoccupations politiques.
Pour le moment, son souci principal était de s’alimenter, et elle décréta que téter le sein de sa maman huit fois par jour devrait être suffisant pour les besoins de sa croissance. Heureusement que le corps de Fanny avait la capacité de produire une source quasiment intarissable de lait, car la mère de famille devait également nourrir le petit Simon. Âgé de seulement une petite année, le petit garçon savait se faire entendre lorsque le besoin de succion se faisait sentir.
Emma et Simon étaient pratiquement frère et sœur de lait, ce qui explique sans doute le lien particulier qui les unira ensuite durant toute leur vie.
Chez les Ashkénazes, qui sont les juifs originaires d’Europe centrale, le premier Chabbat du bébé a pour but de le « consoler ». En effet, la tradition veut qu’un ange lui ait enseigné pendant la grossesse l’entièreté de la Torah, qui peut se définir comme le livre sacré du judaïsme, mais ensuite qu’il l’ait oublié pendant la naissance. Sa famille se réunit alors pour l’aider à affronter cette perte, et mange un repas traditionnel de deuil (lentilles, haricots et pois chiches).
Pour cette occasion, l’indispensable Frida, accompagnée de son mari s’était joint à la maisonnée Einhorn pour célébrer ce Chabbat.
Mais, huit jours après l’arrivée du bébé, et surtout pour les petits mâles, c’est la fête !
Ce jour-là, on célèbre la "Brith Mila" pour les garçons, tandis que pour les filles, la "Brith Leda" peut attendre un mois, voire plus.
La Brith Mila consiste en la circoncision du petit garçon par un Mohel (circonciseur) à la maison ou à la synagogue. Les prières et rituels des deux cérémonies sont identiques, circoncision mise à part.
Son équivalent féminin consiste à tremper les pieds du bébé dans de l’eau fraîche. (Rituel faisant référence à l’épisode de la Genèse où Sarah et Abraham accueillent des étrangers).
Les parents de Fanny, Wolf Liebermann et surtout son épouse Caroline n’auraient raté la Brith Leda de leur petite fille Emma pour rien au monde.
Évidemment, Wolf avait encore du ressentiment pour son gendre, Armand.
Comment aurait-il pu oublier cette triste matinée du 15 janvier dernier, cela faisait six mois maintenant, où celui-ci avait embarqué sa fille unique, Fanny, et ses cinq petits marmots ?
Certes, il reconnaissait être doté d’un caractère autoritaire, et il avait copieusement invectivé son gendre lorsque celui-ci avait "piqué" dans la caisse l’année dernière.
Mais était-ce une raison pour quitter avec armes et bagages sa bonne ville de Strasbourg ? Et surtout pour venir se perdre ici, à Karlsruhe, dans cette maudite Allemagne vaincue ! Et de plus pour vendre de la savonnerie sur les marchés, alors que lui, dans sa belle boutique de draps, au numéro cinq de la rue des Charpentiers, il avait bien besoin d’Armand !
Mais comment raisonner cet homme ? Il n’en faisait qu’à sa tête !
Caroline, son épouse, était toujours inconsolable de la perte de son fils Élie, enrôlé dans l’armée du Kaiser et tué en 1917 sur le front russe. Elle se montrait plus conciliante. Elle comprenait à demi-mot que son gendre aspire à plus d’indépendance. Et même s’il avait "emprunté" un peu d’argent, c’était pour honorer une dette de jeu. Il n’avait sans doute pas pu faire autrement !
Wolf et Caroline avaient réservé une chambre au Mendelssohn hôtel de Karlsruhe, situé à l’extrémité de la Marktplatz, afin de ne déranger personne. Pour la première fois depuis l’ouverture de leur boutique, ils avaient fermé leur commerce une semaine entière. Sur l’élégante porte vitrée de son magasin, Caroline avait accroché une pancarte sur laquelle les passants pouvaient lire la mention suivante :
« Fermeture exceptionnelle du 1er au 8 septembre pour raisons familiales. »
En effet, plus personne ne pouvait désormais les remplacer, puisque trois mois auparavant, Wolf avait perdu son père, le vieux Jacob, âgé de soixante-dix-huit ans. Rien ne présageait une fin aussi brutale, car, la veille de sa mort, il était venu aider au rangement de sa chère boutique dont son père Finkel, lui avait confié les rênes en 1870.
Jacob était décédé dans son sommeil, sans doute sans souffrir, et probablement d’un arrêt cardiaque.
Élie Einhorn était un homme de petite taille.
Malgré cela, lorsqu’elle était encore de ce monde, il dépassait d’une bonne tête sa femme, Ann, qui devait plafonner aux alentours d’un mètre quarante-cinq.
Ce juif très croyant semblait venir d’une autre planète. Hiver comme été, cet "hassid", comme on les appelle, déambulait vêtu d’un long manteau noir, les jambes recouvertes jusqu’à mi-mollet de grandes chaussettes de couleur blanche. Son visage, encadré de papillotes et mangé par une longue barbe était surmonté d’un chapeau noir, le Shtraïmel, dont les larges bords étaient ornés de fourrure. Un pantalon noir et une veste de la même couleur portée sur une chemise blanche complétaient son accoutrement.
À la fin du dix-huitième siècle, sa famille, fuyant les pogroms de Lituanie, à l’extrême nord de l’Europe, s’était dans un premier temps installée en Ukraine, dans le village de Krzywenkie, district d’Husiatyn. Les Cosaques n’étant guère plus cléments envers la race juive, bien au contraire, le père d’Élie, Yaacov, décida de partir en direction de l’ouest, vers une contrée un peu moins sauvage, du moins l’espérait-il, la Silésie. Autrefois province polonaise, une importante colonie juive y résidait depuis très longtemps.
Mais la Pologne, après plusieurs défaites militaires, sera rayée de la carte pendant cent vingt-trois ans, divisée entre la Prusse, l’Autriche, et la Russie. Ensuite, il aura fallu trois guerres, entre 1740 et 1763, pour que le royaume de Prusse, dirigé par Frédéric II vienne à bout de l’Autriche, alors sous la coupe de la monarchie des Habsbourg.
La province de Silésie est alors annexée par la Prusse.
Ce territoire, dont les richesses minières sont importantes, connaît par la suite un fort développement économique, ce qui attira un nombre considérable d’habitants, dont beaucoup de religion israélite.
Katowice, située au cœur du bassin houiller, fut fondée au dix-neuvième siècle. Prenant de plus en plus d’importance, elle gagna le statut de ville en 1865.
C’est à cette époque que Yaacov Einhorn s’installa dans le faubourg juif de cette cité en plein essor. Ces villages où vivaient les juifs depuis le Moyen Âge s’appelaient des "shtetlech". Celui de Katowice abritait à cette époque près de cinq mille personnes.
Toutes les constructions, y compris les synagogues, étaient en bois. La langue parlée était principalement le yiddish, qui est un dialecte local utilisé par plusieurs millions de juifs en Europe centrale, en Ukraine, et en Allemagne.
On parlera même de "Yiddish land", c’est-à-dire d’un vaste territoire où sera utilisé ce langage, dérivé du germanique avec un apport de vocabulaire hébreu et slave.
Depuis la nuit des temps, la famille Einhorn, de père en fils, exerce le métier de colporteur.
Les Einhorn gagnent leur vie plus ou moins misérablement, selon les époques, en vendant toutes sortes de marchandises.
Yaacov s’est spécialisé dans la vente d’élixirs de santé.
Il parcourt la campagne, les ruelles des villages, mais s’arrête aux faubourgs des grandes villes, par peur des persécutions.
Ses clients chrétiens, et qui plus est ceux qui sont contents de ses services, sont les premiers à le houspiller, parfois même à le bousculer.
Ils le traitent de "sale sorcier youpin", car on n’aime pas être redevable à un Juif.
Les breuvages qu’il vend sont censés guérir toutes sortes de maux, et même certaines de ses potions peuvent préserver les innocents du mauvais sort. Il prépare lui-même ses petits flacons, auxquels il donne des noms évocateurs : Élixir de longue vie, ou bien sirop de procréation, destiné aussi bien aux hommes qu’aux femmes en mal d’enfants, ou encore poudre de bonne espérance, afin que la chance tourne dans les foyers en difficulté.
Il passait de longues journées, en solitaire, la plupart du temps dans les forêts afin de récolter les plantes nécessaires à la fabrication de ces "médicaments". Lui-même y croyait dur comme fer. Il en consommait régulièrement, ce qui lui permettait d’avoir un grand pouvoir de persuasion auprès de ses clients. Et parfois, allez savoir pourquoi, certains y verront la main du Tout-Puissant, les remèdes faisaient bon effet !
Yaacov épousa Judyta. Elle mit au monde dans ce ghetto son premier fils, Élie, en cette année 1865. Celui-ci suivra l’enseignement de son père, qui malheureusement sera emporté relativement jeune par une fluxion de poitrine. Sa recette à base de sureau et de fleurs de coquelicots ne suffira pas à le sauver.
En janvier 1885, Élie épouse Ann Kohn qui donnera naissance neuf mois plus tard à Étienne.
Trois ans plus tard, arrive sur terre Hermann, prénom qui sera transformé plus tard par l’intéressé en Armand.
Plus on se rapproche du vingtième siècle, plus les affaires du colporteur sont mauvaises. Il faut dire qu’Élie n’a pas la parole facile ni l’élocution de son père, qui aurait été capable de vendre un cercueil à deux places à un célibataire endurci sans aucune famille.
En 1910, la mort dans l’âme, Élie et Ann assistent au départ de leurs deux fils aînés.
Ils avaient espoir de faire fortune à l’autre bout de la terre !
Étienne, après moult péripéties, était arrivé à bon port à New York, mais, en ce qui concerne Armand, comme nous l’avons vu dans le premier tome de ce récit, Cupidon avait décoché sa flèche.
Il était donc resté en Europe.
Pendant la guerre, durant le terrible hiver 1916, Élie demeure impuissant devant la maladie de son épouse. Sans charbon la petite maison était devenue une glacière. Et sans nourriture suffisante, comment Ann aurait-elle pu résister à l’attaque des microbes qui avaient envahi son organisme ?
En 1918, les Alliés victorieux rétablissent enfin la république de Pologne.
L’Allemagne doit lui restituer une partie de la Silésie, dont la ville de Katowice. Cependant, les termes du traité de Versailles sont flous, et des élections sont organisées. Malgré cela, en juillet 1921, au moment même de la naissance d’Emma, des émeutes éclatent entre les différentes nationalités, mais Katowice demeurera rattachée à la Pologne.
Armand, qui n’avait pas eu de nouvelles de sa famille depuis des années, avait réussi, par l’intermédiaire d’un rabbin polonais de passage à Karlsruhe, à reprendre contact avec son père.
À l’occasion de la Brith Leda d’Emma, Armand s’était saigné aux quatre veines afin de pouvoir lui offrir les billets de train qui lui permettrait d’effectuer les mille kilomètres séparant la capitale de la Silésie à la capitale du Bade Wurtemberg.
Dans la tradition juive, la Brith Leda doit se faire lorsque la fille atteint au moins son premier mois.
Armand, qui comme à son habitude décidait de tout, décréta que le samedi 3 septembre serait une bonne date pour célébrer cet événement. La journée commença sous de bons auspices.
Après une semaine grise et pluvieuse, le soleil daigna faire son apparition, et dévoila un ciel bleu azur parsemé de quelques petits nuages de faible importance.
Dès huit heures du matin Caroline se rendit au domicile de sa fille. Il fallait aider Fanny à préparer sa nombreuse progéniture afin de célébrer dignement le grand jour.
La veille, la mamie avait "kidnappé" Maurice, Rosa et Juliette.
En leur compagnie, elle avait dévalisé les magasins du centre-ville pour les habiller de neuf des pieds à la tête.
À neuf heures précises, tout ce beau monde, Armand en tête, déboule du numéro vingt de la Hebel Strasse. Cinq petites minutes et trois cents mètres suffisent au peloton pour tourner à droite et emprunter la Karl Friedrich strasse. Élie, les mains derrière le dos, toujours pensif comme à son habitude, ferme la marche. Son fils avait réussi à le caser dans une minuscule chambre située au rez-de-chaussée de son immeuble.
Les dix personnes rejoignent alors le numéro seize, siège de la synagogue orthodoxe tenue de main de maître par le rabbin Jacob Ettlingen, nullement diminué par son grand âge.
En effet, malgré ses quatre-vingts printemps, le vénérable homme se tient debout, droit comme un I à la porte de son édifice afin d’accueillir lui-même ses fidèles.
" Ah ! C’est bien, la famille Einhorn, vous êtes les premiers, c’est bien, vous êtes à l’heure." dit-il en langue française, mais avec un épouvantable accent germanique qui a pour effet de transformer les "h" en "re", les "c" en "zé", ainsi que d’accentuer considérablement en longueur les deuxièmes syllabes de chaque mot.
À peine eut-il prononcé ces paroles que le reste de la troupe pointa son nez.
Wolf, solitaire, venant à grandes enjambées de la Marktplatz en rasant les murs, arriva en seconde position. Nathaniel et Frida, bras dessus, bras dessous, tels deux amoureux, firent leur apparition quelques minutes plus tard, arborant un large sourire.
Enfin David, accompagné de son épouse Hannah, toujours aussi belle, fermait la marche.
Avec ses formes appétissantes, ses yeux verts et sa crinière blonde, elle attirait immanquablement le regard des hommes.
Le couple était suivi par leurs adorables marmots, Amir, Dov et Isaac, le petit dernier âgé de cinq ans. Tous les trois étaient constellés de taches de rousseur. C’était une marque de fabrique, car la chevelure de leur père, certes moins fournie qu’au moment de sa rencontre avec les frères Einhorn il y a maintenant une dizaine d’années, était néanmoins d’un rouge toujours aussi flamboyant.
La synagogue était remplie d’une petite centaine de fidèles, les habitués du Chabbat. Seules six femmes occupaient l’espace qui leur était réservé. Pour cela, elles devaient emprunter un escalier donnant sur une mezzanine qui surplombait la grande salle de prière.
Celle-ci était entièrement réservée aux hommes.
C’est une tradition millénaire qui exige la séparation de la gent féminine de la gent masculine, afin qu’aucun désir sexuel ne puisse interférer dans la ferveur de la prière.
À cette époque, sur environ cent mille habitants, la ville de Karlsruhe comptait plus de trois mille personnes de confession juive. La présence de ces Israélites remonte à près de deux siècles, date de la création de la cité par le marquis Charles Guillaume de Bade Durlach.
Dans les années vingt, quarante pour cent des avocats et plus du quart des médecins de la ville étaient juifs. De plus, quatre banques leur appartenaient.
La synagogue de la Kronen-strasse s’avérant trop exiguë, le 22 septembre 1881 fut inauguré un nouveau lieu de culte au numéro seize de la Karl-Friedrich-strasse.
C’était un édifice bâti selon les plans de l’architecte Ziegler, d’une beauté simple, mais extrêmement magnifique. Construit dans le style Renaissance, l’intérieur lui donne un regard imposant. Un plafond finement ouvragé avec un puits de lumière, un magnifique vitrail, une jolie balustrade autour de la galerie complètent la bonne impression de ce fier bâtiment.
Fanny et sa mère Caroline, suivie de Frida, Hannah ainsi que de tous les enfants grimpent donc le bel escalier en bois verni et s’installent sur les sièges de la mezzanine.
Armand, son père Élie, son beau-père Wolf, David, son meilleur ami, et Nathaniel son patron prennent place au premier rang de la salle.
Sur l’estrade, le rabbin Ettlingen leur fait face.
Il réclame le silence, puis il lève les yeux en direction du premier étage. D’une voix solennelle, il appelle Madame Fanny Einhorn. Le saint homme l’invite alors à descendre et à rejoindre l’assemblée des fidèles, en compagnie de sa fille Emma.
Pendant ce court laps de temps, il commence la lecture de la Torah, le livre sacré des Juifs.
À l’arrivée de la mère de famille, le rabbin prononce une bénédiction spéciale, appelée "Mi-chebera’h."
C’est une prière où D. est remercié pour le bon déroulement de l’accouchement et la venue au monde du bébé en bonne santé.
Puis Jacob Ettlingen prononce solennellement le nom d’Emma Einhorn.
L’étymologie d’Emma serait le terme hébreu « imanu-el » se traduisant par « Dieu est avec nous ».
Armand se lève alors. Il rejoint son épouse, et prend son enfant dans ses bras.
Emma pleure, mais quel bébé âgé d’un mois seulement ne serait pas impressionné par une telle cérémonie ?
Malgré cela, Armand, fidèle à la tradition, emmène sa fille au-dessus d’une bassine remplie d’eau située trois mètres en retrait, et il trempe ses petits pieds dans le liquide froid contenu dans le récipient.
Les cris redoublent, mais peu importe, l’assistance prie pour que la nouvelle fille juive devienne en grandissant une femme juive sage et bienveillante pleine de bonté et de noblesse.
Une fois les prières terminées, le petit groupe se réunit dans une pièce annexe où un "Kiddouch", c’est-à-dire une collation, est servi en l’honneur du bébé.
Aux côtés de la famille, outre les Kaufman, on trouve réunis autour de la table de fête les Ginsberg et le grand Moïse Rosenthal.
Samuel Ginsberg et son épouse Esther sont les tout nouveaux et tout jeunes bouchers installés sur la plus grande artère de la ville appelée Kriegs-strasse. Mariée depuis seulement une petite année, Esther arbore déjà fièrement un petit ventre rond annonciateur d’un heureux événement.
Quant à Monsieur Rosenthal, la trentaine largement dépassée, ce géant haut de près de deux mètres n’avait toujours pas trouvé chaussure à son pied. Malgré tous les efforts du rabbin afin de le caser, ce célibataire endurci, par ailleurs très habile tailleur de son métier, vivait toujours seul, au-dessus de son atelier de couture, en compagnie de sa mère, la vieille Gréta, De l’avis de tous, Gréta était pour beaucoup la cause du célibat de son fils.
Le rabbin Ettlingen fait bien entendu également partie des invités.
Il est déjà midi passé, et il est temps de partager les bons mets préparés spécialement pour ce Chabbat de fête.
Fort heureusement, Wolf avait mis la main à la poche, car le pauvre Armand aurait eu beaucoup de difficultés à payer le banquet qui s’étalait sur les belles tables finement décorées.
Pour commencer, les convives se régalèrent de harengs séchés accompagnés de délicieuses amandes. Puis vient le plat traditionnel, le fameux " tchoulent ". La viande, choisie avec soin par Samuel Ginsberg était tendre à souhait. Disposés tout autour du gros morceau de bœuf, les pommes de terre, les haricots, et l’orge perlé se disputaient le plaisir de rassasier les invités. Enfin, plus pour la gourmandise que pour la faim, le kouglof, qui est une brioche à pâte levée agrémentée de raisins secs imbibés de kirsch, trônait à côté des bouteilles de vin.
C’est Moïse Rosenthal qui s’était chargé de fournir la boisson.
Armand jeta un coup d’œil sur l’étiquette d’une des bouteilles, un vin blanc dont la robe jaune ambrée laissait deviner un cru de qualité. Il s’aperçut avec amusement et un peu de nostalgie que le breuvage provenait d’une petite ville de Rhénanie proche de Mayence, Ingelheim.
« Crois-tu que ce vin provient de la propriété de Max Ehrlich ? » lança-t-il en rigolant à son ami David.
En effet, une dizaine d’années auparavant, les deux amis avaient fait les vendanges chez ce vigneron en compagnie de ses fils, Josef et Ludwig. Ils ne pouvaient évidemment pas savoir que le premier avait été abattu sur le front belge dès le mois d’octobre 1914, alors que le second ne resta en vie que trois semaines de plus. Leur pauvre mère, Martha, mourut de chagrin dans l’année qui suivit. Le malheureux Max, incapable de poursuivre seul l’exploitation de son domaine, le laissa quelques mois après la guerre pour une bouchée de pain à des hommes d’affaires véreux qui le mirent sur la paille. Ruiné et en mauvaise santé, il préféra en finir avec l’aide d’une solide corde de chanvre. De courageux soldats venus d’un autre continent, l’Algérie, au service de la France, avaient brisé à tout jamais une famille, semant les graines d’une autre guerre mondiale, encore plus meurtrière.
Emma, accrochée aux bras de sa mère, s’était à peine remise des émotions procurées par sa baignade forcée qu’elle donna à nouveau de la voix.
Fanny, en bonne mère de famille, comprit aussitôt le message.
Elle s’isola à l’abri des regards en pénétrant dans une petite pièce contiguë qui servait de local de rangement. Elle s’assit du bout des fesses sur l’unique chaise en fer forgé présente dans cet endroit, et elle dégrafa son corsage. Ce geste libéra avec grâce deux seins blancs lourdement chargés de lait. Emma se précipita avec gourmandise sur les larges tétons légèrement colorés.
Armand remerciait Moïse Rosenthal pour la qualité de son vin, lorsqu’il s’aperçut de l’absence de son épouse. Frida, qui avait l’œil partout, lui montra d’un geste du menton l’endroit où Fanny s’était installée. Armand se dirigea vers la porte indiquée, puis il l’entrouvrit à moitié afin de jeter un regard discret à l’intérieur de la pièce. Voyant ce spectacle attendrissant, il adressa un sourire ému à sa femme, mais il ne put s’empêcher d’avoir simultanément une brève mais solide érection.
En l’espace d’une fraction de seconde, il se remémora cette soirée du 22 novembre 1910.
Fuyant sa Pologne natale, sur la route de l’exil, il avait effectué deux semaines de vendanges en Rhénanie en compagnie de son frère Étienne et de son ami David. Le trio s’égara à cause d’un brouillard à couper au couteau, et atterrit par le plus grand des hasards dans la ville thermale de Wiesbaden.
Rudolf Schwartz, un riche et généreux bijoutier, les avaient recueillis à la sortie de la synagogue, et les avaient invités à passer le Chabbat dans sa belle demeure. C’est ce jour-là qu’Armand avait fait la connaissance de sa future épouse. En effet, Fanny, en raison de son état de santé, effectuait alors une cure thermale et logeait chez ce même Rudolf Schwartz. Le coup de foudre fut immédiat, et se concrétisa l’année suivante par un mariage.
Dix années plus tard, après une guerre mondiale et moult aventures, Emma Einhorn était la sixième preuve vivante des amours de Fanny et Armand.
En milieu d’après-midi, aux alentours de quinze heures, une fois le dernier morceau de kouglof avalé, et le dernier verre de vin englouti, les convives se séparèrent dans un joyeux brouhaha. Tout le monde étant passablement fatigué, Wolf et Caroline Liebermann décidèrent de rentrer se reposer à leur hôtel.
La famille Einhorn préféra prendre le chemin du jardin botanique, afin de donner un bol d’air aux enfants. Il faut dire que ceux-ci étaient passablement énervés d’avoir passé une partie de la journée enfermés dans la synagogue. Ce jardin, situé en bordure du parc du château, offre à ses visiteurs une véritable oasis de calme et de détente. Élie se montra particulièrement intéressé par l’impressionnante collection de plantes exotiques, dont certaines avaient des vertus médicinales. Cependant, il ne regretta pas d’avoir abandonné son métier de vendeur de poudre de "perlimpinpin". À présent, il tentait de vivre en faisant le commerce de " shmates ". Un "shmates" est une fripe, un vieux vêtement recyclé qu’Élie, une fois lavé et repassé, essayait de fourguer pour un prix dérisoire.
Âgé de cinquante-six ans, vivant seul et se contentant de peu, il passait ainsi le plus clair de son temps par monts et par vaux à pousser sa petite charrette à la recherche d’hypothétiques clients. L’autre grande occupation de son existence était la fréquentation de la synagogue, et les discussions avec son rabbin sur la signification de telle ou telle phrase de la Torah pouvaient prendre des heures et des heures.
Emma trônait dans sa poussette comme une reine, faisant des sourires à tous les passants qui s’extasiaient devant ce nouveau-né si gracieux.
Fanny, fière de sa progéniture, se tenait droite comme un I et faisait de petits signes de tête amicaux lorsqu’elle croisait des personnes de sa connaissance. Devant elle, Frida, un brin hautaine, poussait le landau occupé par Simon, peut être son préféré parmi ses petits protégés. Juste derrière Fanny, Maurice, fier de son rôle d’aîné, tenait la main à ses deux sœurs, Rosa et Juliette.
Nathaniel suivait de près, tout en tenant Ida dans ses bras.
Armand fermait la marche, il était en grande discussion avec son père.
"Papa, si tu veux, tu peux rester ici, on se débrouillera bien. Les temps sont durs, mais Nathaniel pourra te trouver un petit travail, tu seras bien, j’en suis sûr."
" Nisht, Nisht " (Non, Non), répondit l’intéressé.
" Je repars comme prévu dans deux jours. Et qui ira prier sur la tombe de ma pauvre Ann si je ne suis plus là ? On a malheureusement plus de nouvelles de ton frère Étienne parti aux Amériques, mais à Katowice, tes sœurs Miriam et Yaël pourront s’occuper de moi quand je serais vieux et malade."
Armand n’insista pas, il savait que ce n’était pas la peine.
Comme lui, son père était un fieffé têtu, il savait de qui il tenait.
Cette magnifique journée se termina par une collation offerte par Nathaniel. Frida avait installé au fond de son petit jardin du numéro vingt et un de la Bismarkstrasse une grande table recouverte d’une belle nappe blanche. À six heures du soir, il faisait encore bon dans cette minuscule cour baignée de soleil et bien abritée du vent. Si les adultes se contentèrent de se désaltérer avec de la bière, les enfants ne se privèrent pas de faire honneur aux friandises et autres pâtisseries préparées avec amour par la maîtresse de maison.
L’été déclina en pente douce jusqu’à la fin du mois de septembre. Puis, brutalement, les éléments se déchaînèrent.
Tout d’abord la pluie, intense et froide, ensuite le vent, violent et glacé. Enfin la neige s’installa précocement à partir du 15 octobre.
Emma, emmitouflée dans ses langes, avait élu domicile près du poêle à charbon qui chauffait à grand-peine les trois minuscules pièces du logement occupé par la famille Einhorn.
L’argent était loin de couler à flots. Une fois le loyer payé, il fallait faire attention aux dépenses consacrées à la nourriture et il ne restait alors plus grand-chose pour acheter les sacs de charbon.
En cette fin d’année 1921, Nathaniel Kaufman a du mal à faire tourner sa petite entreprise.
Les temps sont de plus en plus durs, surtout l’hiver. Avec les intempéries, les recettes sur les marchés se rétrécissent comme peau de chagrin, malgré tout le talent de bonimenteur dont Armand est pourvu afin d’attirer les badauds.
Armand se partage entre les villes de Karlsruhe le dimanche et le jeudi, d’Heidelberg le lundi, et d’Ettlingen le mardi. Les deux jours restants de la semaine, il aide son patron Nathaniel ainsi que David, le cousin de ce dernier, à la fabrication des savons dans l’atelier de la Bismarkstrasse.
David Kaufman est le "commercial" de l’affaire. Sa carte d’ancien combattant dans la "Deutsche Heer", qui est le nom officiel de l’armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, lui ouvre heureusement bien des portes dans le monde de l’administration. De plus, la mention suivante inscrite sur sa carte de visite : "Croix de fer de Première classe", rend le feldwebel (sergent-chef) Kaufman encore plus sympathique auprès de ses interlocuteurs. Grâce à David et bien évidemment aussi à la qualité des savons fabriqués par son cousin, la plupart des écoliers de la ville se lavaient plus blanc que blanc. Et en Allemagne, tout le monde le sait, on ne plaisante pas avec la propreté.
Cependant, le pays vaincu il y a trois ans maintenant, devait payer un lourd tribut aux Alliés au titre des réparations de guerre. Il est vrai que tout le nord-est de la France, ainsi qu’une grande partie de la Belgique étaient à reconstruire. Les dégâts causés par la guerre étaient énormes.
Pour rembourser, le gouvernement de la République de Weimar, qui est la nouvelle appellation du Reich allemand, hésitant à augmenter de manière inconsidérée les impôts par crainte d’émeutes populaires, n’a donc pas d’autre choix que de faire fonctionner la planche à billets à plein régime.
Il s’ensuivit à partir de la fin de la guerre une inflation considérable qui atteindra son apogée en 1923. L’effondrement de la monnaie s’ensuivit inexorablement.
Au mois d’octobre 1921, un seul dollar valait cent quarante-sept marks. En octobre, le même billet vert s’échangeait contre deux cent vingt-cinq marks. (Pour info, en 1914, le dollar correspondait à quatre marks).
Le prix de ses ingrédients augmentant de jour en jour, Nathaniel était contraint de répercuter la hausse sur le prix de ses savons. Régulièrement aussi, il devait augmenter le salaire de ses employés.
Armand pensait bien sûr que la vie augmentait plus vite que son revenu, et il avait du mal à joindre les deux bouts.
Heureusement, en ces temps difficiles, la solidarité jouait à plein. Frida faisait le maximum pour aider Fanny, quitte à se priver elle-même.
Pour la croissance d’Emma, il fallait du lait de bonne qualité, et pour cela il n’y avait pas de mystère, il fallait nourrir convenablement la mère allaitante. Aussi Frida rognait sur sa propre nourriture pour offrir à Fanny quand c’était possible soit un petit morceau de saucisse (rassurez-vous, en aucun cas du porc), soit quelques belles pommes de terre ou alors du chou afin de confectionner une bonne soupe bien nourrissante.
Deux fois par mois, les parents de Fanny envoyaient un colis de nourriture ainsi que des vêtements chauds pour Maurice et Rosa, qui grandissaient à la vitesse de l’éclair. Par souci d’économie, au fur et à mesure de leur croissance, Juliette portait les affaires de Rosa, et Ida celles de Juliette.
Armand marchait sur sa fierté pour accepter tous ces cadeaux, mais il ne pouvait faire autrement, se sacrifiant lui-même au maximum pour sa femme et ses enfants.
CHAPITRE II
LA MONTÉE DU FASCISME
Ainsi, en ce lundi 5 décembre 1921, Armand part pour son marché de Heidelberg le ventre vide. Dans le petit placard à provisions, il ne reste plus que trois tranches de pain noir et un demi-litre de lait pour le frishtick (petit-déjeuner) de sa famille.
Il fait encore nuit noire lorsqu’il pénètre dans la gare centrale de Karlsruhe, poussant avec peine sa charrette à bras. Une heure et demie plus tard, il se trouve à son poste sur la place du marché.
Son banc se situe juste en face de la fontaine d’Hercule, endroit où, jadis, les hérétiques et les sorcières étaient brûlés.
Déboulant de la Karlsplatz, un jeune marchand de journaux hurle à tue-tête le titre de la première page :
"En France, Henri Landru, accusé du meurtre de huit femmes, est condamné à mort ! Henri Landru… ! "
Armand écoute ce fait divers d’une oreille attentive, mais ne peut se permettre de dépenser les quelques pfennigs nécessaires à l’achat du journal. Sur les coups de dix heures du matin, alors que le pâle soleil de décembre a bien du mal à le réchauffer, il arrive à persuader son premier client d’acheter deux magnifiques savons de couleur bleu émeraude.
"Ce sera pour l’anniversaire de ma femme," précise l’individu, " je pense que c’est un cadeau plus utile qu’un bouquet de fleurs."
Armand, évidemment, ne va pas le contredire, et il le remercie chaleureusement. Agissant comme un aimant, ce premier client en attire un second, puis un troisième, et c’est ainsi qu’un petit attroupement se forme, à la plus grande joie du commerçant.
Soudain, alors que la vente bat son plein, la foule s’écarte progressivement, puis finit par se disperser. Armand aperçoit alors à l’autre extrémité de la place du marché deux groupes d’hommes qui se font face. Ils ne sont pas plus d’une vingtaine en tout, mais ils font du bruit comme cent.
Ce sont des membres du Parti communiste allemand qui affrontent leurs adversaires politiques, les partisans du national-socialisme, surnommés les nazis.
La bagarre est générale.
Rapidement, un premier homme s’écroule, le crâne fendu par une barre de fer. Un deuxième, assommé à coups de poing puis à coups de pied se retrouve allongé sur le pavé, les bras en croix.
Puis, d’un coup, c’est la débandade.
Avant de s’enfuir, les communistes laissent sur le terrain deux autres camarades, victimes de la supériorité des nazis dans l’art du combat de rue. En effet, la plupart d’entre eux sont d’anciens combattants opérant dans les troupes de choc lors de la Première Guerre mondiale.
Ils se sont regroupés sous la férule d’un certain Adolphe Hitler, ancien petit caporal dans l’armée, et actuellement plus ou moins au chômage. Si la teneur de ses propos est funeste, on ne peut lui contester un talent oratoire hors pair. Il sait mieux que quiconque galvaniser son auditoire par sa doctrine plus que simpliste :
C’est facile, pour redonner de la grandeur à l’Allemagne, il suffit de prendre l’argent aux riches et se débarrasser de la totalité des Juifs, source de tous les maux du pays.
Hitler a ainsi créé son propre service d’ordre, la Sturmabteilung, en français les sections d’assaut, ou SA. Les SA préfigureront l’arrivée des SS quatre années plus tard.
Pour l’heure, sur le marché d’Heidelberg, le groupe vêtu de chemises brunes reste maître du terrain. Celui qui semble le chef commence à parader sur la place, bientôt suivi par le reste de ses hommes.
Ils marchent au pas de l’oie, en frappant fortement le sol avec le talon de leurs bottes de cuir noir et en levant le bras droit à quarante-cinq degrés.
Armand croit avoir la berlue.
Il pense avoir reconnu le capitaine Zimmermann, le sinistre directeur du camp de prisonniers d’Erfurt, dans lequel il a croupi pendant près de quatre années.
Pas de doute, c’est bien lui, avec sa corpulence impressionnante, son cou de taureau surmonté par un visage ingrat et massif qui ne laisse place à aucun sentiment de compassion.
Armand tremble comme une feuille. Depuis quelques mois il a bien vaguement entendu parler de la doctrine nazie, mais jamais il n’aurait pensé être confronté de la sorte à cette triste réalité.
Zimmermann s’approche de lui !
Le regard gris acier du capitaine le toise des pieds à la tête.
" Ce n’est pas possible, " se dit Armand, " il y avait au moins dix mille prisonniers à Erfurt, il ne peut pas me reconnaître ! " Et pourtant si. Le capitaine Zimmermann n’oublie jamais un visage.
Un mauvais rictus déforme sa bouche, faisant apparaître trois dents en acier. Il avance doucement, à pas comptés.
" Tu es Français, toi, n’est-ce pas ? Et peut-être juif, aussi ? Ça se voit sur ton visage ! " hurle-t-il.
" Tu viens manger le pain des bons Allemands ! Allez raoust !
Sale juden ! "
D’un violent coup de pied, il démolit les tréteaux. Les savons jonchent le sol.
Armand reste tétanisé sur place.
Il se revoit huit ans en arrière, le 28 novembre 1913, sur la place de Savernes, en Lorraine, lorsque les Prussiens l’avaient arrêté manu militari.
Armand recule de deux pas, il s’attend au pire. Le nazi va-t-il le frapper ?
Finalement, dans un sinistre éclat de rire, la brute édentée tourne les talons et va rejoindre ses camarades en hurlant la devise du Parti national socialiste :
" Un Peuple, un Empire, un Chef ! "
Armand ne demande pas son reste. Il ramasse prestement sa marchandise et file avec sa misérable charrette en direction de la gare. Arrivé à Karlsruhe en début d’après-midi, il raconte à Nathaniel sa mésaventure.
" Bande de cons ! " s’écrie-t-il, "Ce n’est tout de même pas ce minable caporal qui va faire la loi chez nous ! La République doit être là pour nous protéger ! "
Armand tente d’apaiser son patron en lui expliquant qu’il faut faire le dos rond, et surtout pas de vagues. Ils vont bien finir par se calmer, ces nazis, lui dit-il.
Mais l’effet est inverse. Nathaniel explose, surtout lorsque David les rejoint.
Mis au courant des événements de la matinée, l’ancien colporteur en outils de Nuremberg prend fait et cause pour son cousin.
" Il faut jeter ces bandits en prison ! Les Juifs ne doivent pas se laisser faire ! " martèle-t-il.
Malgré tous ces beaux discours, Armand refuse catégoriquement de retourner la semaine suivante sur le marché d’Hindelberg.
" Zimmermann est un fou, vous ne le connaissez pas, il est capable d’assommer un bœuf d’un seul coup de poing !" plaide Armand, qui finalement réussit à avoir gain de cause.
" C’est entendu, " tranche le patron, " On va essayer de te trouver un autre marché pour le lundi."
David suggère la petite ville de Kuppenheim, distante d’une trentaine de kilomètres, et située non loin de la cité thermale de Baden-Baden.
Il a existé entre le quinzième siècle et les années 1940 une importante communauté juive à Kuppenheim, dont témoignait une synagogue construite en 1714 et détruite en 1938. On note aussi la présence d’un cimetière israélite, dont la plus ancienne tombe remonte à 1694.
" Banco ! " accepte Armand avec soulagement, " je vais les inonder de savons ! "
La suite de l’hiver se passe plutôt bien.
L’activité commerciale, sans être mirobolante, se maintient à un niveau acceptable, mais le spectre de l’inflation galopante est toujours présent. D’un mois sur l’autre, les prix peuvent doubler, voire tripler, l’argent a de moins en moins de valeur.
Le 21 juillet 1922, Emma atteint l’âge respectable d’un an. À cette époque, et surtout dans les familles pauvres, l’usage n’est pas de fêter les anniversaires, encore moins d’offrir des cadeaux. Cependant Frida, qui est en admiration devant ce beau bébé, bien joufflu malgré la dureté des temps, tient absolument à marquer l’événement. Parmi les six enfants Einhorn, Emma devient vite sa préférée.
Qui, d’ailleurs, pouvait résister devant cette petite fille aux belles boucles brunes qui entouraient un visage toujours souriant ?
En fait, ce qui caractérisera Emma durant toute sa vie, c’est sa bonne humeur et sa joie de vivre, quelles que soient les épreuves encourues.
Chaque fois que Frida pénétrait dans l’appartement de la rue Hebel Strasse, le bébé levait haut les bras en sa direction, en lui faisant des mimiques et des sourires à faire chavirer le cœur des plus insensibles. Invariablement, cela se terminait par un énorme câlin et des embrassades à n’en plus finir sur les bonnes joues toutes fraîches et toutes roses d’Emma.
Aujourd’hui donc, Frida n’arrive pas les mains vides. Elle tient entre ses mains un mystérieux petit paquet emballé dans un étui de couleur rose.
Fanny, à moitié surprise, commence par gronder son amie, puis, finalement, devant la mine déconfite de celle-ci, l’autorise à ouvrir son précieux colis.
Frida, qui entre autres talents, était une excellente couturière, avait confectionné une magnifique robe d’un beau vert chatoyant assorti à la couleur des yeux d’Emma. Celle-ci, loin de rester indifférente, se mit à applaudir maladroitement avec ses deux petites mains potelées. Peut-être son goût immodéré pour les vêtements lui vient-il de cette journée d’anniversaire ?
Pendant que cette scène touchante se joue à Karlsruhe, Adolphe Hitler purge une peine de trois mois d’emprisonnement trois cents kilomètres plus à l’est, dans la prison Stadelheim de Munich, capitale de la Bavière. Il est accusé de trouble à l’ordre public, coups et blessures en réunion.
En cette même année, l’antisémitisme reprend de plus belle.
Prenons pour exemple l’assassinat de Walter Rathenau.
Walther Rathenau, né à Berlin en 1867 est le fils d’un riche industriel juif, Emil Rathenau, fondateur de la puissante entreprise AEG, et magnat de l’électricité. Walther prend la suite de son père en 1914, ce qui ne l’empêche pas de s’engager aussi dans la politique. Homme d’une très grande intelligence, il obtient le poste de ministre des affaires étrangères.
Le 24 juin 1922, deux hommes, vêtus d’un long manteau de cuir noir, la tête recouverte d’une capuche s’approchent de sa voiture. Ils appartiennent à l’organisation nationaliste nommée "Consul".
Les terroristes sortent chacun un pistolet automatique et ils abattent froidement le ministre, aux cris de : "Mort aux juifs".
Pour couvrir leur fuite, ils lancent une grenade.
En 1923, l’inflation reprend de plus belle. L’Allemagne est incapable d’honorer sa dette de guerre envers les pays vainqueurs. La France et la Belgique, considérant que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, décident de se payer en occupant militairement la riche région minière de la Ruhr. Sous la protection de l’armée, les trains chargés de charbon et de minerai de fer prennent la direction de la Lorraine et de la Flandre. Le ressentiment des Allemands envers les Français est à son comble.
L’inflation atteint des sommets, ce qui entraîne la misère et son cortège de manifestants.
Il faut un milliard de marks pour acheter son pain !
Les Allemands se promènent avec des brouettes remplies de billets pour faire leur marché.
Le 8 novembre 1923, sentant ses compatriotes au bout du rouleau, Adolphe Hitler décide de passer à l’action. Il a en tête de renverser le gouvernement et s’emparer du pouvoir par la force.
Peu après vingt heures, Hitler arrive devant la brasserie Bürgerbräukeller de Munich, accompagné par plusieurs centaines de membres des sections d’assaut, son service de sécurité.
Les rues sont noires de monde.
Pistolet au poing, le chef des nazis se fraie un chemin jusqu’à l’estrade.
Pour obtenir le silence, il tire un coup de feu en l’air.
Le tribun décrète que l’État bavarois est renversé, et il affirme pouvoir former un gouvernement provisoire. Il est soutenu en cela par le général Ludendorff, héros de la Première Guerre mondiale. Il est accompagné d’hommes tels Hermann Göring, le responsable de la sécurité, et Rudolph Hess, son secrétaire particulier.
Hitler enflamme la salle en prononçant un violent réquisitoire contre les criminels de l’armistice de novembre 1918. Ce sont les Juifs, les milieux de gauche et les révolutionnaires qui ont donné un coup de poignard dans le dos à la valeureuse armée allemande, et précipité ainsi la défaite.
À l’instar de Bénito Mussolini qui, l’an passé, avait impressionné le gouvernement italien avec sa marche sur Rome, Hitler veut organiser une marche sur Berlin.
Il est confiant dans le ralliement de l’armée, des autorités et de la population.
Il se trompe lourdement.
Le 9 novembre, en fin de matinée, avec Hitler et Ludendorff en tête de cortège, les manifestants s’avancent à douze de front, en direction de l’Odeonsplatz de Munich.
Les deux mille putschistes passent sans encombre un premier barrage de police, sous les acclamations de la foule. Puis ils traversent le pont qui surplombe l’Isar, rivière qui se jette dans le Danube cent cinquante kilomètres plus loin.
À douze heures trente, le défilé atteint la Felderrnhalle, un grand bâtiment construit il y a moins d’un siècle par Louis 1er de Bavière à l’entrée de la Ludwigstrasse.
À midi, un ordre vient de tomber de Berlin : Le chancelier Stresemann demande à ses troupes d’écraser la rébellion. Les manifestants se heurtent alors à un deuxième cordon de police.
La situation devient confuse.
Max Erwin von Sheubner a trente-neuf ans. Ce diplomate né en Russie, titulaire du grade de lieutenant, est entré au Parti nazi en 1920. Très intelligent, il devient rapidement un proche collaborateur d’Hitler.
En ce 9 novembre, Von Sheubner se tient aux côtés du futur dictateur.
Le capitaine de police, arme au poing, demande aux manifestants de se disperser. Des insultes fusent, et des projectiles sont lancés contre les forces de l’ordre.
Le capitaine ouvre le feu, bientôt suivi par une dizaine de ses hommes.
Von Sheubner reçoit la balle qui aurait pu frapper Hitler.
Sans le savoir, il change le cours de l’histoire. Mortellement blessé, il s’écroule devant son chef.
Ulrich Graf est boucher de profession lorsque la guerre éclate.
C’est un gaillard maigre et de très grande taille, affublé d’une énorme moustache noire. En 1921, il intègre le Parti nazi.
Hitler le remarque de par son physique impressionnant, et l’embauche comme garde du corps.
Ce jour-là, il protège son patron et reçoit cinq balles dans le corps. Gravement blessé, il est lui aussi considéré comme le sauveur d’Hitler. Celui-ci parvient à s’enfuir, mais dans la débandade il se déboîte l’épaule.
Göring, quant à lui, est blessé à la jambe.
Finalement, on dénombre quatre victimes parmi les policiers, et seize morts chez les putschistes.
Ernst Hanfstaengl vit habituellement dans un hôtel particulier à Munich. Cet héritier d’une riche famille bavaroise possède également une maison de campagne dans la petite ville d’Uffing, située à soixante-dix kilomètres plus au sud. C’est un géant de près de deux mètres de haut, qui est séduit par les théories du nazisme ainsi que par le talent oratoire d’Hitler.
Hanfstaengl parvient à introduire ce dernier dans la haute société bavaroise et permet ainsi la récolte de fonds pour financer le parti d’extrême droite.
En cette fin d’après-midi du 9 novembre, Hitler, aux abois, se réfugie chez ce fidèle ami. Absent de son domicile ce jour-là, son épouse, Hélène, lui prodigue les premiers soins.
Le 11 novembre, les forces de l’ordre, bien informées, viennent arrêter le chef des putschistes.
Hitler est incarcéré à la prison de Landsberg. Son procès se déroule quelques mois plus tard, du 26 février au 1er avril 1924.
Si l’accusé s’est montré piteux face à la police au mois de novembre, il révèle, devant la cour de justice, son écrasante supériorité oratoire. Risquant théoriquement la peine de mort, les juges se montrent extrêmement cléments et le condamnent à seulement cinq années de forteresse.
De plus, Hitler sort de prison par anticipation quelques jours avant les fêtes de noël 1924, le 20 décembre exactement. Cet homme responsable du pire génocide de l’humanité mettra à profit ces quelques mois de détention pour rédiger son ouvrage emblématique, "Mein Kampf ", dans lequel il développe, dans un style empreint de haine, ses théories belliqueuses, racistes et antisémites.
En plus de son aversion à l’encontre des juifs, Hitler désigne clairement la France comme l’ennemi héréditaire numéro un qu’il faut abattre à tout prix.
À Karlsruhe, la situation s’aggrave.
Les difficultés économiques s’amplifient, et comme d’habitude surtout pour les petites gens.
En premier lieu les ouvriers, les retraités et les rentiers perdent une grande partie de leur pouvoir d’achat.
Par contre, la classe paysanne, les industriels et les grandes fortunes tirent leur épingle du jeu.
Heureusement, Nathaniel Kaufman est un homme d’affaires avisé. Il ne garde pratiquement aucun mark dans son entreprise.
Au contraire, même s’il n’en éprouve pas la nécessité, il a vite compris qu’il faut investir et emprunter le plus possible auprès des banques. Avec l’inflation plus que galopante, même avec des taux d’intérêt élevés, il sait qu’il n’aura aucun problème à rembourser.
Pour cela, il n’y a qu’à emprunter à nouveau. Il suffit ensuite de faire le gros dos, d’attendre des jours meilleurs, et alors là, ce peut être le jack pot.
Armand se soucie essentiellement pour sa petite famille. Son salaire peine à nourrir sa femme et ses enfants, d’autant plus qu’il a le sentiment d’avoir encore fait une grosse bêtise.
Alors qu’il a déjà six bouches à nourrir, il n’a pas voulu écouter sa femme alors qu’une envie pressante de faire l’amour s’était emparée de lui.
Nous sommes le vendredi 13 avril 1923.
Ce soir-là, la famille est invitée pour le Chabbat chez David Kaufman, son ami de toujours. Hannah a préparé avec amour le "gefiltfishe", la fameuse truite farcie.
David sort alors de derrière les fagots une bouteille de vin blanc du Rhin.
Armand accepte un premier, puis un second, et même un troisième verre. Ce serait malpoli que de refuser de trinquer avec son hôte !
Viens ensuite sur la table un gâteau d’origine polonaise, la "bobka", qui est une sorte de brioche à pâte levée, imbibée de kirsch. Hannah n’avait pas ménagé la liqueur, mais la bouteille était encore au trois-quarts pleine. Les hommes se chargèrent alors de lui jeter un sort, tout en discutant du sujet politique du moment, l’occupation de la Ruhr voisine. Ils devisaient notamment sur les conséquences de la résistance passive des mineurs et des cheminots. Ceux-ci, refusant d’obéir aux forces d’occupation, paralysaient la production de charbon et les transports.
Armand était en accord avec les Français, David avait opinion contraire.
Emma, âgée de presque trois ans, toujours aussi souriante et élégante dans les tenues que lui concoctait Frida, hésitait à prendre parti. Finalement, ne voulant se fâcher avec personne, elle décida de s’offrir un repos qu’elle jugea bien mérité.
Une fois la bouteille d’alcool vidée, les deux débatteurs jugèrent qu’il était raisonnable de se séparer, d’autant plus que tous les convives, le ventre bien plein, aspiraient à tomber dans les bras de Morphée.
Armand donna une vigoureuse accolade à David, embrassa chaleureusement Hannah sur les deux joues, même si cela n’est pas très convenable chez les juifs religieux qui s’interdisent toute familiarité entre hommes et femmes. Il prit ensuite la tête du cortège familial en direction de la rue Hebel Strasse toute proche.
Une fois arrivé au quatrième étage, le chef de famille engage avec peine la clef légèrement rouillée dans la serrure. Il est à peu près certain que la difficulté à ouvrir la porte n’est pas seulement due au mauvais éclairage des lieux.
Fanny s’occupe de coucher les enfants, tandis qu’Armand, bien chargé par l’alcool, regagne directement le lit conjugal. Il commence à penser au devoir du même nom, d’autant plus qu’il ressent comme une certaine sensation de chaleur au niveau du bas-ventre, et précisément un plus bas encore. En d’autres termes, il bande comme un âne.
Fanny ne tarde pas à le rejoindre, et il ne lui faut pas longtemps pour comprendre les pensées de son mari. Elle sent contre ses cuisses un bâton de berger qui, à son contact, s’allonge et se durcit de manière inquiétante. Armand commence à lui caresser les seins avec de plus en plus d’insistance. Elle tente de protester :
" Chéri, ce n’est pas le bon jour, j’ai pris ma température ce matin, je risque de devenir enceinte si…" Le chéri ne lui laisse pas finir sa phrase et lui chuchote à l’oreille.
« Mais qu’est-ce que tu racontes, je vais faire attention, t’inquiètes pas. »
Sur ces bonnes paroles, Armand, qui n’a pas du tout l’intention de se la mettre en bandoulière derrière l’oreille, grimpe prestement sur son épouse. Celle-ci réagit mollement, si bien que l’homme, ravi de l’aubaine, la pénètre avec sa fougue habituelle. Sans doute sous l’effet de l’alcool, incapable de se retenir plus longtemps, il explose en elle immédiatement.
Il lui faut trente secondes pour retrouver ses esprits, avant de se retirer brusquement.
Honteux, il exhorte sa femme afin qu’elle se lave consciencieusement pour effacer toute trace de sa semence.
C’était sans compter sur un spermatozoïde particulièrement rapide et doué d’une grande audace. À peine propulsé dans le vagin de Fanny, ce coquin rencontre un ovocyte ma foi tout à fait sympathique qui se fait un plaisir de lui ouvrir grand les portes du paradis. Bien entendu, cela ne se refuse pas. Ainsi, quelques minutes plus tard, un véritable ovule se forme, donnant naissance le 10 janvier 1924 à un gros bébé prénommée Sophie.
Emma va alors sur ses quatre ans.
L’arrivée de sa petite sœur la perturbe un peu, car évidemment elle se rend bien compte qu’elle n’est plus tout à fait le centre du monde. Mais Emma a bon caractère, elle n’est pas égoïste et elle sait partager. Si maintenant c’est Sophie qui a les faveurs de sa maman, eh bien ce n’est pas grave, elle va désormais exercer son pouvoir de séduction en priorité sur son papa ou à défaut sur Simon, son frère aîné. Quoi qu’il en soit, Emma adore attirer les regards sur elle, il faut qu’elle soit admirée.