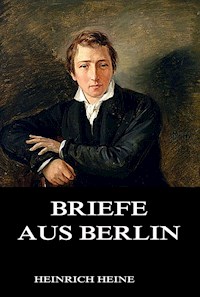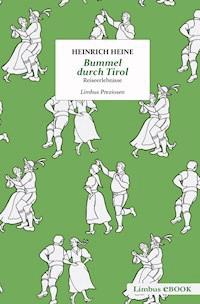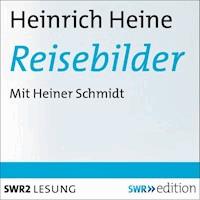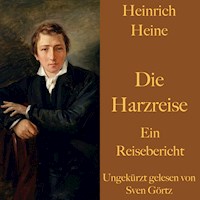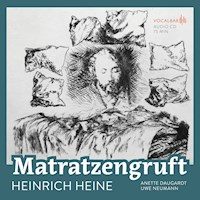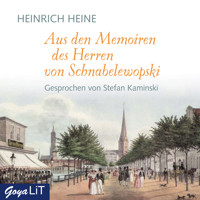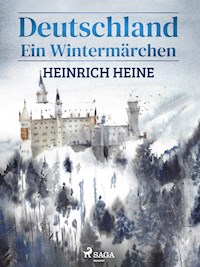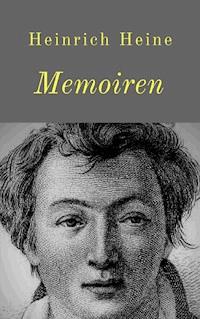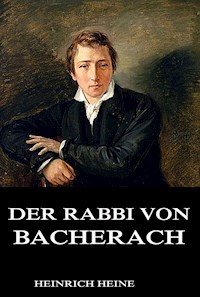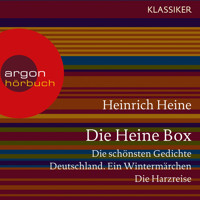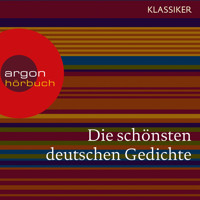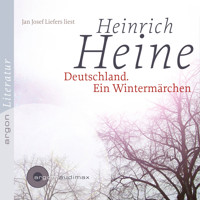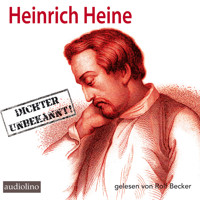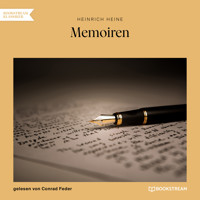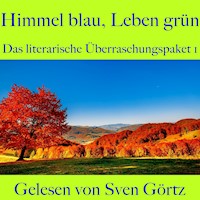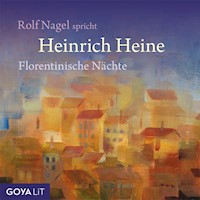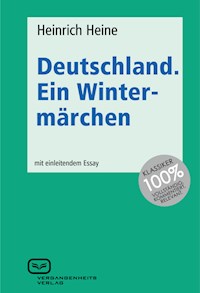Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Votre très chère lettre du cinq courant m'a rempli de la plus grande joie, tant votre bienveillance à mon égard s'y est manifestement exprimée. Je sens mon cœur rafraîchi, quand j'apprends que tant de braves gens se souviennent de moi avec sympathie et amour. Ne croyez pas que j'ai oublié de sitôt notre Westphalie !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076882
©Ligaran 2015
Les morceaux très divers qui composent ce volume, ont été écrits par Henri Heine, à des périodes fort différentes de sa vie, et offrent, aussi bien au point de vue des sujets mêmes que du ton et de l’étendue, une image multiple, mais tout ensemble piquante et vraie, de sa personnalité littéraire.
Les Lettres de Berlin, qui ouvrent le présent volume, furent écrites en 1821 et 1822, et adressées au docteur Schulz, rédacteur de l’Indicateur rhénan westphalien, qui les fit paraître dans la partie littéraire de ce journal. C’est le premier ouvrage en prose qu’ait publié Henri Heine, et le jeune prosateur, âgé de vingt-deux ans à peine, y apparaît déjà presque tout entier, de même que le poète s’était donné presque tout tuilier à connaître dans les Lieder et les tragédies qu’il écrivit vers le même temps. Nous retrouvons dans ces pages un tableau, sinon complet, du moins singulièrement animé et spirituel, de l’un des moments les plus brillants de la vie berlinoise, – le plus brillant peut-être de cette période qui s’étend de 1814 à 1848.
Cette esquisse du Berlin de 1821 donne lieu à de curieux rapprochements avec celles qui nous arrivent du Berlin actuel, lequel n’est plus précisément « une ville de Prusse », comme Heine désignait, entre autres appellations malignes, le Berlin de son temps.
Après ces lettres, nous avons groupé un certain nombre de morceaux critiques, écrits par Heine à différents moments de sa vie, les uns dans sa première jeunesse, les autres dans sa maturité. Parmi ces derniers, le lecteur remarquera les études sur le Struensée de Michel Beer, et sur l’Histoire de la littérature allemande de Wolfgang Menzel. – Heine s’est montré sévère, dans sa correspondance, pour l’Introduction au Bon Quichotte, qui fut publiée en 1837, et que nous avons placée parmi ses fragments de critique littéraire. Le lecteur, assurément, ne partagera qu’à demi ce jugement du poète sur l’un de ses propres écrits, jugement qui eût été moins vif, sans doute, s’il ne se fût pas agi pour lui de consoler son éditeur ordinaire de Hambourg de l’avoir vu accepter, pour ce travail, les offres d’un éditeur de l’Allemagne méridionale.
La dernière partie du volume se compose de Mélanyes recueillis çà et là et qui, presque tous, furent composés par Heine de 1836 à la fin de sa vie. Les trois charmantes lettres, écrites des Pyrénées, où le poète, déjà gravement malade, était allé, en 1846, chercher la guérison à Baréges, font songer, avec une involontaire tristesse, aux trois lettres écrites de Berlin, vingt-cinq ans auparavant. Entre ces deux dates, se place toute la carrière militante de Henri Heine. Mais, si la maladie cruelle qui ne le quitta plus depuis 1846, clôt cette portion militante de sa vie, chacun sait combien d’activité et de verve étincelante garda l’esprit du poète pendant ses longues années de souffrances, – et l’on ne s’étonnera pas de trouver, parmi les derniers morceaux de ce volume, un fragment assez étendu, et qui fut écrit en 1853, c’est-à-dire trois ans avant sa mort. Nous étions donc en droit de dire que De tout un peu, formé de fragments écrits par Heine à toutes les périodes de sa vie, nous donnait en raccourci son fidèle portrait.
Pour achever ce portrait, nous avons placé, à la fin du volume, une esquisse autobiographique, où Heine lui-même s’explique, à sa façon originale, sur sa jeunesse et les principales circonstances de sa vie jusqu’en 1835, dans une lettre écrite à M. Philarète Chasles, le 15 janvier de cette année-là. Cette esquisse, avait sa place naturelle dans le volume que nous publions aujourd’hui.
LES ÉDITEURS.
Étrange ! étrange ! Si j’étais le Bey de Tunis, je sonnerais l’alarme à un évènement aussi louche !
(KLEIST.- Le Prince de Hombourg.)
Berlin, 26 janvier 1822.
Votre très chère lettre du cinq courant m’a rempli de la plus grande joie, tant votre bienveillance à mon égard s’y est manifestement exprimée. Je sens mon cœur rafraîchi, quand j’apprends que tant de braves gens se souviennent de moi avec sympathie et amour. Ne croyez pas que j’ai oublié de sitôt notre Westphalie ! Septembre 1821 est encore trop frais dans ma mémoire. Les belles vallées autour de Hagen, l’aimable Overveg à Unna, les fêtes agréables passées à Hamm, l’excellent Fritz de B. vous, mon cher W…, les antiquités de Soest, même la bruyère de Paderborn, tout se présente encore tout vivant devant mes yeux. J’entends toujours les vieilles forêts de chênes frémir autour de moi, j’entends chaque feuille me chuchoter : Là habitaient les vieux Saxons, qui ont les derniers perdu leur croyance antique et leur qualité de Germains. J’entends toujours une vieille pierre me crier : Voyageur, arrête, c’est ici qu’Armin a battu les légions de Varus ! Pour apprendre à connaître le caractère sérieux et positif des habitants de la Westphalie, leur honnête probité et leur solidité sans prétention, il faut traverser ce pays à pied, et faisant, comme moi, de petites journées, telles que celles des soldats de la landwehr autrichienne,– Je serai enchanté vraiment si je puis, ainsi que vous me l’écrivez, par quelques communications datées de la capitale, obliger tant de personnes qui me sont chères. Aussitôt votre lettre reçue, j’ai préparé papier et plumes, et déjà me voici à l’œuvre.
De notes, je n’en manque point ; la seule question pour moi est celle-ci : quelles sont les choses que je ne dois pas écrire ? c’est-à-dire quelles sont celles que le public connaît depuis longtemps ? celles qui lui sont indifférentes ? celles qu’il doit toujours ignorer ? Autre embarras : il s’agit d’écrire sur beaucoup de matières, mais le moins possible sur le théâtre et autres sujets de ce genre, qui, étant le thème habituel des correspondances dans le Journal du soir, dans la Feuille du malin, dans la Feuille de conversation de Vienne, etc., y sont exposés en détail et systématiquement. L’un trouvera intéressant de savoir par mes récits que Jagor vient d’enrichir la liste de ses ingénieuses inventions en imaginant une certaine glace à la truffe ; un autre sera charmé d’apprendre que Spontini, dans la dernière fête de l’Ordre, portait culotte et habit en satin vert, avec de petites étoiles dorées. Seulement ne me demandez pas de système ; car c’est là l’ange exterminateur de toute correspondance. Je parle aujourd’hui des bals publics et des églises ; demain de Savigny et des jongleurs, qui traversent la ville dans des accoutrements étranges ; après-demain, de la galerie Gustiniani, et de là je reviendrai à Savigny et aux jongleurs. L’association des idées prédominera toujours. Vous recevrez une lettre toutes les quatre ou six semaines. Les deux premières seront d’une longueur disproportionnée, parce que je dois commencer par une esquisse de la vie extérieure et intérieure de Berlin ; une esquisse, dis-je, et non un tableau. Mais par quoi commencerai-je dans cette masse de matériaux ? La règle française me vient ici en aide : Commencez par le commencement !
Je commence donc par la ville, et en me reportant un peu en arrière, je me figure que je viens de descendre à la poste, rue Royale, et que je fais porter mon coffre léger à l’Aigle-Noire, rue de la Poste. Déjà je vous vois me demander : Pourquoi la poste n’est-elle pas rue de la Poste, ni l’Aigle-Noire dans la rue Royale ? Une autre fois, je répondrai à cette question. Pour le moment, je vais courir dans la ville, et je vous prie de me tenir compagnie. Suivez-moi seulement quelques pas ; nous voici déjà sur une place très intéressante : c’est le Pont-Long. Je vous vois tout étonné : « Pas si long ! » dites-vous. Pure ironie, mon cher correspondant. Arrêtons-nous ici un instant, pour contempler la statue du Grand-Électeur. Il se tient fièrement à cheval, pendant que des esclaves enchaînés entourent le piédestal. C’est un bronze magnifique, et incontestablement le plus grand chef-d’œuvre de l’art à Berlin, et on le voit entièrement gratis, parce qu’il est sur le milieu du pont. Il a la plus grande ressemblance avec la statue de l’électeur Jean-Guillaume, sur la place du Marché, à Dusseldorf ; à cela près que, dans la statue de Berlin, la queue du cheval est moins épaisse. Mais je vois que vous êtes poussé de tous les côtés !
Sur ce pont, il y a toujours foule, c’est une presse continuelle. Regardez un peu autour de vous. Quelle grande et magnifique rue ! C’est la rue Royale, où se pressent les magasins, et où les objets de toute nature, en leur étincelante variété, causent aux yeux une sorte d’éblouissement. Avançons encore ; nous voici sur la place du Château. À droite, le Château, édifice élevé et grandiose. Le temps lui a donné une couleur grise, ce qui lui communique un air plus sombre, mais d’autant plus majestueux. À gauche, encore deux belles rues, la rue Large et la me des Frères ; mais tout droit devant vous est la Carrière des Fontes, espèce de boulevard. C’est là que demeure Josty ! Ô vous, dieux de l’Olympe, comme je vous dégoûterais de votre ambroisie, si je décrirais les douceurs accumulées chez Josty ! Oh ! si vous connaissiez le contenu de ces Baisers ! Aphrodite, si tu avais émergé d’une semblable écume, tu serais beaucoup plus douce encore ! Le local est étroit, il est vrai, avec un air lourd, et décoré comme une taverne ; mais le bon remportera toujours la victoire sur le beau. Encaqués comme des harengs, les petits-fils des Brennes sont assis là-dedans, et sirotent de la crème, et font claquer leur langue de plaisir et se lèchent les doigts.
Nous pouvons traverser le château, et aussitôt nous serons dans le parc. « Mais où est donc le parc ? » me demandez-vous. Eh ! mon Dieu, n’y faites pas attention ; encore une ironie. C’est une place carrée, entourée d’une double rangée de peupliers. Nous y rencontrons une statue en marbre, gardée par une sentinelle ; c’est le vieux Dessauer. Il porte exactement le vieil uniforme prussien, sans rien d’idéalisé, absolument comme les héros sur la place Guillaume. Je vous les montrerai à la prochaine occasion : ce sont Keith, Ziethen, Seidlitz, Schwerin et Winterfeld, ces deux derniers portant le costume romain avec une longue perruque.
Nous voici juste devant l’église du Dôme, dont l’extérieur a été tout récemment décoré de neuf, avec adjonction de deux nouvelles tourelles, des deux côtés de la grande tour. Celle-ci, qui est arrondie en haut, n’est pas mal ; mais les deux jeunes tourelles font une figure très ridicule ; on dirait des cages d’oiseaux. Aussi, l’été dernier, le philologue D… se promenant avec l’orientaliste H.… qui se trouvait de passage à Berlin, celui-ci lui montra le Dôme et dit : Que signifient là-haut ces deux cages ? » À quoi le savant et facétieux philologue répondit ; « On y élève des bouvreuils. » Dans deux niches du Dôme on doit placer les statues de Luther et de Mélanchton. Voulons-nous entrer dans le Dôme, pour y admirer l’incomparable image de Begasse ? Vous pouvez vous y édifier aussi aux sermons du pasteur Thevenin. Non, restons plutôt dehors, car il fait des allusions aux sectateurs de la doctrine de M. Paulus. Cela ne m’amuse pas. Regardez tout de suite à la droite même du Dôme cette foule ondulante, qui s’agite dans une enceinte carrée et entourée de grilles de fer. C’est la Bourse. Là trafiquent les confesseurs de l’Ancien et du Nouveau-Testament. Ne les approchons pas trop. Ô Dieu ! Quelles figures ! l’avarice sous chaque muscle. S’ils ouvrent la bouche, je crois qu’ils me crient : « Donne-moi tout ton argent ! » Ils doivent déjà avoir raflé beaucoup. Les plus riches sont certainement ceux sur les fauves mines desquels est gravée le plus profondément l’expression du chagrin et de la mauvaise humeur. Oh ! combien plus heureux tel pauvre diable qui ne sait pas si un louis d’or est rond ou carré ! C’est avec raison qu’on fait ici peu de cas des commerçants. Mais on en fait d’autant plus de ces beaux messieurs là-bas, avec leurs chapeaux à plumets et avec leurs tuniques brodées de rouge ; car le parc est en même temps la place où l’on donne journellement le mot d’ordre et où l’on fait la revue des grand-gardes. Je ne suis pas un ami particulier des choses militaires ; cependant, je dois l’avouer, c’est toujours pour moi un spectacle réjouissant de voir les officiers prussiens groupés en cercle dans le parc. De beaux hommes vigoureux, solides et pleins de vie. Çà et là, il est vrai, on aperçoit encore des figures d’aristocrates bouffis d’orgueil, qui, par leur regard sottement provocateur, se distinguent de la foule. On trouve pourtant ici dans la majorité des officiers, surtout parmi les plus jeunes, une modestie, une simplicité de manières, d’autant plus estimables que l’état militaire, comme je l’ai dit, est l’état le plus respectes à Berlin. L’ancien esprit de caste, si tranché autrefois, s’est fort adouci, il est vrai depuis que tout Prussien est obligé de servir comme soldat, au moins pendant un an, et que, du fils du roi au fils du savetier, personne ne peut se soustraire à cette obligation. C’est là certainement une contrainte très gênante et onéreuse, quoique très salutaire sous beaucoup de rapports. Notre jeunesse est par là garantie du danger de l’effémination. Dans maints États, on entend moins de plaintes sur le fardeau du service militaire, parce qu’on le rejette là tout entier sur le pauvre agriculteur, tandis que le noble, le savant, le riche, et même, comme en Holstein, par exemple, tout habitant d’une ville est exempté du service. Comme toutes les plaintes à cet égard expireraient chez, nous, si l’on exemptait du service nos pékins blagueurs, nos commis de magasin politiqueurs, nos auditeurs, buralistes, poètes et batteurs de pavé, pétris de tant de génie ! Voyez-vous là-bas le paysan faire l’exercice ? Il porte, il présente les armes, et – se tait.
Mais, en avant ! il faut traverser le pont. Vous êtes surpris des immenses matériaux de construction répandus ici, et de ces nombreux ouvriers qui se démènent, causent, boivent de l’eau-de-vie, mais travaillent peu. À côté, il y avait autrefois le Pont-aux-Chiens ; le roi, après l’avoir démoli, fait maintenant construire à sa place un magnifique pont en fer. Déjà, cet été, on a commencé le travail, il traînera encore longtemps, mais enfin il en sortira une œuvre splendide. Et, maintenant, regardez ! là-bas, dans le fond, on aperçoit déjà les Tilleuls.
Vraiment, je ne connais pas d’aspect plus imposant que celui que présentent en amont les Tilleuls, vus du Pont-aux-Chiens. À droite, l’Arsenal, si élevé et si magnifique, la nouvelle Grand-Garde, l’Université et l’Académie ; à gauche, le palais du roi, l’Opéra, la Bibliothèque, etc. édifices de luxe serres contre édifices de luxe. Partout des statues pour ornements ; cependant elles sont en mauvaise pierre et mal ciselées, excepté celles de l’Arsenal. Nous sommes sur la place du Château, la plus large et la plus grande de Berlin. Le palais du roi est le plus simple et le plus insignifiant de tous ces édifices. Notre roi demeure là, simplement et bourgeoisement. Ôtez le chapeau ! le voici qui passe lui-même en voiture. Ce n’est pas le magnifique carrosse attelé de six chevaux, car celui-ci appartient à un ambassadeur. Non, le roi est assis dans une mauvaise calèche à deux chevaux commuas, la tête couverte d’un bonnet ordinaire d’officier et le corps enveloppé dans une capote grise. Mais l’œil de l’adepte voit la pourpre sous cette capote et le diadème sous ce bonnet. « Voyez-vous comme le roi rend avec affabilité le salut à tout le monde ? » Écoutons ! « C’est un bel homme ! » dit en chuchotant cette petite blondine. « C’était le meilleur des époux, » répond en gémissant son amie plus âgée. « Ma foi ! » dit l’officier de hussards, « c’est le meilleur cavalier de notre armée ! »
Mais comment trouvez-vous l’Université ? Ma foi ! un édifice magnifique ! C’est dommage seulement qu’il y ait un si petit nombre de salles ayant les proportions convenables, et que toutes les autres soient si sombres, si tristes ; ce qu’il y a de pis, c’est que la plupart des fenêtres donnent sur la rue et que, de là, en obliquant un peu, on aperçoit l’Opéra ! Ah ! comme le pauvre étudiant doit être sur des charbons ardents, si les sèches plaisanteries, sorties d’un volume, non de maroquin, mais de cuir de cochon, et débitées par un fastidieux professeur, lui assourdissent l’oreille, tandis que ses yeux s’égarent dans la rue et se réjouissent du spectacle pittoresque des brillants équipages, des soldats qui défilent, des nymphes qui passent en sautillant, et de la foule bigarrée, dont les flots roulent vers l’Opéra ! Comme les seize groschen doivent lui brûler la poche, quand il se dit tout bas : Heureux hommes ! ils vont voir madame Eunike dans le rôle de Séraphin, ou madame Milder dans le rôle d’Iphigénie. « Apollini et Muais, » telle est l’inscription tracée en grosses lettres sur la façade de l’Opéra, et le fils des Muses resterait dehors !
Mais, voyez, le cours vient de finir à l’instant, et un groupe d’étudiante s’achemine d’un pas nonchalant vers les Tilleuls. « Quoi ! demandez-vous, tant de philistins qui suivent les cours ! » Chut ! chut ! ce ne sont pas des philistins. Le chapeau haut à la Bolivar et le surtout à l’anglaise ne font pas le philistin, pas plus que l’étudiant n’a pour signe exclusif le bonnet rouge et la castorine ; car il y a ici maint garçon barbier sentimental, maint galopin ambitieux et maint tailleur aux grands airs, qui s’affublent précisément de ce costume. Il faut donc excuser le noble étudiant, s’il ne veut pas être confondu avec des messieurs de cette espèce.
Il y a ici peu de Courlandais, mais d’autant plus de Polonais, soixante-dix et davantage encore, portant presque tous le costume traditionnel des étudiants. Ceux-là n’ont pas à craindre la confusion dont je parlais tout à l’heure. On voit bien à ces figures qu’elles ne sont pas l’enveloppe d’une âme de tailleur. Beaucoup de ces Sarmates pourraient servir de modèles d’affabilité et de noble conduite aux fils d’Hermann et de Thusnelda. C’est une vérité. Quand on voit tant de charmantes qualités aux étrangers, il faut réellement une immense dose de patriotisme pour s’imaginer toujours que le plus précieux et le plus excellent produit de la terre est – un Allemand !
Il y a ici peu de rapports entre les étudiants. Les nations sont abolies. L’association, portant le nom d’Arminia, et composée d’anciens adhérents de la Burschenschaff, a été, dit-on, également supprimée. Les duels sont devenus rares. On en cite un qui a eu tout récemment une issue très malheureuse. Deux étudiants en médecine, Liebschütz et Fébus, dans le cours de sémiotique, se prirent de querelle pour un sujet très futile, parce que tous deux prétendaient également au siège n° 4. Ils ignoraient qu’il y avait deux sièges portant ce même numéro dans la salle ; tous deux avaient reçu ce numéro du professeur. « Imbécile ! » s’écria l’un d’eux, et ce mot termina pour le moment leur futile querelle. Ils se battirent en duel le lendemain, et Liebschütz s’enferra lui-même dans le fleuret de son adversaire. Il mourut un quart d’heure après. Comme il était juif, son corps fut porté au cimetière israélite par ses camarades de l’Université ; Febus, également juif, a pris la fuite, et…
Mais, je le vois, vous n’écoutez plus ce que je vous raconte ; vous êtes en extase devant les Tilleuls. Oui, ce sont les fameux Tilleuls, dont vous avez tant entendu parler. Je suis pris d’un frémissement à la pensée que Lessing s’est peut-être arrêté à cette place, que cette rangée d’arbres a été la promenade favorite de tant de grands hommes qui ont vécu à Berlin. Ici, a marché le grand Fritz : là, il s’est promené ! Mais le présent n’a-t-il pas ses gloires aussi ? Il est juste midi, et voici l’heure de la promenade du beau monde. La foule, en riche toilette, va et vient sous les Tilleuls. Voyez-vous là-bas cet élégant avec ses douze gilets bigarrés ? Entendez-vous les profondes observations qu’il chuchote à sa donna ? Sentez-vous les pommades et les essences précieuses avec lesquelles il est parfumé ? Il vous dévisage avec sa lorgnette, en souriant et en se frisant les cheveux. Mais regardez donc les belles dames ! Quelles formes ! Je deviens poète !
Non, cette dame là-bas, c’est un paradis qui marche, un ciel qui marche, une béatitude qui marche. Et c’est à cet imbécile à moustaches qu’elle lance des regards si tendres ! Ce gaillard-là n’est pas de ceux qui ont inventé la poudre, mais de ceux qui en font usage ; c’est un militaire. Vous vous étonnez que tous les hommes s’arrêtent ici tout à coup pour mettre la main à leur gousset et pour regarder en haut ! Mon cher, nous sommes précisément devant l’horloge de l’Académie, la meilleure de toutes les horloges de Berlin, de sorte qu’aucun passant ne manque de régler ici sa montre. C’est un spectacle amusant pour qui ne sait pas qu’il y a là une horloge. Dans cet édifice se trouve aussi l’Académie de chant. Je ne peux pas vous procurer de billet pour y aller ; le président, M. le professeur Zelter, n’est pas, dit-on, très prévenant pour ceux qui lui demandent cette faveur.
Mais regardez donc la petite brunette qui vous lance des regards pleins de promesse. Et c’est à une petite créature si gentille qu’on voudrait faire pendre au cou une espèce de plaque de chien ! Comme elle secoue gracieusement sa petite tête frisée, en faisant de petits pas avec ses petits pieds ; puis elle sourit de nouveau, pour montrer ses petites dents blanches ! Elle doit, à votre extérieur, vous avoir reconnu pour un étranger. Quelle foule de messieurs couverts de crachats ! Quelle masse de décorations ! quand on se fait prendre mesure pour une redingote, le tailleur vous demande : « Avec ou sans taille (pour la décoration) ? » filais, halte-là ! Voyez-vous cet édifice au coin de la rue Charlotte ? C’est le Café Royal. Entrons-y, je vous prie ; je ne peux passer sans y avoir jeté un coup d’œil. Vous ne voulez pas ? soit ; mais, en revenant, il faudra bien vous y résigner. Vis-à-vis, en direction oblique, vous voyez l’Hôtel de Rouen, et à gauche, l’Hôtel de Pétersbourg ; ce sont les deux hôtels les plus renommés. Tout près de là est la confiserie de Teichmann : ses bonbons farcis sont les meilleurs de Berlin ; mais il y a trop de beurre dans les gâteaux. Si, pour huit groschen, vous voulez mal dîner, allez dans le restaurant à côté de Teichmann, au premier étage. À présent, regardez à droite et à gauche. C’est la grande rue Frédéric. En la contemplant, on peut se faire une idée de l’infini. Mais ne nous y arrêtons point ; on s’enrhume ici. Il y a un courant d’air malsain entre la porte de Halle et celle d’Oranienbourg. Ici, à gauche, on voit de nouveau beaucoup de bonnes choses réunies dans un petit espace. D’un côté demeure Sala Tarone ; de l’autre, est le Café du Commerce, et là, enfin, habite Jagor ! Un soleil est l’écusson affiché au-dessus de la porte de ce paradis, symbole caractéristique ! Quelles sensations ce symbole n’éveille-t-il pas dans l’estomac d’un gourmand ! Ne va-t-il pas hennir à son aspect comme le coursier de Darius, fils d’Hystape ? Agenouillez-vous Péruviens modernes, ici habite – Jagor ! Et cependant, ce soleil n’est pas sans taches ; si nombreuses que soient les exquises délicatesses indiquées ici sur la carte, dont on imprime chaque jour le programme sans cesse renouvelé, le service, ma foi ! est souvent très lent ; souvent aussi le rôti est vieux et coriace, tandis que la plupart des mets, à mon avis, sont mieux préparés et plus savoureux dans le Café Royal. Mais le vin ! Oh ! pourquoi n’ai-je pas la bourse de Fortunatus ! Si vous voulez charmer vos yeux, je vous engage à regarder les images exposées ici dans les vitrines du rez-de-chaussée de Jagor. On y voit, à côté les uns des autres, l’actrice Stich, le théologien Neander, et le violoniste Boucher. Comme elle sourit, la gracieuse femme ! Oh ! si vous la voyiez, dans le rôle de Juliette, quand elle accorde le premier baiser à Roméo ! Ses paroles sont une vraie musique.
(MILTON.)
Mais, Neander, quel air distrait ! Certainement il pense aux gnostiques ; il pense à Basilidès, à Valentin à Bardesanès, à Carpocratès et à Marcus ! Boucher a, vraiment, une ressemblance frappante avec l’empereur Napoléon. Il se dit l’artiste cosmopolite, le Socrate des violonistes, il ramasse un argent fou, et, dans sa reconnaissance, il appelle Berlin la capitale de la musique. – Mais, passons vite ; voici encore une confiserie, et c’est ici qu’habite Lebeuve, un nom magnétique. Regardez les beaux édifices, des deux côtés des Tilleuls. C’est le grand monde de Berlin qui habite ce quartier. Passons vite. La grande maison à gauche est la confiserie de Fusch. Tout y est décoré de la manière la plus brillante ; partout des glaces, des fleurs, des figures en massepain, des sources, bref, l’élégance la plus exquise ; mais tout ce qu’on y consomme est plus cher, et en même temps plus mauvais que dans aucun autre établissement de la ville. Nul choix dans les sucreries et presque toutes sont desséchées ; sur la table, deux ou trois vieux journaux moisis ; et cette longue, longue demoiselle qui sert les chalands, n’est pas même jolie ! N’entrons pas chez Fusch. Je ne mange pas de glaces ni de rideaux de soie, et si je veux avoir quelque chose pour les yeux, je vais voir le Cortez ou l’Olympie de Spontini. – À droite, vous pouvez voir quelque chose de nouveau. On construit des boulevards, pour mettre la rue Guillaume en communication avec la rue Letzte. Arrêtons-nous ici, pour contempler la porte de Brandebourg et la Victoire qui la surmonte. La porte, élevée par Langhaus sur le modèle des Propylées d’Athènes, consiste en une colonnade de douze grandes colonnes doriques. Quant à la déesse là-haut, vous la connaissez, je pense, suffisamment par l’histoire moderne. La bonne dame a bien subi certaines épreuves ; mais il n’y paraît pas, à la voir diriger son char avec tant d’assurance.
Passons sous la porte. Ce que nous voyons maintenant devant nous, est le célèbre Thiergarten, traversé dans son milieu par la large chaussée qui conduit à Charlottenbourg. Des deux côtés sont deux statues colossales, dont l’une pourrait représenter Apollon ; mais, au fond, ce sont d’ignobles blocs mutilés ! On devrait les jeter à bas ; car certainement mainte Berlinoise enceinte a déjà, en les regardant, conçu de funestes envies. De là les nombreuses figures hideuses, que nous avons rencontrées sous les Tilleuls. La police devrait s’en mêler.
Revenons maintenant. Je sens que j’ai faim, et je veux entrer au Café Royal. Voulez-vous prendre une voiture ? Ici, tout près de la porte, stationnent des droschkis ; tel est le nom donné à nos fiacres de Berlin. On paye quatre gros pour une seule personne, six gros pour deux, et le cocher vous conduit où vous voulez. Les voitures sont toutes égales, et les cochers portent tous des capotes grises. Si l’on est pressé, et qu’il pleuve horriblement, impossible de trouver une seule de ces droschkis. En revanche, s’il fait beau temps comme aujourd’hui, ou si l’on n’en a pas grand besoin, on trouve les droschkis réunies en masse. Montons. Fouette, cocher ! Quels flots de monde se meuvent sous les Tilleuls ! Combien de gens qui vagabondent là, sans savoir où ils pourront dîner aujourd’hui ! Comprenez-vous bien, cher ami, tout ce que renferme ce mot : dîner ? Qui connaît la valeur de ce mot connaît le secret de toutes les agitations de la vie humaine. Fouette, cocher ! – Que pensez-vous de l’immortalité de l’âme ? Vraiment, c’est une grande invention, beaucoup plus grande que celle de la poudre. Que pensez-vous de l’amour ? Fouette, cocher ! N’est-il pas vrai que c’est la loi de l’attraction et rien de plus ? Comment trouvez-vous Berlin ? N’êtes-vous pas d’avis que la ville, quoique neuve, belle et régulièrement bâtie, produit cependant une impression un peu froide ? Madame de Staël fait cette remarque très ingénieuse : « Berlin, cette ville toute moderne, quelque belle qu’elle soit, ne fait pas une impression assez sérieuse ; on n’y aperçoit point l’empreinte de l’histoire du pays, ni du caractère de ses habitants, et ces magnifiques demeures nouvellement construites ne semblent destinées qu’aux rassemblements commodes des plaisirs et de l’industrie, » M. de Pradt dit quelque chose de bien plus piquant encore. – Mais vous n’entendez rien à cause du roulement des voitures. Bon ! nous sommes au terme. Halte-là ! Nous sommes devant le Café Royal.
Cet homme à la mine attable, qui se tient sous la porte, est Beyermann. Voilà ce que j’appelle un maître-d’hôtel ! Il n’y a pas là de façons rampantes avec des courbettes, mais des attentions et des prévenances : de la politesse et de l’urbanité, à côté d’un zèle infatigable dans le service : bref, la crème d’un maître d’hôtel. Entrons. Quel beau local ! le devant est le plus splendide cale de Berlin, tandis que le fond renferme le plus beau restaurant. C’est le rendez-vous du monde élégant et instruit. Vous rencontrez ici souvent les hommes les plus intéressants.
Apercevez-vous là-bas ce grand homme aux larges épaules, en surtout noir ? C’est le célèbre Cosméli, qui est aujourd’hui à Londres et demain à Ispahan. Je me représente ainsi le Pierre Schlemihl de Chamisso. Voyez, il s’apprête à lancer quelque paradoxe.
Remarquez-vous cet autre homme de grande taille, à la mine hautaine et au front élevé ? C’est Wolf, qui a dépecé Homère et qui sait faire des hexamètres germaniques.
Et à la table là-bas, ce petit homme, toujours en mouvement, ce visage dont les muscles s’agitent sans cesse d’une façon convulsive, ces gestes comiques et sinistres tout ensemble ? C’est le conseiller du tribunal de la Chambre, Hoffmann, qui a écrit le chat Murr ; et ce personnage de taille élevée et d’expression solennelle, assis en face de lui, est le baron de Luttwitz, qui a donné, dans la Gazette de Vöss, le compte rendu véritablement classique du chat Murr.
Voyez-vous aussi cet élégant à la tournure dégagée, qui prononce l’allemand du bout des lèvres, à la façon des Courlandais, et qui se tourne dans ce moment vers un homme sérieux, de haute taille, habillé d’un surtout vert ? C’est le baron de Schilling, qui, dans la Feuille de dimanche de Winden, a tant mis en émoi « les chers petits-fils de Teut. » L’autre, le personnage grave, est un poète. M. le baron de Maltitz.
Mais devinez-vous qui est cet homme à la mine déterminée, debout près de la cheminée ? C’est votre antagoniste. Hartmann, du Rhin, bien digne de son nom en effet, un homme (Mann) mais un homme dur (Hart), un homme de bronze et fondu d’un seul jet.
Mais qu’ai-je à faire, de tous ces messieurs ? J’ai faim. Garçon, la carte ! Voyez-moi cette liste de mets splendides ! Comme leurs noms ont un accent mélodieux et caressant, as music on the Waters ! Ce sont des formules magiques, mystérieuses, qui nous ouvrent l’accès du royaume des esprits. Et du Champagne avec cela ! Permettez-moi de verser une larme d’émotion ! Mais vous, homme sans cœur, vous n’avez aucun sens pour toutes ces splendeurs ! vous ne demandez que des nouvelles, de misérables caquetages de citadins. Je vais vous satisfaire.
Mon cher monsieur Gans, qu’y a-t-il de nouveau ? Il secoue sa vénérable tête grise et hausse les épaules. Adressons-nous plutôt à ce petit bonhomme joufflu ; ce drôle a toujours ses poches pleines de nouveautés, et une fois qu’il se met en train de les raconter, il continue toujours comme la roue d’un moulin. Qu’y a-t-il de nouveau, mon cher musicien de la Chambre ?
Rien du tout. Le nouvel opéra de Hellwig, LesOuvriers mineurs, a peu répondu à l’attente, dit-on. Spontini compose maintenant un opéra, dont Koreff a écrit le libretto. Son sujet, à ce qu’on assure, est tiré de l’histoire de la Perse. Bientôt nous aurons aussi l’Aucassin et Nicolette de Koreff, avec la musique de Schneider. Celle-ci est encore soumise, dans ce moment, à quelques retouches. Après le carnaval, on attend aussi Didon, opéra héroïque de Bernard Klein. Madame Bohrer et Boucher ont de nouveau annoncé des concerts. Quand on donne le Freyschutz, il est toujours difficile d’obtenir des billets. Le chanteur Fischer, qui est ici, ne se présentera pas en publie, mais il chante beaucoup dans les sociétés particulières. Le comte Brühl est encore très malade ; il s’est cassé la clavicule. Nous craignions déjà de le perdre, et il n’aurait pas été facile de trouver un intendant de théâtre aussi enthousiaste que lui de l’art allemand. Le danseur Antonini a été ici, il demandait pour chaque soirée cent louis qu’on lui refusa. Adam Muller, l’écrivain politique, est venu également à Berlin, ainsi que le fabricant de tragédies, Houwald. Madame Woltmann est probablement encore ici ; elle écrit des Mémoires. Dans l’atelier de Rauch, on travaille toujours aux bas-reliefs des statues de Blücher et de Scharnhost. Les opéras représentés pendant le carnaval sont indiqués dans les journaux. La tragédie du docteur Külm, intitulée : Les Habitants de Damas, sera représentée encore cet hiver. Wach est occupé d’un devant d’autel, que notre roi donnera à l’église de la Victoire, à Moscou. Madame Stich est depuis longtemps relevée de couches ; elle reparaîtra sur la scène demain, dans Roméo et Juliette. Caroline Fouqué a publié un roman en lettres ; c’est elle qui a écrit les lettres du héros, tandis que celles de la dame sont du prince Charles de Mecklenbourg. Le chancelier d’État est en convalescence ; c’est le docteur Rust qui le soigne. Le docteur Bopp, nommé professeur de langues orientales à l’Université, a fait sa première leçon sur le sanscrit devant un nombreux auditoire. De temps en temps, on confisque encore ici des numéros de la Feuille de Conversation, de Brockhaus. Du dernier ouvrage de Goerres, Affaires des provinces rhénanes, personne ici ne dit mot ; à peine sait-on qu’il existe. Le jeune garçon qui a tué sa mère à coups de marteau était fou. Les agitations des mystiques dans le nord de la Poméranie font grand bruit. Sous le titre : La Pure, Hoffmann publie maintenant chez Willmann, à Francfort, un roman qui renferme, dit-on, beaucoup d’allusions politiques. Le professeur Hubitz s’occupe toujours de traductions de grec moderne, et taille maintenant des vignettes pour l’Expédition de Souvarou contre les Turcs, imprimé par ordre de l’empereur Alexandre Ier qui veut en faire un livre populaire à l’usage des Russes. C’est chez Christiani que C.L. Blum vient de publier ses Lamentations des Hellènes, qui renferment beaucoup de passages poétiques. La réunion des artistes dans l’Académie a été très brillante, et la recette a été employée pour une œuvre pie. Walter, acteur du théâtre grand-ducal vient d’arriver de Carlsruhe, et se présentera dans les Aventures de voyage de Stubert Madame Hermann reviendra ici au mois de mars, où madame Stich partira alors pour un voyage. Jules de Voss a écrit une nouvelle pièce : Le nouveau Marché. Sa comédie, Quentin Metsys, sera représentée la semaine prochaine. Le Prince de Hombourg, par Henri de Kleist, ne sera pas représenté. On a renvoyé à Grillparzer le manuscrit de sa trilogie Les Argonautes, qu’il avait envoyée à notre intendance.
« Garçon, un verre d’eau ! »
N’est-ce pas qu’il en sait des nouvelles, le musicien ! C’est à lui qu’il faut nous en tenir. Il pourvoira la Westphalie de nouveautés, et ce qu’il ne sait pas, la Westphalie n’a pas besoin de le savoir davantage. Il n’est d’aucun parti, d’aucune école ; ce n’est ni un libéral, ni un romantique, et s’il lui échappe quelque médisance, il en est aussi innocent que l’infortuné roseau auquel le vent arrachait ces paroles : Midas, le roi Midas a des oreilles d’âne !
Berlin, le 16 mars 1822.
J’ai reçu votre communication du 2 février, et j’y ai vu avec plaisir que vous êtes satisfait de ma première lettre. Vous m’avez légèrement indiqué votre désir : pas trop de personnalités mises en relief ! J’y ferai mon possible. Il peut en résulter, en effet, des malentendus. Les gens ne regardent pas le tableau que j’ai esquissé, mais les petites figures que j’y ai placées pour l’animer, et finissent peut-être même par croire que je tenais surtout à ces figures. Mais on peut aussi peindre des tableaux sans figures, comme on peut manger la soupe sans sel. On peut parler à mots couverts, comme nos journalistes. Si vous parlez d’une grande puissance du Nord de l’Allemagne, tout le monde sait que par ces mots vous entendez là la Prusse. Je trouve cela ridicule. On dirait un bal masqué où les danseurs ont ôté leurs masques. De même, les gens savent parfaitement à qui je fais allusion si je parle d’un grand jurisconsulte du Nord de l’Allemagne, qui porte sa chevelure noire en longues boucles ondulantes sur les épaules, qui lance, des regards béats et dévots vers le ciel, cherchant peut-être par là à se donner une ressemblance avec l’image du Christ ; enfin qui, avec un nom français, et en dépit de son origine française, prend toujours les airs d’un matador teutomane. Du reste, j’appellerai tout par son nom ; à cet égard, je pense comme Boileau. Je dépeindrai aussi mainte personnalité ; je me soucie peu du blâme de ces gens qui regardent la correspondance de convention comme un doux lit de repos, où l’on se berce mutuellement avec cette consigne aimable : « Louons-nous les uns les autres, mais ne disons pas qui nous sommes. »
Je le sais depuis longtemps, qu’une ville ressemble à une jeune fille, qui aime voir sa gracieuse figure se refléter dans le miroir de la correspondance étrangère ; mais je n’aurais jamais pensé que Berlin, en se mirant de la sorte, prendrait les airs séniles d’une vraie commère. À cette occasion, j’ai fait cette découverte : Berlin est le grand rendez-vous des badauds et des commères.
Je suis très maussade aujourd’hui ; je suis morose, agacé, irritable ; la mauvaise humeur a rabattu mon imagination, et toutes mes plaisanteries portent des crêpes de deuil. Ne croyez pas que quelque infidélité féminine en soit la cause. J’aime toujours les femmes ; lorsque, à Goettingue, je me trouvais dans l’impossibilité d’avoir aucun commerce avec les femmes, je me suis au moins procuré un chat ; mais l’infidélité féminine ne provoquera plus chez moi que des rires. Ne croyez pas non plus que ma vanité ait reçu quelque douloureuse blessure ; le temps est passé où, chaque soir, je tordais péniblement mes cheveux en papillotes, où je portais continuellement une glace dans ma poche et m’occupais, vingt-cinq heures du jour, à faire le nœud de ma cravate. Ne croyez pas enfin que des scrupules religieux tourmentent et agitent peut-être mon âme tendre ; aujourd’hui, je ne crois plus qu’au carré de l’hypoténuse et au Gode civil du royaume de Prusse. Non, une raison beaucoup plus sensée motive mon chagrin : mon plus précieux ami, le plus aimable de tous les mortels. Eugène de B… est parti avant-hier ! C’était le seul homme dans la société duquel je ne m’ennuyais point, le seul dont les bons mots pleins d’originalité me rendaient une sérénité joyeuse, tandis que dans les traits nobles et doux de sa figure, je pouvais en quelque sorte revoir les traits de mon âme d’autrefois, lorsque je menais encore une vie belle et pure, une vie de fleurs, et que je ne m’étais pas encore souillé de haine et de mensonge.
Mais écartons ces tristes pensées ! Je dois maintenant parler de ce que les gens chantent et disent chez nous aux bords de la Sprée. Leurs raisonnements subtils comme leurs propos de vipères, leurs causeries niaises et leurs médisances envenimées, vous apprendrez tout, mon cher correspondant.
Boucher qui, depuis longtemps a donné le dernier – des derniers – de tous ses concerts, et qui maintenant charme peut-être Varsovie ou Pétersbourg avec ses tours de force sur le violon, a en effet raison s’il appelle Berlin la capitale de la musique. Pendant tout l’hiver ç’a été ici une chanterie et une sonnerie à rendre sourd à jamais. Un concert succédait à l’autre.
L’Espagnol auquel il est fait allusion, c’est Escudero, élève de Baillot, excellent violoniste, jeune, épanoui, joli garçon, sans cependant devenir le protégé