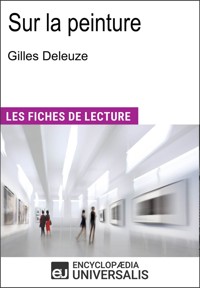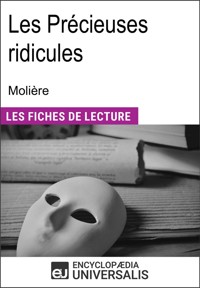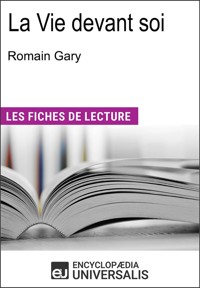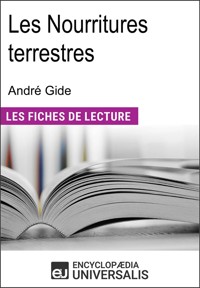Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Idées & Notions : joli titre pour une collection consacrée au savoir. Mais comment se relient les deux faces de ce diptyque ? Il est possible de le dire en peu de mots. Le volet « idées » traite des courants de pensée. Il passe en revue les théories, manifestes, écoles, doctrines. Mais toutes ces constructions s’élaborent à partir de « notions » qui les alimentent. Les notions sont les briques, les outils de base de la pensée, de la recherche, de la vie intellectuelle. Éclairons la distinction par un exemple : l’inconscient est une notion, le freudisme une idée. Les droits de l’homme, la concurrence ou l’évolution sont des notions. La théologie de la libération, la théorie néo-classique ou le darwinisme sont des idées. Notions et idées sont complémentaires. Les unes ne vont pas sans les autres. Notions et idées s’articulent, s’entrechoquent, s’engendrent mutuellement. Leur confrontation, qui remonte parfois à un lointain passé, tient la première place dans les débats d’aujourd’hui. La force de cette collection, c’est de les réunir et de les faire dialoguer. Le présent volume sélectionne idées et notions autour d’un thème commun : Dictionnaire des Idées & Notions en Sciences humaines.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852291249
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Karavai/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans le Dictionnaire des Idées & Notions en Sciences humaines, publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles du Dictionnaire à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
ACTES DE LANGAGE
L’expression « acte de langage » traduit l’anglais speech act. Cette notion a été développée dans la seconde moitié du XXe siècle par les philosophes dits de l’école d’Oxford, tenants d’un courant également connu sous le nom de « philosophie du langage ordinaire ».
• « Quand dire, c’est faire »
On considère généralement que la théorie des actes de langage est née avec la publication posthume en 1962 d’un recueil de conférences données en 1955 par John Austin, How to do Things with Words. Le titre français de cet ouvrage, Quand dire, c’est faire (1970), illustre parfaitement l’objectif de cette théorie : il s’agit en effet de prendre le contre-pied des approches logiques du langage et de s’intéresser aux nombreux énoncés qui, tels les questions ou les ordres, échappent à la problématique du vrai et du faux. Dire « Est-ce que tu viens ? » ou « Viens ! » conduit à accomplir, à travers cette énonciation, un certain type d’acte en direction de l’interlocuteur (en lui posant une question ou en lui donnant un ordre).
Les énoncés auxquels Austin s’est intéressé en tout premier lieu sont les énoncés dits performatifs. Un énoncé performatif, par le seul fait de son énonciation, permet d’accomplir l’action concernée : il suffit à un président de séance de dire « Je déclare la séance ouverte » pour ouvrir effectivement la séance. L’énoncé performatif s’oppose donc à l’énoncé constatif qui décrit simplement une action dont l’exécution est, par ailleurs, indépendante de l’énonciation : dire « J’ouvre la fenêtre » ne réalise pas, ipso facto, l’ouverture de la fenêtre, mais décrit une action. L’énoncé performatif est donc à la fois manifestation linguistique et acte de réalité.
Les exemples d’énoncés performatifs sont nombreux : « Je jure de dire la vérité », « Je te baptise », « Je parie sur ce cheval », « Je t’ordonne de sortir », « Je vous promets de venir », etc. Dans le détail, l’identification et la caractérisation des énoncés performatifs se heurte à un certain nombre de difficultés. D’une part, les performatifs ne sont tels que dans des circonstances précises, car ils doivent répondre à des conditions de « succès » : seul le président devant l’assemblée réunie peut dire avec effet « Je déclare la séance ouverte », ou le prêtre dans l’église « Je te baptise ». D’autre part, seules certaines formes linguistiques particulières permettent de construire des énoncés performatifs : le verbe doit être à la première personne et au présent (« Il promet de venir » ou « J’ai promis de venir » ne sont pas des performatifs réalisant une promesse, mais des constatifs décrivant une promesse). Pour autant, la frontière entre énoncés performatifs et énoncés constatifs reste incertaine. Si les verbes de parole (ou verbes « délocutifs », comme promettre, permettre, ordonner, conseiller, accepter, refuser, maudire, protester, jurer, etc.) paraissent prototypiques pour la construction d’un énoncé performatif, leur présence n’est pourtant ni nécessaire (baptiser n’est pas un verbe de parole) ni suffisante (mentir, injurier ou insulter, bien que verbes de parole, ne permettent pas d’exprimer un performatif). Par ailleurs, à côté des performatifs explicites, force est de reconnaître, à la suite d’Austin, l’existence de performatifs « masqués » (comme « La séance est ouverte »), d’énoncés mixtes performatifs-constatifs (comme « Je vous remercie ») ou encore de performatifs implicites (comme l’impératif « Viens ! » qui équivaut au performatif explicite « Je t’ordonne de venir »).
Le programme tracé par Austin dans son ouvrage est beaucoup plus large que la seule étude des énoncés performatifs : c’est une véritable théorie générale des actes de langage qu’il propose. Il établit une distinction entre trois grands types d’actes, qu’il appelle respectivement « locutoires », « illocutoires » et « perlocutoires ». L’acte locutoire (ou « acte de dire quelque chose ») consiste à construire un énoncé auquel est associée une signification linguistique (un contenu propositionnel). L’acte illocutoire (ou « acte effectué en disant quelque chose ») se définit comme l’action réalisée en direction de l’interlocuteur (question, promesse, ordre...). Tous les énoncés sont dotés d’une valeur illocutoire : cela est vrai non seulement des énoncés performatifs, mais également des énoncés constatifs, qui marquent eux aussi un certain type d’acte de langage (le constat d’un certain état de choses). Enfin, l’acte perlocutoire est caractérisé en termes d’effets que l’énonciateur vise à produire sur son interlocuteur grâce à l’énoncé : le convaincre, l’émouvoir, l’intimider... Contrairement aux deux précédents types d’actes, les actes perlocutoires ne sont pas strictement linguistiques : on peut obtenir un effet perlocutoire par un comportement gestuel non verbal.
• La force illocutoire
La théorie des actes de langage mise en place par Austin a été reprise et développée par divers auteurs, au tout premier rang desquels figure John Searle, auteur d’un ouvrage paru en 1969, et traduit en français en 1972 sous le titre Les Actes de langage. Reprenant l’idée selon laquelle la production d’un énoncé revient à accomplir un certain acte qui vise à modifier la situation des interlocuteurs, Searle appelle force illocutoire ce qui permet d’établir sa valeur d’acte de langage. Pour lui, le contenu d’un énoncé résulte de sa force illocutoire ajoutée à son contenu propositionnel. Des énoncés différents peuvent avoir le même contenu propositionnel tout en correspondant à des actes de langage différents (par exemple, « Pierre ferme la porte » ; « Est-ce que Pierre ferme la porte ? » ; « Pierre, ferme la porte ! » ; « Pourvu que Pierre ferme la porte ! ») ; d’autres peuvent avoir la même force illocutoire exprimée de façon très différente (par exemple, « Ferme la porte ! » ; « Je t’ordonne de fermer la porte » ; « Est-ce que tu pourrais fermer la porte, s’il te plaît ? »).
La question des conditions de succès ainsi que celle de la classification même des types d’actes de langage ont été reprises par Searle dans son ouvrage de 1979, traduit en 1982 sous le titre Sens et expression. Il y étudie notamment les formes indirectes d’expression des actes illocutoires – ce que la tradition reprendra ultérieurement sous l’appellation d’« actes de langage indirects ». Par opposition aux actes de langage directs qui, tels ceux qui sont exprimés par les performatifs explicites, sont immédiatement déchiffrables dans la forme même de l’énoncé, les actes de langage indirects (« Auriez-vous du feu, par hasard ? ») doivent être reconstruits par l’auditeur au terme d’un calcul qui fait appel à plusieurs types de connaissances, linguistiques et extralinguistiques, ainsi qu’à des capacités d’inférence.
L’idée défendue par les philosophes de l’école d’Oxford, selon laquelle le langage est une forme d’action sur autrui, et pas seulement un mode de représentation du monde, n’est certes pas nouvelle. Depuis l’Antiquité, la rhétorique s’en était fait l’apôtre et, dès les débuts de la linguistique, plusieurs courants l’avaient également formulée, dans des perspectives diverses : réflexions sur les « fonctions du langage » (Karl Bühler, Roman Jakobson), opposition entre le l’attitude, ou « modus », et le contenu, ou « dictum » (Charles Bally), approches sémiotiques de la pragmatique (Charles Peirce, Charles Morris ou Ludwig Wittgenstein). Mais c’est certainement à Austin et à Searle que l’on doit d’avoir donné un statut théorique à cette conception du langage.
Après ces deux pionniers, plusieurs auteurs ont enrichi la discipline par leurs travaux. Certains, comme Peter Strawson, se sont inscrits directement dans la lignée de la théorie des actes de langage ainsi tracée, en cherchant notamment à redéfinir la notion d’illocutoire et les différents niveaux de la signification. D’autres, s’appuyant sur la théorie des actes de langage, ont exploré de nouvelles pistes ouvertes par la pragmatique linguistique, toujours dans le but d’appréhender le langage comme un moyen d’agir sur le contexte interlocutif : ainsi des études sur la dimension des présupposés et de l’implicite dans le langage, ou encore l’analyse des interactions communicatives.
Catherine FUCHS
ALIÉNISME
Apparu en 1833, le terme aliénisme, dérivé d’aliénation, a surtout été utilisé par la suite pour désigner rétrospectivement la nouvelle spécialité médicale qui s’est développée au XIXe siècle par l’application à l’étude et au traitement de la folie des méthodes de la médecine moderne née de la philosophie des Lumières.
• De la « manie » à l’aliénation mentale
Au début du XIXe siècle, plusieurs auteurs européens ont publié dans leurs pays respectifs, sous des régimes politiques très différents, des ouvrages posant la question de savoir quel devrait être désormais le traitement médical de la folie : en Toscane, Vincenzo Chiarugi (1759-1820), en Savoie, Joseph Daquin (1732-1815), en France, Philippe Pinel (1745-1826) et, en Angleterre, Samuel Tuke (1784-1857). Pinel, médecin de l’hospice de Bicêtre pendant la Convention, a proposé dans son Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie de l’an IX (1800) de substituer à la notion de « manie », qui gardait encore le sens antique de « folie » considérée comme une perte totale de la raison, celle d’aliénation mentale, définie comme une contradiction interne entre les fonctions de l’entendement et les fonctions affectives, mais respectant au moins partiellement la raison du sujet ainsi devenu « étranger », aliéné à lui-même. Le médecin peut, en s’appuyant sur la partie non aliénée de la raison, pratiquer un traitement moral, par opposition au traitement physique, de l’aliénation.
Les causes déterminantes de l’aliénation mentale sont en effet, pour Pinel et pour les aliénistes qui le suivent, des causes morales, les passions de l’âme, les causes physiques n’étant qu’adjuvantes. Il convient donc tout d’abord de renoncer aux moyens physiques brutaux (coups, chaînes, immersion brutale, saignée...), jusque-là utilisés dans le traitement de la folie, pour établir avec l’aliéné une relation à la fois de confiance et d’autorité. Cela était impossible à réaliser dans ce lieu d’enfermement et non de soins qu’était à la fin du XVIIIe siècle l’hôpital général, et ne pourra se faire que dans de nouvelles institutions où les aliénés ne seront plus mélangés avec d’autres malades, délinquants ou criminels. L’expérience de Pinel pour traiter selon ces nouveaux principes les aliénés de La Salpêtrière le conduisit à distinguer quatre espèces d’aliénation : la manie, ce terme perdant le sens général de folie pour en prendre un plus restreint ; la mélancolie ; l’idiotisme, état pour lequel Pinel admet l’existence de causes physiques expliquant ainsi l’échec du traitement moral entrepris par Jean Itard (1774-1838) du fameux enfant sauvage, Victor de l’Aveyron ; la démence.
Si Johann Christian Heinroth (1773-1843) propose dès 1814 de nommer psychiatrie, littéralement « médecine de l’âme », cette nouvelle spécialité médicale, ce terme sera long à remplacer en français celui d’aliénisme, pourtant postérieur.
• En France : la loi du 30 juin 1838 créant les asiles d’aliénés
Les idées politiques de Jean Étienne Dominique Esquirol (1772-1840), monarchiste, catholique et franc-maçon, firent de lui le principal inspirateur de la loi votée sous la monarchie de Juillet le 30 juin 1838, créant dans chaque département un asile d’aliénés. La loi fixait les règles juridiques de l’internement dans ces établissements en tentant de concilier la défense de la société et des familles et les droits des citoyens, même aliénés. Les opposants à cette loi étaient moins les défenseurs des libertés individuelles que ceux qui s’élevaient contre le coût de construction et de fonctionnement de ces établissements à la charge des départements, notamment pour les aliénés indigents. Des velléités de réforme de la loi de 1838 sous la IIIe République n’aboutirent qu’à remplacer la dénomination « asile d’aliénés » par celle d’hôpital psychiatrique et ce ne fut qu’en 1990 que la loi fut réformée, la question de la prise en charge financière du traitement des malades mentaux ayant été en partie résolue par l’instauration sous la IVe République de l’assurance-maladie obligatoire. Sous le second Empire, le plan d’inspiration haussmannienne, prévu pour le département de la Seine, avec un asile central, Sainte-Anne, à Paris et des asiles en périphérie, ne fut qu’en partie réalisé. L’asile dont les aliénistes avaient rêvé de faire l’instrument du traitement moral des aliénés sera en quelque sorte victime de son succès, du fait de l’augmentation constante, tout au long du second Empire, des sujets internés pour d’autres raisons, notamment sociales, que l’aliénation.
Les aliénistes devaient faire reconnaître par la société leur compétence particulière dans l’art difficile de reconnaître les états d’aliénation relevant d’un internement. Ils devaient le faire aussi auprès des autorités judiciaires dans le domaine de la médecine légale avec l’appréciation, conformément aux articles du Code civil de 1804 et du Code pénal de 1810, de l’éventuelle existence d’un état d’aliénation lors d’actes de la vie civile, de délits, surtout ceux de nature sexuelle, ou de crimes de sang (Esquirol avait cru résoudre l’épineuse discussion sur les aliénés criminels, en introduisant la notion de monomanie homicide). En 1843 sont créées, pour débattre de ces questions, les Annales médico-psychologiques, puis en 1852, après la révolution de 1848 à laquelle participèrent nombre d’aliénistes, la Société médico-psychologique (toujours actives). La faculté de médecine ne voyait pas d’un bon œil l’apparition de cette nouvelle spécialité qui mettait en cause l’unité de la médecine, et la chaire dite de « clinique des maladies mentales et de l’encéphale » ne fut créée à Sainte-Anne qu’en 1875, marquant ainsi l’apogée et la fin de l’aliénisme.
• De l’aliénation aux maladies mentales
Des maladies autres que les états d’aliénation, ou bien dues à des causes physiques ont été entre-temps décrites. Déjà en 1822, Antoine Laurent Bayle (1799-1858) avait montré l’existence, chez les sujets morts dans un état de démence avec paralysie générale, d’une atteinte cérébro-méningée dont la nature syphilitique sera établie vers 1879. À la fin du XIXe siècle, la majorité des malades internés dans les asiles ou les maisons de santé privées le sont pour « paralysie générale », le délire mégalomaniaque que provoque la syphilis cérébrale suscitant l’image du « fou-qui-se-prend-pour-Napoléon » comme archétype de l’aliénation.
Lorsque Jean-Pierre Falret (1794-1870) publie le recueil de ses travaux en 1864, il l’intitule Des maladies mentales car ils ne traitent plus de la seule aliénation, mais d’un ensemble plus étendu de maladies. Ainsi, la clinique des troubles mentaux liés à ce qu’on nomme en 1882 « alcoolisme » est maintenant bien connue. Un rôle de plus en plus important est attribué à l’hérédité familiale dans la genèse des maladies mentales avec la formulation de théories sur la « dégénérescence » de l’espèce humaine. Émile Zola (1840-1902) a, dans Les Rougon-Macquart, tracé l’« histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire » où s’associent alcoolisme et dégénérescence.
D’autre part, la description des principales maladies neurologiques par Jean-Martin Charcot (1825-1893), à partir de 1860, avait ouvert à la psychiatrie le champ des névroses, notamment l’hystérie, la grande névrose, et la névrose d’angoisse qui appellent d’autres méthodes thérapeutiques (hypnose, psychothérapie, puis psychanalyse) que le traitement moral.
• La sortie de l’hôpital psychiatrique
Si, dès 1900, le Congrès international de psychiatrie préconise le traitement des malades mentaux en dehors de l’asile, ce n’est qu’en 1921 qu’est ouvert à Paris un premier service libre à l’hôpital Henri-Rousselle. Paradoxalement, un des promoteurs de cette « désaliénation », Édouard Toulouse (1865-1947), partageait avec d’autres médecins de l’entre-deux-guerres des convictions eugéniques sur la nécessité de « protéger la race » du danger d’une prolifération des aliénés, sans que fort heureusement aucune mesure en ce sens ne soit prise en France.
Après la Seconde Guerre mondiale, à la suite de l’extermination planifiée des malades mentaux dans l’Allemagne nazie ou leur mort par inanition dans les hôpitaux psychiatriques des pays occupés, s’amorce en France un mouvement « désaliéniste » qui précède l’antipsychiatrie anglaise de la fin des années 1960. Il aboutit, dès mars 1960, à la politique dite de secteur, confiant à une équipe médicopsycho-sociale unique les soins aussi bien extra qu’intra-hospitaliers de la population adulte vivant dans un secteur géo-démographique de 60 000 habitants, une équipe de psychiatrie infanto-juvénile prenant en charge les malades mineurs.
Jean GARRABÉ
ANTIPSYCHIATRIE
Tenter de situer l’antipsychiatrie par rapport à la psychiatrie, c’est courir le risque majeur d’accepter un couple antinomique où le second terme recouvrirait une doctrine impliquant une démarche objectivante, celle même que récuse l’antipsychiatrie. « L’antipsychiatrie, écrit Danielle Sivadon, se veut silence sur le vacarme des théories [...] on imagine mieux du noir sur une toile, un écran silencieux, une feuille de papier blanc » (L’Avenir d’une utopie).
• Origine du mouvement
Comme tout phénomène humain, le mouvement a une histoire. Il débute à Londres dans les années 1960 et groupe des psychiatres anglais et américains ; certains sont psychanalystes. Freud avait déjà apporté « la peste » dans la psychiatrie en abordant le problème des psychoses psychanalytiquement. Elles n’étaient plus constitutionnelles ou organiques mais s’engendraient d’un manque radical, manque non symbolisé faisant la place à un cataclysme imaginaire (Lacan), substance même d’une tentative de reconstruction qui constitue la psychose elle-même. C’était reprendre par la psychogenèse la folie au compte de la psychologie en ouvrant en même temps le champ clos de celle-ci, ainsi que l’exprime Michel Foucault : « Jamais la psychologie ne pourra dire la vérité sur la folie puisque c’est la folie qui détient la vérité de la psychologie. » Ce mode d’approche permettait l’écoute décisive du discours de la folie, mais l’effet tournait court au niveau de la pratique psychiatrique pour deux raisons : d’une part la persistance du milieu psychiatrique institutionnel ; d’autre part, le désir de guérir. La tentative qui avait été faite par Freud se trouvait stérilisée par la répression sociale.
C’est contre cette violence de la psychiatrie comme outil de la répression sociale de la folie que naît et se développe l’antipsychiatrie, et c’est ce point de départ qui motive la référence à une philosophie existentielle (Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Sartre) reléguant à l’arrière-plan l’apport psychanalytique dont les tenants sont même suspects, comme les psychiatres, de viser la guérison et la récupération des sujets au nom d’une société, soupçon qui n’est pas toujours dénué de fondement.
David Cooper, le premier – et c’est à lui qu’on doit le terme d’antipsychiatrie –, s’engage dans une expérience en milieu psychiatrique sur le mode des communautés thérapeutiques. Il s’agit de faire en sorte que les malades deviennent responsables de leur communauté et des mesures thérapeutiques qui peuvent être prises. Les médecins et le personnel ne sont plus là comme des soignants s’occupant de soignés, mais comme des référents pour que le discours de la folie soit reçu. Cette première expérience en milieu psychiatrique aboutit à l’échec, car elle est faussée et rejetée par ce milieu.
En 1965, les docteurs Ronald David Laing et Aaron Esterson fondent avec David Cooper la Philadelphia Association afin de créer des lieux d’accueil originaux. Trois de ces centres (households) s’ouvrent successivement : Kingsley Hall, qui a fonctionné jusqu’en 1970, puis deux autres maisons, encore appelées « communes ». Dans son rapport de 1969, l’association se fixe, entre autres, les buts suivants : délivrer la maladie mentale, en particulier la schizophrénie (au sens extensif des Anglo-Saxons), de toutes les descriptions ; entreprendre de rechercher les causes des maladies mentales, les moyens de les détecter, de les prévenir, de les traiter ; organiser des lieux d’accueil pour les personnes souffrant ou ayant souffert de maladie mentale. Le rapport ajoute : « Nous visons à changer la façon dont les faits de la santé mentale et de la maladie mentale sont considérés ; c’est une invitation à changer de modèle [...] ce qui est en cause ce n’est pas la maladie d’une seule personne mais c’est un processus social [...] nous voyons comment des gens sont rejetés de l’environnement humain par des désirs, demandes et attentes contradictoires qui leur sont adressés inconsciemment par les autres personnes et par eux-mêmes. Quand on est relégué, il n’y a plus qu’une seule chose à faire, c’est de se casser la tête contre les murs. Pour explorer les contradictions des communications qui nous poussent à certains moments à agir, ou à être pris pour un fou, nous avons besoin d’une communauté souple où les gens ne sont pas contraints à prendre les rôles de docteur, d’assistante sociale, d’infirmier ou de malade. »
Il est possible de caractériser la vie à Kingsley Hall à l’aide de quelques traits : « Chacun peut discuter les actions de n’importe quelle autre personne. Bien qu’il n’y ait ni staff, ni malades, ni rites institutionnels, aucun résident ne donne à un autre des tranquillisants ou des sédatifs. Des comportements sont possibles là, qui sont intolérables dans la plupart des autres lieux. Chacun se lève ou reste au lit, à son gré, mange ce qu’il veut quand il le veut, reste seul ou avec d’autres, et, en général, établit ses propres règles. Chaque personne, homme ou femme, a sa propre chambre. Il existe des pièces où les gens peuvent être ensemble à leur gré. Il n’y a pas eu de suicides. »
Ce qui caractérise un tel lieu d’accueil de la folie, écrit Maud Mannoni, « c’est une façon de débarrasser le sujet au maximum de tout cadre pour lui donner la possibilité de se retrouver par un processus conçu comme intérieur et spontané. Le malade y entre pour qu’y puisse s’y dérouler une crise qui ne serait tolérée dans aucun autre milieu. Laing propose pour cette crise le terme de métanoïa, conversion, transformation. Il faut, d’après Laing, s’efforcer de suivre et d’assister le mouvement d’un épisode schizophrénique aigu au lieu de l’arrêter. Il n’existe, ajoute Laing, rien de plus tabou dans notre société que certaines demandes régressives [...] L’accueil dans ces communautés anglaises consiste en une mise en place qui évoque le psychodrame ; le malade vient pour « régresser » et mettre en acte « sa » scène. Un public est nécessaire au patient comme témoin et support de son délire [...], une dramatisation de l’angoisse de castration se référant à un champ où la mort et la vie sont étroitement liées et mises en jeu continuellement ».
• Le discours de la folie et la société
La pratique de l’antipsychiatrie, qui se veut au plus haut point incluse dans la cité – posant comme un de ses buts essentiels la tolérance et l’acceptation de la folie, voire sa lecture, à la manière dont on décrypte un rêve ou un symptôme –, ne pouvait que se centrer sur l’articulation de la folie et de la société. Elle a d’abord contesté l’obligation des soins qui fait du psychiatre un auxiliaire de la police par le processus d’internement. C’est là un malaise ressenti et dénoncé par les psychiatres eux-mêmes. Mais, plus encore, cette obligation des soins, dit l’antipsychiatrie, conduit le sujet en crise aiguë à la chronicité. À partir de là, l’antipsychiatrie s’inscrit dans un projet politique en dénonçant le rôle que la société fait jouer à la psychiatrie, un rôle répressif fondé idéologiquement sur un savoir médical. Ce savoir médical tend à plaquer le modèle de la santé physique sur la santé mentale et à objectiver le malade en négligeant son discours, qui est révélateur non seulement de sa plainte, mais beaucoup plus de la non-reconnaissance de son existence par une société aliénée dans le rendement et le profit. La répression exercée par la psychiatrie s’articule avec la répression générale qui sévit dans les sociétés capitalistes. « L’antipsychiatrie a choisi de défendre le fou contre la société » (Maud Mannoni). Dès lors, l’antipsychiatrie en vient à nier la notion de maladie mentale et Cooper voit dans la descente dans la psychose l’amorce d’un véritable phénomène de mort et de résurrection.
Le discours de la folie a toutes les chances d’être entendu quand Laing affirme : « Je pense que les schizophrènes ont plus de choses à apprendre aux psychiatres sur le monde intérieur que les psychiatres à leurs malades. » L’on ne saurait que le suivre sur cette voie quand on pense qu’une thérapeutique classique ou médicamenteuse vise d’abord à priver le sujet de son expression propre. Laing dénonce l’aliénation imposée par la société pour qu’on y soit accepté, aliénation dans une culture qui amène l’auteur à poser la possibilité d’une contre-culture ou la création d’une autre société dont on trouve le manifeste (1967) dans le rapport du Congrès international de dialectique de la libération (Londres). Il s’agit là d’une prise de position avant tout politique, traitant d’une révolution socioculturelle et de toutes les formes de contestation des institutions sociales : anti-université, anti-hôpital, théâtre libre, radio-pirate, journaux et cinéma clandestins. Ce congrès rassemblait des groupes venus de nombreux pays – hippies, provos d’Amsterdam, étudiants de Berlin-Ouest, activistes politiques de Norvège, de Suède, du Danemark, anti-universitaires américains, représentants des cinq continents –, différentes personnalités : Berke, Cooper, Laing, Redler, Bateson, Carmichaël, Guerassi, Goodman, Henry, Marcuse, Sweezy..., et même un moine bouddhiste, qui y lut des poèmes. Les implications politiques de l’antipsychiatrie sont ainsi venues au premier plan. À partir de là, la lutte contre toutes les formes d’aliénation ne pouvait que se généraliser : l’aliénation, c’est le mal que l’on peut dénoncer au niveau même de la socialisation du sujet dans sa famille, la famille étant une microsociété qui participe à l’idéologie de la société et qui impose au sujet cette idéologie. Dans L’Équilibre mental, la folie et la famille (Sanity, Madness and Family), Laing et Esterson situent les effets pathogènes en jeu dans les discours du patient et de sa famille en se référant au « double lien » (double bind) de Gregory Bateson, c’est-à-dire à l’existence de vœux contradictoires dans l’expression des parents, le sujet se trouvant ainsi placé dans une situation de conflit permanent et de candidature à la schizophrénie.
Voilà le Mal dénoncé ; il y a donc un « Bien » quelque part ; si le « Mal » est dans le monde extérieur, le « Bien » sera à l’intérieur du sujet. Une grande ombre se profile : Jean-Jacques Rousseau, suivi par d’autres dont, plus récemment, Wilhelm Reich. L’évacuation du « Mal » hors de l’intérieur du sujet n’est pas sans nous porter à la limite d’un monde paranoïaque. Si les psychanalystes, actuellement, ont été récupérés par la société au point qu’ils prêtent leur concours, quand ils ne l’instituent pas eux-mêmes, à la « psychiatrie institutionnelle de secteur » obéissant à un souci de quadrillage de la santé mentale (Mannoni), ce fait ne suffit pas, évidemment, à réfuter ce que Freud a apporté. Faute d’avoir saisi le point vif de la visée freudienne, et pour n’avoir jugé celle-ci que par son aspect théorisé et par son asservissement à une idéologie ambiante, normative, l’antipsychiatrie s’est détournée du fondement même de la psychanalyse que Lacan, à la suite de Freud, a pointé tout au long de son œuvre : le sujet se constitue au niveau du signifiant ; il en est divisé ; le conflit n’est pas entre un extérieur « mal » et un intérieur « bien », mais au centre même de ce sujet constitué par la parole – un signifiant pour un autre signifiant, telle est l’aliénation majeure que la psychose met en question et enseigne à la fois. Il ne suffit pas d’« un changement réel de l’attitude des hommes à l’égard de la propriété, plus efficace que n’importe quel commandement éthique ; mais cette juste vue des socialistes est troublée et dépouillée de toute valeur pratique par une nouvelle méconnaissance idéaliste de la nature humaine » (Freud, Malaise dans la civilisation). L’idéalisme, en effet, survient quand la sexualité n’est plus au centre du développement du sujet (l’antipsychiatrie succombe ici à une présomption de l’imaginaire) ; le refoulement redevient, lui, central ; le retour du refoulé fait sa part à l’« être-pour-la-mort » ; la drogue peut y pourvoir.
Une expérience française qu’on peut, en un certain sens, rattacher à l’antipsychiatrie, s’est développée à l’École expérimentale de Bonneuil (Val-de-Marne) sous la direction de Maud Mannoni, mais la psychanalyse y garde toute sa place. On essaie d’y écouter pleinement le discours de l’enfant psychotique ; c’est difficile, c’est angoissant, surtout si on ne s’en débarrasse pas en en rendant responsable la société telle qu’elle est.
Depuis la fin des années 1970, le courant de l’antipsychiatrie semble avoir perdu une bonne partie de son audience et même de sa puissance rhétorique. Certains – tel Michel Crozier, qui parle rétrospectivement des « années folles de l’antipsychiatrie » – y voient le déclin d’une des formes les plus spectaculaires de la « logique folle, c’est-à-dire sans limites ni contraintes », qui caractérisait la « révolution culturelle » des décennies 1960 et 1970. Mais cet apparent déclin tient peut-être aussi au fait que la violence anti-institutionnelle de ce courant a finalement permis aux psychiatres classiques et aux pouvoirs publics, jusque-là trop prudents, voire retardataires, de s’ouvrir en ce domaine aux mises en question les plus urgentes.
L’antipsychiatrie n’en a pas moins été une audace ; si les antipsychiatres ont osé trop, leur audace a cependant ouvert la question du sujet et de sa liberté dans la mesure où ils s’y sont eux-mêmes engagés.
Robert LEFORT
AUTRE
Le débat philosophique sur autrui est inséparable de la question du primat de la conscience : comment expliquer l’existence d’une autre conscience, sous quelles modalités la rencontrer ?
• De la sympathie à l’identification : tentatives d’approches de l’autre
La doctrine qui va produire un impact certain sur les réflexions proprement psychologiques est celle de la sympathie. Développée au XVIIIe siècle, elle forme le cœur de l’ouvrage de Max Scheler, Nature et formes de la sympathie, contribution à l’étude des lois de la vie affective (1913) qui est aux frontières de la psychologie et de la philosophie. S’appuyant sur la psychologie de l’enfant, la psychologie de la forme et même l’éthologie, Scheler insiste sur le fait que la prise de conscience de soi est seconde, la participation à un « nous » étant le phénomène premier : c’est « avec autrui » que je me saisis comme existant, c’est immédiatement que j’appréhende l’existence de l’autre. La sympathie traduit bien ce mouvement : il ne s’agit ni d’une connaissance intellectuelle, ni d’une fusion affective, mais d’une saisie immédiate du sens émis par l’autre.
Quelle est ensuite la modification apportée par la réflexion psychanalytique ? Le terme de « l’autre » est certes très peu présent chez Freud dans la mesure où le corrélat de la pulsion est défini comme étant son « objet ». Or l’autre comme tel semble précisément exclu des premiers buts essentiellement auto-érotiques de la pulsion sexuelle, par exemple au premier stade oral : « Relevons ce qui nous paraît être le caractère le plus frappant de cette activité, que la pulsion n’est pas dirigée vers d’autres personnes, elle se satisfait dans le corps propre de l’individu, elle est auto-érotique » (Sigmund Freud, Trois Essais sur la théorie sexuelle, 1905). Comment situer alors l’émergence de l’autre ? Tout d’abord, Freud souligne que, dès avant la puberté, les diverses pulsions partielles visent déjà une seule personne. L’autre est donc cet objet total vers lequel va se concentrer l’objectif.
Mais l’autre, c’est aussi cette « autre scène » sur laquelle se déroule le rêve : l’inconscient comme lieu des désirs refoulés. Il est justement inséparable d’un certain nombre de figures rencontrées pendant l’enfance. La deuxième topique de Freud (ça-moi-surmoi), élaborée à partir de 1920, met justement en place un système d’instances qui constituent des précipités de ces figures. C’est particulièrement le cas du surmoi qui est, au sens premier, l’image du parent interdicteur et qui prend également la forme de l’idéal du moi. Le parent du même sexe, cause de l’interdit œdipien, est aussi l’objet de l’idéalisation. L’autre en moi prend ainsi la figure de l’ensemble des valeurs morales, culturelles, esthétiques auxquelles se réfère le sujet et par rapport auxquelles il s’évalue lui-même. Cet autre en moi, Freud décrit sa formation à travers le processus d’identification, processus fondamental puisqu’il ne prend plus l’autre comme simple objet mais comme modèle agissant directement sur ce que nous sommes, et pas seulement sur ce que nous voulons posséder. C’est précisément pour penser l’émergence de ces figures que Freud fait un lien entre les stades les plus précoces et les constructions plus élaborées. Le stade oral, comme il le note dans un passage des Trois Essais rajouté en 1915, prépare la relation plus tardive à l’autre : « Le but sexuel réside dans l’incorporation de l’objet, prototype de ce qui jouera plus tard, en tant qu’identification, un rôle psychique si important. »
• Vers la distinction de l’autre et de l’Autre
La thématique de l’identification laisse cependant une question en suspens. Il semble que l’évolution pulsionnelle se fasse de manière autonome, sans que l’autre comme tel soit présent autrement que comme source de la première satisfaction, sous la forme du sein nourricier, qui sert de support au développement de l’auto-érotisme. On perçoit nettement cette difficulté dans la théorie de Mélanie Klein, pour qui les pulsions érotiques et destructrices ont pour objet le sein, divisé en « bon » et « mauvais », la figure de l’autre maternel ne surgissant que dans une phase ultérieure (« Contribution à la psychogenèse des états maniaco-dépressifs », in Essais de psychanalyse, 1935). Peut-on alors évoquer un défaut de prise en compte du désir de cet autre maternel ?
La théorie de la séduction de Jean Laplanche insiste ainsi sur le fait que les zones érogènes sont « prélevées » dans le corps de l’enfant par les soins donnés par l’autre. Mais cet autre est lui-même un être de désir, dont les fantasmes inconscients sont à l’origine du développement de la sexualité infantile proprement dite, elle-même tissée de fantasmes. L’auto-érotisme est donc « déjà » fantasmatique et profondément relié à la vie psychique de l’autre parental. Il s’agit pour Laplanche de conjoindre la dimension première de l’attachement et l’émergence de la sexualité : « cet autre [...] pour sa part, n’est pas aussi simple que l’attachement voudrait le croire : c’est un autre “compromis” par son propre inconscient, par son “autre” interne peut-on dire, de sorte que les messages qu’il envoie sont des messages eux-mêmes compromis » (Le Fourvoiement biologisant de la sexualité chez Freud, 1993). Il reste cependant que la notion même d’« autre » conserve l’imprécision qu’elle a chez Freud qui, dans un rare texte utilisant le terme spécifique der Andere, en fait un usage essentiellement descriptif : « Dans la vie psychique de l’individu, l’autre [der Andere] intervient très régulièrement comme modèle, objet, soutien et adversaire » (Psychologie des masses et analyse du moi, 1921). L’opération entreprise par Jacques Lacan consiste à dégager ces strates, pour reconstruire la théorie psychanalytique sur la base d’une distinction de différents niveaux d’altérité. Lacan dégage, d’une part, l’Autre (le « grand autre ») comme lieu symbolique du langage qui préexiste à tout sujet, et qui rend possible la signification, et, d’autre part, le « petit autre », le « petit a », produit de l’identification imaginaire avec mon semblable qui fait obstacle à la reconnaissance du désir, qui est toujours désir de l’Autre : « Si j’ai dit que l’inconscient est le discours de l’Autre avec un grand A, c’est pour indiquer l’au-delà où se noue la reconnaissance du désir au désir de reconnaissance » (« L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud », in La Psychanalyse, 1957).
On trouve chez Lacan une double ambition. Tout d’abord, se situer par rapport à la tradition philosophique qui, chez Hegel, construit le rapport de la conscience à l’autre conscience comme un désir de reconnaissance : désormais, cet autre n’est plus une autre conscience mais l’inconscient qui me donne son langage, que je méconnais. Ensuite, donner sens aux ambiguïtés freudiennes, en distinguant deux types d’identification : l’identification imaginaire qui m’aliène, et une identification à un trait de l’Autre qui signe mon accès au monde symbolique et au désir. Cela permet également de ne pas confondre toutes les figures de l’altérité : le père réel (le géniteur) n’est pas le père imaginaire (le modèle idéal) ni le père symbolique (l’interdit de l’inceste porté par toute la culture). L’autre se diffracte en une multiplicité de figures.
Alexandre ABENSOUR
BEHAVIORISME
L’acte de naissance du behaviorisme est constitué par l’article intitulé « La Psychologie telle qu’un behavioriste la voit », que John Watson publia en 1913 dans la revue qu’il dirigeait, la Psychological Review. Il développa et précisa ensuite ses idées dans divers articles et dans plusieurs ouvrages, dont le principal est Behaviorism, publié pour la première fois en 1925. Bien que Watson lui-même n’ait pas apporté de découvertes empiriques considérables, l’influence des idées qu’il a ainsi exprimées et du véritable manifeste qu’il a lancé en 1913 fut telle, aux États-Unis et par contrecoup dans le reste du monde, que l’on a pu parler à ce sujet de « rupture » dans le champ de la psychologie. Pour toute la psychologie qui se réclame du qualificatif « scientifique », c’est-à-dire d’abord, certes, pour la psychologie expérimentale générale, mais aussi pour d’autres secteurs de la psychologie (et même, au-delà de celle-ci, pour des domaines tels que la biologie ou les sciences sociales), la notion de « comportement » devient alors une notion de référence.
Il est important de voir avec précision en quel sens elle le devient, pour pouvoir saisir le fond des débats et des développements historiques qui ont affecté la psychologie depuis environ un siècle.
• La rupture watsonienne
Le terme même de comportement est ancien et, au début du XXe siècle, les dictionnaires le qualifient de « vieux ». Une de ses premières utilisations françaises se trouve chez Pascal : « Pour reconnaître si c’est Dieu qui nous fait agir, il vaut bien mieux s’examiner par nos comportements au-dehors que par nos motifs au-dedans. » Mais, bien entendu, son usage nouveau s’inspire plutôt de la tradition cartésienne, celle des animaux-machines. C’est en 1907 que Henri Piéron réintroduit le terme dans le langage psychologique français à titre d’équivalent de l’américain behavior (ou de l’allemand Verhalten), pour désigner « les manières d’être et d’agir des animaux et des hommes, les manifestations objectives de leur activité globale ». Toutefois, il considère, comme le fait de son côté Pavlov, que les faits ainsi identifiés renvoient à la physiologie.
Les idées développées par Watson vont ainsi être en net contraste avec deux courants qui lui préexistent. La naissance de la psychologie scientifique lui est, d’une certaine manière, antérieure : Gustav T. Fechner, Hermann L. Helmholtz, Wilhelm Wundt – qui fonda en 1879 le premier laboratoire de psychologie expérimentale – Hermann Ebbinghaus, Ivan Setchenov, Ivan Pavlov, Alfred Binet et d’autres chercheurs, ont ouvert la voie en observant divers types de comportements et en essayant de les mettre en relation avec leurs conditions d’apparition. Toutefois, la notion de comportement elle-même ne fut pas alors encore complètement dégagée. En France, Pierre Janet utilise systématiquement le terme de « conduites », mais en y englobant les contenus de conscience, qui lui paraissent en être indissociables.
Watson prend nettement position contre les conceptions de ce type ; il se montre fort sévère pour la postérité de Wundt, pour la psychologie introspective allemande et pour les émules qu’elle a aux États-Unis ; il condamne la « trentaine d’années stériles » de cette science et s’oppose à William James. Selon lui, la psychologie doit devenir une « science naturelle » – ou, pour être plus clair, une « science de la nature » – au même titre que la médecine, la chimie ou la physique. « Pourquoi, écrit-il dans Le Behaviorisme, ne pas faire de ce que nous pouvons observer le champ réel de la psychologie ? Limitons-nous aux choses qui peuvent être observées et formulons des lois concernant uniquement ces choses. » Cette limitation a, d’une certaine façon, fondé effectivement la psychologie scientifique, mais, en même temps, la façon dont elle doit être conçue n’a cessé de diviser cette discipline.
Le premier principe de Watson est donc de rejeter toute référence non seulement à des entités « métaphysiques » telles que l’âme ou l’esprit, mais encore à la conscience. Cela implique le refus de considérer les états mentaux comme des objets d’observation. C’est sur ce point capital que le radicalisme de John Watson est novateur. La psychologie scientifique a commencé à se développer dès que l’on a décidé, à l’instar de ce qui se faisait dans les sciences déjà évoluées, de fonder la connaissance sur des « faits », c’est-à-dire sur des observables. Mais le pas ainsi franchi est resté insuffisant aussi longtemps qu’on a continué d’admettre que les états mentaux étaient aussi des observables. Watson, au contraire, exclut ces états du champ de l’observation, et il décide de ne prendre en compte que des observables objectifs, ceux qui apparaissent dans l’univers matériel : ce sont précisément ceux-ci qui constituent les comportements. Le prolongement de cette prise de position est que le langage soit lui-même considéré comme un comportement et qu’il soit analysé comme tel.
Le choix épistémologique de Watson est le même que celui qu’avaient fait avant lui Pavlovet, encore avant ce dernier, son maître Setchenov. Une différence importante sépare toutefois Watson de ceux-ci : c’est qu’il distend quelque peu les relations entre le comportement et l’activité nerveuse, au point d’être parfois accusé de négliger cette dernière ; il proteste de l’importance qu’il lui attribue, mais il considère le système nerveux central comme étant seulement un organe intégré au corps dans son ensemble. Pavlov, dont il faut rappeler qu’il n’observait pas de façon directe le système nerveux, considérait le point de vue objectif qu’il avait adopté, ainsi que l’ensemble de ses propres travaux, comme étant « physiologique » et comme traitant de l’« activité nerveuse supérieure ». Watson parle des mêmes choses en termes de comportement et de psychologie. L’évolution ultérieure a suivi le second plutôt que le premier : on réserve le qualificatif de physiologiques aux observations directes du tissu nerveux ou de ses manifestations électriques ou chimiques, et l’on parle de psycho-physiologie lorsque celles-ci sont prises en compte en même temps que celles qui portent sur des comportements globaux.
• La conception « stimulus-réponse », forme typique du behaviorisme
Lorsqu’on examine avec quelque recul la conception que Watson et ses continuateurs se font du comportement, on voit clairement qu’ils considèrent le plus souvent ce terme comme étant l’équivalent de « réponse » ou de « réaction ». Ces deux derniers termes impliquent nettement que le comportement pris en considération se produit en présence d’un événement défini de l’environnement, qui est appelé « stimulus ». La question de savoir ce qu’est au juste un stimulus ne peut en aucun cas recevoir une réponse simple en psychologie. Toutefois, le behaviorisme tend à simplifier le problème en disant, de façon en quelque sorte circulaire, que le stimulus est ce qui, dans l’environnement, détermine la réponse.
Enregistrement d'un comportement de caractère émotionnel. Enregistrement d'un comportement de caractère émotionnel, le rythme cardiaque, chez un chien qui a précédemment acquis un conditionnement d'évitement. Après l'audition d'un son, qui sert de stimulus conditionnel, le chien reçoit un choc électrique (pénible mais non douloureux) s'il n'appuie pas sur une pédale. En fait, le chien appuie toujours sur la pédale. On peut voir qu'aussitôt après l'audition du son (S.C.1 ou S.C.2) son rythme cardiaque s'accélère; mais dès que le chien a appuyé sur la pédale, son rythme cardiaque revient à la normale; cela se produit au bout de deux secondes dans un cas (R.E.1, cercles), au bout de cinq secondes dans l'autre (R.E.2, triangles). D'après Soltysik et Kowalska, 1960, reproduit dans «Le Ny», 1967.
De la concomitance on glisse, en effet, aisément à la causalité et l’on pourra dire que le stimulus « produit », « provoque » ou « déclenche » la réponse. Une expression plus faible, et donc préférable, consiste à dire que le stimulus « suscite » (en anglo-américain evokes) la réponse. Cette façon de conceptualiser le comportement, qui est étroitement apparentée à l’idée de « réflexe », bien que ce terme ne soit pas employé de façon extensive par les behavioristes, conduit à ce que l’on désigne souvent par l’expression de « théorie S-R », ou « stimulus-réponse ». Il est plus approprié de parler de « conception S-R », étant donné qu’il s’agit là d’une position épistémologique plutôt que d’une théorie à proprement parler. Dans cette conception, l’objet de la psychologie se trouve être précisément l’étude des relations entre les stimulus et leurs réponses.
Une première démarche possible consiste alors à tenter d’identifier des réponses et à repérer les stimulus qui les suscitent de façon régulière. Watson la met en œuvre partiellement dans ses recherches sur le problème des émotions. Critiquant la méthode de William James, qu’il considère comme essentiellement introspective, il s’en tient à la notion de « réponse émotionnelle », la seule, selon lui, qui permette une étude objective et expérimentale. Il renonce assez rapidement à expérimenter sur des adultes, dont les réactions émotionnelles sont trop complexes, et ne craint pas, dans son laboratoire, de soumettre de très jeunes sujets à des stimulations fortes ; elles lui permettent d’isoler trois grandes classes de réactions émotionnelles primitives, qu’il rapporte à la peur, à la colère et à l’amour – « dans un sens plus large qu’il n’est habituel de l’employer ».
Enregistrement d'un comportement de caractère émotionnel. Enregistrement d'un comportement de caractère émotionnel, le rythme cardiaque, chez un chien qui a précédemment acquis un conditionnement d'évitement. Après l'audition d'un son, qui sert de stimulus conditionnel, le chien reçoit un choc électrique (pénible mais non douloureux) s'il n'appuie pas sur une pédale. En fait, le chien appuie toujours sur la pédale. On peut voir qu'aussitôt après l'audition du son (S.C.1 ou S.C.2) son rythme cardiaque s'accélère; mais dès que le chien a appuyé sur la pédale, son rythme cardiaque revient à la normale; cela se produit au bout de deux secondes dans un cas (R.E.1, cercles), au bout de cinq secondes dans l'autre (R.E.2, triangles). D'après Soltysik et Kowalska, 1960, reproduit dans «Le Ny», 1967.
La recherche des stimulus qui suscitent des réponses de façon innée peut donc être une des démarches du behaviorisme S-R. Elle sera réinventée et développée plus tard par les éthologistes de l’école « objectiviste », qui, dans un contexte théorique quelque peu différent, l’appliqueront avec succès à l’étude des comportements instinctifs chez l’animal et, avec plus de risque théorique, à l’enfant ou à l’homme. Toutefois, ni Watson ni les behavioristes qui le suivent ne mettent au centre de leurs investigations ce type de relations stimulus-réponse, qui est pourtant parmi les plus stables. En dépit de l’hommage qu’il rend à Darwin, dont il qualifie les descriptions de « tout à fait objectives et behavioristes », Watson s’écarte de lui et s’oppose à William James au sujet de l’extension des activités instinctives chez l’homme.
Ce qui va demeurer durant plusieurs décennies au centre de la psychologie behavioriste est l’ensemble des phénomènes d’apprentissage. D’emblée, Watson fait siennes les découvertes de Pavlov et de son école : il les réinterprète, les intègre à sa conception et pousse à ce qu’elles soient développées. Sa contribution à cette recherche est l’étude expérimentale, qu’il conduisit avec sa femme, R. Rayner, des réactions émotionnelles conditionnées chez des enfants.
Dans ce contexte, à l’intérieur du schéma S-R, S désigne, autant et plus que les stimulus innés, les stimulus qui sont devenus capables de susciter la réponse. La « théorie de l’activité nerveuse supérieure » de Pavlov s’appelle désormais « conditionnement ». La différence n’est pas seulement terminologique, car le mécanisme fondamental du conditionnement est conçu par les behavioristes comme étant celui de la substitution. Un stimulus Si suscitait une réponse R ; désormais, un stimulus Sc suscite cette même réponse R. Tel est le paradigme fondamental de l’apprentissage dans la conception S-R. Celle-ci est essentiellement, pour reprendre une formule ultérieure de Neal Miller, une « théorie du trait d’union ».
La conception S-R du behaviorisme n’est certes pas totalement dominante puisque, en demeurant dans un cadre méthodologiquement et épistémologiquement behavioriste, Edward C. Tolman et un certain nombre de chercheurs qui lui sont apparentés tentent de développer une théorie cognitiviste, illustrée par le schéma S-S ; l’apprentissage y est plus une modification des connaissances qu’une pure et simple modification du comportement. Toutefois, c’est la conception S-R qui, historiquement, apparaît aujourd’hui comme la plus représentative du behaviorisme.
• Le développement du behaviorisme
Après Watson, la psychologie expérimentale se développe, aux États-Unis, de façon extrêmement rapide ; elle se caractérise, pour l’essentiel, par son inspiration behavioriste. Toutefois il subsiste aussi, parallèlement, une pratique assez étendue de la psychologie non expérimentale, surtout dans le domaine clinique, où le behaviorisme ne pénètre que très lentement et où les courants psychanalytiques deviennent bientôt prédominants.
En psychologie expérimentale générale, si le thème central des recherches et de l’élaboration théorique demeure celui de l’apprentissage, un second thème s’y trouve de plus en plus étroitement lié, selon la même formulation behavioriste : celui de la motivation.
Des années trente aux années cinquante, se déroule un grand débat sur les théories de l’apprentissage, alimenté par de nombreuses recherches expérimentales, soit chez l’animal, à partir de procédures de conditionnement, soit chez l’homme, notamment au moyen des apprentissages par cœur. L’objectif principal est de construire une théorie unifiée du comportement qui soit capable de rendre compte, à partir d’un nombre limité de principes, de postulats ou de lois, de tous les phénomènes observés, aussi bien chez l’animal que chez l’homme. Les chercheurs les plus marquants qui aient travaillé à cette tâche sont, entre autres, Clark L. Hull, Edward C. Tolman, Edwin R. Guthrie, Burrhus F. Skinner.
Ce dernier est sans conteste le plus positiviste et le plus strictement « S-R » des théoriciens behavioristes de cette période ; il répond de façon négative, au moins provisoirement, à la question qu’il a lui-même posée : « Des théories de l’apprentissage sont-elles nécessaires ? » Il construit un système original et un peu marginal par rapport aux autres behavioristes, mais il apporte une contribution expérimentale et théorique importante. En premier lieu, il met en évidence et conceptualise, à peu près en même temps que Jerzy Konorski et Stefan Miller en Pologne, un « second type » de conditionnement, qu’il appelle « opérant » et que Hilgard et Marquis nommeront « instrumental ». Par contraste avec le comportement « répondant » qu’illustre le conditionnement pavlovien, dit aussi « classique », le comportement opérant n’est pas tant déterminé par le stimulus qui le précède que par celui qui le suit. Skinner réinterprète donc l’apprentissage par essais et erreurs, ainsi que la « loi de l’effet » de Edward L. Thorndike, et les intègre à une théorie du conditionnement et du comportement. Il isole ainsi un troisième moyen par lequel l’environnement agit sur celui-ci. Les deux premiers étaient la liaison S-R innée et la liaison S-R conditionnelle classique ; le troisième est la modification du comportement par les stimulus qui le suivent, dont la récompense et sa suppression sont deux cas typiques. On a pris l’habitude – de façon peu heureuse, car cela ajoute à la confusion terminologique – de détourner le terme pavlovien de « renforcement » de son sens primitif pour désigner ce type d’effet du stimulus subséquent.
Toutefois, la théorie behavioriste la plus ambitieuse de cette période a été le système hypothético-déductif de Hull, qui repose sur l’énonciation formalisée d’un certain nombre de « postulats » et de « corollaires » d’où sont dérivées des prédictions qui peuvent être expérimentalement mises à l’épreuve. Bien que le système de Hull n’ait, précisément, pas résisté à l’expérimentation, il a joué un rôle historique très important et a préfiguré l’organisation logique et conceptuelle des modèles de l’époque postérieure.
Ceux-ci ont reposé, pour l’essentiel, sur l’introduction de relations probabilistes entre les stimulus et les réponses, ou entre les réponses et les stimulus. Toutefois, les modèles sont alors devenus beaucoup plus locaux, l’introduction des probabilités n’ayant pas connu le succès d’ensemble escompté. Après les théories médiationnistes, héritières de celles de Hull, dont on va reparler, il n’y aura plus aucune grande théorie behavioriste d’ensemble qui soit à la fois assez générale et assez précise.
• Évolution, mise en cause et affaiblissement du behaviorisme
À partir de la fin des années quarante, les diverses théories behavioristes S-R se heurtent à de croissantes difficultés internes et externes.
Les premières sont elles-mêmes de deux espèces. Tout d’abord apparaissent un certain nombre de désaccords entre des prédictions expérimentales dérivées des théories, et les résultats observés empiriquement. Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, ces désaccords ne constituent pas, en eux-mêmes, un échec dans la voie suivie ; ils correspondraient plutôt à un type de succès de la psychologie expérimentale. C’est, en effet, la première fois, dans l’histoire millénaire des idées que les hommes se forgent à propos de leur propre psychisme, qu’une conception d’ensemble est mise à mal par sa confrontation avec des faits recueillis spécialement à cette fin. Le désaccord tient ainsi à ce que les conceptions étaient assez précises pour pouvoir être infirmées, ce qui n’est pas souvent le cas pour d’autres sortes de théories. C’est pour une large part autour des notions de renforcement, de motivation et d’anticipation que se cristallisent ces difficultés. Le lieu théorique d’où elles naissent est assez facilement repérable : il se trouve dans ce qui joint S et R. En renonçant à l’introspectionnisme, le behaviorisme – et la psychologie objective en général – se prive de toute possibilité d’accès direct à la connaissance des activités internes. Peut-on pour autant nier l’existence de ces dernières ? Les exigences mêmes de la recherche expérimentale tendent progressivement à bousculer toute tentative de supprimer ce problème, ou de le contourner par la simple description des concomitances entre stimulus et réponses.
Dans le débat sur les théories de l’apprentissage, des conceptions différentes s’étaient déjà opposées sur ce point. On a évoqué plus haut l’extrémisme positiviste de Skinner. Tolman, pour sa part, avait accepté d’utiliser des « constructions conceptuelles hypothétiques » (hypothetical constructs) pour rendre compte des comportements, alors que Hull s’en tenait à des « variables intermédiaires » (intervening variables), beaucoup plus directement fixées aux variables observables. Un exemple des secondes était la variable intermédiaire « degré de faim », ou plus généralement « force du mobile » (drive), que l’on peut inférer et estimer à partir de la relation qui lie, d’une part, la durée de la privation de nourriture d’un animal, d’autre part, la vigueur d’un de ses comportements, appris au moyen d’une récompense alimentaire.
Les premiers désaccords expérimentaux avaient conduit à des remaniements théoriques locaux ; c’est ainsi qu’à la motivation par privation évoquée plus haut Hull avait adjoint une motivation différente, la « motivation incitatrice ». Un des moyens de construire celle-ci était de prendre en compte la relation qui lie la vigueur d’un comportement avec récompense à l’importance de la récompense.
Vers le début des années cinquante, ces remaniements deviennent insuffisants ; la solution cherchée aux difficultés expérimentales et théoriques donne alors naissance aux théories de la médiation. Elles consistent, pour l’essentiel, à introduire un ou plusieurs chaînons s-r, dits « médiats », entre S et R, c’est-à-dire entre le stimulus et la réponse observables ; le nouveau schéma général est ainsi du type S → r → s → R. Les entités intermédiaires r et s sont, conformément aux idées de Watson, considérées comme « implicites », c’est-à-dire non observables de façon directe. Toutefois, les développements expérimentaux ultérieurs devraient, en droit, conduire à les mettre en évidence. Vingt-cinq ans après, il faut convenir qu’ils n’y sont pas parvenus et qu’ainsi la théorie behavioriste S-R n’a pas pu échapper à la contradiction entre l’observable et l’inobservable.
Vers la fin des années cinquante, le behaviorisme se heurte aussi à une très vive contestation externe, qui a pour objet principal les problèmes du langage.
Les premiers actes en sont la publication en 1957 du livre de Skinner, Verbal Behavior, et la critique acérée qu’en donne Noam Chomsky deux ans plus tard. Paradoxalement, l’ouvrage de Skinner est presque entièrement spéculatif ; Chomsky considère qu’il donne, en outre, des activités langagières une idée appauvrie et inexacte. D’une manière générale, toutes les recherches, même non skinneriennes, qui portent sur les « comportements verbaux », notamment celles qui étudient les apprentissages associatifs, sont considérées par l’école chomskyenne comme sans intérêt. La polémique atteint une âpreté inhabituelle, peut-être parce qu’elle a de surcroît un arrière-fond idéologique : les États-Unis sont au cœur de leur guerre du Vietnam et de leur contestation universitaire.
La psycholinguistique, en tant que discipline originale, vient juste de naître de la rencontre de linguistes, de spécialistes de la toute nouvelle théorie de l’information et de psychologues partisans d’un behaviorisme assoupli, tels Charles Osgood et George Miller. Ce courant est rapidement supplanté par la psycholinguistique d’inspiration chomskyenne, qui se proclame « cognitiviste », voire « mentaliste », c’est-à-dire foncièrement antibehavioriste en ce qu’elle affirme l’existence et la prééminence des activités mentales ou centrales. Les auteurs appartenant à cette tendance s’opposent aussi au behaviorisme par la faible importance qu’ils accordent aux facteurs d’environnement, et plus spécialement à l’apprentissage ; la plupart d’entre eux marquent leur prédilection pour un point de vue innéiste ou nativiste. Une certaine jonction s’établit entre leurs idées et celles de Jean Piaget.
En même temps que se développe ce courant, et pour une large part indépendamment de lui, la notion d’« information » pénètre progressivement et profondément la psychologie. Les problèmes relatifs à la motivation et à l’affectivité sont désormais traités à part. Ce qui se passe « dans la tête » du sujet humain est de plus en plus largement conçu comme une certaine sorte de traitement de l’information, ce qui constitue une autre branche du cognitivisme.
On pourrait dire que le behaviorisme S-R est alors en plein déclin si, assez curieusement, ne prenait essor à ce même moment une de ses applications : le courant de la behavior therapy – expression traduite en français par « thérapies du comportement », « thérapies comportementales », voire « thérapies behaviorales » – ou encore des « modifications du comportement ».Comme l’indique cette dernière expression, il s’agit de mettre au point des techniques reposant sur une série de résultats expérimentaux relatifs aux apprentissages, interprétés dans une perspective S-R, et de les utiliser en vue de modifier des comportements jugés pathologiques ou indésirables, par exemple asociaux (c’est-à-dire non conformes à une certaine conception de la société). Ces pratiques ont suscité, notamment en France, de vives objections théoriques, cliniques, déontologiques et politiques ; leur appréciation définitive reste à établir.