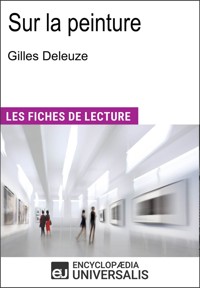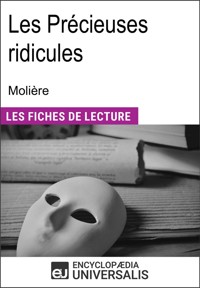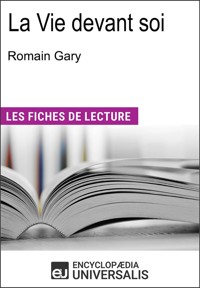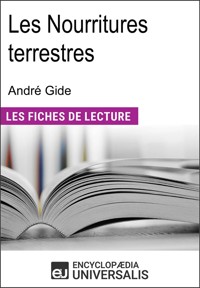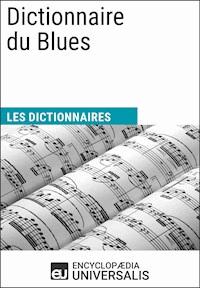
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Né du contact entre la musique des esclaves noirs du sud des États-Unis et la culture occidentale, le blues va exercer une influence majeure sur de nombreux courants musicaux du XXe siècle. Ce dictionnaire, dont les articles sont empruntés au fonds de l’Encyclopædia Universalis, explore l’histoire et l’esthétique de ce style musical. D’Allison (Luther) à Williamson (Sonny Boy), il retrace la vie et l’œuvre de plus de 70 musiciens et musiciennes qui, en un siècle de création tourmentée, l’ont marqué de leur empreinte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341002080
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Johnkwan/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans le Dictionnaire du Blues, publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles du Dictionnaire à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
ALLISON LUTHER (1939-1997)
Dans ce mouvement perpétuel où s’inscrit, entre langue vernaculaire et culture de masse, une musique noire américaine toujours entre disparition et renaissance, les générations se chevauchent, et coexistent tous les styles. De son appartenance à la troisième génération, prise entre blues d’avant sa naissance et blues de sa maturité, Luther Allison tire une problématique musicale qui l’oblige à une synthèse entre la forme terrienne, ouvrière, prolétaire des origines du blues et ses formes dérivées – rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, rock – qui l’influencent en retour.
Il naît à Mayflower (ou à Widener ?), dans l’Arkansas, le 17 avril 1939, avant-dernier garçon d’une famille nombreuse et il monte à Chicago en 1951 avec ses parents âgés, que les aînés prennent en charge. L’un d’eux, Ollie, est guitariste, et le jeune Luther débute à la basse électrique dans son groupe avant de fonder les Four Jivers avec un autre frère, Grant, à la batterie. Il joue du rhythm and blues, mais le blues le tient, et il fait ses classes avec Magic Sam, Buddy Guy et Jimmy Dawkins, admire Otis Rush, son idole, n’ignore ni Muddy Waters ni B.B. King, et rencontre Freddy King avant d’enregistrer en Californie avec Sunnyland Slim, Johnny Shines et Shakey Jake. Il doit à ce dernier de figurer dans une anthologie, Sweet Home Chicago, publiée par Delmark, chez qui il grave son premier disque, Love Me Mama, en 1969. Il est ensuite l’alibi blues de l’usine Motown (trois enregistrements entre 1972 et 1976), tourne beaucoup avec ses Blue Nebulae, triomphe au festival d’Ann Arbor (Michigan) et franchit l’Atlantique en 1976. Il trouve en Europe, en France notamment, où il s’installe en 1983, sinon la gloire, au moins le respect dû à son art et à sa personne.
Affable, d’un contact facile, attentif aux autres (il envisageait au moment de sa mort d’un cancer pulmonaire, le 12 août 1997 à Madison, Wisconsin, de se lancer dans une campagne antitabac), il ne ménage pas sa peine : engagements, disques et tournées se succèdent jusqu’à ce que l’Amérique reconnaisse, un rien trop tard, ce fils prodigue débordant d’énergie. Elle passe dans son chant, tendu, intense, convaincu, à l’émotion retenue, comme dans son jeu de guitare, simple et dépouillé, même quand il étire le son jusqu’à la saturation ou s’évade, servi par les qualités de sa voix, hors des frontières du blues.
Il refusera toujours les limites implicites assignées bien plus aux musiciens noirs qu’aux musiciens blancs, ces derniers demeurant libres de mélanger les genres sans encourir reproches et désaffection, et, parti d’une expression commune à ses compagnons du West Side de Chicago, il gravera, après un Love Me Papa purement blues à Paris, une série de disques controversés, où il mêle à la tradition du blues la ballade soul, la batterie rock et les sons synthétiques. Life Is a Bitch en témoigne mieux que d’autres, et il arrive à un équilibre avec Bad Love, qui le réconcilie avec son public et qui, suivi de Blue Streak et de Reckless, largement distribués outre-Atlantique, lance sa carrière américaine. Il connaît enfin le succès et finit en beauté, non sans réaffirmer en chanson son credo : « Je sais que je suis un bluesman. »
Il faut écouter en priorité Bad Love (1994), synthèse réussie des courants qui traversent sa musique, Love Me Papa (1977), son ode au blues, et Where Have You Been ?, pour le suivre en concert à Montreux de 1976 à 1994 avant de revenir, si on le souhaite, à l’ordre chronologique : Love Me Mama (1969), guitare aiguë, très B.B. King, touchant mais sans originalité ; Bad News Is Coming et Luther’s Blues (1972 et 1974), où il s’est affermi, densifié ; Live et Live In Paris, témoignages de son passage à la Chapelle des Lombards en avril 1979 ; Life Is A Bitch (1984), premier essai, inégal, de synthèse ; Here I Come (1985), à l’hétérogénéité en partie compensée par son chant ; Hand Me Down My Moonshine (1992), où il est à la guitare sèche ; Blue Streak (1995) et Reckless (Ruf-Alligator, 1996), son dernier disque, toujours marqué par B.B. King, James Brown en citation, enlevé comme d’habitude à l’énergie, mais sans doute trop produit...
Francis HOFSTEIN
BLIND BLAKE (1890 env.-env. 1933)
Qui était Blind Blake ? On ne possède de lui qu’une photographie publicitaire, celle d’un grand Noir aveugle, de larges mains semblant écraser sa guitare, un sourire figé, la trentaine... Mais on ne connaît ni ses lieux ni ses dates de naissance et de mort, ni même son véritable nom : Arthur Phelps ? Arthur Blake ? Il semble avoir vécu entre la Floride et Chicago, avec peut-être des incursions dans les Caraïbes, d’où il aurait ramené nombre d’idées musicales.
Une certitude cependant : Blind Blake est un des musiciens américains les plus importants du XXe siècle. Il a en effet fortement contribué à créer le style dit de ragtime blues, ou Piedmont blues, et est sans doute l’inventeur du fingerpicking, jeu de guitare virtuose et singulier apparu dans les vallées des Appalaches et dans lequel le guitariste décompose les accords en coordonnant les mouvements simultanés de son pouce (qui joue les cordes basses de façon alternée) et de son index ou de son majeur, voire parfois de son annulaire, qui joue en même temps les notes sur les cordes aiguës de l’instrument.
Si on en juge par les fortes ventes des quelque quatre-vingts titres qu’il a enregistrés entre 1926 et 1932, la popularité de Blind Blake fut considérable, aussi bien d’ailleurs parmi les Noirs que parmi les Blancs. Son œuvre est un étourdissant festival de virtuosité et d’inspiration et touche à tous les genres de l’époque. On trouve bien sûr de remarquables blues (West Coast Blues, Diddie Wa Diddie, Police Dog Blues), mais encore davantage de pièces du music-hall de l’époque empreintes de jazz ainsi que certains des plus extraordinaires ragtimes à la guitare jamais enregistrés (Guitar Chimes, Southern Rag, Blind Arthur’s Breakdown) qui demeurent encore aujourd’hui des modèles obligés pour tout apprenti guitariste en fingerpicking.
Blind Blake a aussi accompagné au disque nombre de vedettes de son époque, comme Gus Cannon, Ma Rainey ou Leola B. Wilson. Il a exercé une influence considérable, autant dans le blues (Blind Boy Fuller, le révérend Gary Davis, Buddy Moss, John Jackson) que dans la country music (Merle Travis, Doc Watson, Marcel Dadi).
Son œuvre intégrale, magistrale, a été rééditée en CD par Document et JSP.
Gérard HERZHAFT
BLUES
Le blues prend forme vocale et instrumentale originale au sein de la population noire du sud des États-Unis d’Amérique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Né de l’esclavage, où les Noirs étaient traités plus comme un capital d’exploitation fermier ou ouvrier que comme des êtres humains, nourri par le racisme, la ségrégation et la misère, il en porte la douleur et en exprime le climat d’affliction, mais témoigne aussi de la vitalité de ses inventeurs.
Plus parole que musique, malgré une structure harmonique bientôt définie, il est une chronique autobiographique et poétique qui, toujours entre humour et mélancolie, métaphore et lucidité, inscrit dans l’universel la joie et le malheur, l’espoir et la souffrance d’un groupe d’individus, et lui donne statut.
Ainsi, assimilant tous les folklores, se développant parallèlement aux autres formes musicales que sont les spirituals, la musique country et le jazz, le blues marquera-t-il de son empreinte toutes les musiques populaires qui ont émergé au XXe siècle.
• Origine et définition
Lorsque les chants, les musiques et les langues des terres africaines razziées par les marchands d’esclaves, mais coupés de leur fonction rituelle, sociale et culturelle, fragmentés par l’oubli, déformés par l’interdit et le refoulement, rencontrent les sons, danses, chants et musiques des terres américaines, langues anglaise, française, allemande, berceuses, comptines, hymnes, chansons et ballades, gavotte, valse, quadrille ou polka, les œuvres classiques ou populaires du répertoire orchestral européen, commence la lente genèse du blues, musique qui n’a pas vraiment d’origine, mais qui, moyen de communication, de reconnaissance et d’ascension sociale, comme l’atteste la plus-value donnée aux musiciens dans les ventes d’esclaves, signe l’inscription du Noir dans sa nouvelle société.
Viennent d’abord : les chants de travail, les cris et les appels, qui rythment le labeur aux champs ou sur les chantiers ; les mélopées, les fredonnements ou les « petits airs » que remarque Thomas Jefferson en 1787 dans ses Notes on the State of Virginia ; le violon, qui distrait et fait danser les maîtres et qui, joint au banjo et aux morceaux de bois ou d’os qui remplacent les tambours interdits par le « Code noir », enchante aussi les esclaves ; les chants religieux, empruntés pour l’essentiel à la liturgie protestante... d’où naissent, avec le minstrel show, d’abord composé de Blancs à face noircie (1843), puis de Noirs (Georgia Minstrels, 1865), le spiritual – dont la première manifestation organisée sera la mise sur pied, le 6 octobre 1871, de la tournée des Fisk University Jubilee Singers –, le jazz et enfin le blues, né sans doute entre 1865 et 1870, c’est-à-dire après la guerre de Sécession, après l’abolition de l’esclavage.
Descendant de l’art du griot, du conteur d’Afrique, évoquant la figure du trobar, le troubadour de la Provence des XIIe et XIIIe siècles, le blues est là dès que le Noir se parle à lui-même, mais il ne pouvait trouver sa forme et son espace qu’à partir de l’identité de ses inventeurs. Esclave, le Noir est sans nom, ne s’appartient pas. Libre, et bien que sa condition n’en soit souvent nullement améliorée, il peut chanter en son nom, chanteur qui exprime un groupe dont il est en même temps l’expression. Ainsi peut-il raconter son histoire et l’histoire de son peuple, créer mythes et poèmes, dire ce qu’il vit, et parler d’amour, l’amour de la femme comme celui de la langue, amour gourmand dont dépend l’humour. Car le blues, enfanté dans la douleur, ne peut exister que dans la liberté du sujet.
L’origine du mot lui-même est indécise (to be blue, broyer du noir, ou blue devils, improbables lutins ou feux follets venus d’une ballade irlandaise) et lointaine (début du XIXe s.), tandis que ses acceptions sont aussi variées qu’imbriquées.
Terme générique qui caractérise et recouvre une forme capitale de la musique américaine, elle-même définie par des critères musicaux, historiques, psychologiques, sociologiques... qui la contiennent mais qu’elle ne cesse d’excéder, le blues se définit comme une sensation, un sentiment de soi habituellement traduit par cafard, passé dans ce sens dans la langue (« j’ai le blues »), et auquel correspond assez bien le spleen des poètes (Vigny, Baudelaire). Il est ainsi une sensibilité, une émotion expressive (feeling) qui passent dans le jeu, dans le chant, et sans lesquelles il ne se passe rien. Et il est l’impalpable densité qui donne corps à la musique, transcende les styles et les races et rend accessible à tous ce qu’il raconte.
Il est donc un texte, tissé de la mémoire d’un peuple, de ses légendes (John Henry, Stack O Lee) et de sa vie quotidienne, blues que hante la femme et que traversent, du spirituel au trivial, de l’obscène au sublime, le charançon du coton et le contremaître sans pitié, les pénitenciers et les inondations, la mule fatiguée et les chiens dressés pour la chasse au nègre, les incendies et les voyages, l’alcool et la maladie, les jeux, les juges et les shérifs, la prison et la sécheresse, les fleuves, le feu et le ciel, la guerre, la boxe et les présidents des États-Unis... Conteurs, chanteurs et musiciens ont constitué une tradition orale dont ils ont assuré la transmission dans une improvisation constante.
Par sa répétition infinie, l’homme s’interroge sur lui-même dans cet état d’âme, d’esprit et d’humour que créent le doute de soi et la proximité sue, connue de la mort. Catharsis, le blues s’en fait la résolution, projetant avec les moyens du bord une vision du monde, une philosophie qui le rend au moins provisoirement possible et qui inscrit la solitude dans l’universel. Langue vernaculaire, qui parle l’opacité et l’invisibilité du corps noir, en exhibe et en cache (double entendre) la sexualité, sa création fut une forme de survie, sublimation par laquelle ses créateurs se sont imposés dans la culture de notre monde, tandis qu’il reste le seul lieu d’identité du Noir américain.
• Structure harmonique
Essentiellement vocal, le blues se déroule selon un schéma AAB :
A : Woke up this morning, blues around my bed,A : Woke up this morning, blues around my bed,B : Went for my breakfast, blues was in my bread.
La mélodie compte bien moins que les paroles qu’elle soutient ; le blues est une structure de douze mesures, comportant trois phrases de quatre mesures, s’organisant autour de trois accords (tonique, sous-dominante, dominante) et marqué par l’altération des troisième et septième degrés de la gamme diatonique (blue notes auxquelles s’ajoutera celle de la quinte), dont l’origine est parfois rapportée aux gammes pentatoniques africaines.
Il existe plusieurs gammes de blues, que Philippe Baudoin présente ainsi dans Jazz mode d’emploi (cf. figure).
Trois gammes de blues.
Cependant, chanté, prêché et parlé, joué en majeur, mais aussi en mineur, sur tous les tempos, du lent au rapide, instrument (guitare, surtout, et piano) à l’unisson, en soutien, en contrepoint ou qui relaie, remplace, continue la voix, le blues peut être à huit ou à seize mesures et, dans son déroulement, ne pas respecter du tout les douze mesures, chaque musicien gardant la liberté de suivre sa propre métrique, de choisir sa progression d’accords et de modifier les paroles, imposant son rythme, son invention, ses sentiments et ses affects à un blues qui trouve sa vie et son originalité dans l’interprétation plus ou moins improvisée dont il est l’objet.
Codifié au tout début du XXe siècle par W. C. Handy, qui fut un des premiers à noter sur le papier ce trésor d’invention populaire, le blues partage avec le jazz sa gamme et ses blue notes, comme on peut l’entendre, écoute indispensable à qui veut réellement le sentir et le comprendre, dans les enregistrements de tous les musiciens de jazz, qu’ils jouent le blues ou s’en inspirent, imprimant au besoin ou à l’envi son climat à n’importe quel thème ou morceau, qu’il soit ou non un blues.
• Histoire et principaux interprètes
Le blues entre sur le marché du disque et de la musique avec la publication du Crazy Blues gravé à New York pour OKeh le 14 février 1920 par Mamie Smith. Celle-ci n’est pas la première Noire à enregistrer, mais son immense succès amène les compagnies phonographiques à créer pour le public noir des séries spéciales et bon marché appelées « colored » puis « race records ». Près de sept mille disques de blues, de spiritual, de gospel et de jazz seront publiés de 1920 à 1940, où disparaît le terme devenu infamant de « race », que remplace pour la musique noire enregistrée par des Noirs pour des Noirs celui de rhythm and blues.
Apparu par le courant dit des chanteuses de blues classiques, illustré par Ma Rainey, Bessie Smith « l’Impératrice », Ida Cox, Sippie Wallace, Rosa Henderson, Clara Smith, Lucille Hegamin, Edith Wilson, Victoria Spivey..., qui ne chantent pas que le blues et gardent l’empreinte des scènes de théâtre et de vaudeville sur lesquelles elles se produisent, le blues trouve son terreau le plus fertile et ses musiciens essentiels dans les États du Sud, pauvres et paysans. Chanteurs polyvalents (songsters), attachés à la terre ou itinérants, ils lui donnent son expression musicale et thématique, la liant au lieu, au terroir et à l’environnement, climat économique, social et relationnel du comté ou de l’État qui imprime leur chant et installe entre eux ressemblance et différence.
Le delta du Mississippi passe pour le berceau du blues et produit une forme pure, puissante, lancinante et incantatoire dont le représentant dominant est Charley Patton, qu’entourent, tous guitaristes, Son House, spécialiste du bottleneck, Skip James, Bukka White, Big Joe Williams, Robert Johnson, devenu une légende, Mississippi John Hurt, Tommy Johnson... Sur la côte est, Blind Blake, « Blind » Willie McTell, Barbecue Bob, le révérend « Blind » Gary Davis, Blind Boy Fuller, l’harmoniciste Sonny Terry..., instrumentistes souvent brillants, sont à l’articulation entre le jazz, la musique populaire blanche, le ragtime et le blues, qui, au Texas, couvre un champ plus vaste et plus varié. En témoignent les enregistrements de Blind Lemon Jefferson, le plus célèbre, du rugueux Henry Thomas et de Lead Belly, plutôt des songsters, de Ramblin’ Thomas, « Funny Papa » Smith et Texas Alexander.
Memphis (Tennessee) est la première ville à donner son nom au blues, bien qu’elle rassemble des musiques aussi différentes que celles de Frank Stokes, du Memphis Jug Band (représentant une forme orchestrale, avec banjo, violon, mandoline, cruchon, kazoo et washboard, très répandue dans le Sud dans les années 1920), de Memphis Minnie, bientôt à Chicago et une des rares femmes de cet ensemble, de Walter « Furry » Lewis et de Sleepy John Estes. Les pianistes prédominent à Saint Louis (Missouri) : Roosevelt Sykes, Peetie Wheatstraw, Walter Davis, auxquels on associe Leroy Carr, d’Indianapolis, dont le duo avec le guitariste Francis « Scrapper » Blackwell créera un style.
Chicago, enfin. En deux temps, avant et après la Seconde Guerre mondiale, elle va prendre dans l’histoire du blues une place centrale. Ville industrielle, créatrice d’emplois, elle attire très tôt les Noirs du Sud à la recherche de travail et de liberté raciale, et des bluesmen, comme Thomas A. Dorsey (alias Georgia Tom), un des fondateurs du gospel, et Tampa Red, viennent dès 1928 y enregistrer, s’y produire et s’y installer, provisoirement ou définitivement. Là, tandis que le blues change, solistes qui s’adjoignent une section rythmique, thèmes qui traduisent l’urbanisation noire et répondent aux nouvelles conditions de vie des musiciens et de leur public, blues qui recroise le jazz et les musiques blanches, production qui s’organise (chasseurs de talent, responsables – J. Mayo Williams, noir, Lester Melrose, blanc... – d’enregistrement, catalogues, réclame...), s’illustrent Big Bill Broonzy le magnifique, John Lee « Sonny Boy » Williamson, Washboard Sam, William « Jazz » Gillum, Memphis Slim, Big Maceo, Arthur « Big Boy » Crudup, Lil Green... Et montent du Sud profond, comme en opposition avec le ragtime, les accents du boogie-woogie, manière spéciale d’interpréter le blues au piano, encore appelé barrelhouse ou honky-tonk, que jouent Pinetop Smith, Meade « Lux » Lewis, Albert Ammons, Pete Johnson, Jimmy Yancey, Cripple Clarence Lofton, Sammy Price et bien d’autres, qui influenceront vivement les pianistes de jazz.
La guerre, alors, entraînant une nouvelle émigration noire vers les centres industriels (Chicago, Detroit, les chantiers navals de la Californie), provoquant des prises de conscience chez les nombreux soldats noirs de l’armée américaine mêlés aux Blancs et découvrant d’autres rapports et d’autres pays, amenant paradoxalement une relative prospérité, puis la fermeture pendant deux ans (1943-1945) des studios d’enregistrement, enfin l’apparition d’un nouveau matériel, de nouvelles techniques et de nouveaux produits (bandes magnétiques, chlorure de vinyle, 45-tours) et l’essor des juke-boxes, des compagnies phonographiques indépendantes et des stations de radio, vont modifier radicalement la scène du blues.
Chicago, avec son ghetto, ses studios et sa tradition, non seulement garde sa place, égale pour le blues à celle de New York pour le jazz, mais la renforce, abritant une foule de musiciens résidents ou de passage, qui créeront cette forme superbe, violente et désespérée qui a nom Chicago blues. Au centre, avec son petit orchestre par lequel les plus grands passeront, servant de modèle aux Noirs comme aux Blancs, né dans le Mississippi, Muddy Waters. Autour, Jimmy Reed, les harmonicistes Little Walter, Big Walter Horton, le contrebassiste et compositeur Willie Dixon, les pianistes Otis Spann, Little Brother Montgomery, Sunnyland Slim, le batteur Fred Below... que suivront Otis Rush, Magic Sam, Buddy Guy, Junior Wells... tandis que montent de Memphis le torrentueux Howlin’ Wolf, et de Helena (Arkansas), l’étonnant Sonny Boy Williamson II (Rice Miller).
Le blues est partout, dans les villes et dans les campagnes, mais se voit bientôt, comme le jazz, voler son statut de musique populaire par le rhythm and blues, vaste champ musical d’abord hétérogène, que le marché et son industrialisation et sa rationalisation progressives vont rapidement cadrer, rhythm and blues avec lequel, dans les années 1950, le blues se confond.
Tous les styles alors coexistent, marqués par les particularismes locaux, musiciens dont l’idiome commun ne gomme pas la façon propre de traduire leur environnement dans un rapport entre collectif et individuel que le blues crée et brouille sans cesse, communautés d’interprètes où les échanges sont permanents, mais aussi individualités marquantes dont la singularité engendre un style ou un courant, parfois étouffant (les épigones de B. B. King), parfois enrichissant (la polyinfluence de Lonnie Johnson), mais introduisant toujours dans le tissu musical ambiant à la fois suture et rupture.
Ainsi de B. B. King, né dans le Mississippi, disc-jockey à Memphis, où il rencontre Ike Turner, Junior Parker, Bobby « Blue » Bland, Little Milton..., enregistrant en Californie, et dont le style incisif, efficace et gorgé d’émotion domine largement le monde du blues. Trajectoire voisine pour T-Bone Walker, autre stature dominante, merveilleux guitariste aux lignes claires, venu du Texas en Californie. Où se mêlent jazz, blues et boogie-woogie pour donner les guitaristes Lowell Fulson ou Pee Wee Crayton, et les pianistes Lloyd Glenn ou surtout Charles Brown, bluesman à la voix de crooner. Et s’imposent l’envoûtant Elmore James, rattaché à l’école de Chicago, John Lee Hooker à Detroit et Lightnin’ Hopkins à Houston (Texas), tandis qu’à La Nouvelle-Orléans, d’où viendrait le banjoïste Papa Charlie Jackson, semble n’exister d’abord que Lonnie Johnson, époustouflant guitariste soliste. Elle est ville de fanfares et de pianistes, dont l’extraordinaire Professor Longhair, est un des creusets du rhythm and blues (Fats Domino, Little Richard) et abrite dans son arrière-pays les sons du blues du bayou (Slim Harpo, Lightnin’ Slim) et ceux de la musique cajun et zydeco dont l’accordéoniste Clifton Chenier est le représentant le plus célèbre.
B.B. King. À la fois guitariste, compositeur et chanteur, le bluesman américain B.B. King eut une influence majeure sur le monde du rock par son art du solo et son sens du spectacle. (TDC Photography/ Shutterstock.com)
Cependant, tandis que les disques noirs passent la ligne et pénètrent le monde blanc, rhythm and blues à son apogée, rock and roll qui naît, le blues se marginalise. Et il faudra l’Europe, au moment où le Mouvement pour les droits civiques prend de l’ampleur et de la réussite, années 1960 que dominent entre autres Ray Charles, James Brown, Otis Redding et Aretha Franklin, pour que s’opère un retour aux origines. Passent en France les tournées de l’American Folk Blues Festival, inaugurant la venue sur notre continent, où certains s’installent (Memphis Slim, Champion Jack Dupree), de la plupart des grands bluesmen, et se découvrent ou se redécouvrent en Amérique les « fondateurs » : Bukka White, Son House, Big Joe Williams, Sleepy John Estes, le révérend Robert Wilkins...
Le blues cesse de représenter une musique à l’hétérogénéité interne, mais voit se diversifier et se recomposer les genres, formes stylistiques qui se côtoient, se mêlent, divergent et parfois s’éteignent, tandis que, générations et couleurs mélangées, ses cinquante ans d’existence se présentent en même temps sur scène. Songsters nés au XIXe siècle (Mance Lipscomb, Jesse Fuller) et bluesmen ignorés (« Mississippi » Fred McDowell, Robert Pete Williams) surgissent comme du passé, que rejoignent, dans le delta, R. L. Burnside ou Jessie Mae Hemphill. À Chicago, que révèrent les Rolling Stones, jouent Fenton Robinson, Freddie King, Hound Dog Taylor, Magic Slim, Jimmy Johnson... Albert King enregistre à Memphis chez Stax, marque de la musique soul, et en Californie, au sein d’une communauté musicale active (Phillip Walker, Dave Alexander...), se révèle le Texan Albert Collins.
Le blues poursuit sa route, thématique qui s’étrécit parce que les mots cèdent devant les notes, champ que forcent les influences et les lois du marché, blues qui devient une idée, un concept, voire une forme qui recouvre des musiciens à la limite de la perte d’identité et un public plus riche de préjugés que d’ouverture. Rock, soul, funk et pop le pillent comme le gospel, mais, parallèlement à sa dilution, diffusion, dissolution vers tous les secteurs de la musique enregistrée, de plus en plus soumise aux impératifs financiers de la production de masse (impérialisme du hit-parade, obsession de la rentabilité, importance croissante de l’image publicitaire et télévisuelle), s’accomplit un énorme travail d’archivage et de recherche. Causé par l’Europe et mené presque exclusivement par des Blancs, il entraîne la fondation de centres de documentation et d’études universitaires, la multiplication des revues spécialisées, la mise en œuvre de prospections et enquêtes de terrain et, relancées par l’apparition du disque compact, des rééditions discographiques toujours plus nombreuses.
Ainsi grandit la connaissance du blues et de ses musiciens disparus, tandis que d’innombrables festivals se tiennent à travers l’Amérique et le monde, présentant gloires locales et nationales, musiciens obscurs et jeunes Blancs dévoués à la cause, et attirant un vaste auditoire, mais sans que se résolve cette question cruciale : comment garder son authenticité et atteindre en même temps à la notoriété et à la fortune dans une société qui n’aime l’originalité que commerciale ?
B. B. King y est passé maître, qui, sans se renier, a continué à se produire, toujours impeccable et souvent passionnant, de même que se sont produits John Lee Hooker, Lonnie Brooks, Walter « Wolfman » Washington, Clarence « Gatemouth » Brown, R. L. Burnside, James Cotton... Mais la forme expressive du blues ne correspond plus aux préoccupations et aux identifications de la jeunesse noire. Ne l’impressionne pas non plus sa reconnaissance internationale, majoritairement blanche, qui a mis le blues à la place inexpugnable qu’il occupe dans l’histoire du XXe siècle et de l’art. Musique de nécessité devenue musique de répertoire, le blues est maintenant loin de son terreau d’origine et la persistance, sous d’autres codages, de la ségrégation et de ses corollaires, ne peut garantir son avenir.
Francis HOFSTEIN
BROONZY BIG BILL (1893 ou 1898-1958)
En se produisant en Europe dans les années 1950 seul avec sa guitare, Big Bill Broonzy a ouvert au blues les oreilles et les yeux du public international, jouant un rôle déterminant dans l’émergence du blues revival, l’avènement du folk boom et la genèse du rock anglais. Mais, avant cela, il fut d’abord – et surtout – une des grandes vedettes du Chicago blues des années 1930 et 1940, enregistrant des centaines de titres sous son nom et accompagnant de sa guitare élégante, swinguante et incisive une multitude de bluesmen.
Fils d’un métayer du Mississippi, William Lee Conley Broonzy naît à Scott (Mississippi) un 26 juin, 1893 ou 1898. Bill Broonzy s’exerce très jeune au violon, devient prédicateur et tourne dans des medicine shows avant de s’installer à Chicago en 1918 après son service militaire. Initié à la guitare par Papa Charlie Jackson, notamment, Big Bill s’impose en quelques années comme un des meilleurs guitaristes de la ville, aussi à l’aise dans le blues que dans les autres genres populaires noirs de l’époque, comme le ragtime ou le hokum. Il enregistre abondamment à partir de 1927 et connaît des succès considérables auprès de la clientèle noire avec Big Bill blues, Selling that stuff, Bull cow blues, Serve it to me right, Keep your hands off her, Rockin’ chair blues... Big Bill Broonzy est dans les années 1930 l’archétype du bluesman urbain et sophistiqué.
Bien qu’analphabète, Broonzy est aussi un des meilleurs paroliers du blues de cette époque. En quelques versets empreints d’images évocatrices, d’humour sarcastique et de morale paysanne, il trousse des blues emplis de la nostalgie d’un Sud dont on regrette la vie nonchalante et le climat, de thèmes forts sur les tensions de la grande ville, de pièces dansantes et légères, très souvent osées. Sa musique ne cesse d’évoluer. À la fin des années 1920, il enregistre en duo guitare-piano à la façon du blues de Saint Louis puis exclusivement en petite formation, ajoutant une section rythmique (contrebasse, seconde guitare, batterie ou washboard), voire des cuivres. Cette instrumentation confère à ce blues urbain des années 1930 une coloration jazzy qui le rapproche du swing. Mais la guitare de Big Bill, moelleuse, est toujours en avant et prend souvent des solos pleins de verve. Ses accompagnateurs sont aussi pour beaucoup dans la réussite de ses disques, en particulier le formidable pianiste Joshua Altheimer.
Ses talents exceptionnels de guitariste permettent à Big Bill Broonzy, outre sa carrière de vedette du blues, d’être aussi un des accompagnateurs les plus demandés par les studios durant les années 1930 et 1940. Il figure sur plusieurs centaines de titres, marquant de sa guitare certains des meilleurs morceaux des figures les plus populaires de la musique noire, en blues, en jazz ou en variétés. Big Bill joue aussi le rôle de talent scout pour les grands labels de Chicago et découvre ainsi à Chicago et dans le Sud de nombreux nouveaux artistes. Cette activité débordante fait apparaître Big Bill comme une des figures clés du Chicago blues d’avant 1944, qui urbanise alors le blues sudiste des migrants pour en faire une forme de musique populaire commerciale.
Mais Big Bill Broonzy possède aussi une capacité particulière à flairer les évolutions du temps. En 1938, il remplace au pied levé Robert Johnson, récemment décédé, sur la scène du Carnegie Hall de New York pour le célèbre concert organisé le 23 décembre par John Hammond, From Spirituals to Swing. Celui qui n’a plus tiré de charrue depuis sa tendre enfance est présenté comme un « laboureur du Mississippi » ! Lorsque le blues de Chicago change après la Seconde Guerre mondiale, Broonzy est un des tout premiers à sauter dans le train du courant folk, alors en gestation. Se souvenant de son expérience du Carnegie Hall, Big Bill joue en Europe et sur les scènes américaines le rôle du « dernier chanteur de blues », interprétant pour un public exclusivement blanc de vieux folk songs comme John Henry, ses blues réaménagés dans un style de country blues soliste acoustique ainsi que des chansons protestataires alors à la mode, parmi lesquelles le puissant Black, brown and white. Ce dernier rôle de folk singer permettra à Big Bill de vivre de sa musique jusqu’à sa mort, et d’enregistrer substantiellement dans ce style de soliste acoustique. Big Bill Broonzy réalise aussi enfin à plus de cinquante ans un de ses grands rêves, apprendre à lire et écrire. Cela lui permettra de rédiger – avec l’aide de Yannick Bruynoghe – une autobiographie passionnante, Big Bill Blues, publiée à Londres en 1955, et qui fera l’admiration d’Henry Miller.
Atteint d’un cancer de la gorge, Big Bill Broonzy meurt à Chicago le 15 août 1958. Parmi ceux qui portent son cercueil figure Muddy Waters, qui sera le principal continuateur de l’œuvre considérable de celui qui fut, avant tout, le véritable « boss » du Chicago blues.
La discographie de Big Bill Broonzy est pléthorique. Un coffret de deux CD, Big Bill Broonzy : The Blues. Chicago, 1937-1945 (Frémeaux & Associés FA 252) regroupe les chefs-d’œuvre enregistrés à Chicago. Big Bill Broonzy : Black, Brown And White (Mercury 8427432) rassemble les meilleurs titres de sa dernière œuvre.
Gérard HERZHAFT
BROWN CHARLES (1922-1999)
Un des grands créateurs du blues californien, ou West Coast blues, le pianiste et chanteur Charles Brown a connu une énorme popularité entre 1945 et 1954. Voix mourante, insinuante, chagrinée jusqu’au désespoir, piano et guitare tissant un subtil mais solide canevas, compositions sophistiquées jusqu’à l’affectation : la musique de Charles Brown et de ses nombreux disciples a reflété mieux qu’aucune autre les aspirations de ses contemporains noirs, celles d’une réussite sociale dans les grandes cités où ils étaient venus chercher du travail et une meilleure vie durant les années de guerre. D’ailleurs, le style de Brown, comme son parcours, est aux antipodes de celui, brut et rural, des bluesmen venus du Delta à Chicago, comme Muddy Waters. Charles Brown lui-même récusait le qualificatif de « bluesmen », préférant celui de « blue ballad singers ». La critique de l’époque parlera de « sepia Sinatras », crooners noirs pour une société « de couleur » en mouvement vers l’ascension sociale.
Charles Brown naît à Texas City (Texas) le 17 janvier 1922. Élevé par ses grands parents, tous deux musiciens de jazz et de gospel, Charles émigre du Texas à Los Angeles en 1943, après des études de pharmacie et une formation de pianiste classique. Il fréquente les cabarets chics de Hollywood, où son jeu de piano virtuose, marqué par Fats Waller et Earl Hines, attire l’attention. Il remplace Nat King Cole au sein du trio Three Blazers du guitariste Johnny Moore. Le succès est instantané avec des blues et des ballades douces-amères qui sont souvent devenus des classiques repris encore aujourd’hui : Driftin’ Blues, Merry Christmas Baby, Black Nights, Trouble Blues, Race Track Blues, Soothe Me, Rockin’ Blues. En 1948, après la disparition des Three Blazers, Charles Brown décide de voler de ses propres ailes ; il va triompher sur les plus grandes scènes des États-Unis, de San Francisco à New York et de La Nouvelle-Orléans à Detroit.
Mais, à la fin des années 1950, son style, en demi-teintes et en nuances, cesse de plaire à une jeunesse noire avide de nouveaux rythmes et d’une autre attitude. Brown n’a bientôt plus les moyens d’entretenir une formation et se cantonne aux petits bars de voisinage des banlieues californiennes. Alors que les styles de blues plus rudes et crus – passés eux aussi de mode parmi les Noirs – trouvent un second souffle auprès de l’auditoire jeune, blanc et nordiste du folk boom des années 1960, la musique de Brown apparaît à ces mêmes oreilles trop urbaine et jazzy.
Malgré quelques vaines tentatives de retour ponctuées de bons albums (parmi lesquels, en 1970, Legend !