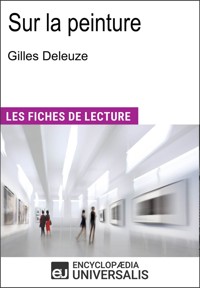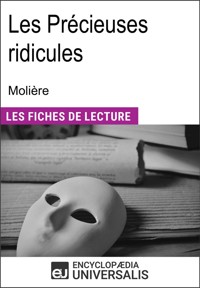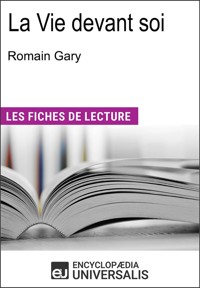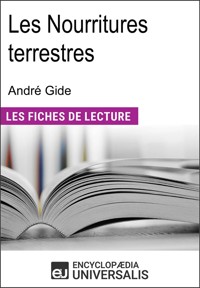Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le cinéaste Volker Schlöndorff a suggéré que l'histoire du cinéma allemand était faite d'une série de ruptures esthétiques doublées d'une grande continuité dans le domaine de l'industrie cinématographique. C’est ce double parcours que retrace le Dictionnaire du Cinéma allemand. Les quelques 70 articles qui composent la table des matières font la part belle aux cinéastes (de STROHEIM et MURNAU à PETZOLD et HANEKE), mais les films eux-mêmes, les comédiens les plus marquants et l’arrière-plan historique du cinéma d’outre-Rhin viennent compléter le panorama. Empruntés au fonds de l’Encyclopædia Universalis, les articles sont signés des meilleurs spécialistes
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341002684
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Ponsulak/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans le Dictionnaire du Cinéma allemand, publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles du Dictionnaire à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Aguirre, la colère de dieu, de Werner Herzog
Aguirre, la colère de dieu (Aguirre, der Zorn Gottes) est le premier long métrage de fiction réalisé par un auteur alors connu pour la qualité de ses documentaires : Signes de vie (Lebenszeichen, 1967) puis Fata Morgana (1970). Il s’agit aussi du premier grand rôle de Klaus Kinski avec Werner Herzog, avant Nosferatu, fantôme de la nuit (Nosferatu, Phantom der Nacht, 1979), remake du film de Murnau, Woyzeck (1979), Fitzcarraldo (1982), et Cobra verde (1987) – films dans lesquels ses personnages alternent, et parfois cumulent, le statut du fou mégalomane et celui de la victime expiatoire. Par l’intensité de ses visions et par le jeu plus grand que nature de l’acteur principal, par le caractère « reportage » d’un tournage, mais aussi par la puissance poétique de la musique, le film atteint un succès que retrouvèrent rarement les œuvres ultérieures du réalisateur.
Toute l’œuvre de Herzog s’intéresse aux humbles, aux exploités, à ceux que l’on classe comme fous : Bruno S., héros des deux films L’Énigme de Kaspar Hauser (Jeder für sich und Gott gegen alle, 1974) et La Balade de Bruno (Stroszek, 1977), mais aussi aux illuminés, et aux rapports de ceux-ci avec la nature et le cosmos.
• L’homme qui voulait être dieu
Au début de 1561, un groupe constitué de conquistadores, d’Indiens esclaves, de deux jeunes femmes et d’un moine, conduit par Pizarre, atteint le fleuve Amazone, non loin de sa source, en cherchant la mythique terre d’El Dorado, où se trouve, dit-on, tout l’or du monde. Une partie de l’expédition prend le fleuve, sur quatre radeaux. Mais un matin, les hommes de l’un d’eux sont retrouvés exterminés par un ennemi invisible. Les difficultés s’accumulent. Aguirre, le commandant en second, se mutine contre ceux qui veulent renoncer à l’expédition. Il en fait arrêter puis il fait tuer le chef et élit un « empereur » fantoche des territoires conquis – en fait une forêt impénétrable à la lisière de laquelle bringuebale un trône porté à dos d’homme. Beaucoup périssent des flèches des Indiens, de maladie, ou assassinés. Aguirre reste le seul chef à bord, et devenu fou d’orgueil, rêve de s’accoupler à sa fille Florès pour fonder une « race pure ». Il erre au milieu des morts et des mourants, sur un radeau qui dérive...
• Un désastre programmé
Tourné au Pérou, le film est librement inspiré de la vie d’un personnage réel. Le sous-titre est motivé par une déclaration hallucinée d’Aguirre (« Je suis la colère de Dieu »), odieux et visionnaire à la fois, les yeux bleus perdus dans un rêve qui place la gloire avant l’or. Après un début fulgurant, le récit ralentit graduellement, ou plutôt garde une lenteur tranquille jusqu’à une sorte d’engourdissement contemplatif contredisant la cruauté des scènes évoquées (un soldat décapité dont la tête coupée achève le décompte qu’il a entamé vivant).
Les premiers plans du film présentent les voyageurs, partis des sierras péruviennes, au départ du fleuve Amazone, peu large à cet endroit. La voix calme du narrateur, le prêtre de l’expédition, accompagne par intermittence les images. La procession des esclaves péruviens, de leurs lamas, de soldats espagnols casqués, d’une chaise à porteur, d’une femme en habit de cour, sur les pentes d’une montagne perdue dans les nuages, aux sons irréels de la musique électronique de Popol Vuh, est une des plus extraordinaires apparitions de l’écran.
Comme dans certains films historiques ou antiques de Pasolini, la caméra portée à l’épaule confère à cette chronique du XVIe siècle une allure de reportage assez proche des documentaires d’exploration des années 1940-1950. Gouttes d’eau sur l’objectif, scènes elliptiques, personnages fixant la caméra (qui reste presque toujours au sein du groupe des personnages) contribuent à cette impression. Rappelons que Herzog, quand il signe Aguirre, a déjà réalisé plusieurs documentaires et en tournera d’autres. Il montre une nature magnifique et impénétrable, avec laquelle on ne peut pas se fondre et qui triomphera toujours. Les petits singes, qui envahissent le radeau à la fin du film, incarnent la dérision des prétentions humaines sur cette nature : ils sont le seul peuple sur lequel « règne » désormais Aguirre.
Les dialogues, en allemand, ostensiblement post synchronisés sur un ton neutre, toujours comme chez Pasolini, sont rares. Sorte de diable blond, Klaus Kinski, acteur qui généralement ne voulait tourner que dans des films populaires à petit budget, ne dit presque rien au début du film, comme s’il attendait son tour. Il joue de son corps, de ses roulements d’yeux et de ses postures déhanchées de chimpanzé, comme un acteur du muet incarnant Quasimodo. La voix off narrative n’intervient que par intermittence, et le moine chroniqueur n’est pas présent dans une grande partie des scènes. S’il l’est, c’est comme un représentant impuissant ou complice de l’Église qui, dit-il dans le film, « a toujours été du côté des puissants ». La dérision des rites et du calendrier chrétiens au milieu d’une nature étrangère, le ridicule des procédures humaines (un procès truqué en pleine jungle) créent un sentiment de vanité shakespearienne.
En même temps, le film rappelle sobrement la réalité historique : les massacres, les spoliations, l’esclavage dont furent victimes les Indiens, avec l’alibi – ou le double jeu – d’une volonté de « convertir » et de sauver. Les humiliés, les exploités (dont le prince déchu, ainsi que les deux femmes de l’expédition, nobles et bien habillées, mais totalement asservies), sont les vrais héros d’Aguirre.
Le film aura un certain écho dans le cinéma américain, et on en trouve des réminiscences aussi bien dans l’« opéra » Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola, que dans une réplique et certains plans du beau film de guerre La Ligne rouge (The Thin Red Line, 1999) de Terrence Malick.
Michel CHION
AKIN FATIH (1973- )
Depuis l’ours d’or attribué en 2004 à Gegen die Wand (Head On), et les succès en France de ses deux films suivants, Auf der anderen Seit (De l’autre côté) en 2007 et Soul Kitchen en 2010, Fatih Akin est devenu l’auteur-réalisateur allemand le plus connu des spectateurs français et des grands festivals.
D’ascendance turque, né à Hambourg en 1973, Akin a manifesté très jeune des ambitions cinématographiques. En 1998, Kurz und Schmerzlos (L’Engrenage) raconte l’histoire de trois amis issus de l’immigration, le Turc Gabriel, le Serbe Bobby, et le Grec Costa, décidés à se faire une place dans le milieu de St-Pauli, le quartier hambourgeois de la prostitution. Le film recherche l’efficacité en jouant des codes du polar américain et échappe à ceux du policier psychologique allemand télévisuel.
Deux ans plus tard, Im Juli (2000, Julie en juillet) se présente à la fois comme une comédie romantique et un road-movie, dont les deux acteurs principaux sont deux des jeunes vedettes les plus connues de l’époque, Moritz Bleibtreu et Christiane Paul. Le film conduit le spectateur de Hambourg vers Istanbul à la suite de Daniel, tombé amoureux d’une jeune femme turque qu’il va rejoindre, en traversant l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, et la Roumanie, jusqu’en Turquie où il trouvera l’amour, après de nombreuses et cocasses aventures.
Solino (2002) a confirmé le succès commercial rencontré par le film précédent, mais a valu au cinéaste des critiques sévères. Ce récit de la vie d’une famille italienne – et singulièrement de deux frères –, originaire de Solino et installée à Duisbourg, utilise en effet les ficelles modernisées du mélodrame traditionnel. Le film commence en 1964 et s’achève en 1984. Ces grandes étapes de dix ans en dix ans rythment le film. Cependant, celui qui penserait trouver ici une peinture de l’histoire allemande, à l’instar de la trilogie de Fassbinder entamée par Le Mariage de Maria Braun, sera déçu. Fatih Akin n’est pas un cinéaste de l’histoire. Ce n’est que le sort des individus qui l’intéresse. À travers le récit de la vocation contrariée de Gigi, c’est bien plutôt la sienne qu’Akin veut raconter en affirmant sa volonté de pratiquer un cinéma où le primat des acteurs, chargés d’incarner avec énergie les virtualités de scénarios plein de rebondissements, est aussi celui de la psychologie individuelle sur les mécanismes sociaux.
Head On et De l’autre côté vont marquer une inflexion certaine dans le travail d’Akin. Le premier film reste centré sur ses personnages : l’alcoolique quadragénaire (Biro Ünel) et la jeune femme (Sibel Kekilli) qui veut échapper à sa famille en l’épousant. Les deux acteurs se donnent pleinement dans un jeu naturaliste parfois à la limite de l’hystérie, ce qui valut à Sibel Kekilli le prix d’interprétation au festival de Berlin. La construction repose sur une succession de scènes habilement variées, passant rapidement du dramatique à de petits intermèdes comiques pour conduire au mélodrame amoureux.
En 2007, après Crossing the Bridge, documentaire sur la vie musicale d’Istanbul, De l’autre côté met en place une structure plus complexe où les personnages et les générations se croisent et se déplacent d’Allemagne en Turquie. L’intrigue est plus précisément ancrée dans la réalité contemporaine. Fatih Akin revendique ici la filiation avec le cinéma iranien qui se manifeste par certaines scènes moins découpées et moins dialoguées. Enfin, Hannah Schygulla, icône fassbindérienne, jette un pont entre le cinéma de Fatih Akin et le nouveau cinéma allemand des années 1970. Le film mêle très intelligemment de nombreux thèmes du cinéma d’art et d’essai européen : immigration, conflit de générations, misère sexuelle et prostitution, revendications identitaires, relation amoureuse homosexuelle. Pourtant, s’il aborde dans les deux films certains problèmes liés à l’immigration et à l’intégration des jeunes nés en Allemagne de parents turcs, en instillant des éléments plus documentaires, Akin continue de faire prévaloir une conception cinématographique d’identification classique aux personnages.
Le prix du scénario accordé à De l’autre côté, première récompense cannoise depuis de très longues années pour un film allemand, contribua à conforter le statut d’auteur de Fatih Akin. Il était ainsi logique que Soul Kitchen reçût à l’occasion du festival de Venise en 2009 le prix du jury pour cette comédie délaissant totalement le thème de la relation germano-turque. Soul Kitchen peut être considéré comme une variation sur le genre du Heitmatfilm (film présentant la vie d’une communauté villageoise), mais transposé dans le cadre d’une grande ville cosmopolite, ici Hambourg.
Le propriétaire du restaurant Soul Kitchen abandonne la nourriture de cantine populaire traditionnelle pour une cuisine plus originale et une ambiance plus branchée. Mais il doit affronter la spéculation immobilière qui transforme les anciens quartiers industriels en quartiers de bureaux et d’appartements bourgeois. Akin choisit cette fois la voie de la comédie à l’humour facile, du clin d’œil sociologique et du cinéma fonctionnel. Une touche policière, le choix de la bande originale, et une pincée de suspense font de Soul Kitchen un divertissement à succès, le plus grand du réalisateur en Allemagne avec plus d’un million de spectateurs.
Fatih Akin s’est imposé comme un cinéaste de la nouvelle Europe « multiculturelle » en réussissant à échapper à l’étiquette nationale du cinéma allemand. Tout au long de sa carrière, sa versatilité lui a permis de naviguer parmi les genres cinématographiques (polar, comédie, mélo historique, drame sur les relations entre cultures, ou documentaire avec PollutingParadise, 2012), tout en restant avec succès fidèle à sa conception d’un scénario « bien ficelé », porté par le dynamisme de ses acteurs.
Pierre GRAS
DIETRICH MARLENE (1901-1992)
Si Garbo était « la divine », Marlene est « l’impératrice ». Elle l’est parce qu’on ne l’imagine guère sans le costume d’apparat qui sied à la fonction dans The Scarlet Empress (L’Impératrice rouge, 1934), évidemment, ou dans Dishonored (X27, 1931), Shanghai Express (1932), Blonde Vénus (1932), The Devil Is a Woman (La Femme et le pantin, 1935), tous de Josef von Sternberg. Il en va de même sous la direction d’autres réalisateurs : Rouben Mamoulian (Song of Songs [Cantique d’amour], 1933), Frank Borzage (Desire [Désir], 1933), Jacques Feyder (Knight without Armor [Chevalier sans armure], 1937), William Dieterle (Kismet, 1944), ou Orson Welles (Touch of Evil [La Soif du mal], 1958), où elle retrouve le costume de son personnage de Golden Earings (Les Anneaux d’or, Mitchell Leisen, 1947). Si Sternberg a façonné son personnage, au point d’affirmer, évoquant involontairement sans doute une célèbre formule de Flaubert, « Marlene n’est pas Marlene, c’est moi ! », en fait, le personnage existait à l’état naissant avant Sternberg – Der Blaue Engel (L’Ange bleu, 1930) est son quinzième film ! Il continuera d’exister après lui à l’écran, dans ses tours de chant et, souvent, dans la vie.
• Un couple baudelairien
Maria Magdalena Dietrich, dite Marlene Dietrich, née à Berlin le 27 décembre 1901, a connu une longue carrière par rapport à la plupart des stars hollywoodiennes, tout particulièrement sa grande rivale Greta Garbo. Elle a incarné pendant plus de trente ans, à l’écran comme au music-hall, une image mythique et singulière de la femme, à la fois objet de culte amoureux et sujet lucide et dominateur.
Marlene Dietrich est la fille d’un officier de cavalerie. Son enfance à Weimar est à la fois protégée et marquée par la discipline. Elle manifeste très tôt des prédispositions pour le violon, mais doit abandonner l’espoir d’une carrière d’instrumentiste à la suite d’une maladie du poignet. Dans le Berlin en crise des années 1920, elle vit la bohème d’une jeunesse sans repères, jouant du violon dans les cinémas ou se produisant comme danseuse dans des tournées. Elle suit aussi des cours de théâtre avec un assistant de Max Reinhardt et débute au cinéma en 1923 (Der Kleine Napoleon [Le Petit Napoléon], Georg Jacoby), avant d’épouser l’année suivante un régisseur influent, Rudolf Sieber. Ses parures extravagantes, ses jambes et ses rôles provocants, parfois ambigus, la font remarquer. Des spectacles musicaux tels que Es liegt in der Luft, avec la très masculine Margo Lion, et des films comme Cafe Elektric (Filles d’amour, Gustav Ucicki, 1927) ou Prinzessin Olala (Princesse Olala, Robert Land, 1928) en font une vedette. Josef von Sternberg, frappé par la souveraineté de son regard, contrastant avec une très « vivante » sensualité, l’impose dans le rôle de Lola-Lola dans L’Ange bleu (1930), d’après le roman de Heinrich Mann. En l’espace de sept films, le metteur en scène va faire de la blonde et pulpeuse Allemande une star sophistiquée et « glamour », exhibant les tenues les plus troublantes et ambiguës : plumes, peau de gorille, robes drapées, fourrures, collants, smokings d’homme...
Parmi les admirateurs de Marlene, la majorité (surtout masculine) apprécie cette transformation, considérant que sa silhouette, dans L’Ange bleu, est encore lourde, sans grâce, trop « germanique ». C’est confondre un peu vite le personnage et l’actrice : lourdeur du corps et vulgarité font partie de l’entraîneuse Lola-Lola. Elles restent présentes dans certaines scènes de Morocco (Cœurs brûlés, 1930), où s’opère le remodelage de la star. Le point de vue, féminin (et féministe), de Louise Brooks rencontrant à Hollywood pour la première fois Marlene, « une jolie blonde bien en chair », est bien différent. « Ses beaux cheveux blonds étaient étroitement bouclés, elle portait une robe de gaze bleu ciel avec de lourds bas de soie allemands. À ma grande surprise, elle me dit bonsoir d’une voix chaude et amicale. Elle était encore tout à fait Lola-Lola de L’Ange bleu. Mais, à partir du moment où Cœurs brûlés fut distribué, toute ressemblance avec ce personnage magnifique s’évanouit à tout jamais. Dans la nouvelle Dietrich, si raffinée, il n’y avait plus trace d’heureuse vulgarité ou de générosité impulsive. Ses mouvements brutaux et dynamiques s’étaient atténués jusqu’à cette démarche majestueuse qu’elle avait entre les séances de pose photographiques. Elle n’osait plus jouer, de peur d’ouvrir ses yeux, à présent mi-clos et lourdement ombragés de faux cils. Et toute démonstration émotive eût nui à l’éclairage savant qui sculptait ses joues rondes... » Impitoyable, Louise Brooks conclut : « Chaque fois que je vois L’Ange bleu, je pleure un peu. »
Le couple cinématographique que forment durant cinq ans Marlene Dietrich et Josef von Sternberg mêle à une forme d’amour fou une étrange perversité, où voisinent fétichisme, ambiguïté sexuelle et masochisme. Une nouvelle écrite par Sternberg dans sa jeunesse, citée par Robert Benayoun, décrit un employé timide qui est fasciné par un mannequin de cire dans une vitrine, et rencontre bientôt une jeune femme, « réplique vivante de son idole ». Cette dialectique de l’idole sans vie et de la femme de chair est au cœur de la relation entre le Pygmalion et sa Galatée, comme elle demeurera la contradiction qui anime de bout en bout le mythe de Marlene.
• Un personnage dédoublé
Dans X27, dans Shanghai Express, dans L’Impératrice rouge, le cinéaste s’emploie à magnifier la beauté de l’actrice, en recourant aux artifices de l’éclairage et du vêtement, en la fondant dans le décor, sans que la créature mythique cesse pour autant d’être une femme terrienne et charnelle. Dans La Femme et le pantin, d’après le roman de Pierre Louÿs, elle détruit moins ses deux amants qu’elle ne s’en prend à la vanité de leur code viril amoureux, tandis que dans Morocco, elle devient l’esclave d’un séduisant légionnaire au cœur dur. C’est dans Blonde Vénus que Sternberg touche au plus près l’opposition entre ses deux attitudes qui fonde le double personnage de Marlene. Pur objet de regard et de désir engoncé dans les costumes les plus inattendus – justifiant la description de la nouvelle Dietrich par Louise Brooks –, elle met le spectacle et la prostitution au service de l’amour conjugal et maternel. Sternberg joue merveilleusement de l’alternance entre la femme-décor et la femme d’intérieur dans des images qu’on croirait alors sortie d’un Heimat Film allemand. Pour lui, l’amour est à la fois une transformation de l’être aimé en objet de regard et l’acceptation du fait d’être statufié par le regard amoureux, pour la femme comme pour l’homme. « Ce qui est subversif dans la conception de Dietrich par Sternberg, écrit la critique féministe Molly Haskell, est qu’elle ne peut être enrôlée dans un camp idéologique-sexuel plutôt qu’un autre. Elle parodie les notions conventionnelles de l’autorité mâle et les règles du jeu sexuel sans détruire sa crédibilité en tant que femme. »
D’autres réalisateurs, après Sternberg, sauront magnifier le personnage de Marlene Dietrich sans l’affadir, comme Ernst Lubitsch (Angel [Ange], 1937), Billy Wilder (A Foreign Affair [La Scandaleuse de Berlin], 1948 ; Witness for Prosecution [Témoin à charge], 1957), Alfred Hitchcock (Stage Fright [Le Grand Alibi], 1950), Fritz Lang (Rancho Notorious [L’Ange des maudits], 1952). Son personnage ne cesse pourtant de devenir plus terrestre, jusqu’à la souillure physique (Destry Rides again [Femme ou démon], George Marshall, 1939) ou le corps à corps viril (Seven Sinners [La Maison des sept péchés], Tay Garnett, 1940). Marlene Dietrich perd en partie son originalité, rivalisant davantage avec d’autres femmes qu’avec la vanité masculine, lorsqu’elle incarne une entraîneuse ou une tenancière de saloon. Elle trouve son dernier rôle important dans Judgement at Nuremberg (Jugement à Nuremberg, Stanley Kramer, 1962). Dès 1937, elle avait refusé de revenir en Allemagne, malgré la demande pressante de Goebbels, avant de prendre la nationalité américaine et d’effectuer des tournées parmi les G.I.’s entre 1943 et 1945. Les Allemands ne le lui pardonneront qu’après 1960, à l’occasion d’un de ces tours de chant où Marlene devenait enfin son propre Pygmalion, et qu’elle allait poursuivre quelques années. Sa voix et son mythe illuminent le commentaire de The Black Fox : the True Story of Adolf Hitler (La Véritable Histoire d’Adolphe Hitler), montage de documents, qui remporte l’oscar du documentaire en 1962. Outre les documentaires qui lui sont consacrés, elle apparaît une dernière fois dans un film de fiction de David Hemmings en 1978, Just a Gigolo. Elle finit sa vie recluse et solitaire dans un appartement de l’avenue Montaigne à Paris. Elle s’éteint en 1992 et est inhumée à Berlin.
Marlene Dietrich et Billy Wilder. Marlene Dietrich et Billy Wilder pendant le tournage de «La Scandaleuse de Berlin» (1948), de Billy Wilder. (Paramount Pictures/ Album/ AKG)
Joël MAGNY
EISNER LOTTE H. (1896-1983)
Née à Berlin, Lotte Eisner se lance dans des études d’histoire de l’art et se plonge dans la littérature. Après la guerre, dans l’Allemagne de la république de Weimar, Berlin devient le centre d’une activité intellectuelle et artistique dont l’effervescence va étonner l’Europe. Un jour, Lotte Eisner lit le manuscrit d’une pièce, Baal, dont l’auteur est Bertolt Brecht. Elle pressent l’importance que va prendre cet auteur, dont elle fait la connaissance. Elle suit, au théâtre, les mises en scènes de Max Reinhardt et devient critique dramatique au Berliner Tageblatt. Après avoir commencé à fréquenter les studios, Lotte Eisner se passionne pour le cinéma. En 1927, elle est engagée au Film Kurier où elle assure la critique cinématographique. Le cinéma allemand combine alors l’« expressionnisme », hérité de la peinture, le « Kammerspiel » (théâtre de chambre, intimiste) et le réalisme social. Murnau, en pleine gloire, est appelé aux États-Unis. Lotte H. Eisner rencontre Pabst, Ludwig Berger, bien d’autres, dont Fritz Lang qui sera toujours son ami. L’expérience des plateaux de tournage renforce son acuité critique. Mais la crise du début des années trente amène Hitler au pouvoir. Lotte H. Eisner est juive. Le 31 mars 1933, les nazis occupent les bureaux du Film Kurier. Elle doit se réfugier à Paris.
L’année 1934 marque un tournant décisif de son existence : elle fait la connaissance de Henri Langlois et de Georges Franju. C’est le début d’une grande aventure, celle de la Cinémathèque française. 1939 : la guerre éclate. Lotte H. Eisner, sous l’Occupation, échappera aux nazis en prenant une fausse identité : Louise Escoffier. En 1945, elle est nommée conservatrice et chargée des recherches historiques de la Cinémathèque française. Étroitement associée à ce qui sera toujours, pour elle, la « maison de Langlois », elle écrit des articles, entreprend de rassembler tous les documents qu’elle peut trouver : dessins, maquettes de décors, scénarios, pour le musée de la Cinémathèque. Archiviste, elle recueille des trésors ; critique de cinéma, elle provoque, déjà, une réévaluation des films américains de Fritz Lang. En 1952, son premier livre, L’Écran démoniaque, consacré à l’époque de l’expressionnisme, est publié aux éditions André Bonne, mais dans un texte tronqué. Lotte H. Eisner a gagné depuis lors une renommée mondiale. En 1964, Eric Losfeld publie son ouvrage fondamental, F. W. Murnau. Grâce à Losfeld encore, L’Écran démoniaque paraît, en 1965, dans sa version intégrale qui sera, de nouveau, enrichie pour sa réédition, en 1981.
Entre-temps, Lotte H. Eisner, qui n’avait jamais pu se remettre du nazisme, avait tout de même renoué avec l’Allemagne. Au cours des années soixante et soixante-dix, son inlassable curiosité lui fait découvrir les jeunes cinéastes allemands porteurs d’un renouveau qu’elle attendait : Volker Schloendorff, Werner Herzog, Rainer Fassbinder, Wim Wenders.
En 1975, une opération de la cataracte contraint Lotte H. Eisner à quitter ses fonctions à la Cinémathèque française. Elle a écrit, en allemand, son livre sur Fritz Lang, qu’elle a soumis chapitre par chapitre au cinéaste, avant la disparition de ce dernier, en 1976. Insatisfaite de l’édition allemande, et des traductions anglaise et italienne, elle avait remis l’ouvrage au point avec Bernard Eisenchitz, pour une édition française publiée en 1984.
E.U.
Jacques SICLIER
EXPRESSIONNISME
En France, l’expressionnisme a longtemps été rejeté, comme une calamité germanique et brumeuse. Soulignant l’attraction qu’exerçait le Paris brillant des années folles sur l’internationale cosmopolite des arts et des lettres, Paul Morand lui oppose le repoussoir allemand : « Londres, New York [...] avaient les yeux fixés sur nous [...]. Je ne parle pas de Berlin qui se tordait alors dans les affres de la dévaluation, de la faim et de l’expressionnisme. »
L’expressionnisme aurait donc été l’enfer des autres : tout au moins l’effondrement esthétique résultant d’une débâcle guerrière, politique et cosmopolite. Ses œuvres, convulsives et avortées, traduiraient la faillite historique du peuple allemand et de ses élites. Et l’ignorance de l’expressionnisme, en France, n’a jamais empêché de le condamner. Or un tel jugement se fonde sur un contresens historique. L’explosion expressionniste advient avec le mouvement de rénovation artistique et littéraire qui se manifeste en Allemagne à partir de 1905. Après 1918, l’expressionnisme ne fait plus guère que se survivre quelques années à lui-même. On a donc pris les derniers soubresauts d’un phénomène esthétique pour son zénith. Bien loin d’avoir poussé sur les décombres de la République de Weimar, l’expressionnisme en a été comme le rêve prémonitoire et la prophétie d’apocalypse.
Bref, l’expressionnisme n’est pas l’effet esthétique d’un écheveau déterministe de catastrophes, mais une révolte. En ce sens, il manifeste la pesée extrême du tourment intérieur sur la recherche formelle. Comme Malaparte a défini la technique du coup d’État, les poètes et les peintres expressionnistes ont inventé le style de l’angoisse et la technique du « malaise dans la civilisation ». Il est assez absurde de voir là le témoignage des miasmes morbides de l’âme allemande, puisque Benn ou Kirchner, après tout, ne font que radicaliser le programme du spleen baudelairien. Et la première dramaturgie géniale de l’expressionnisme est née avant lui, et ailleurs : c’est un tableau de 1893, Le Cri, œuvre du peintre norvégien Edvard Munch. Titubant contre la balustrade d’un pont qui domine la mer soulevée comme par un spasme, un être hagard se serre les tempes à deux mains et crie sous un ciel sanglant. Deux personnages, vus de dos, s’éloignent dans le lointain, leurs hauts-de-forme sur la tête.
Or ce cri tragique de l’horreur existentielle a été poussé dans la société scandinave, conformiste, puritaine et bourgeoise. Le crépuscule des dieux et ses tintamarres wagnériens n’expliquent donc rien du tout. En revanche, l’intrusion de l’inconscient sur les divans de Vienne ou de Christiania, ou à la Salpêtrière, a peut-être joué pour l’expressionnisme le rôle qu’avait tenu le destin dans la tragédie grecque. Le terme doit être entendu ici dans son acception clinique. « La sueur par expression, écrit Littré, se dit des gouttes de sueur qui se montrent sur la face de ceux qui souffrent une angoisse extrême, et, particulièrement, sur celle des agonisants. » Voici la scène originaire de la genèse expressionniste, qui va faire de la culpabilité et de l’agonie les supports de l’expression, grossie démesurément par l’emphase dramatique du style. Le corps est né pour se désarticuler. L’optique découpe ses cadrages cruels. Dans ce musée imaginaire de l’horreur bien réelle – celle de la société – prennent place les nus d’Egon Schiele ou les cadavres de Gottfried Benn. Brecht en plaisantera plus tard : « Les petits cris méchants des damnés me soulagent. »
L’expressionnisme a poussé jusqu’à la caricature l’idée romantique d’une modernité qui creuse son tombeau et organise son propre suicide. Comme dans L’Homme sans qualités de Musil, tout commence par une dépression météorologique et un accident de voiture. Les expressionnistes, fascinés et épouvantés par les rythmes de la ville et de la technique, rêvent d’apocalypse et de régénération et veulent détruire au marteau le confort bourgeois, sa dignité rationnelle et ses artifices. Entre 1909 et 1918, l’Allemagne intellectuelle et artistique est radicalement mise en question par l’expressionnisme, l’une des premières avant-gardes artistiques et littéraires avec le futurisme. Les manifestes belliqueux se succèdent en un tourbillon de paroles. Symboliquement, l’une des revues majeures du mouvement se nomme Der Sturm (l’orage, l’assaut). Une nouvelle poésie, relevant à la fois du théâtre et du cabaret, exprime violemment les instincts et les pulsions obscures, en « un soulèvement éruptif de haine, d’extase, en une soif d’humanité nouvelle et un langage qui vole en éclats pour faire voler en éclats le monde » (Gottfried Benn). Il s’agit pour l’expressionnisme d’en finir, par la violence s’il le faut, avec la langue des maîtres, des arts, des armes et des lois, et de couper le cordon avec la « mère », langue des écrivains ou nature des peintres.
Le nihilisme des expressionnistes s’exerce donc aussi contre la forme bourgeoise. Cette volonté de renouveau esthétique et d’orages stylistiques les conduit à s’émanciper de l’anecdote, du sujet. Même si la peinture ou, à plus forte raison, le théâtre expressionnistes restent souvent tributaires de la figuration, leur visée est tout autre : la figure n’est pour l’expressionniste qu’un moyen de trouer le réel, de le désosser et de l’autopsier comme dans les corps décomposés de Benn, et de scruter le visible si loin qu’il se dissout et se transmue, tel l’Ange de Rilke, en Invisible. Or, paradoxalement, cet idéalisme frénétique va de pair avec une réflexion sur le matériau, la technique et les conditions de l’art et avec une virtuosité rarement poussée aussi loin, comme en témoignent la renaissance du bois gravé, les réformes scéniques d’Appia, ou, dans le roman, le refus de la convention psychologique, par exemple dans l’Assassinat d’une renoncule, de Döblin. L’expressionnisme a donc mis en pièces la mimèsis aristotélicienne, telle qu’elle perdurait dans le naturalisme ou la peinture impressionniste. L’imitation de la nature a fait son temps, l’abstraction peut naître, et, avec elle, l’art moderne : c’est un expressionniste, Kandinsky, qui invente l’abstraction dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Comment est survenue cette rupture ? « Pour l’impressionnisme, écrit Paul Klee, le point décisif de la genèse de l’œuvre, c’est l’instant récepteur de l’impression de nature ; pour l’expressionnisme, celui, ultérieur, où l’impression reçue est rendue, dans une combinaison nouvelle. »
Ces révolutions poétiques, qui ne sont pas formelles comme l’a cru Lukács, débouchent sur l’idée d’une synthèse des arts. Kandinsky, Kokoschka, Schönberg, pour ne citer qu’eux, ne se sont pas limités à leur médium spécifique. Il s’agit d’ailleurs d’une synthèse morcelée, à l’image de l’époque, et non d’un fantasme de synthèse totalisante comme chez Wagner. L’irruption d’un nouvel opérateur esthétique, le montage, concept clé de la modernité, introduit à la même époque par Freud dans la théorie des pulsions, permet de réaliser cette synthèse détonante. Une telle fusion des arts se heurte toutefois à des échecs, puisque l’expressionnisme n’a pas su construire un théâtre ou un cinéma parfaits sur la scène desquels il aurait pu s’inscrire : Wedekind n’est en effet qu’un précurseur du mouvement, et Brecht, malgré ses pièces de jeunesse, en fut le critique le plus acerbe, même s’il défendit l’originalité esthétique des expressionnistes face aux positions conformistes de Lukács ou des fonctionnaires marxistes.
En fin de compte, les expressionnistes ont cru à la force du mot et de l’art, et à la toute-puissance des idées qui devaient assurer le succès de leur rébellion. Ils ont été des chercheurs – d’arrière-monde, certes –, mais faustiens ; des fanatiques, certes, mais libertins et prolifiques. L’écrasement de la révolution allemande, spartakiste ou bavaroise, dans laquelle ils s’étaient engagés en grand nombre, porte un coup fatal à leur idéalisme. D’autres avant-gardes, comme Dada, la « nouvelle objectivité » ou l’« art prolétarien » vont en finir avec lui dès les années 1920. Mais tous les détracteurs de l’expressionnisme lui doivent tant, qu’ils sont en réalité ses héritiers et ses débiteurs. Car l’expressionnisme est double : obsédé par les tourments de l’intériorité et du passé romantique, il est, en Allemagne, le dernier cri de la subjectivité et de cet individu qui, selon Hofmannsthal, est mort dans les tranchées de la Grande Guerre. Saisissant l’avenir, l’expressionnisme inaugure une ère nouvelle, âge de l’abstraction et d’un art transgresseur de ses limites, dissolvant le sujet. Bref, l’expressionnisme, malgré ses nostalgies, si sensibles chez Benn par exemple, et qui expliquent la conversion de certains de ses adeptes au nazisme, a mis du vin neuf dans les fûts neufs. Idéologie pour les marxistes officiels, dégénérescence pour les nazis (sauf pour Goebbels, qui fut tenté d’annexer le mouvement à la politique « aryenne », comme Mussolini l’avait fait du futurisme en Italie, mais qui en fut dissuadé par Hitler), l’expressionnisme agonise tout au long des années 1920. Le IIIe Reich ne fera disparaître qu’un cadavre. La biographie des expressionnistes majeurs est d’ailleurs un long martyrologe de la création, du nihilisme et de la persécution : suicidés, internés, exterminés dans les camps de Hitler ou de Staline, morts d’accidents comme dans une série noire de passages à l’acte, les expressionnistes allemands ont pourtant, dans leurs rapides existences convulsives, mis l’art moderne à la question, et en ont exprimé l’angoisse et les secrets.
Jérôme BINDÉ
1. Arts
En 1919, le marchand de tableaux Daniel-Henry Kahnweiler s’en prend dans la revue Das Kunstblatt, sous le pseudonyme de Daniel Henry, à l’idée de plus en plus répandue en Allemagne que l’expressionnisme, alors prétexte à d’innombrables articles dans la presse allemande, serait d’origine française. Émigré de Stuttgart à Paris en 1907, promoteur de la peinture cubiste, il se prononce en connaissance de cause. Le mot, indique-il, n’est pas en usage en France, où les critiques d’art n’accordent aucune place à la notion qu’il est censé recouvrir.
Certes, un Français tombé dans l’oubli, Julien-Auguste Hervé, a proposé en 1901, au Salon des indépendants, huit tableaux sous l’appellation Expressionnismes. Mais son néologisme est resté sans suite. Il n’avait aucunement le projet d’inventer un courant esthétique. Il ne visait qu’à dégager avec intensité, au moyen d’une symbolique appuyée, le sens qu’il prétendait donner aux scènes typiquement urbaines qu’il peignait.
Et dans les pays de langue anglaise ? Si le terme est attesté au XIXe siècle, il est tellement rare que son incidence sociale a été nulle. En Grande-Bretagne, deux emplois en tout et pour tout. Un article anonyme du Tait’s Edinburgh Magazine rapporte en 1850 l’émergence d’une « école expressionniste » en peinture ; estampille inconsistante, qui a vite disparu. En 1880, par ailleurs, l’homme d’affaires et mécène Charles Rowley aurait évoqué, dans une conférence à Manchester, l’existence d’une « aile expressionniste » parmi les peintres britanniques contemporains. Il aurait désigné par là des artistes attachés à transmettre leurs émotions et leurs passions. L’avenir n’en a rien retenu. Aux États-Unis, enfin, une seule trace, peu susceptible de postérité puisqu’elle est présente dans une œuvre d’imagination. En 1878, le critique d’art Charles de Kay, dans The Bohemian, un roman satirique, met en scène de jeunes écrivains exaltés qui, à New York, se sont baptisés « expressionnistes ».
En définitive, c’est en Allemagne que le mot « expressionnisme » bénéficie peu avant 1914, sous sa forme Expressionismus, d’une destinée singulière. L’origine de sa vogue fut bien la France, contrairement à ce que supposait Kahnweiler, mais par un chemin qu’il ignorait. En 1911, à Berlin, lors de l’exposition annuelle de la Sécession, d’avril à septembre, quelques peintures d’artistes ont été rassemblées dans une salle sous l’étiquette Expressionnistes français. Entre autres, Braque, Derain, Dufy, Marquet, Picasso, Van Dongen, Vlaminck y sont regroupés à leur insu. Le président de la Sécession en personne, le peintre impressionniste Lovis Corinth, s’en est déclaré l’initiateur. D’après la rumeur, il aurait été conseillé par un artiste allemand qui avait fréquenté l’atelier de Matisse.
Toujours est-il que le label adopté s’est répandu rapidement et abondamment à partir de mai 1911, grâce aux comptes rendus de cette exposition. Dans la revue qu’il dirigeait, Kunst und Künstler, traditionnel soutien des impressionnistes, Karl Scheffler s’étonne, en juin 1911, de voir des artistes français s’afficher sous une dénomination qu’il juge extravagante. Dénomination, relève-t-il avec aigreur, qu’on trouve maintenant dans la bouche de tous les snobs qui se rassasient de formules vides.
Dans le domaine de la littérature, l’emploi du mot fut parallèle à son apparition dans le vocabulaire des arts plastiques. En juillet 1911, dans le supplément littéraire du quotidien Heidelberger Zeitung, Kurt Hiller, jeune écrivain de formation philosophique, stigmatise les « esthètes » qui se bornent à enregistrer des « impressions ». Il oppose à ces « impressionnistes » la génération nouvelle des « expressionnistes » à laquelle il est fier d’appartenir, celle d’Alfred Döblin, de Franz Kafka, de Franz Werfel, et qui, dédaignant le factice, met en jeu par l’écriture le fond même de l’existence.
• L’opposition à l’impressionnisme
En quelques mois, l’expressionnisme est perçu de tous côtés avec une signification particulière : il passe pour une réaction contre l’impressionnisme et, plus généralement, contre les conceptions anciennes attribuant à l’art une fonction d’imitation de la nature. Cette option « antinaturaliste », laissant place avant tout à la vertu démiurgique de la subjectivité, à l’invention créatrice, et récusant toute volonté de « reproduction » du réel, s’impose en tant que ligne d’orientation émanant de la nouvelle qualification.
Le succès de cette appellation est explicable par l’état de la peinture en Allemagne. En dépit des initiatives de galeries privées, comme Gurlitt à Berlin, qui présente des tableaux de peintres impressionnistes français dès 1887, l’art dominant, par le biais de l’enseignement et des Salons, est en effet un art académique. Il bénéficie de la protection de l’empereur et de son entourage. Non seulement Guillaume II attribue les commandes, distribue les récompenses, mais il se pique, omnipotent et omniscient, d’être un connaisseur.
Les atteintes à la suprématie de cet art officiel datent des années 1890, avec l’apparition des Sécessions. La première est fondée à Munich en 1892 pour contrecarrer l’apathie de la Société des amis des arts, et surtout l’arbitraire de son système de sélection. Elle libère les artistes de leur sujétion au style de la peinture de genre, historique et allégorique. Avec la création de la Sécession berlinoise, en 1898, grâce à ses membres influents que sont Lovis Corinth, Walter Leistikow, Max Liebermann, Max Slevogt, le programme se fait beaucoup plus combatif. En 1900, la Sécession expose une quarantaine de peintres étrangers, dont Pissarro, Renoir, Whistler.
Ulcéré, Guillaume II intervient résolument contre ces audaces, qu’il s’applique à vitupérer publiquement. Pour l’amateur de pacotille qu’il est, une pacotille exaltant les valeurs morales et patriotiques, quand sont outrepassées les règles qu’il a lui-même fixées, le résultat ne peut être qu’un « art de caniveau ». Les sécessionnistes, considérés comme les « modernes », deviennent avec constance l’objet de ses blâmes.
Sur Paris, capitale de l’art en Europe, se projettent alors les aspirations de mécontents, pour qui ces conditions de création représentent des entraves à une expression originale. Le voyage à Paris, même bref, est l’expérience de beaucoup de jeunes Allemands de l’époque. Ainsi d’August Macke, de Franz Marc, de Max Pechstein, de Ludwig Meidner. Les Russes Kandinsky et Jawlensky, émigrés à Munich, exposent même au Salon d’automne de 1905, celui par lequel arrive le défi aux normes de l’harmonie, le fauvisme.
Des impressionnistes, qui n’ont pas brisé avec l’imitation de la nature, l’intérêt des jeunes artistes de l’Allemagne impériale se porte ainsi vers les récentes avant-gardes, qui remettent en cause radicalement leurs prédécesseurs. Au point que Kandinsky, avec sa compagne d’alors, Gabriele Münter, choisit de vivre à Paris plus d’un an, de mai 1906 à juin 1907. Il y retrouve l’une de ses anciennes élèves de Munich, l’artiste d’origine russe Elisabeth Epstein, qui le met en rapport avec Robert Delaunay. À partir de celui-ci, tout un réseau de relations franco-allemandes se développe ensuite de 1911 à 1914.
Significative d’un renoncement à l’admiration vouée aux impressionnistes est la référence insistante à Vincent Van Gogh. Plusieurs expositions l’ont rendu familier en Allemagne : la Sécession de Munich en 1901, la Sécession de Berlin en 1903, à Munich encore l’Association des artistes en 1904, à Dresde la galerie Arnold en 1905. Une édition de ses lettres à son frère Théo a été publiée en allemand en 1906. Apogée de l’enthousiasme qu’il suscite, l’exposition, à Cologne, de l’Union des amateurs d’art et des artistes d’Allemagne, le Sonderbund : trois salles lui sont consacrées, du 25 mai au 30 septembre 1912, rassemblant 110 tableaux.
Dans le catalogue, l’auteur de la Préface, Richard Reiche, souligne que ce qu’il appelle déjà nettement le « mouvement expressionniste » s’est formé sur les influences du postimpressionnisme français : « Si cette exposition internationale présentant des artistes allemands vivants tente de donner une vue d’ensemble du mouvement expressionniste, une section a pour objectif de montrer aussi, rétrospectivement, la base historique sur laquelle s’élabore cette peinture très discutée qui est celle d’aujourd’hui – l’œuvre de Vincent Van Gogh, de Paul Cézanne, de Paul Gauguin. »
L’opposition à l’impressionnisme est un élément constitutif des tendances nouvelles, comme l’a mis en évidence, deux ans auparavant, une polémique dans Kunst und Künstler. Deux dessins d’Emil Nolde y sont publiés, sans qu’il en ait été auparavant informé, à l’occasion de l’exposition d’art graphique de la Nouvelle Sécession à la galerie berlinoise Maximilian Macht. Aussitôt, Nolde adresse des remerciements au directeur de cette revue, mais en lui signalant qu’il désapprouve ses critères de valeur, lesquels critères, selon lui, reviennent à obtempérer aux goûts de Max Liebermann et à ne défendre que des « artistes vieille mode ». La « jeune génération », précise Nolde, ne supporte plus de voir les tableaux de Liebermann. Elle en est « saturée ». Elle considère que son œuvre, « pas seulement ses travaux actuels, mais pas mal de ses anciens », est « faible » et relève du « toc ».
À la suite de ce jugement tranchant, ressenti par les adeptes de l’impressionnisme et les sécessionnistes comme une provocation, Nolde fut exclu à la mi-décembre 1910 de la Sécession berlinoise. Son comité d’administration estima qu’il ne pouvait plus rester dans une organisation dont il vilipendait le président, alors que celui-ci avait été démocratiquement élu. Ce qui se révélait ainsi avec violence, c’était la fracture entre deux générations, c’est-à-dire entre deux conceptions esthétiques. Quant à Liebermann, il fut à ce point ébranlé d’être relégué du côté de l’art du passé qu’il démissionna de son poste, laissant la place à son confrère et ami Lovis Corinth.
• Une génération en révolte
Pourquoi la contestation des valeurs établies prend-elle pareille ampleur ? Depuis l’avènement de Guillaume II, en 1888, à la tête de l’empire, aucun pays n’a connu un semblable essor économique. Cette transformation extrêmement rapide s’est accompagnée d’une forte poussée démographique. La population allemande a presque triplé en un siècle, passant d’une quarantaine de millions en 1871 à une cinquantaine au début du siècle, et à près de soixante-dix millions à la veille de la Première Guerre mondiale. La main-d’œuvre affluant vers les centres industriels, les villes ont crû en importance. Avec deux millions d’habitants, Berlin est devenu la métropole la plus moderne d’Europe.
En revanche, la société n’a guère changé dans son fonctionnement. Elle est antidémocratique et les structures féodales sont maintenues dans tous ses rouages. Avec, pour conséquence, l’éveil d’un malaise dans une grande partie de la jeunesse. Le devoir de discipline envers la patrie, la morale, le droit est ressenti comme inadapté et dépassé. À la tête de l’État, un empereur prétend régenter à peu près tout, et jusqu’au goût artistique de ses sujets. Peu à peu, la nouvelle génération intellectuelle est affectée d’une crise des valeurs. Devant les mentalités asservies à l’autorité, les fils entrent en révolte contre les pères.
Ce n’est pas un hasard si les nouveaux venus qui ambitionnent d’assurer la relève dans les arts plastiques, dans le théâtre, dans la poésie, sont des citadins. Bien que presque tous enfants de bourgeois, ils réagissent aux conséquences du surpeuplement. Le développement du prolétariat et ses conditions de vie, ses revendications politiques ne les laissent pas indifférents. Ils se rebellent contre la réalité et refusent l’asservissement de l’esprit. Ils battent en brèche le scientisme, le machinisme, la morale régnante. Ils veulent régénérer la condition humaine.
Dès 1914, tirant le bilan du bouillonnement intellectuel en cours dans les pays germaniques, l’écrivain autrichien Hermann Bahr montre, dans un essai, que celui-ci n’a pu s’articuler que sur un terrain social spécifique. Notre époque, écrit-il, tend à réduire l’homme à un « simple instrument ». Elle le plie aux exigences de la machine. Elle l’oblige à « être vécu », au lieu de le laisser vivre lui-même sa vie. Quelle était l’attitude habituelle de « l’impressionniste » ? Il se contentait d’être « le gramophone du monde extérieur ». Au contraire, l’homme de la nouvelle génération se sent humilié. Chez lui éclate le refus de la soumission : « Voici que des ténèbres s’élève son cri de détresse – un cri qui appelle à l’aide, qui appelle à l’Âme, à l’Esprit. Tel est, en art, ce qui est nommé Expressionnisme. »
Kurt Pinthus, l’auteur de la plus célèbre anthologie rassemblant les poètes dits « expressionnistes » en 1919, Crépuscule de l’Humanité, estime lui aussi que ces refus et ces aspirations sont à l’origine de l’avant-garde artistique et littéraire en Allemagne. À son avis, la protestation aurait pris simplement la forme d’un nouveau dandysme si elle n’avait d’abord été fondée sur une insatisfaction sociale : « On percevait de plus en plus distinctement l’impossibilité d’une Humanité qui s’était mise dans la dépendance absolue de sa propre création, de sa science, de la technique, de la statistique, du commerce et de l’industrie, d’un ordre communautaire pétrifié, d’usages bourgeois et conventionnels. »
• À Dresde, le groupe Die Brücke
Rétrospectivement, on voit que l’année charnière pour les premières manifestations de groupe contre le conformisme ambiant est 1905. Le 9 février meurt Adolph von Menzel. Réputé pour ses études sur l’impressionnisme français, Julius Meier-Graefe a évoqué, dans l’ouvrage qu’il a consacré au Développement historique de l’art moderne, le sens de son œuvre pour les Allemands de l’époque : « Menzel épuise notre réalité comme Delacroix notre rêve. Si complètement que les particularités proprement allemandes de l’Allemagne contemporaine, absorbées par Menzel comme une énorme éponge, n’ont pas les apparences d’une atmosphère locale, mais existent en tant que symbole universel. » Pour beaucoup de membres de la génération artistique encore en herbe, la disparition de Menzel équivaut à l’abrogation de son exemplarité tutélaire, en même temps qu’à l’enterrement de la peinture du XIXe siècle.
Tel est l’état d’esprit qui incite quelques mois plus tard, le 7 juin 1905, quatre étudiants en architecture à l’École technique supérieure de Dresde à s’associer en une communauté d’avant-garde, baptisée Die Brücke, ou Le Pont : Fritz Bleyl (1880-1966), Erich Heckel (1883-1970), Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976). La dénomination a été proposée par ce dernier. Pour lui, il s’agit d’un symbole. Un pont est le dispositif permettant le passage d’une rive à une autre, le moyen de s’évader vers un autre territoire, loin de toutes les contraintes imposées.
Le groupe initial s’enrichit en 1906 de Max Pechstein (1881-1955) et, pour un an seulement, d’Emil Nolde (1867-1956), qui a accepté de s’y intégrer sur la proposition de Schmidt-Rottluff. La tête pensante en est Kirchner, un peu plus âgé que ses camarades. Sur un bois gravé, il représente en 1905 une vue de Dresde : le pont de la reine Auguste, qui relie la ville ancienne à la ville nouvelle.
En 1906, Kirchner formule le programme du groupe qui, par les mots cette fois, synthétise la nécessité de passer ensemble de l’ancien au nouveau. En quelques lignes sont exprimés une volonté collective de rupture avec le passé et une exaltation de l’intuition créatrice : « Ayant foi en une évolution, en une génération nouvelle de créateurs et d’amateurs d’art, nous appelons la jeunesse entière à nous rejoindre, et parce que nous sommes la jeunesse porteuse de l’avenir nous voulons nous donner, face aux pouvoirs bien établis de nos prédécesseurs, la possibilité de vivre et de travailler en toute liberté. Sont avec nous tous ceux qui traduisent spontanément et sans altération ce par quoi ils sont poussés à créer. »
D’où vient que ces jeunes artistes choisissent une telle position ? Non de lectures philosophiques, mais de leur rejet d’une vie sociale sclérosée. Leur découverte des arts dits primitifs au musée ethnographique de Dresde a produit sur eux un choc. Pour annuler l’univers figé des conventions, des conformismes, des modèles académiques, leur objectif est de reconquérir un espace où il leur sera possible de renouer avec des valeurs authentiquement humaines, en communion avec la nature.
En 1911, malgré le succès de l’organisation qu’ils ont conçue pour favoriser la vente de leur production, Kirchner et Pechstein décident de quitter Dresde, ville engoncée dans une mentalité de province, pour Berlin. Ils y sont bientôt rejoints par leurs compagnons. Kirchner a l’intention d’y poursuivre l’activité collective de Die Brücke. Mais en 1912, Pechstein décide de rallier la Nouvelle Sécession. Il est alors exclu du groupe, qui ne tarde pas à se désagréger. Petit à petit, les divergences conduisent, en 1913, à sa dissolution officielle.
Dans son existence même, Die Brücke fut l’expression de l’humanité nouvelle à laquelle ses membres s’efforcèrent de parvenir : ils travaillaient ensemble et vivaient en communauté, partageant ateliers et matériel. Leur association fut réellement organique. C’est ce qui la différencie des regroupements de peintres, qui jusque-là se trouvaient plutôt rassemblés au hasard des circonstances, par la constatation, après coup, d’un style commun. Bleyl, Heckel, Kirchner et Schmidt-Rottluff furent unis beaucoup plus par un sentiment de révolte que par la volonté d’élaborer, à partir de principes solidement définis, une esthétique nouvelle. Toutefois, cette révolte se traduisait par une identité de vues devant l’art de l’époque, dans une opposition à son marché, ses valeurs, ses idéaux.
Leur apologie du « barbare » en peinture, du « sauvage », correspondait à leur désir de voir l’homme renouer avec sa nature élémentaire, afin d’accéder à sa vérité intérieure et de régénérer sa capacité d’émotion. Par la gravure sur bois, qu’ils pratiquèrent avec intensité, ils aspiraient à retrouver une création non commandée par des dogmes et modèles, à travers des procédés rudimentaires et des formes naïves.
• À Munich, Der Blaue Reiter
Autre lieu de focalisation des tentatives d’innovation artistique avant 1914, Munich. Dans cette ville d’art, les luttes ne sont pas moins âpres qu’à Dresde. En dehors de l’entourage de Jugend, la revue qui soutient l’Art 1900, l’académisme y règne depuis la fin du XIXe siècle. L’École des beaux-arts y est pourvue d’enseignants prestigieux : Franz von Stuck, Hugo von Habermann, Adolf von Hildebrand. Mais il s’agit d’artistes enfermés dans la routine de leur éminent savoir-faire.
En 1911,