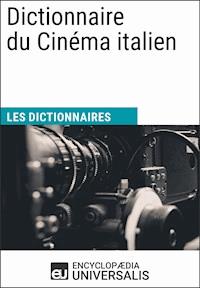
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Né en 1905, avec le tournage de La Prise de Rome, le cinéma italien a connu l'une des histoires les plus riches et les plus originales de la production mondiale. De Michelangelo Antonioni à Franco Zeffirelli, ce dictionnaire propose, en quelque quatre-vingts articles empruntés au fonds de l'Encyclopaedia Universalis, d'en parcourir les grandes étapes et de (re)découvrir, sous la conduite des meilleurs spécialistes, l'œuvre des artistes et créateurs qui lui ont assuré si grand et durable rayonnement.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852299467
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Ponsulak/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans le Dictionnaire du Cinéma italien, publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles du Dictionnaire à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
AMELIO GIANNI (1945- )
Né en Calabre en 1945, Gianni Amelio vient à Rome, attiré par le cinéma. Cinéphile passionné, il commence à réaliser des films pour la télévision en 1970. De nombreuses années de difficultés l’attendent avant qu’il ne soit reconnu, même si dès 1974 il est présent à Cannes avec La città del sole. Amelio aura été longtemps un créateur en proie au doute, ne parvenant pas à faire avancer ses projets les plus novateurs. Pendant cette période qui dure plus de dix ans et qui n’est que partiellement interrompue par Colpire al cuore (1982), le cinéaste accumule les expériences et les recherches. Il introduit aussi dans son œuvre un bagage culturel original, celui d’un homme du Sud hanté par le déracinement.
Dès son premier film, La fine del gioco, un moyen-métrage tourné en 16 mm, Gianni Amelio pose le problème des rapports entre le cinéma et son sujet – ici un jeune garçon accompagné par un éducateur vers un centre de redressement. Le second film, La città del sole, est apparemment très différent du premier. À la démarche documentaire succède la reconstitution historique et la tentative d’analyser, au travers d’une expérience passée, une problématique contemporaine. Œuvre métaphorique, le film s’interroge sur les liens qui existent entre l’utopie et l’action concrète. La città del sole s’inspire d’un ouvrage homonyme écrit au XVIe siècle par le moine dominicain Tommaso Campanella. Dans ce livre, le philosophe calabrais décrit un État imaginaire où règne un communisme intégral.
En 1975, Gianni Amelio réalise un documentaire sur le tournage de Novecento de Bernardo Bertolucci, Bertolucci secondo il cinema : inoubliable ouverture, avec la musique de Johnny Guitar et Sterling Hayden découvert en paysan émilien fauchant l’herbe d’un pré. Amelio saisit les contradiction d’un tournage qui confronte autobiographie et distance critique, réalité et artifice, film militant et coproduction à gros budget, paysans de la basse vallée du Pô et stars internationales.
Choisissant de tourner avec une caméra vidéo noir et blanc sans grande définition, le metteur en scène décrit dans La morte al lavoro (1978) le lent basculement dans l’irréalité d’un jeune homme vivant dans un appartement où s’est suicidé un acteur. Amelio enchaîne avec Effetti speciali (Effets spéciaux), vidéo expérimentale de 60 minutes réalisée en 1978, et Il piccolo Archimede, entreprise plus classique de long-métrage en 16 mm, produit par la R.A.I. en 1979.
En 1982, Colpire al cuore (Frapper au cœur) est présenté en compétition au festival de Venise. L’un des premiers, Gianni Amelio s’intéresse au problème du terrorisme et met en scène les relations ambiguës entre un fils et son père. Le fils d’un professeur d’université découvre que son père fréquente un couple d’étudiants terroristes. Le jeune homme les dénonce et provoque leur arrestation. Très bien accueilli, le film semble ouvrir à Amelio les voies du succès. Mais la faillite de Gaumont en Italie empêche la circulation normale du film, et Amelio est à nouveau confronté à de grandes difficultés. En 1983, il contribue à une série de films d’une heure inspirés d’œuvres d’écrivains italiens. I velieri (Les Voiliers), d’après Anna Banti, évoque de façon indirecte le thème du terrorisme avec l’histoire d’un adolescent enlevé lorsqu’il était tout enfant et qui a conservé de cet événement un unique souvenir, l’image d’un phare. En 1988, toujours pour la télévision, Amelio réalise I ragazzi di Via Panisperna (Les Jeunes Gens de la rue Panisperna) sur le groupe de chercheurs – notamment Bruno Pontecorvo (le frère de Gillo Pontecorvo) et Ettore Majorana, le physicien disparu en mer – qui autour d’Enrico Fermi fit progresser la connaissance de l’atome, dans les années 1930, en pleine période fasciste. Il faut attendre Portes ouvertes en 1990 pour que le cinéaste connaisse enfin le succès. Adapté d’un roman de Leonardo Sciascia et interprété par Gian Maria Volontè, le film est sélectionné pour les oscars et reçoit le Félix du meilleur film européen, distinction qu’obtiendra également Les Enfants volés. Dans ce film, qui se déroule lui aussi dans les années 1930, alors que le fascisme rétablit la peine capitale, Amelio prend position contre la peine de mort.
Avec Il ladro di bambini (Les Enfants volés), grand prix spécial du jury à Cannes en 1992, puis avec Lamerica, présenté à Venise en 1994, Amelio réalise deux œuvres majeures. Les Enfants volés reprend le thème de La fine del gioco : un carabinier emprunte une voie buissonnière pour conduire deux enfants – dont la mère est en prison – dans une école spécialisée. Lamerica décrit avec lucidité le passage de l’Albanie du communisme au libéralisme, et évoque le mirage d’un Occident perçu à l’Est comme une nouvelle Amérique que l’on rêve d’atteindre. Lion d’or du festival de Venise, Così ridevano (Mon Frère, 1998) aborde la thématique de l’émigration des Siciliens dans un Piémont industriel propice aux trafics mafieux. Soucieux de renouvellement, Amelio tourne ensuite en Allemagne Le chiavi di casa (Les Clefs de la maison, 2004), analyse poignante du handicap et du difficile apprentissage que doit accomplir un père pour accepter l’infirmité de son fils. C’est en Chine qu’il réalise La stella che non c’è (L’Étoile imaginaire, 2006), première tentative occidentale – en suivant le périple d’un technicien italien – de décrire les profonds changements que connaît la Chine contemporaine. Après avoir donné en 2012 une adaptation du roman posthume d’Albert Camus Le Premier Homme, Gianni Amelio poursuit son exploration des failles de notre société avec L’Intrepido, présenté à la Mostra de Venise 2013.
Gianni Amelio est une des voix les plus authentiques du cinéma italien, et un des rares auteurs nés depuis 1945 à pouvoir s’imposer sur le plan international. Au côté de Nanni Moretti et Paolo Sorrentino, il représente le meilleur d’une production transalpine qui se trouve souvent en porte à faux par rapport à un passé trop prestigieux.
Jean A. GILI
AMIDEI SERGIO (1904-1981)
Nous évaluons assez mal en France les mécanismes de la production cinématographique italienne, peu structurée de façon durable, notamment en ce qui concerne la place des scénaristes et surtout celle des soggiotori (« créateurs de sujets ») dont il n’y a guère d’équivalents ailleurs. Sergio Amidei a ainsi joué un rôle capital, et, à travers sa longue et diverse carrière, c’est tout le cinéma italien depuis les années 1940 qui, en fait, défile devant nous.
Né à Trieste alors que cette ville était encore austro-hongroise, il émigre avec joie en terre italienne comme il avait accueilli avec joie, adolescent, le rattachement de sa ville natale à l’Italie. En 1924, il est engagé à Turin comme figurant dans Maciste aux enfers, de Guido Brignone. D’étudiant qu’il était, il se retrouve bientôt assistant-réalisateur d’une série de Maciste puis de diverses comédies, tournées notamment à Nice et à Paris (il est mal vu du régime fasciste). En 1936, toutefois, il est à Rome et fournit à Goffredi Alessandrini le sujet d’un film, Don Bosco, ce qui fait de lui le scénariste (pas toujours présent au générique) d’une série de films de R. Freda, M. Bonnard, C. Mastrocinque, et de Mario Camerini (T’amero sempre, version de 1944).
En 1945, se produit l’événement décisif de sa vie : Amidei fournit à Rossellini le sujet de Rome ville ouverte. Il va collaborer, plus ou moins étroitement, aux scénarios de tous ses films ultérieurs, de Paisà à Stromboli, ainsi qu’avec Zavattini pour le scénario de Sciuscià de V. De Sica (1946). Cette insertion enthousiaste dans le néoréalisme se complète en 1950 quand Amidei assure la production de Dimanche d’août de Luciano Emmer, film dont il a eu l’idée.
Sans cesser d’être l’un des scénaristes les plus actifs de l’Italie (quelque 75 films, la plupart en collaboration), Amidei s’intéressera encore épisodiquement à la production, dans des sociétés éphémères. La carrière d’Alberto Sordi, dont il est l’ami de très longue date, lui doit également beaucoup. S’il est resté fidèle à Rossellini (La Peur, 1954 ; Le Général Della Rovere, 1959) et à Luciano Emmer, il a aussi signé des scripts pour Gianni Franciolini (Les Amants de la villa Borghese, 1953), Antonio Pietrangeli (Joyeux Fantômes, 1960), Luigi Zampa (Les Années rugissantes, 1962), Carlo Lizzani (Chronique des pauvres amants, 1954 ; Le Procès de Vérone, 1963). Une production qui reflète le progressif éparpillement du cinéma transalpin depuis la retombée du néo-réalisme. Après une courte interruption entre 1972 et 1977, il « reprend du service » et signe le scénario d’Un bourgeois petit, petit, de Mario Monicelli (1977) et de Contes de la folie ordinaire, de Marco Ferreri (1980), d’après les nouvelles de Charles Bukowski. Il meurt pendant la préparation de La Fuite à Varennes dont il avait écrit le scénario avec le réalisateur Ettore Scola. Désabusé, il déclarait peu avant : « Les raisons de la crise du cinéma italien remontent très loin, les hommes politiques et même les Italiens n’aiment plus depuis longtemps le cinéma italien. »
Gérard LEGRAND
ANTONIONI MICHELANGELO (1912-2007)
Il y a dans chaque culture nationale comme dans chaque moyen d’expression des moments ou des personnes qui semblent être des points de convergence. Ainsi des œuvres incarnent et propulsent en même temps certains changements culturels collectifs, si bien que l’itinéraire de leur auteur tend peut-être injustement à décevoir après coup, lorsqu’il vient s’insérer dans un courant plus régulier. Au même titre que l’œuvre de Bergman ou de Resnais, celle de Michelangelo Antonioni est marquée par un tel cheminement intellectuel.
• Les premiers films
Né en 1912 à Ferrare, Antonioni entre dans la profession en 1942 comme assistant de Marcel Carné pour Les Visiteurs du soir ; jusqu’à 1950, il collabore à quelques scénarios et réalise des courts-métrages qui ne sont pas indifférents. C’est l’époque où le cinéma italien connaît la flambée du néo-réalisme fortement marqué à gauche, et qui, prôné ou contredit, influencera profondément toute la vie culturelle italienne de l’époque. Les deux premiers courts-métrages d’Antonioni, Gente del Pò (1943-1947) et N.U. (1948, c’est-à-dire Nettezza urbana ; il s’agit d’un documentaire sur les éboueurs), s’inscrivent directement dans ce mouvement néo-réaliste tandis que La Villa dei mostri (1950, documentaire sur le parc aux rochers sculptés de Bomarzo) témoigne de son ouverture à un certain fantastique.
En 1950, la culture italienne a déjà entamé sa déprovincialisation. Face au cinéma traditionnel (les mélos, les drames et les comédies), d’ailleurs nullement méprisable et fort populaire, le néo-réalisme, s’il ne remporte pas dans la péninsule de grands succès publics, apporte une vision plus ouverte au monde et contribue à faire connaître le cinéma italien à l’étranger. Depuis déjà quelques années, les écrivains américains ont été publiés en Italie grâce à Pavese et à Vittorini, et l’emphase d’annunzienne ne paraît plus obligatoirement liée à l’expression écrite italienne. C’est dans ce nouveau contexte qu’Antonioni produit en 1950 son premier long-métrage, Chronique d’un amour.
Comme il avait influencé le premier film de Visconti Ossessione, le « film noir » américain a certainement inspiré cette histoire – devenue traditionnelle depuis Thérèse Raquin et américanisée par James Cain avec Assurance sur la mort et Le facteur sonne toujours deux fois – d’une femme et d’un amant qui veulent supprimer le mari. Stylistiquement, en revanche, on distingue l’admiration du débutant pour le Laura de Preminger et pour Les Dames du bois de Boulogne de Bresson. La technique du plan-séquence triomphe en effet dans Chronique d’un amour. Ce style, que certains voulurent théoriser (alors que ses plus grands utilisateurs, Welles comme Preminger, Bresson comme Antonioni, Mizogushi comme Hitchcock, ne s’y enfermèrent jamais), procure au récit une fluidité, une aisance plus romanesque, et permet aussi une plus grande pudeur, un understatement fort anglo-saxon. Il nous est possible de distinguer avec l’éloignement combien est grande la postérité de Chronique d’un amour. Si, en effet, Lucia Bosé, qui interprète l’héroïne du film, ne peut nier sa dette à l’égard de la Louise Brooks des films de Pabst, elle a, à son tour, inspiré l’héroïne de L’Année dernière à Marienbad, de Resnais et Robbe-Grillet. Et il convient aussi de citer Bardem, Maselli et Kast au nombre des cinéastes les plus directement marqués par cette histoire policière. Plus récemment, si le cinéaste Jia Zhanke, pour Still Life (Chine, 2006), s’inspire du peintre Liu Xiaodong, il serait étonnant que pour décrire le barrage des Trois Gorges ni le peintre ni le cinéaste n’aient connu les images déshumanisées de L’Éclipse ou du Désert rouge. On oubliera miséricordieusement de nombreux cinéastes sans talent qui ont essayé de « faire de l’Antonioni » comme d’autres « faisaient du Godard ».
Tandis que I Vinti (1952), film à sketches, retrace le « malaise » de la jeunesse de l’époque (mais son sketch inspiré du fait-divers notoire des « J3 de Malnoue » est alors interdit en France), La Signora senza camelie (1953) est un portrait de la profession de cinéaste, en Italie, à ce moment-là, mais des conventions mélodramatiques (l’auteur, isolé et génial, face aux contraintes dégradantes du commerce) affaiblissent le film. Tourné pour un film collectif, L’Amore in città (1953), l’épisode « Tentato suicidio » est plus intéressant : Antonioni y inaugure en effet une méthode de « cinéma direct » où le cinéaste se fait à la fois détective et psychiatre pour interroger des femmes qui ont essayé de se tuer.
Dans Le Amiche (Femmes entre elles), Antonioni adapte, en 1955, un récit de Pavese, « Entre femmes seules », tiré du Bel Été. Tout en restant plus fidèle que jamais au plan-séquence, il réalise le film peut-être le plus parfait et le plus beau de son œuvre. Dans cette structure des rapports amicaux et sentimentaux, des haines et des rivalités qui traversent un groupe de femmes de la bourgeoisie turinoise, Antonioni réalise, comme dans Chronique d’un amour, la synthèse des apports anglo-saxon et français tout en rendant un hommage sans flagornerie à Pavese, bien qu’il n’ait jamais éprouvé à l’égard de la femme les sentiments de panique et de fascination que ressentit, jusqu’au suicide, l’écrivain. Pour Antonioni, la femme est en effet un être plus fort, plus intelligent, plus équilibré que l’homme, et non, comme pour Pavese, l’incarnation de l’ombre, de l’irrationnel, de l’inconnu.
Après ce film, intervient dans la vie du cinéaste un changement profond : sa femme, Letizia, le quitte. Il Grido (1957) peut être vu comme le plus déchirant des cris de douleur d’un artiste pourtant secret et avare de confidences. Le film, qui présente l’errance d’un ouvrier, abandonné par celle qu’il aime, dans le décor de la grise plaine du Pô, est une œuvre étrange et forte, qui n’a pas le caractère de pure beauté classique du film précédent, mais dont la séduction austère demeurera.
• Le vertige dans l’image
Aucun des films d’Antonioni n’a, jusqu’alors, connu de succès commercial, et il a dû, pour vivre, effectuer des travaux non signés, dirigeant par exemple la seconde équipe de nombreux péplums.
Après avoir rencontré Monica Vitti, il parvient néanmoins en 1959, malgré mille difficultés, à réaliser L’Avventura qui fera sensation au festival de Cannes cette année-là. Avec La Notte (1960), L’Eclisse (1962) et Il Deserto rosso (1964), il va faire tourner Monica Vitti dans quatre œuvres qui lui vaudront une notoriété internationale. Ces quatre films se caractérisent par un changement de style : Antonioni renonce au plan-séquence et n’hésite plus à recourir fréquemment aux gros plans et aux contrechamps ; le thème aussi est le même dans ces quatre œuvres : l’incommunicabilité et le désarroi de l’homme qui découvre que ses règles morales sont dépassées par l’évolution du monde. Les critiques cessent de citer perpétuellement Pavese (ce qui agaçait Antonioni) et, plus justement, évoquent Fitzgerald, Adorno ou Musil. Les films ont un souffle plus ample, le récit s’étend plus volontiers dans des digressions plastiques comme la séquence baroque sur la ville de Noto, en Sicile, dans L’Avventura, le finale de L’Éclipse, qui ne montre que des objets ou des lieux déserts (la référence picturale est ici Giorgio De Chirico), ou les paysages désolés de la zone industrielle de Ravenne dans Le Désert rouge.
Antonioni accède au rang de grand cinéaste international tandis que Monica Vitti entame, de son côté, une carrière de star comique. Avec Blow-up, policier psychologique anglais (1966), Zabriskie Point, essai romancé sur la « rage de vivre » d’un jeune Américain (1970), Chung Kuo (1972 ; La Chine, reportage qui connaîtra quelques mécomptes en raison des vicissitudes de la « révolution culturelle » maoïste) et Profession reporter (1975), attachant portrait d’un « perdant » incarné par Jack Nicholson, Antonioni nous donne alors des films séduisants et personnels, où l’on retrouve de discrets rappels des thèmes des premières œuvres, mais qui ne jouent plus le rôle de catalyseur de la culture européenne.
À noter toutefois qu’avec Il Mistero di Oberwald (1980), tiré de L’Aigle à deux têtes, de Cocteau, il est parmi les premiers à réaliser un film de fiction, de long-métrage, en vidéo. Ensuite, pour l’exploitation en salle, l’image électronique sera « recopiée » sur pellicule. Le résultat est plus curieux que convaincant. Avec Identificazione di una donna (1982) , il revient au style classique, avec une belle histoire d’amour. C’est alors qu’il rencontre celle qui sera sa dernière compagne, Enrica.
En 1985, un accident cérébral grave contraint Antonioni à l’inaction, jusqu’à ce qu’il puisse, malgré sa condition physique, revenir à la mise en scène, avec l’aide de Wim Wenders pour Par-delà les nuages (1995), puis, en 1994, pour Eros (2004, les autres épisodes étant signés Wong Kar-wai et Steven Soderbergh). Que dire de ces derniers films ? Antonioni semble reproduire ici les dernières années de Luchino Visconti, avec cet acharnement à travailler, infiniment respectable, et qui prolongea sans doute son existence ; une vision exhaustive de son œuvre ne pourra les supprimer, mais ils ne sont nullement indispensables à sa grandeur créatrice – alors que ses courts-métrages initiaux, moins connus, le sont.
Sa dernière apparition publique peut être datée de l’automne 2006, lorsqu’il assiste à l’exposition de ses tableaux en plein centre de Rome. Le palazzo ancien qui abrite cette exposition, près du Panthéon, aujourd’hui utilisé comme musée, fut naguère affecté à la Bourse de Rome, et c’est là qu’Antonioni tourna plusieurs scènes de L’Éclipse (1962). Il meurt le 30 juillet 2007.
• Une œuvre aux multiples facettes
Comme plusieurs grands cinéastes, Antonioni, au moment de son décès, a fait l’objet d’études et d’hommages divers. Les appréciations de son œuvre relèvent évidemment de la liberté critique, mais peut-être, objectivement, sont-elles trop influencées par la renommée : il est courant d’entendre dire que l’œuvre d’Antonioni ne commence vraiment qu’avec L’Avventura. Ce qui est exact, c’est que ce fut là le début de sa célébrité internationale. On a aussi tendance à montrer une certaine unanimité : c’est oublier que le cinéaste eut bien de la peine à réaliser les films qu’il désirait, que l’Avventura fut hué à Cannes, que des cinéastes éminents comme François Truffaut ou Orson Welles n’ont jamais caché leurs plus sévères réserves sur son œuvre. On peut rappeler sa période de formation, ses documentaires, comme Gente del Po, par exemple : mais il faut mentionner que ce film a été considéré, au même titre que l’Ossessione de Visconti, comme une œuvre fondatrice de l’école néo-réaliste. Là encore il est important de rappeler sa période de formation. Antonioni a fait partie de ce groupe de jeunes gens fous de cinéma, influencés par le Parti communiste italien (clandestin), qui se regroupaient autour de la revue Cinema dirigée par Vittorio Mussolini – ce dernier étant à la fois fasciné par leur potentiel de création, et désireux comme eux de faire un cinéma italien qui tienne tête aux autres productions nationales. C’est de ce groupe (où figuraient notamment Visconti, De Santis ...) que naîtra le néo-réalisme. Le jeune Antonioni ne fut pas uniquement influencé par ses collègues, il collabora aussi au scénario du film fasciste de Rossellini, Un pilota ritorna. Car bien des cinéastes italiens de cette époque ont vécu leurs années d’apprentissage sous le régime mussolinien... Ce fut le cas pour Fellini ou pour Risi, il serait vain de le leur reprocher aujourd’hui.
Ainsi, l’examen de l’œuvre d’Antonioni, avec ses multiples facettes, ne peut se borner à la partie la plus importante, celle des longs-métrages de fiction. Il y a sa vision documentariste (ses débuts, mais aussi son film sur la Chine), ses travaux « alimentaires » (ce film de commande sur Soraya en 1965, Le Bout d’essai, épisode du film collectif Les Trois Visages), ou ses tâches de réalisateur de seconde équipe pour Lattuada ou Brignone. Il y a ses apparitions dans de longs interviews télévisés – qui nous le montrent plein d’humour (comme dans le film de 1966 de Gianfranco Mingozzi, Michelangelo Antonioni, storia di un autore). Il y a ses tableaux, ses quelques rares livres. Antonioni, dans sa complexité, dans son œuvre comme dans les rapports parfois épineux qu’il entretint avec la société qui l’entourait, reste l’un des grands inventeurs de forme du XXe siècle.
Paul Louis THIRARD
Courts-métrages
Gente del Po, 1943-1947 ; N.U., 1948 ; L’Amorosa menzogna, 1948-1949 ; Superstizione, 1949 ; Sette Canne un vestito, 1949 ; La Funivia del Faloria, 1950, La Villa dei mostri, 1950 ; Khumba mela, 1989 ; 12 registi per 12 città ; 1989. Noto, Mandorli, Vulcano, Stromboli, Carnevale, 1993 ; Destination Verna, 2000 ; Lo Sguardo di Michelangelo, 2004.Longs-métrages
Cronaca di un amore, 1950 (Chronique d’un amour) ; I Vinti, 1952 ; La Signora senza camelie, 1953 (La Dame sans camélias) ; Tentato Suicidio, 1953, épisode de L’Amore in città (L’Amour à la ville) ; Le Amiche, 1955 (Femmes entre elles) ; Il Grido, 1957 (Le Cri ou La Femme de sa vie) ; L’Avventura, 1959 (L’Aventure) ; La Notte 1960 (La Nuit) ; L’Eclisse, 1962 (L’Éclipse) ; Deserto rosso, 1964 (Le Désert rouge) ; I Tre Volti (épisode), 1965 ; Blow-up (1966) ; Zabriskie Point, 1969-1970 ; Chung Kuo, 1972 (La Chine) ; Profession reporter, 1975 ; Il Mistero di Oberwald, 1980 ; Identificazione di una donna, 1982 ; Par delà les nuages, 1995 ; Eros, 2004, co-réalisation.ARGENTO DARIO (1940- )
Né à Rome le 7 novembre 1940, Dario Argento est surtout réputé pour ses films policiers et d’horreur d’une grande violence, très efficaces, à la forme élaborée jusqu’à la sophistication.
Fils du producteur Salvatore Argento et d’une photographe de mode d’origine brésilienne spécialisée dans les portraits glamour d’actrices, Elda Luxando, son enfance est surtout marquée par des lectures déjà très orientées (Edgar Allan Poe) et une cinéphilie très populaire, allant du Fantôme de l’Opéra, d’Arthur Lubin (1943), dont il réalisera un remake en 1999, aux stars du cinéma italien, Sophia Loren ou Gina Lollobrigida, qu’il rencontre dans les studios de pose de sa mère avant de les admirer à l’écran. Après avoir abandonné le lycée, Dario Argento débute dans le journalisme à l’Araldo dello Spettacolo, magazine de spectacle local, puis comme critique pour le quotidien romain Paesa Sera. Il s’y fait remarquer par ses attaques contre la censure, son intérêt pour les acteurs, les films d’Elio Petri ou de Fritz Lang, son admiration pour Antonioni, qu’il rencontrera à la sortie de Blow up (1967). Il se passionne pour le western italien naissant (Pour une poignée de dollars, 1964), alors méprisé. Il collabore à partir de 1967 à plusieurs scénarios de westerns et de films de guerre. Crédité avec Bernardo Bertolucci comme co-auteur du sujet d’Il était une fois dans l’Ouest (1968), il semble qu’il ait moins apporté à Sergio Leone qu’il n’en ait tiré de leçons de forme : à savoir que le cinéma est avant tout affaire de temps, de rythme, et que l’auteur est « un personnage du film » qui doit faire « sentir sa présence ».
Son premier film est produit par son père qui crée la SEDA (Salvatore e Dario Argento), associé à Goffredo Lombardo, de l’importante firme Titanus. L’Oiseau aux plumes de cristal (1970) est un giallo, genre typiquement italien qui s’inspire des romans de gare des années 1920 à couverture jaune (giallo), et qui fut lancé au cinéma par Mario Bava avec La Fille qui en savait trop (1962). Il s’agit de films policiers à énigme reposant surtout sur la recherche de l’identité d’un tueur en série, agrémentés d’érotisme, voire de sadisme, de violence, et dont l’atmosphère tend au fantastique. À l’exception de Suspiria (1977), Inferno (1980) et de Le Fantôme de l’Opéra, tous les films d’Argento seront des gialli. Le héros de l’Oiseau aux plumes de cristal, un écrivain, assiste à un premier meurtre et mène son enquête. L’intrigue prend un tour pirandellien : qu’a réellement vu l’écrivain ? Ne serait-il pas le coupable ?... Qualifié de « polar-illusion », ce film au voyeurisme « chic et toc », aux références envahissantes (Mario Bava, Hitchcock, Lang...), n’en crée pas moins un climat de terreur envoûtante grâce au talent graphique du cinéaste et à ses cadrages « au rasoir ». En 1971, Le Chat à neuf queues et Quatre Mouches de velours gris manifestent la même indifférence à l’égard du scénario et de la vraisemblance, leur préférant les intrigues alambiquées et des morceaux de bravoure constitués d’images chocs aux effets violents à base de sang, de sexe, d’images graphiques et géométriques, dominées par la couleur rouge.
Les Frissons de l’angoisse (1975), qui ouvre la période la plus féconde d’Argento, quoique ouvertement inspiré par Blow up, auquel il emprunte son interprète David Hemmings et l’enquête sur les zones d’ombre d’une photographie, manifeste l’originalité et la radicalité de sa démarche. Au cœur du film, la suspicion sur la vérité de l’image, thème majeur d’une grande part du cinéma contemporain, comme celui de Brian De Palma. Avec Suspiria et plus encore Inferno, c’est très logiquement qu’un sujet de giallo vire au fantastique teinté de gore.
Depuis la fin des années 1960, l’Italie connaît les années de plomb, avec ses attentats, ses assassinats politiques (Aldo Moro en 1978), aboutissant à un climat de peur et de suspicion généralisée. Le sentiment paranoïaque qui sous-tend les films de Dario Argento est le produit de cette situation historique, tout comme sa volonté de créer un univers abstrait et poétique proche de celui d’Antonioni, qui, via le goût du maniérisme, rejoint Leone et Bertolucci. Après un relatif piétinement d’une dizaine d’années (Ténèbres, Phenomena, Trauma...), des films comme Le Syndrome de Stendhal (1986) et Le Fantôme de l’Opéra, tous deux interprétés par sa fille Asia Argento, actrice et réalisatrice, et fort mal accueillis, confirment la démarche poétique d’Argento qui a réalisé en 2007 La terza madre (Mother of Tears), troisième volet, après Suspiria et Inferno, d’une « trilogie des trois Mères » inspirée de l’écrivain Thomas De Quincey. Avec Giallo (2009), le metteur en scène revient à ses premières amours pour une nouvelle variation sur les pièges et les jeux de miroir du roman policier « à l’italienne ».
Joël MAGNY
BARUCHELLO GIANFRANCO (1924- )
Gianfranco Baruchello est un peintre, écrivain et cinéaste italien d’avant-garde né en 1924 à Livourne. Il obtient un doctorat de droit, et crée, très jeune, une entreprise de produits biochimiques qu’il abandonne définitivement en 1959, malgré sa réussite, pour se consacrer à la peinture. Après une première phase d’expérimentation « informelle », où il utilise un vernis noir sur la toile blanche, il choisit comme éléments premiers d’un vocabulaire de formes personnelles les pièces d’une turbine électrique qu’il démonte et auxquelles il donne des noms : Image-stimulation, Entité hostile, etc. En 1962-1963, il recouvre de blanc des livres, des journaux en pile : les Cimetières d’opinions, le Monument aux non-héros. Pour sa première exposition à New York, en 1964, il présente un ensemble de dessins de machines imaginaires sur plaques de plexiglas superposées.
Sa rencontre avec Marcel Duchamp en 1963 est décisive. Il lui consacre, avec Henry Martin, un livre publié aux États-Unis en 1985 : Why Duchamp ; c’est l’œuvre même de Duchamp, son extrême liberté, ses inventions qui vont lui servir de miroir, plutôt que de modèle, pour se découvrir lui-même. Baruchello, après avoir peint au minium, avec le doigt, les formes de son premier vocabulaire, va utiliser le hasard pour accomplir une œuvre considérable, où des images de petite dimension, accompagnées de textes écrits à la main, restituent le pullulement des événements qui l’intéressent dans tous les domaines : politique, social, scientifique, poétique, sans jamais les séparer du contexte quotidien de sa propre vie. Tableaux, dessins « vus de loin », qui exigent, contrairement à la plupart des tableaux modernes, d’être lus de tout près.
Au-delà de toute visée esthétique, Gianfranco Baruchello cherche à atteindre ce qu’il appelle la « beauté éthique ». Pour lui, l’exercice de la peinture se lie à une « soft-technology de la survie du moi », qui implique une résistance particulière à l’égard des formes les plus contraignantes de la société et du pouvoir. Il procède à l’enregistrement de ses propres rêves, dont il tire un récit qui le rapproche des écrivains italiens d’avant-garde : Les Aventures dans l’armoire de plexiglas (1968). Mais dès 1964, avec le film La Verifica incerta (La Vérification incertaine), projeté à Paris en 1965, il présente sa manière de travailler à partir d’images « déjà faites ». Ce film est en effet le produit du traitement qu’il fait subir à 150 000 mètres de pellicule au rebut, où le cinémascope hollywoodien, coupé d’abord en tranches arbitraires selon le système aléatoire des random numbers, est mis à nu par la répétition de ses stéréotypes : baisers languissants, portes qui s’ouvrent et se ferment sans cesse, scènes de violence, etc.
En 1968, il invente Artiflex, une société qui mime les procédés des sociétés industrielles, avec publicité dans les journaux, registres, tampons, etc. : elle se propose d’envoyer des « paquets-théâtre » (où les choses les plus insolites sont réunies) à ceux qui en feront la demande et finit par leur suggérer de placer des « petits capitaux à fonds perdu » dans « la gestion d’une machine distributrice de pistaches dans les rues de Pékin ». Plusieurs films en 16 millimètres, tournés à cette époque, Contraint à disparaître (1968), Normes pour les holocaustes (1969), etc., comptent parmi les œuvres les plus incisives du cinéma militant.
Pendant les années 1970, Baruchello entreprend d’appliquer à l’agriculture son éthique de « survie » : il fonde la société — réelle cette fois — Agricola Cornelia S.p.A., qui entend faire fructifier dix hectares de terres en friche à trente kilomètres de Rome, où il installe son atelier. Poussant jusqu’au bout la théorie duchampienne des ready-made, il en démonte le mécanisme en considérant des camions de betteraves à sucre comme des ready-made utiles. Des abeilles ayant constitué un essaim sauvage dans un des murs de cette maison-atelier labyrinthique, il en tire la leçon dans une suite de tableaux intitulés Le Miel de la peinture et en publiant aux États-Unis, avec la collaboration de Henry Martin, How to Imagine (Comment imaginer), où il rend compte de toute l’expérience qui consiste à lier agriculture et créativité.
Parallèlement, Gianfranco Baruchello conçoit de nombreuses boîtes vitrées, où il accumule, comme dans ses tableaux, des petites images, des cartes, des photos et des photocopies, des objets trouvés par hasard et des textes, qu’il consacre aux sujets les plus divers : la navigation en solitaire, la « grande bibliothèque de Babel », etc. : ce sont, pour la plupart, des jeux linguistiques mis en espace, comme dans de petits théâtres. Il concevra, en 1982, le décor du Rossignol de Stravinski pour le théâtre de la Scala à Milan en agrandissant au format de la scène l’une de ces boîtes.
Dans son livre Sentito vivere (Entendu vivre), qu’il fait paraître en 1978, Baruchello s’identifie à une licorne pour décrire en quarante-deux poèmes en prose quarante-deux tableaux qu’il aurait pu peindre. D’une manière très personnelle, cette « licorne » a accompli une œuvre qui dépasse toutes les catégories du réel et de l’imaginaire et qui anticipe, à elle seule, sur une ère « post-mass media ».
Alain JOUFFROY
BAVA MARIO (1914-1980)
Mario Bava s’est longtemps distingué, dans la cohorte des cinéastes italiens mineurs, comme « spécialiste du film fantastique », mais on peut s’interroger sur la validité de cette qualification. Né à San Remo, fils d’un sculpteur, il débuta par quelques courts-métrages, puis fut assistant de réalisateurs tels que Camerini, Soldati, Monicelli et Freda, tout en affirmant dès 1943 sa vocation de chef opérateur sur L’Avventura di Annabella de Luigi Menardi. Il appliqua son instinct photographique et sa science du décor au premier film qu’il réalisa comme metteur en scène, Le Masque du démon (La Maschera del demonio, 1960, avec Barbara Steele), film d’horreur « gothique » très réussi, et continua une carrière esthétiquement intéressante avec Hercule au centre de la Terre (Ercole al centro della Terra, 1961), « péplum » qu’on peut placer immédiatement après les meilleurs produits du genre. Mais, peut-être en raison d’un tempérament versatile, Bava n’a pas tardé à sacrifier la cohérence artistique de ses films à des effets dérisoires, liés à des entreprises purement commerciales. Sa renommée de grand photographe, qui lui avait valu de collaborer avec Raoul Walsh tournant en Italie Esther et le roi (Esther and the King, 1960) et de mettre lui-même en scène, semble-t-il, une partie du film d’Arthur Lubin, Les Mille et Une Nuits (Le Meraviglie di Aladino, 1962), n’a pas résisté à la dispersion de son travail. Il n’est pas exclu non plus que, formé au noir et blanc (Le Masque du démon joue avec bonheur de dominantes contrastées, moins expressionnistes d’ailleurs que veloutées), Bava se soit senti dans l’embarras devant les problèmes posés par la couleur. Il est passé (souvent sous le pseudonyme de John M. Old) du film policier (La fille qui en savait trop [La Ragazza che sapeva troppo], 1963) au film d’épouvante psychologique (Le Corps et le fouet [La Frusta e il corpo], 1962), sauvé partiellement par la présence de Dahlia Lavi ; Les Trois Visages de la peur (I Tre Volti della paura, 1963) et au western (La Strada di Fort Alamo, 1964). L’époque étant au mélange des genres, il concocta même un récit de science-fiction avec ingrédients d’horreur (Terrore nello spazio, 1965) ! En 1968, Diabolik (adaptation d’un célèbre photo-roman) fut une agréable surprise, où s’équilibraient humour, érotisme et « fantastique moderne ». Mais Bava est retombé, par la suite, dans sa routine chaotique, en dépit de quelques tentatives pour rediriger lui-même sa photographie, comme s’il y retrouvait ses racines et y sentait sa justification. Se pliant à la mode, il fait ruisseler le sang dans Un ’accetta per la luna di miele (1970) ou dans Gli Orrori del castello di Norimberga (1972), mais cette surenchère n’aboutit qu’à l’ennui. Parmi ses derniers films, il faut mentionner, à titre de curiosités, une adaptation de La Vénus d’Ille, de Mérimée, mais aussi La Maison de l’exorcisme (Il Diavolo e il morse, 1974), sous-produit hâtif et hétérogène de L’Exorciste de William Friedkin. À l’éparpillement ornemental de L’Île de l’épouvante (Cinque Bambole per la luna d’agosto, 1971), dernier film où Bava ait montré quelque élégance, s’ajoute ici la prétention. L’ambition évidente du petit-maître des débuts a fait place à la médiocrité du professionnel plat qui s’acharne à faire « son » film chaque année.
Gérard LEGRAND
BELLOCCHIO MARCO (1939- )
Contemporain de Bernardo Bertolucci, « provincial » influencé comme lui par Gramsci, Brecht et Godard, débutant en même temps que lui, Bellocchio a connu une évolution différente, plus confidentielle, plus austère aussi. Loin des succès internationaux, il construit une œuvre de révolté marqué par le sens de l’absolu et de la dérision. Passionné de psychanalyse, il a réalisé une œuvre profondément autobiographique, en empruntant les outils de la métaphore et sans aucun attendrissement sur soi.
Marco Bellocchio est né à Plaisance (Émilie-Romagne). Son père est avocat. Dernier avec son frère jumeau Camillo d’une famille de huit enfants, il fréquente les écoles religieuses et s’intéresse à la poésie, à la peinture, pense devenir acteur. Pendant ses études de cinéma au Centro Sperimentale de Rome (où il deviendra professeur en 1996), il réalise plusieurs courts-métrages où apparaissent les thèmes de la révolte en milieu étudiant, du « film dans le film », de la critique de la famille et de l’appel aux mythes antiques. Il écrit le scénario des Poings dans les poches à Londres, où il réside grâce à une bourse d’études, et réalise le film en 1965, principalement dans la maison de famille de sa mère à Bobbio. C’est le récit de la destruction et du meurtre des membres de sa famille par un jeune garçon épileptique. Le film, différent de la production habituelle, remporte un grand succès international. Son protagoniste, Lou Castel, sera longtemps l’alter ego de Bellocchio, et jouera dans Au nom du Père (1971) et Les Yeux, la Bouche (1982).
En 1967, La Chinoise de Godard et La Chine est proche de Bellocchio sont couronnés au festival de Venise. Ce second film, critique féroce de la bourgeoisie provinciale, évoque la tentation de l’inceste, de la révolution, l’opportunisme des sociaux-démocrates, que Bellocchio, alors proche des maoïstes, rejette, sans montrer pour autant d’indulgence envers l’extrême gauche. Bouleversé par le suicide en 1968 de son jumeau, il « se jette dans le militantisme », tourne de courts films commandés par l’« Union des communistes marxistes-léninistes d’Italie », comme Vive le 1er mai rouge et prolétarien (1969). En 1971, il retourne à son enfance avec Au nom du père, où il affirme que l’enseignement catholique ne vise même pas à former des consciences religieuses, mais simplement des « lâches », pacifiques et apolitiques. La présence de la comédienne Laura Betti dans le film rappelle le dialogue constant entre Pasolini et lui au cours de ces années.
Après l’échec esthétique de Viol en première page (1972), qui lui montre qu’il ne saurait faire de compromis avec le cinéma commercial, il tourne en 1975 un long reportage, Fous à délier, qui se situe dans la logique du mouvement antipsychiatrique. L’institution militaire est mise en cause à son tour dans La Marche triomphale (1976). Il retrouve Laura Betti pour une adaptation cinématographique de La Mouette de Tchekhov (1977).
Marco Bellocchio rencontre en 1977 le psychanalyste Massimo Fagioli, qui sera lié très intimement à tous ses films suivants. Suicide, solitude, révolte marquent Le Saut dans le vide (1980), Les Yeux, la bouche (1982) et l’adaptation d’Henri IV (1984) de Pirandello avec Marcello Mastroianni. Le scandale injustifié que provoque Le Diable au corps en 1986 remet un moment Bellocchio du côté du succès commercial, mais ses films suivants, La Sorcière (1988), Autour du désir (1991), Il Sogno della farfalla (1994) restent confidentiels, malgré une recherche esthétique et thématique toujours aussi rigoureuse. Le Prince de Hombourg (1997), adapté de Kleist, médite avec brio sur la culpabilité, la loi et l’institution. Avec La Nourrice (1999) et surtout Le Sourire de ma mère (2002) et Buongiorno, notte (2003), sa thématique de référence (le pouvoir, la folie, la famille) a pris un relief nouveau, lui permettant d’élargir le cercle de son audience. Il donne ensuite Vincere (2009), qui évoque l’ascension vers le pouvoir de Mussolini. Avec La Belle endormie(2012), le thème de l’euthanasie lui permet de décrire une nouvelle fois l’impossible dialogue entre l’Église et la société italienne.
La rigueur et l’intransigeance de Bellocchio sous-tendent ce que Bertolucci caractérisait à son propos, en décembre 1995, comme « l’amour (réciproque) de la beauté ».
René MARX
BENE CARMELO (1937-2002)
Né à Campi Salentina, dans les Pouilles, en 1937, Carmelo Bene débute à Rome en 1959 dans une interprétation très remarquée de Caligula d’Albert Camus, tant l’acteur y semble excéder les limites propres au travail de la simple interprétation. Grand inventeur et opérateur, depuis le début des années 1960, de ce qu’on appellera les cantine (caves) de Rome – une forme de l’underground théâtral qui s’imposera ensuite dans les années 1970 –, il imagine un théâtre qui, à la suite d’Artaud, tend à détruire l’expression dramaturgique conventionnelle. Tour à tour « monstre sacré » et « enfant terrible » de la scène italienne, il crée dès ses débuts une figure nouvelle qui concentre l’expression des différentes fonctions théâtrales : non seulement celle, toute-puissante, de l’acteur, mais aussi celles du metteur en scène, de l’auteur-adaptateur, du décorateur.
• Le théâtre déconstruit
Doté de possibilités physiques et vocales hors du commun, Bene s’attaque dès 1961 à de grands classiques de la scène ou de la littérature : ses « démons » préférés seront, d’une part, Pinocchio, de l’autre, Hamlet, deux moments emblématiques de sa redéfinition de l’acteur. Le premier permet de rejeter le projet humaniste du comédien et de confronter l’acteur à l’impossible mise en œuvre d’un « devenir-pantin ». Le second effectue la déconstruction humoristique d’une des pièces fondamentales du répertoire occidental. Au cours de cette première période, les recherches de Bene visent le fait spécifique du théâtre et de la théâtralité. C’est même par là que son travail est constamment engagé dans une opération critique fondamentale qui aboutit à une formule devenue célèbre : « ôter de scène », au lieu de mettre en scène. Hamlet va d’ailleurs servir de modèle pour l’ensemble de ses réélaborations shakespeariennes qui réduisent le texte à sa plus simple expression thématique, complétée par des références intertextuelles empruntées à quelques textes de Freud et surtout à Hamlet ou les suites de la piété filiale de Jules Laforgue.
À partir de 1967, Carmelo Bene s’investit dans le cinéma, en proposant d’abord Hermitage, et, en 1968, Notre-Dame des Turcs, qui lui assure un succès public international à Venise (prix spécial du jury). Cette œuvre constitue un moment clé de sa recherche. Elle aura d’abord été un roman, puis une mise en scène théâtrale, avant de devenir un film. Les autres films (Don Juan, 1970 ; Capricci, 1969 ; Salomè, 1972 ; Un Hamlet de moins, 1974) ont marqué à différents titres – surtout dans son travail sur le montage – l’expression cinématographique : détruisant l’aspect narratif, Bene privilégie les déconstructions baroques, les artifices de la couleur, et une expérimentation de la voix, désormais perçue comme « instrumentation vocale ».
• Le travail de la voix
De retour à la scène en 1974, Carmelo Bene investit les grands théâtres italiens – jusqu’à la Scala ou l’Accademia di Santa Cecilia à Rome. Chaque thème shakespearien – Roméo et Juliette (Paris, 1977), Richard III (1977), Othello (1979) ou Macbeth (Paris, 1983), Macbeth Horror suite (Paris, 1996) – est relu, et Bene n’en garde qu’un motif à peine perceptible, le revalorisant par une réécriture personnelle qui exalte ses qualités d’acteur en osant une constante mise en détresse du corps et de la voix. À partir des années 1980, il est le plus souvent seul sur scène. Après avoir éliminé de ses dramaturgies ce qui restait encore des fonctions de l’acteur, il accorde une place de plus en plus importante à la masse musicale et aux possibilités d’interprétation vocale. C’est au cours de ces années qu’il théorise le concept de « machine actoriale », qui lui permet de mener à bien ses recherches sur la multiplicité des puissances créatrices. C’est dans ce même sens qu’il va utiliser, de manière inégalée, les techniques d’amplification et de modification du son. Aussi bien Gilles Deleuze que Pierre Klossowski, en France, ont souligné le travail de la voix et du corps accompli par Carmelo Bene, qui a su donner aussi une nouvelle réalité à la lecture des poètes. Avec ses « concerts » autour de Dante (Paris, 1996), Leopardi, Campana, il achève un travail qui avait commencé avec Quatre diverses manières de mourir en vers (1980), une création pour la télévision italienne où il donnait voix à quatre poètes tragiques russes : Blok, Essenine, Maïakovski et Pasternak.
Jean-Paul MANGANARO
Œuvres de Carmelo Bene
Opere, Bompiani, Milan, 1995 ; Notre-Dame-des-Turcs, suivi de l’Autobiographie d’un portrait, trad. J. P. Manganaro, P.O.L., Paris, 2003 ; Théâtre, ibid., 2004.Études
Carmelo Bene/Dramaturgie, Centre international de dramaturgie, Paris, 1977C. BENE & G. DELEUZE, Superpositions, Minuit, Paris, 1979.BENIGNI ROBERTO (1952- )
Acteur et réalisateur italien né le 27 octobre 1952 à Castiglion Fiorentino, en Toscane.
Roberto Benigni est le fils d’un modeste métayer déporté dans un camp de travail allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. L’humour dont fait preuve son père lorsqu’il raconte ses souvenirs contribue à forger le talent comique du jeune Benigni et sera la source d’inspiration de La vita è bella (La vie est belle). Benigni s’inscrit dans un séminaire jésuite à Florence, mais il abandonne vite les cours pour le spectacle. Après un travail comme assistant de magicien, il rejoint un théâtre expérimental à la fin des années 1960. Il coécrit un monologue semi-autobiographique avec lequel il part en tournée dans toute l’Italie pour le tournage du film Berlinguer, ti voglio bene (1977). Il interprète plusieurs rôles au cinéma et commence sa carrière de réalisateur en 1983 avec Tu mi turbi (Tu me troubles), dont il est aussi le scénariste et interprète. Dans ce premier film, il tourne aux côtés de Nicoletta Braschi, qui deviendra sa femme et jouera dans la plupart de ses films (elle sera son épouse à l’écran dans La vie est belle). Benigni poursuit sa carrière de cinéaste sous la triple casquette de réalisateur, scénariste et acteur avec Il piccolo diavolo (1989 ; Le Petit Diable), Johnny Stecchino (1992) et Il Mostro (1994 ; Le Monstre), une farce sur la mafia qui bat les records d’entrées dans les salles italiennes. Au milieu des années 1990, Benigni séduit le public européen par ses talents d’imitateur et son exubérance gestuelle, qui ne sont pas sans rappeler son idole, Charlie Chaplin. Il interprète des rôles dans des films américains (Down by Law de Jim Jarmusch, 1986 ; Le Fils de la panthère rose de Blake Edwards, 1993), mais reste relativement méconnu aux États-Unis jusqu’à la sortie de La vie est belle en 1998. Le film connaît un immense succès et devient le film étranger qui réalise le plus de recettes aux États-Unis. L’acteur aux talents multiples tourne également en France dans Astérix et Obélix contre César (1998).
Lors de la cérémonie des oscars de 1999, Roberto Benigni, co-scénariste, réalisateur et premier rôle de La vie est belle, déploie le charme et le talent de comique frénétique qui l’ont rendu populaire dans le monde entier et fait de son film l’un des plus gros succès de l’année précédente. En recevant l’Oscar du meilleur acteur – c’est seulement la deuxième fois que ce prix est décerné à l’interprète d’un film étranger –, Benigni, littéralement fou de joie, gagne la scène en sautant sur les dossiers des fauteuils et en s’exclamant qu’il veut faire l’amour avec tout le monde. La vie est belle obtient également l’Oscar du meilleur film étranger, qui vient s’ajouter à la trentaine de récompenses internationales, dont le grand prix du jury à Cannes (1998), décernées au film. Dans cette tragi-comédie, Benigni interprète le rôle de Guido Orefice, un juif italien qui tombe amoureux d’une belle institutrice et l’épouse, mais leur vie va être brutalement interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Interné dans un camp de concentration nazi, Guido fait de cette expérience un jeu amusant afin de protéger son jeune fils. Aux critiques qui lui reprochent une évocation superficielle de la Shoah, Benigni réplique que son intention était de raconter une touchante histoire d’espoir. Le film marque la consécration internationale de Benigni, qui était déjà une star du grand écran en Italie.
En 2002, Benigni réalise Pinocchio, un des films les plus coûteux de l’histoire du cinéma italien. Avec Le Tigre et la neige (2005), il propose encore un hymne à la vie avec une histoire qui se déroule pendant la guerre d’Irak. L’ensemble de sa carrière est consacré par un césar d’honneur, en 2008. À partir de 2006, l’acteur donne TuttoDante, un spectacle dans lequel la récitation de chants de la Divine Comédie alterne avec des propos sur l’actualité et des souvenirs personnels.
E.U.
BERTINI FRANCESCA (1888-1985)
Nul ne sait vraiment quand est née Francesca Bertini. En 1888 probablement, le 11 avril. C’est du moins la date enregistrée par l’état civil de Florence. En 1892 peut-être. C’est la date qu’elle avançait dans ses souvenirs (Il resto non conta) publiés en 1969.
Née dans une famille de la petite bourgeoisie florentine, elle a grandi à Naples, où elle a d’abord fait du théâtre. En 1910, alors qu’elle interprète (déjà) le rôle titre d’Assunta Spina sur les planches du Teatro Nuovo, elle est remarquée par Gerolamo Lo Savio, directeur de Film d’arte italiana, filiale romaine de la firme Pathé : elle débute devant les caméras la même année dans Il Trovatore, dirigé, à Rome, par Louis Gasnier. Son nom éclaire l’histoire du premier cinéma italien – celui des dive et des mélodrames flamboyants –, en même temps que ceux de ses grandes rivales, Lyda Borelli, Pina Menichelli ou Italia Almirante Manzini. Plus que ses rivales, Francesca Bertini a su cependant varier son registre, s’adapter par exemple au réalisme d’Assunta Spina (tourné en partie dans les rues de Naples par Gustavo Serena en 1914-1915). Elle évolue avec la même aisance dans la haute société convenue des drames post-symbolistes et dans les milieux populaires de l’Italie du Sud. Elle est dirigée par Baldassare Negroni (notamment en 1913 dans Histoire d’un Pierrot





























