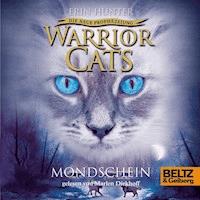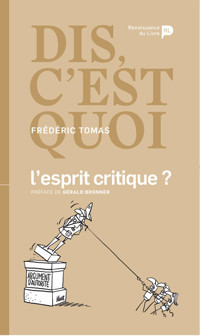
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
À l’heure des fake news et de la quantité grandissante d’informations mises à notre disposition, la nécessité de faire preuve d’esprit critique n’a jamais été aussi grande. Mais qu’est-ce que cela signifie, faire preuve d’esprit critique ? Peut-on développer cette faculté et si oui, comment ? Cet ouvrage a pour objectif de proposer une réflexion sur l’esprit critique, ainsi que sa pratique au niveau individuel et sociétal. Un dialogue y est proposé sur notre capacité à ne pas se laisser berner par des biais cognitifs ou des arguments fallacieux, pour ensuite se concentrer sur nos facultés à communiquer au mieux les résultats de nos réflexions critiques au monde extérieur. Certains outils issus des champs de la pédagogie et de la psychologie sont décrits en détail. Il s’agit ici de proposer des options permettant de stimuler la pensée critique, de se protéger de la désinformation, et de renforcer le libre examen et l’affranchissement volontaire des dogmes chez le lecteur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIS, C’EST QUOI
l’esprit critique ?
Frédéric Tomas
Dis, c’est quoi l’esprit critique ?
Renaissance du Livre
Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Directrice de collection : Nadia Geerts
Maquette de la couverture : Aplanos
Mise en page : CW Design
Illustrations : © Kanar
e-isbn : 9782507057039
dépôt légal : D/2020.12.763/09
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
Frédéric Tomas
DIS, C’EST QUOI
l’esprit critique ?
Préface de Gérald Bronner
Préface
L’esprit critique : une nouvelle forme de responsabilité
La question que pose le livre de Frédéric Tomas, « qu’est-ce que l’esprit critique », nous rappelle un sujet essentiel du temps présent. Essentiel parce que les infox (la dernière crise pandémique nous l’a encore montré), étendent chaque année un peu plus l’empire qu’elles ont sur l’esprit de nos concitoyens. Cette question est essentielle encore parce que nous vivons dans un monde numérique où chacun a le droit d’intervenir – par un blog, un compte Facebook ou encore un commentaire sur un site d’information – dans l’espace public. C’est sans doute un bien, mais comme chaque droit, il devrait s’accompagner de devoirs. Le premier devoir ressort justement de l’esprit de méthode qu’on peut aussi appeler l’esprit critique. Il consiste d’abord à tenter de raisonner librement et aussi juste que possible. Comme le rappelait Descartes dans les règles de la méthode : « Il ne suffit pas d’avoir l’esprit bon, encore faut-il en user bien. »
Ce petit texte balaye sous la forme d’un dialogue quelques-uns des grands points de l’histoire des idées qui nourrissent une réflexion sur l’esprit critique (Descartes, Hume, Al-Ghazali et bien d’autres). Il faut reconnaître que la question de la perception, du réel et du doute a occupé les hommes dès lors qu’ils ont cherché à penser le monde. La problématique de l’erreur, du raisonnement biaisé, n’a donc pas attendu les travaux de la psychologie cognitive pour obséder l’humanité dès que celle-ci a cherché des règles de pensée qui lui assurait un rapport rationnel au monde. On pourrait mentionner les innombrables penseurs, Aristote, Cicéron, Bacon, Malebranche, Descartes, Condorcet et bien d’autres qui se sont donné pour tâche de formaliser les façons de penser juste, en se méfiant du critère d’évidence et des pièges séduisants du sophisme. Dans ce tableau, il faudrait réserver une place particulière à John Stuart Mill et à son Traité de logique. Il faudrait sans doute ajouter les apports de Vilfredo Pareto dans son Traité de sociologie générale, la résolution du paradoxe de Saint Pétersbourg par Daniel Bernouilli en 1738… Mais, à vrai dire, toutes ces contributions ne font que préfigurer les recherches menées par Amos Tversky et Daniel Kahneman à la fin du vingtième siècle, lesquels se reconnaissent de prédécesseurs : Paul Meehl et ses recherches sur la comparaison entre les prédictions cliniques et statistiques ; Ward Edwards et son introduction, en psychologie, d’études sur la probabilité subjective dans le cadre du paradigme bayésien ; Herbert Simon et le programme qu’il définit pour penser les stratégies du raisonnement ; Jerome Bruner qui fut l’un des premiers à offrir une illustration empirique de ce programme ou encore Fritz Heider et ses travaux pionniers sur la perception ordinaire de la causalité.
Dans le fond, tous ces auteurs, et c’est cette substance que nous propose d’approcher le livre de Frédéric Tomas, ont dessiné la figure d’un être humain qui se meut dans un univers cognitif limité : la beauté de l’esprit critique consiste justement à tenter de dépasser ces limites par la méthode. C’est à la fois une approche réaliste et optimiste de notre nature qui est réalisable à la condition de penser les contraintes réelles qui pèsent sur notre jugement. Le résultat de ce long dialogue qui a traversé l’histoire de la pensée peut être synthétisé comme suit.
D’abord, les individus se meuvent dans un univers informationnel limité dans le temps et dans l’espace (ce sont les conditions dimensionnelles de la rationalité humaine). La limite spatiale qui pèse sur notre jugement est la plus aisée à concevoir. Il s’agit d’une condition commune à l’humanité parce que l’information qui est traitée par notre cerveau nous parvient par les limites de nos sens et que nous n’avons le plus souvent accès par notre expérience qu’à un échantillon du réel limité à partir duquel nous conjecturons. Le sociologue de la connaissance De Gré en a proposé une illustration didactique. Il imagine que l’on place quatre individus en face d’une pyramide. On constate alors que chacun d’eux prétend que cette objet est d’une couleur différente : l’un dit qu’elle est bleue, l’autre, rouge etc. La première idée qui viendra à l’esprit de celui à qui l’on demande de commenter le fait sera peut-être que certains d’entre eux mentent ou méjugent. C’est qu’il ne tiendra pas compte des limites spatiales de la rationalité de ces acteurs. En effet, placé devant une face différente, chacun ne perçoit que la couleur apparente de cette pyramide qui est en fait polychrome. Il eut fallu, pour que ces individus se fassent une idée plus objective de la couleur de cette pyramide, qu’ils en fassent le tour, c’est-à-dire qu’ils utilisent une méthode pour s’affranchir des limites qui pèsent sur leur rationalité. Il se trouve que le périmètre des phénomènes sociaux pouvant être éclairés par cette seule limite de notre rationalité est immense. Ainsi, les mondes sociaux que nous fréquentons, que ce soit dans la réalité physique ou numérique, nous exposent préférentiellement à tel type d’informations ou d’arguments. Les efforts à faire pour s’extraire de ces chambres d’écho ne sont pas impossibles à produire mais demandent une certaine motivation.
Dans le registre des limites dimensionnelles de notre rationalité, il faut ajouter les limites temporelles qui pèsent sur notre jugement. Là aussi il existe de nombreuses illustrations du fait que notre jugement est affecté par notre condition temporelle. Les économistes, à commencer par Samuelson ou Shackle, s’en sont beaucoup préoccupés. On ne se connaît pas bien soi-même, ce qui n’est pas une nouveauté, du moins se connaît-on différemment suivant la position d’où l’on se place pour s’observer. Et le futur de nos désirs apparaît frappé d’une grande variation suivant le genre de présent à partir duquel nous émettons nos anticipations. Notre conscience reste définitivement limitée dans le temps et l’espace, et sans cesse, notre esprit pallie cette insuffisance en convoquant la croyance.
Ensuite, notre jugement peut aussi s’égarer en raison des limites culturelles qui pèsent sur lui. Les systèmes de représentations que nous implémentons par socialisation nous aident à comprendre le monde, mais il arrive assez souvent que ces représentations constituent aussi un obstacle entre nous et le monde. Nous traitons les informations en fonction de ce filtre interprétatif, avec un résultat ne correspondant pas toujours aux normes de la rationalité objective. On s’est, par exemple, longtemps étonné de la stabilité du système des castes en Inde. Cette situation semblait paradoxale : les « intouchables », ceux qui, a priori, avaient le plus de raisons de contester cet ordre (parce qu’ils constituaient la frange la plus basse de cette société très hiérarchisée), étaient aussi ceux qui avaient le plus tendance à la respecter, d’après Max Weber. Pour éclaircir ce paradoxe, le sociologue allemand expliqua que ce système commandait à l’individu de respecter l’activité professionnelle prescrite à sa caste, et de remplir les devoirs qui en découlaient. Mais ce commandement n’était aussi bien suivi d’effet, poursuivait Max Weber, que parce qu’il était lié à l’idée de la transmigration des âmes, en raison de laquelle chacun croit qu’il peut améliorer ses chances de réincarnation en respectant les préceptes de sa caste. D’où ce paradoxe, que Weber soulignait, pour montrer qu’il n’était paradoxe que du point de vue de l’observateur étranger au système social en question : ce sont les castes les plus basses qui, compte tenu de leurs croyances, ont le plus intérêt à se conformer aux devoirs de leur statut social.
Enfin, la troisième grande limite qui pèse sur notre rationalité est celle qui a trait à notre cognition et aux défaillances de certaines de nos inférences. Certaines de nos idées fausses sont la conséquence du fonctionnement « normal » de notre esprit. Ce fonctionnement, qui n’est pas perceptible sans un effort particulier, repose sur des procédures mentales que nous utilisons avec une telle habitude qu’elles deviennent presque des routines. Si nous les mobilisons aussi fréquemment, c’est qu’elles nous rendent de précieux services et proposent des solutions souvent acceptables à nos problèmes. Beaucoup de nos erreurs viennent de la confiance excessive que nous accordons à ces routines mentales, c’est pourquoi elles ne sont pas totalement déraisonnables, même lorsque les conséquences qu’elles engendrent sont cocasses ou dramatiques. La vie quotidienne nous confronte souvent à des situations dont la complexité excède, sur le court terme, nos capacités cognitives. Nous pouvons alors céder à des raisonnements captieux intuitivement satisfaisants, mais qui conduisent à des idées fausses.
La prise en compte de ces trois limites de notre rationalité nous protège d’un certain nombre de raisonnements captieux. Elle nous permet d’espérer pouvoir faire notre déclaration d’indépendance mentale et nous rapproche d’assez près de ce qu’il convient d’appeler l’esprit critique. C’est d’une toute autre manière que nous propose d’aborder cette question Frédéric Tomas dans son livre, il emprunte la forme classique du dialogue, forme idoine dans une certaine philosophie antique qui cherchait aussi les voies pour penser bien. La forme même du dialogue rappelle d’ailleurs une chose essentielle : l’esprit critique s’enseigne bien et se perpétue à condition d’avoir une bonne observation de soi-même. Ce n’est pas un enseignement qui peut tomber du ciel ou d’un rapport vertical.
Gérald Bronner
Dis, c’est quoi l’esprit critique ?
À ma famille, merci.
Dans cette petite saynète, fictionnelle ou bien réelle – qui le sait vraiment ? –, je m’étais rendu chez mon cousin, afin de récupérer sa voiture. Entre alors l’un de ses fils, traînant les pieds et vociférant dans la barbe qui devait lui naître dans quelques années.
Franchement, la prof de français m’a énervé aujourd’hui.
Ah bon ? Qu’est-ce qu’elle t’a fait ?
Elle voit des choses que ses étudiants ne voient pas !
Des choses ? Comme des petits hommes verts, ou des esprits frappeurs ? Parce que si c’est le cas, il faut aller en discuter avec la direction rapidement...
Mais non ! Des choses dans le livre !
Ah, tu veux dire qu’elle interprète certaines choses que vous n’aviez pas vues et qui, du coup, vous semblent bizarres ?
Oui ! Par exemple, aujourd’hui, dans le livre qu’on doit lire, elle nous dit que le fait que le village soit vide représente la solitude intérieure du personnage principal. Mais comment est-ce qu’elle peut savoir ça ?
C’est une excellente question. Et pour tout te dire, j’en suis arrivé exactement à la même réflexion que toi plus tard durant mes études. Tu sais, j’ai commencé mes études à l’Université libre de Bruxelles en suivant un parcours de langues et littératures modernes. Et, soyons honnête, j’y suis surtout allé pour les langues. Mais manque de chance pour moi, il fallait se coltiner la littérature qui allait de pair. Et lorsque j’étais confronté à une analyse comme celle que tu viens de décrire, la même question naissait dans mon esprit : comment mon professeur, qui n’était pas présent du temps où Yeats ou Blake écrivaient, pouvait-il interpréter les textes qu’il nous faisait lire de manière objective ? Autrement dit, qu’est-ce qui me dit que son analyse a autant de valeur, voire plus, qu’une autre ?
Voilà, c’est ça. Comment est-ce que tu as résolu ce problème ?
De plusieurs manières, pour tout te dire. D’une part, j’ai tenté de voir si d’autres personnes pensaient la même chose que mes professeurs, ou si leur interprétation était unique, et donc discutable. Mais la question de la subjectivité ou, plus précisément, de l’absence d’objectivité me chagrinait. Je me suis donc mis en quête de ces éléments objectifs, ce qui m’a progressivement éloigné de l’analyse littéraire. Cela explique probablement pourquoi j’ai fait un master en sciences du langage. Le terme « science » avait une importance particulière pour moi, parce qu’il représentait justement ce retrait de la subjectivité au profit d’une recherche de vérité générale. C’est à ce moment que j’ai commencé à m’intéresser à l’esprit critique. Et pour cela, je me suis plongé avec intérêt dans les ouvrages liés à l’épistémologie et au scepticisme.
Épistémologie et scepticisme, ce sont deux termes que j’ai déjà entendus, mais est-ce que tu peux les expliquer, pour que je sois certain de suivre ?
L’épistémologie est une discipline qui cherche à comprendre comment nous savons ce que nous savons.
Ça commence bien !
Le terme est divisible en deux racines étymologiques grecques. La première, episteme, concerne la connaissance, tandis que logos indique le discours, l’étude, la réflexion portée sur un sujet. Il s’agit donc d’un champ d’étude qui investigue la manière dont nous concevons le monde, comment nous pouvons structurer nos connaissances et, par la même occasion, nous rapprocher d’une forme de vérité, si tant est que cela soit possible.
D’accord, je vois. Et le scepticisme ? C’est un terme plutôt négatif ça, non ?
Initialement, le scepticisme n’est pas négatif. En grec ancien, skeptomai













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)