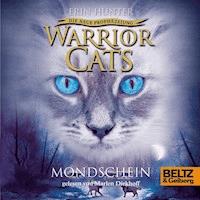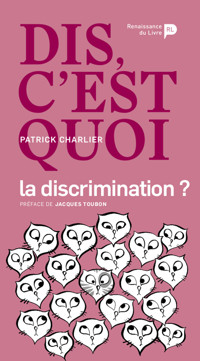
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Une école interdit le foulard, un propriétaire refuse de louer son appartement à une famille noire, un restaurant refuse l'accès d'une personne aveugle à cause de son chien d'assistance, une compagnie d'assurance refuse un prêt hypothécaire à un couple qui a plus de 75 ans, une chaîne commerciale interdit aux hommes de porter la barbe... Discrimination ou non ? Pour promouvoir l'égalité, prévenir la ségrégation ou l'exclusion, les pays européens ont adopté, sous l'impulsion de l'Union européenne, des lois interdisant la discrimination. Même si nous faisons partie d'une commune humanité, nos origines, nos langues, nos cultures, nos religions ou convictions, nos genres, nos âges sont divers. Cette diversité est une richesse, elle ouvre aussi la porte aux inégalités... et à la discrimination. Toute différence n'est pas nécessairement une discrimination. Elle est même parfois indispensable. Offrir un aménagement raisonnable pour la personne en situation de handicap, garantir des mesures de protection particulières aux enfants mineurs... autant de mesures qui peuvent paraître discriminatoires mais sont nécessaires.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Patrick Charlier est juriste. Après une première expérience professionnelle comme enseignant dans une école professionnelle de coiffure, il a travaillé pour la Ligue des droits humains durant 9 ans. Depuis 2001, il travaille pour Unia (Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations) dont il est aujourd'hui un des deux co-directeurs. Il y a occupé plusieurs fonctions, du Service racisme à l'Observatoire des migrations, avant de devenir coordinateur du département Discrimination.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dis,
c’est
quoi
la discrimination ?
Patrick Charlier
Dis, c’est quoi la discrimination ?
Renaissance du Livre
Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Renaissance du Livre
@editionsrl
directrice de collection : nadia geerts
maquette de la couverture : aplanos
mise en page : cw design
illustrations : alex skim
isbn : 978-2-507-05665-0
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
Faire connaître le droit de la discrimination est plus que jamais indispensable.
En droit européen et international, une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives : être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap, origine…) et relever d’une situation visée par la loi (accès à l’éducation, un stage ou un emploi, un service, un logement…).
Ce dialogue entre un père et son fils très curieux aborde la notion de discrimination en prenant comme point de départ une situation d’injustice vécue à l’école. Cette injustice n’est pas une discrimination telle que prohibée par la loi mais, très habilement et pédagogiquement, Patrick Charlier amène le lecteur à découvrir les sources du droit de la discrimination, ses définitions et modalités de mise en œuvre et les différents domaines dans lesquels ce droit permet de protéger chaque personne dans son individualité.
Différentes études ont démontré que les jeunes sont plus sensibles que les adultes aux injustices et aux discriminations vécues ou ressenties personnellement. À cet égard, la vigilance quant à la banalisation des stéréotypes et la prévention des discriminations doit s’exercer précocement, afin de bâtir des générations pour qui l’égalité se vit et doit se vivre concrètement, et de former une jeunesse qui soit actrice de la lutte contre les discriminations. Pour cela, la connaissance du droit et de ses droits paraît fondamentale. Ce texte nous y conduit : il contribue, par des mots simples et des exemples du quotidien, à la diffusion de la grille de lecture des droits, à la vulgarisation du droit et à la promotion de l’égalité.
Indispensable au fonctionnement et au maintien de notre contrat social, le droit remplit en effet des fonctions essentielles : il structure et rend possible la vie en société, il fonde et encadre l’action des pouvoirs publics, il traduit et protège les valeurs collectives, il délimite les droits et devoirs de chacun, il permet encore une résolution pacifique des conflits. Parce que toute personne, à tout âge, est confrontée à l’omniprésence des règles juridiques dans les différents aspects de sa vie quotidienne, l’approche par le droit peut offrir une perception concrète de la manière dont s’opèrent et se régulent les rapports sociaux dans une société non régie par la force. Le droit représente également une ressource que les personnes doivent mobiliser pour faire vivre et évoluer une société démocratique.
C’est pourquoi le Défenseur des droits, homologue français d’Unia en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, estime que la sensibilisation des enfants et des jeunes aux notions fondamentales de l’État de droit doit faire partie du socle commun de compétences et de connaissances que leur environnement éducatif est chargé de leur transmettre, afin de les préparer à devenir des citoyens actifs et responsables. Il s’agit bien, en pleine cohérence avec les finalités du droit à l’éducation inscrites dans la Convention internationale des droits de l’enfant, de permettre à ces derniers de connaître et d’exercer leurs droits1.
L’éducation aux droits doit être considérée comme un levier de l’accès à l’égalité. Pour sortir de la fiction juridique selon laquelle « Nul n’est censé ignorer la loi » et faire en sorte que chacun, et en particulier le plus vulnérable ou le plus discriminé, puisse exercer ses droits, il est impératif d’en faciliter l’intelligibilité et l’appropriation par le plus grand nombre, et ce, le plus précocement possible, en particulier dans le cadre de la scolarisation.
C’est à ces conditions que pourra être consolidé le pacte social de chaque État démocratique, par l’appropriation et le respect des « règles du jeu » fixées par le droit, qui organisent les rapports individuels et collectifs pour tous et pour chacun, quelle que soit leur situation personnelle ou familiale.
Des règles du jeu qui feront effectivement de nos enfants et de nos jeunes des acteurs et des sujets de droit, en leur reconnaissant les mêmes libertés et les mêmes droits, mais aussi les mêmes obligations à l’égard de la société à laquelle ils appartiennent, et en forgeront leur indépendance d’esprit.
Je salue donc l’initiative de Patrick Charlier et invite le plus grand nombre, jeunes et moins jeunes, à lire cet ouvrage et à poursuivre la réflexion au-delà de ce dialogue, car la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité est l’affaire de chacune et de chacun.
Jacques Toubon
À mes enfants, Sven et Aurore, que leur sens de la justice et d’un monde meilleur continue de les guider et à nous inspirer.
À Murielle, parce que chaque instant mérite d’être vécu.
À ma collègue Laure, dont le soutien bienveillant et une relecture pointue m’ont rappelé qu’il faut aller à l’essentiel.
À Nadia qui m’a offert cette belle opportunité qui s’est révélée bien plus un plaisir qu’une contrainte.
Contre le Littré, le Robert, le Larousse et les autres, je ne peux me résoudre à écrire « droits de l’homme », mêmedans les références officielles. C’est pourquoi vous lirez « Déclaration universelle des droits de l’Homme», « Convention européenne des droits de l’Homme » ou encore « Cour européenne des droits de l’Homme ». Merci à Josiane d’avoir accepté cette hérésie grammaticale.
Mon fils rentre furieux de l’école. Tous les garçons de sa classe ont reçu une punition collective. Pas les filles. Il trouve ça injuste. Je lui demande ce qui s’est passé.
À la fin du cours de gymnastique, Nicolas, un élève de sa classe, ne retrouve plus ses chaussures. Il cherche, retourne ses vêtements, fouille son sac de sport, une fois, deux fois, trois fois… Rien. Dans le vestiaire, ça chuchote, ça rit, ça se moque. D’autres essaient de chercher et d’aider Nicolas. En vain. L’institutrice presse les enfants de quitter le vestiaire pour entrer en classe et houspille Nicolas qui, une fois encore, est le dernier à être prêt, lui qui est tellement lent pour tout faire. Nicolas fond en larmes, il ne retrouve pas ses chaussures et il doit rentrer en classe avec ses petites sandalettes de gymnastique, trempées par la pluie. Ses pieds sont trempés. Les rieurs s’en donnent à cœur joie, mais de manière assez discrète pour ne pas trop se faire remarquer par l’institutrice.
Nicolas est inquiet. S’il rentre à la maison sans ses chaussures, il risque une fois de plus de se faire gronder et réprimander pour sa distraction. Comment peut-on égarer ses chaussures ? Il continue de pleurer en classe sans que personne lui prête vraiment attention.
Au milieu du cours, voilà qu’arrive Ishane, le responsable de la cantine. Il a trouvé une paire de chaussures dans le frigo. Explosion de rires dans la classe, que l’institutrice peine à maîtriser. Nicolas est fondamentalement soulagé. Mais il se sent mal aussi. Qui a pu être aussi méchant pour cacher ses chaussures dans le frigo de la cantine ? Pourquoi lui en veut-on ? Pourquoi est-ce toujours de lui qu’on rigole ? Pourquoi d’ailleurs n’est-il jamais invité aux anniversaires ?
Après les rires, l’institutrice suspend sa leçon pour entamer son enquête. Elle veut savoir qui a caché les chaussures de Nicolas dans ce frigo. Qu’il se dénonce ! Plus personne ne moufte. Parce que les élèves savent que lorsqu’elle a ce regard noir, il vaut mieux faire profil bas. Elle est d’autant plus en colère qu’elle se sent coupable. Elle s’est montrée brusque avec Nicolas dans le vestiaire, parce qu’elle était convaincue qu’il s’était montré une fois encore trop distrait, alors qu’on lui avait joué un mauvais tour. Elle n’a pas non plus apprécié le reproche d’Ishane qui sous-entendait qu’elle pourrait quand même mieux tenir sa classe et que des chaussures dans un frigo, ce n’était pas vraiment du plus hygiénique.
Elle veut donc savoir qui est le coupable pour lui donner une punition méritée. Personne ne se dénonce. Elle regarde les élèves un à un dans les yeux, menace, interroge. Sans résultat. La sonnerie annonçant le début de la récréation retentit. Dans un mouvement pavlovien, les élèves se lèvent pour sortir, mais l’institutrice les arrête. Pas question de sortir, pas question de récréation tant qu’elle ne sait pas qui a caché les chaussures de Nicolas. Que le coupable se dénonce, sinon c’est toute la classe qui va en pâtir. C’est alors que Lily-Rose lève le doigt. L’institutrice a un petit mouvement d’hésitation. Ce n’est quand même pas elle, cette élève modèle, la première de classe qui a fait cela. Mais ce n’est pas pour se dénoncer qu’elle veut parler, ni même pour accuser un camarade. Lily-Rose souligne simplement que ce n’est pas juste que les filles restent en classe et soient soupçonnées, puisqu’elles étaient dans leur vestiaire et qu’aucune d’entre elles ne peut avoir caché les chaussures de Nicolas. L’institutrice vacille devant cet argument et rapidement libère les filles. Juste avant de sortir, Lily-Rose souligne également qu’il n’est pas juste que Nicolas doive rester en classe, parce que ce n’est certainement pas lui qui a caché ses chaussures. Avant même la fin de la phrase, l’institutrice intime à Nicolas d’aller à la récréation, espérant ainsi se racheter du comportement qu’elle a eu avec lui dans le vestiaire.
Restent tous les garçons de la classe. Personne ne se dénonce. L’institutrice soupçonne un petit groupe de trois élèves, mais sans preuve, sans aveu, elle ne peut quand même pas les accuser. Alors, elle menace encore. Si le coupable ne se dénonce pas avant la fin de la récréation, tous les garçons de la classe seront punis. La sonnerie retentit à nouveau, la récréation est finie. L’institutrice met sa menace à exécution, une rédaction de deux pages à rendre pour le lendemain sur le thème de l’hygiène dans les frigos.
C’est la raison de la colère de mon fils. Il n’a rien fait et il a une punition. Quelle injustice : simplement parce qu’il est un garçon !
À table, lors du repas, commence alors une discussion en famille. Ça part dans tous les sens, mais nous essayons de mettre un peu d’ordre dans les arguments qui sont échangés.
Nous avons tellement parlé ce soir-là que mon fils a dû se coucher plus tard… après avoir fait sa punition.
Dix années se sont écoulées depuis. Préparant le présent livre, je lui rappelle cette anecdote. Enfin, « anecdote », façon de parler. Parce que, pour lui, le souvenir de cette injustice reste vif, la colère est encore là, il continue à ne pas comprendre et à ne pas accepter. Il reste fâché contre cette institutrice qui, depuis ce moment-là, a perdu tout crédit à ses yeux. Elle n’est plus que cette injustice, alors que, pourtant, il a passé aussi beaucoup de bon temps dans sa classe, elle leur a appris tellement de choses, elle faisait preuve d’enthousiasme, de créativité. Mais tout cela est oublié. Reste cette blessure.
Comment se fait-il que, si longtemps après, je sois encore touché par cette injustice ?
Ce que tu as vécu, tu le ressens comme une injustice. Aujourd’hui encore, tu as la sensation qu’elle n’a été ni réparée ni même reconnue. Tu continues à avoir une petite pointe dans le ventre. Cela étant, si je ne t’avais pas rappelé cette histoire, tu n’y aurais plus pensé et elle serait restée bien enfouie. Cet épisode ne t’a pas empêché d’avancer dans la vie. Mais pense à celles et ceux qui vivent des injustices régulièrement, pas une fois de temps à autre, mais régulièrement. Ou alors celles et ceux qui vivent une injustice profonde, une humiliation, parce qu’ils ne sont pas dans la norme, pas comme les autres, d’origine étrangère, avec une couleur de peau différente, avec un accent, avec un handicap, d’une culture, d’une religion différente de la majorité, qu’ils sont homosexuels… Ce n’est pas une fois de temps à autre qu’ils ont une piqûre de rappel, mais bien plus souvent, dans des faits de la vie quotidienne, dans une remarque, dans un regard.
En fait, à l’époque, je me souviens que je partageais ton indignation. Mais lorsque j’ai proposé que tu ne fasses pas ta punition et que je prenne contact avec l’institutrice ou la direction pour expliquer notre désaccord, cela t’a paru encore plus difficile. Hors de question que j’intervienne, tu ne voulais certainement pas te faire remarquer, faire différemment des autres. Se faire remar













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)