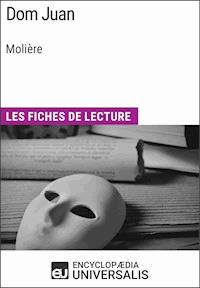
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Le 15 février 1665, Molière (1622-1673) donne
Dom Juan, une comédie fort dangereuse, à la suite de
Tartuffe qui venait d’être interdit.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Dom Juan de Molière
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 49
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341000178
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Nito/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Dom Juan, Molière (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
DOM JUAN, Molière (Fiche de lecture)
Le 15 février 1665, Molière (1622-1673) donne Dom Juan, une comédie fort dangereuse, à la suite de Tartuffe qui venait d’être interdit. Quinze jours après la première, les pressions de toutes sortes et la prudence font que l’écrivain retire sa pièce : Le Festin de pierre, cette version originale qui n’a pas été imprimée, qu’on nommera en 1682 Dom Juan, sera à jamais perdue. Les éditions que nous connaissons sont donc toutes des versions reconstruites à partir d’éléments pris dans le supposé Festin de pierre d’origine, et postérieures à la mort de Molière.
• Une comédie qui sent le soufre
Tragi-comédie en cinq actes et en prose, comédie de cape et d’épée, comédie burlesque, parcours dans une île (la Sicile), Dom Juan représente l’histoire d’un fuyard et d’un séducteur qui ne croit rien sinon que « deux et deux font quatre ». « Grand seigneur méchant homme », ce jeune homme à peine marié transgresse le sacrement qu’il vient de recevoir pour fuir Elvire, sa femme, et courir d’autres fortunes, en mer. Lui et son valet Sganarelle essuient une tempête et sont sauvés par un paysan (Pierrot), ridicule, mais fiancé. Dom Juan en profitera pour séduire sa promise et l’amie de sa promise en leur promettant le mariage. Toujours sur les chemins, il donnera une leçon de libertinage et d’humanité à un pauvre ermite, sauvera par les armes les frères d’Elvire attaqués par des brigands et venus se venger de lui, profitera de ce geste aristocratique pour leur échapper, reviendra chez lui en passant par le monument du Commandeur, qu’il a tué quelque temps avant, ne s’étonnera pas que la statue se meuve, enfin, dans son palais, ridiculisera un bourgeois débiteur (Monsieur Dimanche) et un père excédé (Dom Louis). Pressé de toutes parts, il ne lui restera que l’hypocrisie et l’imposture qui étaient celles de Tartuffe pour résister à la vengeance des frères d’Elvire et refuser le duel, convaincre Dom Louis de sa subite conversion, et enfin se donner une image de dévot. Elvire, venue le convaincre de se racheter serait bien une proie possible, mais elle résiste en fuyant à son tour pour rentrer dans son couvent. La grande question qui occupe Dom Juan, c’est le sacré, la statue qui vient dîner et qui l’invite. Il se rend au festin promis, serre la main du Commandeur et disparaît dans les « dessous » du théâtre, dans un grand bruit spectaculaire : voilà bien de quoi réclamer des gages au public, ce dont Sganarelle s’acquittera à merveille, d’autant que Molière, chef de troupe, interprète le rôle... Car Sganarelle, le benêt, le valet pleurnichard qui a la foi du charbonnier (il croit à Dieu, au Diable, au loup-garou et au Moine bourru, pêle-mêle) est plus qu’un faire-valoir. C’est un partenaire qui permet de mettre en valeur un véritable « méchant » qui se bat contre le Sacré et séduit par son héroïsme. Dom Juan sent le soufre, et l’on ne peut qu’aimer le soufre en le voyant. Les opposants à Molière avaient bien raison de le craindre et de le combattre, au nom de Dieu, contre le théâtre, parce que le rire, dans cette pièce, pervertit à tout coup, et que le grand aristocrate, au moment où l’aristocratie décline, reste admirable, surtout lorsqu’il affronte l’inconnaissable Sacré.
• Un texte mythique
Avant Molière, Tirso de Molina en Espagne (L’Abuseur de Séville, 1630) avait créé le mythe de Don Juan en utilisant une série de légendes populaires pour prouver que la Providence divine, pourtant largement disponible, ne pouvait être pervertie ni convoquée in extremis par un jeune homme trop confiant en son merveilleux pouvoir. En Italie, les acteurs de la commedia dell’arte s’en étaient emparés. Enfin en France, dès 1659 chez Dorimond (Le Festin de pierre, ou le Fils criminel) et Villiers (Le Festin de pierre, ou le Fils criminel, 1660), Don Juan était devenu le type du jeune homme libertin ne croyant ni en Dieu, ni au Diable, ni au pouvoir du Père. Molière connaît tout cela lorsqu’il écrit cette pièce. Sa comédie, dont on pense qu’elle fut vite écrite, reprendra donc tous ces éléments pour les mettre au service du libertinage philosophique.
L’édition de 1682, la première, sera copieusement « cartonnée », c’est-à-dire censurée par le lieutenant-général de police (une grande partie de la scène du pauvre disparaît, entre autres coupures). On a donc collé de nouvelles pages contenant les remaniements nécessaires à la place du texte de 1682, jugé trop dangereux. La seule édition à peu près fiable, mais qui ne peut tenir compte des censures faites dès 1665, est celle qui fut imprimée à Amsterdam, en 1683. Mais cette édition, deux fois réimprimée (en 1694 et 1699) est vite oubliée, si bien qu’on reproduit ensuite l’édition de 1682, « cartonnée ». Seuls restent, chez quelques collectionneurs, de rares versions du texte de 1682 avant le cartonnage, et quelques éditions d’Amsterdam. Ce n’est qu’en 1813 qu’on imprimera enfin le texte complet de 1682 en prenant soin, cette fois, de citer les passages « cartonnés » (retour de la scène du pauvre), en 1819 qu’on retrouvera l’édition d’Amsterdam, et en 1841 qu’on jouera la pièce de 1682 avec les passages censurés, à l’Odéon.





























