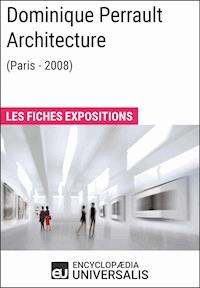
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Après Christian de Portzamparc (1996), Renzo Piano (2000), Jean Nouvel (2001), Morphosis (2006) et Richard Rogers (2007), le Centre Georges-Pompidou a présenté du 11 juin au 22 septembre 2008 la première grande exposition consacrée à l'architecte de la Bibliothèque nationale de France, Dominique Perrault...
À PROPOS DE L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 35
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341009713
© Encyclopædia Universalis France, 2016. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Bluraz/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Les grandes expositions sont l’occasion de faire le point sur l’œuvre d’un artiste, sur une démarche esthétique ou sur un moment-clé de l’histoire des cultures. Elles attirent un large public et marquent de leur empreinte l’histoire de la réception des œuvres d’art.
Sur le modèle des fiches de lecture, les fiches exposition d’Encyclopaedia Universalis associent un compte rendu de l’événement avec un article de fond sur le thème central de chaque exposition retenue : - pour connaître et comprendre les œuvres et leur contexte, les apprécier plus finement et pouvoir en parler en connaissance de cause ; - pour se faire son propre jugement sous la conduite de guides à la compétence incontestée.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Dominique Perrault Architecture (Paris - 2008)
Après Christian de Portzamparc (1996), Renzo Piano (2000), Jean Nouvel (2001), Morphosis (2006) et Richard Rogers (2007), le Centre Georges-Pompidou a présenté du 11 juin au 22 septembre 2008 la première grande exposition consacrée à l’architecte de la Bibliothèque nationale de France, Dominique Perrault. Conçue et mise en scène par Perrault lui-même, avec Frédéric Migayrou comme commissaire du Centre Georges-Pompidou, cette présentation n’avait par définition pas de vocation critique ni historique. Elle s’inscrivait plutôt, comme les précédentes, dans la tradition de l’exposé propédeutique, dont Piano et Rogers avaient, l’un et l’autre, si brillamment montré l’efficacité.
L’exposition Dominique Perrault Architecture, qui reprend sobrement le nom de l’agence (DPA), évitait ainsi les pièges de l’autocélébration pour montrer trente ans d’architecture et une cinquantaine de projets, étudiés ou réalisés. Avant de pénétrer dans l’espace fluide de la galerie sud du Centre Georges-Pompidou, un texte extrait d’une conférence donnée à Madrid en janvier 2008 s’affichait comme un manifeste : « Pourquoi l’histoire n’est-elle plus un élément de référence suffisant pour les architectes contemporains ? », interrogeait Perrault. Il semble en effet acquis, selon lui, « que cette matière est désormais largement supplantée par la géographie, par un questionnement sur la dimension géographique. [...] L’importance accordée au lieu a pour conséquence immédiate de dévoiler les insuffisances d’une architecture uniquement tournée vers le bâtiment. [...] Dès lors, il s’agit d’essayer de penser l’architecture comme un élément à part entière du paysage, c’est-à-dire de prendre conscience du fait que nous créons des paysages artificiels, que la nature dans laquelle nous vivons est, aussi étrange que cela puisse paraître, toujours plus artificielle ». Ces prémisses théoriques aident à comprendre certains des projets parmi les plus anciens de l’architecte : la B.N.F., bien sûr, dont il remporte le concours en 1989 et qui lui vaudra une renommée internationale – ainsi que de sévères critiques –, mais également l’E.S.I.E.E. (École supérieure d’ingénieurs en électrotechnique et électronique) à Marne-la-Vallée (1984-1987) ou le vélodrome et la piscine olympique de Berlin (1992-1999), autant de réalisations dans lesquelles les notions d’effacement et de vide l’emportent sur la traditionnelle image d’une masse dressée.
La présence massive de





























