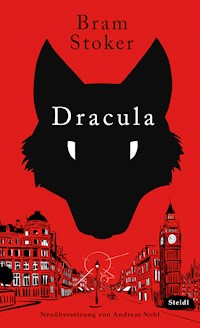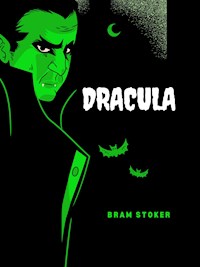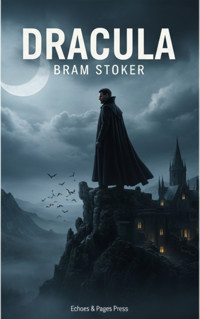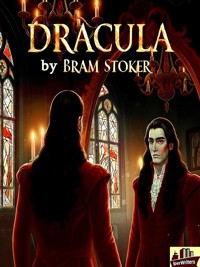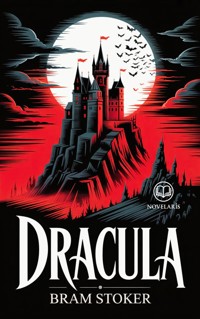
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Jonathan Harker, jeune clerc de notaire anglais, se rend en Transylvanie pour conclure une transaction immobilière avec le mystérieux comte Dracula. Mais il découvre rapidement qu'il est prisonnier dans le sinistre château de son hôte, un être surnaturel assoiffé de sang. Pendant ce temps, d'étranges événements frappent l'Angleterre : la fiancée de Harker, Mina, et son amie Lucy subissent d'inexplicables affaiblissements nocturnes. Le professeur Van Helsing et ses compagnons comprennent qu'un ancien mal s'est réveillé et menace de contaminer le monde moderne. S'engage alors une lutte épique entre les forces du bien et l'incarnation même du mal. Dracula de Bram Stoker, publié en 1897, est le roman fondateur du mythe vampirique moderne. L'auteur irlandais crée un chef-d'œuvre fascinant du gothique victorien et utilise magistralement la technique du récit epistolaire pour créer une tension dramatique saisissante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 843
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bram Stoker
Dracula
Nouvelle traduction française intégrale
Copyright © 2025 Novelaris
Tous droits réservés. Aucune partie de cet e-book ne peut être reproduite, distribuée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur.
ISBN: 9783689312534
Table des matières
CHAPITRE I : LE JOURNAL DE JONATHAN HARKER
CHAPITRE II : JOURNAL DE JONATHAN HARKER — suite
CHAPITRE III : JOURNAL DE JONATHAN HARKER — suite
CHAPITRE IV : JOURNAL DE JONATHAN HARKER — suite
CHAPITRE VI : LE JOURNAL DE MINA MURRAY
CHAPITRE VII : EXTRAIT DU « DAILYGRAPH », 8 AOÛT
CHAPITRE VIII : LE JOURNAL DE MINA MURRAY
CHAPITRE XII : JOURNAL DU DR SEWARD
CHAPITRE XIII : JOURNAL DU DR SEWARD — suite.
CHAPITRE XIV : LE JOURNAL DE MINA HARKER
CHAPITRE XV : JOURNAL DU DR SEWARD — suite.
CHAPITRE XVI : JOURNAL DU DR SEWARD — suite
CHAPITRE XVII : JOURNAL DU DR SEWARD — suite
CHAPITRE XVIII : JOURNAL DU DOCTEUR SEWARD
CHAPITRE XIX : JOURNAL DE JONATHAN HARKER
CHAPITRE XX : JOURNAL DE JONATHAN HARKER
CHAPITRE XXI : JOURNAL DU DR SEWARD
CHAPITRE XXII : JOURNAL DE JONATHAN HARKER
CHAPITRE XXIII : JOURNAL DU DR SEWARD
CHAPITRE XXIV : JOURNAL PHONOGRAPHIQUE DU DR SEWARD, RACONTÉ PAR VAN HELSING
CHAPITRE XXV : JOURNAL DU DR SEWARD
CHAPITRE XXVI : JOURNAL DU DR SEWARD
CHAPITRE XXVII : JOURNAL DE MINA HARKER
Cover
Table of Contents
Text
CHAPITRE I : LE JOURNAL DE JONATHAN HARKER
(Rédigé en sténographie.)
3 mai. Bistritz. — Nous avons quitté Munich à 20 H 35 le 1er mai et sommes arrivés à Vienne tôt le lendemain matin ; nous aurions dû arriver à 6 h 46, mais le train avait une heure de retard. Buda-Pesth semble être un endroit merveilleux, d’après l’aperçu que j’en ai eu depuis le train et le peu que j’ai pu voir en me promenant dans les rues. Je craignais de m’éloigner trop de la gare, car nous étions arrivés en retard et devions repartir à l’heure prévue. J’avais l’impression que nous quittions l’Occident pour entrer en Orient ; le plus occidental des magnifiques ponts qui enjambent le Danube, qui est ici d’une largeur et d’une profondeur impressionnantes, nous a conduits au cœur des traditions de la domination turque.
Nous sommes partis assez tôt et sommes arrivés à Klausenburgh après la tombée de la nuit. Je me suis arrêté pour la nuit à l’hôtel Royale. J’ai dîné, ou plutôt soupé, d’un poulet préparé avec du poivre rouge, qui était très bon mais donnait soif. (Mémo : demander la recette à Mina.) J’ai interrogé le serveur, qui m’a répondu que ce plat s’appelait « paprika hendl » et que, comme il s’agissait d’un plat national, je pourrais le trouver partout dans les Carpates. Mes connaissances rudimentaires en allemand m’ont été très utiles ici ; en effet, je ne sais pas comment je pourrais m’en sortir sans elles.
Ayant eu un peu de temps libre à Londres, j’avais visité le British Museum et fait des recherches dans les livres et les cartes de la bibliothèque concernant la Transylvanie ; il m’avait semblé qu’une certaine connaissance préalable du pays ne pouvait manquer d’avoir une certaine importance dans mes relations avec un noble de ce pays. J’ai découvert que la région qu’il a mentionnée se trouve à l’extrême est du pays, juste à la frontière de trois États, la Transylvanie, la Moldavie et la Bucovine, au milieu des Carpates ; l’une des régions les plus sauvages et les moins connues d’Europe. Je n’ai trouvé aucune carte ni aucun ouvrage indiquant l’emplacement exact du château de Dracula, car il n’existe pas encore de cartes de ce pays comparables à nos cartes topographiques ; mais j’ai découvert que Bistritz, la ville postale mentionnée par le comte Dracula, est un endroit assez connu. Je vais noter ici quelques-unes de mes observations, car elles me rafraîchiront la mémoire lorsque je parlerai de mes voyages avec Mina.
La population de Transylvanie se compose de quatre nationalités distinctes : les Saxons au sud, mélangés aux Valaches, qui sont les descendants des Daces ; les Magyars à l’ouest, et les Szekelys à l’est et au nord. Je vais me rendre chez ces derniers, qui prétendent descendre d’Attila et des Huns. C’est peut-être vrai, car lorsque les Magyars ont conquis le pays au XIe siècle, ils y ont trouvé les Huns installés. J’ai lu que toutes les superstitions connues dans le monde sont rassemblées dans le fer à cheval des Carpates, comme s’il s’agissait du centre d’une sorte de tourbillon imaginaire ; si c’est le cas, mon séjour pourrait être très intéressant. (Mém., je dois interroger le comte à leur sujet.)
Je n’ai pas bien dormi, même si mon lit était assez confortable, car j’ai fait toutes sortes de rêves étranges. Un chien a hurlé toute la nuit sous ma fenêtre, ce qui a peut-être joué un rôle, ou alors c’était le paprika, car j’ai bu toute l’eau de ma carafe et j’avais encore soif. Vers le matin, je me suis endormi et j’ai été réveillé par des coups continus à ma porte, donc je suppose que je devais dormir profondément à ce moment-là. J’ai pris pour petit-déjeuner davantage de paprika, une sorte de porridge à base de farine de maïs qu’ils appellent « mamaliga », et des aubergines farcies de chair à saucisse, un plat excellent qu’ils appellent « impletata ». (Mémo : demander la recette de ce plat également.) J’ai dû prendre mon petit-déjeuner à la hâte, car le train partait un peu avant huit heures, ou plutôt aurait dû partir, car après m’être précipité à la gare à 7 h 30, j’ai dû rester assis dans le wagon pendant plus d’une heure avant que nous commencions à bouger. Il me semble que plus on va vers l’est, moins les trains sont ponctuels. Qu’en est-il en Chine ?
Toute la journée, nous avons semblé flâner à travers un pays qui regorgeait de beautés de toutes sortes. Parfois, nous voyions de petites villes ou des châteaux au sommet de collines escarpées, comme on en voit dans les anciens missels ; parfois, nous longions des rivières et des ruisseaux qui, à en juger par les larges berges rocailleuses de chaque côté, semblaient sujets à de grandes inondations. Il faut beaucoup d’eau, et un fort courant, pour nettoyer les berges d’une rivière. À chaque gare, il y avait des groupes de personnes, parfois des foules, vêtues de toutes sortes de tenues. Certaines d’entre elles ressemblaient aux paysans de chez nous ou à ceux que j’avais vus en France et en Allemagne, avec des vestes courtes, des chapeaux ronds et des pantalons faits maison ; mais d’autres étaient très pittoresques. Les femmes étaient jolies, sauf quand on s’approchait d’elles, mais elles étaient très maladroites au niveau de la taille. Elles portaient toutes des manches blanches bouffantes d’un genre ou d’un autre, et la plupart d’entre elles avaient de grandes ceintures avec de nombreuses bandes de tissu qui flottaient comme les robes d’un ballet, mais bien sûr, elles portaient des jupons en dessous. Les personnages les plus étranges que nous avons vus étaient les Slovaques, qui étaient plus barbares que les autres, avec leurs grands chapeaux de cow-boy, leurs grands pantalons bouffants blanc cassé, leurs chemises en lin blanc et leurs énormes ceintures en cuir épais, larges de près de 30 cm, toutes cloutées de clous en laiton. Ils portaient des bottes hautes, dans lesquelles ils avaient rentré leur pantalon, et avaient de longs cheveux noirs et de grosses moustaches noires. Ils sont très pittoresques, mais ne semblent pas très sympathiques. Sur scène, on les prendrait immédiatement pour une vieille bande de brigands orientaux. On me dit cependant qu’ils sont très inoffensifs et plutôt dépourvus d’assurance naturelle.
C’était à la tombée de la nuit lorsque nous sommes arrivés à Bistritz, une vieille ville très intéressante. Située pratiquement à la frontière, puisque le col de Borgo mène de là à la Bucovine, elle a connu une existence très mouvementée, dont elle porte certainement les traces. Il y a cinquante ans, une série de grands incendies a causé des ravages terribles à cinq reprises. Au tout début du XVIIe siècle, la ville a subi un siège de trois semaines et perdu 13 000 habitants, les victimes de la guerre proprement dite étant aggravées par la famine et les maladies.
Le comte Dracula m’avait indiqué de me rendre à l’hôtel Golden Krone, que j’ai trouvé, à ma grande joie, tout à fait démodé, car je voulais bien sûr découvrir autant que possible les coutumes du pays. On m’attendait manifestement, car lorsque je m’approchai de la porte, je me retrouvai face à une femme âgée à l’air joyeux, vêtue de la tenue paysanne habituelle : un sous-vêtement blanc avec un long tablier double, devant et derrière, en tissu coloré, presque trop moulant pour être pudique. Lorsque je m’approchai, elle s’inclina et dit : « Monsieur l’Anglais ? Oui, répondis-je, Jonathan Harker. Elle sourit et transmit un message à un homme âgé en chemise blanche qui l’avait suivie jusqu’à la porte. Il partit, mais revint immédiatement avec une lettre :
« Mon ami, bienvenue dans les Carpates. Je vous attends avec impatience. Dormez bien cette nuit. Demain, à trois heures, la diligence partira pour la Bucovine ; une place vous y est réservée. À l’ , au col de Borgo, ma voiture vous attendra et vous conduira chez moi. J’espère que votre voyage depuis Londres s’est bien passé et que vous apprécierez votre séjour dans ma belle région.
Votre ami,
DRACULA.
4 mai. — J’ai découvert que mon logeur avait reçu une lettre du comte lui demandant de me réserver la meilleure place dans la diligence ; mais lorsque je lui ai demandé des détails, il s’est montré quelque peu réticent et a prétendu ne pas comprendre mon allemand. Cela ne pouvait pas être vrai, car jusqu’alors, il l’avait parfaitement compris ; du moins, il avait répondu à mes questions exactement comme s’il le comprenait. Lui et sa femme, la vieille dame qui m’avait accueilli, se regardèrent d’un air effrayé. Il marmonna que l’argent avait été envoyé dans une lettre et que c’était tout ce qu’il savait. Lorsque je lui ai demandé s’il connaissait le comte Dracula et s’il pouvait me donner des informations sur son château, lui et sa femme se sont signés et, affirmant qu’ils ne savaient rien, ont simplement refusé de parler davantage. L’heure du départ approchait et je n’ai pas eu le temps de poser la question à quelqu’un d’autre, car tout cela était très mystérieux et nullement rassurant.
Juste avant mon départ, la vieille dame est venue dans ma chambre et m’a dit d’un ton très hystérique :
« Vous devez partir ? Oh ! jeune Herr, vous devez partir ? » Elle était dans un tel état d’excitation qu’elle semblait avoir perdu toute maîtrise de l’allemand qu’elle connaissait et le mélangeait à une autre langue que je ne connaissais pas du tout. Je parvenais tout juste à la suivre en lui posant de nombreuses questions. Lorsque je lui ai dit que je devais partir immédiatement et que j’étais occupé par des affaires importantes, elle m’a demandé à nouveau :
« Savez-vous quel jour nous sommes aujourd’hui ? » Je lui ai répondu que nous étions le 4 mai. Elle a secoué la tête et m’a répété :
« Oh, oui ! Je le sais ! Je le sais, mais savez-vous quel jour nous sommes ? » Comme je lui disais que je ne comprenais pas, elle poursuivit :
« C’est la veille de la Saint-Georges. Ne savez-vous pas que ce soir, lorsque l’horloge sonnera minuit, toutes les forces du mal régneront en maître sur le monde ? Savez-vous où vous allez et ce qui vous attend ? » Elle était manifestement si bouleversée que j’ai essayé de la réconforter, mais en vain. Finalement, elle s’est agenouillée et m’a supplié de ne pas partir, ou du moins d’attendre un jour ou deux avant de partir. Tout cela était très ridicule, mais je ne me sentais pas à l’aise. Cependant, j’avais des affaires à régler et je ne pouvais permettre à rien de m’en empêcher. J’ai donc essayé de la relever et je lui ai dit, aussi gravement que possible, que je la remerciais, mais qu’ , mon devoir était impératif et que je devais partir. Elle s’est alors levée, a séché ses yeux et, prenant un crucifix autour de son cou, me l’a offert. Je ne savais pas quoi faire, car, en tant que membre de l’Église anglicane, on m’a appris à considérer de telles choses comme une forme d’idolâtrie, mais il me semblait si impoli de refuser le geste d’une vieille dame qui avait de si bonnes intentions et se trouvait dans un tel état d’esprit. Elle a dû voir le doute sur mon visage, car elle a mis le rosaire autour de mon cou et m’a dit : « Pour le bien de votre mère », avant de quitter la pièce. J’écris cette partie du journal en attendant la diligence, qui est bien sûr en retard, et le crucifix est toujours autour de mon cou. Je ne sais pas si c’est la crainte de la vieille dame, les nombreuses traditions fantomatiques de cet endroit ou le crucifix lui-même, mais je ne me sens pas aussi serein que d’habitude. Si ce livre parvient à Mina avant moi, qu’il lui transmette mes adieux. Voilà la diligence !
5 mai. Le château. — Le gris du matin a disparu, et le soleil est haut dans le lointain horizon, qui semble dentelé, je ne sais pas si c’est par des arbres ou des collines, car il est si loin que les grandes choses et les petites se confondent. Je n’ai pas sommeil, et comme on ne m’appellera pas avant que je me réveille, j’écris naturellement jusqu’à ce que le sommeil vienne. Il y a beaucoup de choses étranges à noter, et, de peur que ceux qui les liront ne s’imaginent que j’ai trop bien dîné avant de quitter Bistritz, je vais décrire mon dîner en détail. J’ai dîné de ce qu’ils appellent un « steak de brigand » : des morceaux de lard, d’oignon et de bœuf, assaisonnés de poivre rouge, enfilés sur des brochettes et rôtis au feu, à la manière simple de la viande pour chats de Londres ! Le vin était un Golden Mediasch, qui produit une étrange sensation de picotement sur la langue, qui n’est toutefois pas désagréable. Je n’en ai bu que deux verres, et rien d’autre.
Quand je suis monté dans la diligence, le cocher n’avait pas pris place et je l’ai vu discuter avec la propriétaire. Ils parlaient manifestement de moi, car ils me regardaient de temps en temps, et certaines des personnes assises sur le banc devant la porte – qu’ils appellent par un nom qui signifie « porte-parole » – sont venues écouter, puis m’ont regardé, la plupart avec pitié. J’entendais souvent répéter beaucoup de mots, des mots étranges, car il y avait de nombreuses nationalités dans la foule ; j’ai donc discrètement sorti mon dictionnaire polyglotte de mon sac et je les ai cherchés. Je dois dire qu’ils ne m’acclamaient pas, car parmi eux se trouvaient « Ordog » - Satan, « pokol » - l’enfer, « stregoica » - sorcière, « vrolok » et « vlkoslak » - qui signifient tous deux la même chose, l’un étant slovaque et l’autre serbe pour désigner soit un loup-garou, soit un vampire. (Mémo : je dois interroger le comte sur ces superstitions).
Lorsque nous sommes partis, la foule rassemblée autour de la porte de l’auberge, qui avait entre-temps considérablement grossi, a fait le signe de croix et m’a pointé du doigt. J’ai eu du mal à faire comprendre à un autre passager ce que cela signifiait ; il n’a pas voulu répondre au début, mais quand il a appris que j’étais anglais, il m’a expliqué que c’était un charme ou une protection contre le mauvais œil. Ce n’était pas très agréable pour moi, qui partais vers un endroit inconnu pour rencontrer un homme inconnu, mais tout le monde semblait si gentil, si triste et si compatissant que je ne pouvais m’empêcher d’être touché. Je n’oublierai jamais la dernière image que j’ai eue de la cour de l’auberge et de sa foule de personnages pittoresques, tous se signant, debout autour de la large arcade, avec en arrière-plan le feuillage luxuriant des lauriers roses et des orangers dans des bacs verts regroupés au centre de la cour. Puis notre cocher, dont les larges culottes de lin couvraient tout l’avant du siège du cocher - « gotza » comme on les appelle - fit claquer son grand fouet sur ses quatre petits chevaux, qui couraient côte à côte, et nous nous mîmes en route.
Je perdis rapidement de vue et de mémoire mes craintes fantomatiques dans la beauté du paysage qui défilait sous nos yeux, même si j’avais connu la langue, ou plutôt les langues, que parlaient mes compagnons de voyage, je n’aurais peut-être pas pu m’en débarrasser aussi facilement. Devant nous s’étendait une terre verdoyante en pente, couverte de forêts et de bois, avec ici et là des collines escarpées, couronnées de bosquets d’arbres ou de fermes, dont les pignons aveugles donnaient sur la route. Il y avait partout une masse étourdissante de fleurs fruitières - pommiers, pruniers, poiriers, cerisiers - et, tandis que nous roulions, je pouvais voir l’herbe verte sous les arbres parsemée de pétales tombés. La route serpentait entre ces collines verdoyantes de ce qu’on appelle ici le « Mittel Land », se perdant dans les courbes herbeuses ou disparaissant derrière les extrémités éparses des pinèdes qui descendaient ici et là les flancs des collines comme des langues de feu. La route était accidentée, mais nous semblions la parcourir à toute vitesse, avec une hâte fébrile. Je ne comprenais pas alors pourquoi nous étions si pressés, mais le conducteur était manifestement déterminé à ne pas perdre de temps pour atteindre Borgo Prund. On m’a dit que cette route était excellente en été, mais qu’elle n’avait pas encore été remise en état après les neiges de l’hiver. À cet égard, elle diffère de la plupart des routes des Carpates, car selon une vieille tradition, celles-ci ne doivent pas être trop bien entretenues. Autrefois, les hospadars ne les réparaient pas, de peur que les Turcs ne pensent qu’ils se préparaient à faire venir des troupes étrangères et ne précipitent ainsi la guerre qui était toujours sur le point d’éclater.
Au-delà des collines verdoyantes du Mittel Land s’élevaient les puissantes pentes boisées de l’ , jusqu’aux hauts sommets des Carpates elles-mêmes. À droite et à gauche, elles se dressaient, baignées par le soleil de l’après-midi qui faisait ressortir toutes les couleurs magnifiques de cette belle chaîne de montagnes, d’un bleu profond et violet dans l’ombre des sommets, vertes et brunes là où l’herbe et la roche se mêlaient, et une perspective infinie de rochers déchiquetés et de pics pointus, jusqu’à ce qu’ils se perdent eux-mêmes dans le lointain, où s’élevaient majestueusement les sommets enneigés. Ci et là, il semblait y avoir de puissantes fissures dans les montagnes, à travers lesquelles, alors que le soleil commençait à descendre, nous voyions de temps en temps le reflet blanc de l’eau qui tombait. L’un de mes compagnons m’a touché le bras alors que nous contournions le pied d’une colline et que nous découvrions le sommet enneigé d’une montagne qui semblait, alors que nous serpentions sur notre chemin, se trouver juste devant nous :
« Regardez ! Isten szek ! » — « Le siège de Dieu ! » — et il se signa respectueusement.
Alors que nous continuions notre route sans fin et que le soleil descendait de plus en plus bas derrière nous, les ombres du soir commencèrent à nous envahir. Ce phénomène était accentué par le fait que le sommet enneigé de la montagne reflétait encore le coucher du soleil et semblait briller d’un rose délicat et frais. Ici et là, nous croisions des Tchèques et des Slovaques, tous vêtus de costumes pittoresques, mais je remarquai que le goitre était douloureusement répandu. Au bord de la route, il y avait de nombreuses croix, et lorsque nous passions devant, mes compagnons se signaient tous. Ici et là, un paysan ou une paysanne était agenouillé(e) devant un sanctuaire, sans même se retourner à notre approche, mais semblant, dans son abandon à la dévotion, n’avoir ni yeux ni oreilles pour le monde extérieur. Beaucoup de choses étaient nouvelles pour moi : par exemple, les meules de foin dans les arbres, et ici et là de très beaux bouquets de bouleaux pleureurs, dont les tiges blanches brillaient comme de l’argent à travers le vert délicat des feuilles. De temps en temps, nous croisions une charrette à ridelles, la charrette ordinaire des paysans, avec sa longue colonne vertébrale en forme de serpent, conçue pour s’adapter aux irrégularités de la route. On y trouvait immanquablement tout un groupe de paysans rentrant chez eux, les Tchèques avec leurs peaux de mouton blanches et les Slovaques avec leurs peaux colorées, ces derniers portant à la manière d’une lance leurs longs bâtons, avec une hache à leur extrémité. À la tombée de la nuit, il commença à faire très froid, et le crépuscule grandissant semblait fondre dans une brume sombre la pénombre des arbres, chênes, hêtres et pins, bien que dans les vallées qui s’enfonçaient profondément entre les contreforts des collines, alors que nous montions à travers le col, les sapins sombres se détachaient ici et là sur le fond de la neige tardive. Parfois, lorsque la route traversait les forêts de pins qui semblaient se refermer sur nous dans l’obscurité, de grandes masses de grisaille, qui parsemaient ici et là les arbres, produisaient un effet particulièrement étrange et solennel, qui prolongeait les pensées et les sombres fantaisies engendrées plus tôt dans la soirée, lorsque le soleil couchant projetait un relief étrange sur les nuages fantomatiques qui, dans les Carpates, semblent s’enrouler sans cesse à travers les vallées. Parfois, les collines étaient si escarpées que, malgré la hâte de notre cocher, les chevaux ne pouvaient avancer que lentement. Je souhaitais descendre et les gravir à pied, comme nous le faisons chez nous, mais le cocher ne voulait rien entendre. « Non, non, disait-il, vous ne devez pas marcher ici, les chiens sont trop féroces » ; puis il ajoutait, avec ce qui semblait être une plaisanterie sinistre, car il regardait autour de lui pour capter le sourire approbateur des autres : « et vous en aurez peut-être assez avant de vous endormir ». Le seul arrêt qu’il acceptait de faire était une pause pour allumer ses lampes.
À la tombée de la nuit, les passagers semblèrent s’agiter et se mirent à lui parler les uns après les autres, comme pour le presser d’accélérer. Il fouetta les chevaux sans pitié avec son long fouet et, poussant des cris sauvages d’encouragement, les incita à redoubler d’efforts. Puis, dans l’obscurité, je vis devant nous une sorte de tache de lumière grise, comme s’il y avait une brèche dans les collines. L’excitation des passagers grandissait ; la diligence folle se balançait sur ses grands ressorts en cuir et tanguait comme un bateau ballotté par une mer déchaînée. Je devais m’accrocher. La route devenait plus plate et nous semblions voler. Puis les montagnes semblaient se rapprocher de nous de chaque côté et nous regarder d’un air menaçant ; nous entrions dans le col de Borgo. Les uns après les autres, plusieurs passagers m’offrirent des cadeaux, qu’ils me remirent avec une insistance qui ne souffrait aucun refus ; ceux-ci étaient certes étranges et variés, mais chacun était offert en toute sincérité, accompagné d’un mot aimable, d’une bénédiction et de cet étrange mélange de gestes inquiétants que j’avais vu à l’extérieur de l’hôtel à Bistritz : le signe de croix et la protection contre le mauvais œil. Puis, alors que nous roulions à toute allure, le conducteur se pencha en avant et, de chaque côté, les passagers, se penchant par-dessus le bord de la voiture, scrutaient avidement l’obscurité. Il était évident que quelque chose de très excitant était en train de se produire ou était attendu, mais bien que j’aie interrogé chaque passager, personne ne m’a donné la moindre explication. Cet état d’excitation a duré un certain temps, puis nous avons enfin vu devant nous le col s’ouvrir sur le côté est. Au-dessus de nos têtes, des nuages sombres et roulants s’amoncelaient, et l’air était chargé d’un sentiment oppressant de tonnerre. Il semblait que la chaîne de montagnes avait séparé deux atmosphères et que nous étions maintenant entrés dans celle où grondait le tonnerre. Je cherchais moi-même du regard le véhicule qui devait m’emmener chez le comte. À chaque instant, je m’attendais à voir la lueur des lampes à travers l’obscurité, mais tout était noir. La seule lumière provenait des rayons vacillants de nos propres lampes, dans lesquels la vapeur de nos chevaux épuisés s’élevait en un nuage blanc. Nous pouvions maintenant voir la route sablonneuse s’étendre devant nous, mais il n’y avait aucun signe d’un véhicule. Les passagers reculèrent avec un soupir de joie, qui semblait se moquer de ma propre déception. Je réfléchissais déjà à ce que je devais faire lorsque le conducteur, regardant sa montre, dit aux autres quelque chose que je pouvais à peine entendre, tant il parlait doucement et à voix basse ; je crus comprendre « Une heure de moins que prévu ». Puis, se tournant vers moi, il me dit dans un allemand pire que le mien :
« Il n’y a pas de calèche ici. Le Herr n’est finalement pas attendu. Il va maintenant se rendre en Bucovine et reviendra demain ou après-demain ; mieux vaut après-demain. » Pendant qu’il parlait, les chevaux se mirent à hennir, à renifler et à s’emballer, de sorte que le cocher dut les retenir. Puis, sous les cris des paysans et leurs signes de croix, une calèche tirée par quatre chevaux arriva derrière nous, nous dépassa et s’arrêta à côté de la diligence. À la lueur de nos lampes, je pouvais voir que les chevaux étaient d’un noir de jais et magnifiques. Ils étaient conduits par un homme grand, avec une longue barbe brune et un grand chapeau noir qui semblait cacher son visage. Je ne pouvais voir que l’éclat d’une paire d’yeux très brillants, qui semblaient rouges à la lumière de la lampe, lorsqu’il se tourna vers nous. Il dit au cocher :
« Vous êtes en avance ce soir, mon ami. » L’homme balbutia en réponse :
« Le Herr anglais était pressé », ce à quoi l’étranger répondit :
« C’est pourquoi, je suppose, vous avez souhaité qu’il se rende en Bucovine. Vous ne pouvez pas me tromper, mon ami ; j’en sais trop, et mes chevaux sont rapides. » Tout en parlant, il sourit, et la lumière de la lampe éclaira une bouche à l’expression sévère, aux lèvres très rouges et aux dents acérées, blanches comme de l’ivoire. L’un de mes compagnons murmura à l’oreille d’un autre une phrase tirée du poème « Lenore » de Burger :
« Denn die Todten reiten schnell »
(« Car les morts voyagent vite »).
L’étrange cocher entendit manifestement ces mots, car il leva les yeux avec un sourire brillant. Le passager détourna le visage, tout en faisant le signe de croix avec deux doigts. « Donnez-moi les bagages de Monsieur », dit le cocher ; et avec une extrême promptitude, mes sacs furent sortis et placés dans la calèche. Je descendis alors du côté de la diligence, tandis que la calèche s’approchait, le cocher m’aidant d’une main qui saisit mon bras dans une étreinte d’acier ; sa force devait être prodigieuse. Sans un mot, il secoua ses rênes, les chevaux firent demi-tour et nous nous enfonçâmes dans l’obscurité du col. En me retournant, je vis la vapeur des chevaux de la diligence à la lumière des lampes, et projetées contre elle, les silhouettes de mes anciens compagnons se signant. Puis le cocher fit claquer son fouet et appela ses chevaux, qui s’élancèrent vers la Bucovine. Alors qu’ils disparaissaient dans l’obscurité, je ressentis un étrange frisson et un sentiment de solitude m’envahit ; mais on me jeta une cape sur les épaules et une couverture sur les genoux, et le cocher me dit dans un excellent allemand :
« La nuit est fraîche, mein Herr, et mon maître, le comte, m’a demandé de prendre soin de vous. Il y a une flasque de slivovitz (l’eau-de-vie de prune du pays) sous le siège, si vous en avez besoin. » Je n’en ai pas pris, mais c’était réconfortant de savoir qu’elle était là. Je me sentais un peu étrange et assez effrayé. Je pense que s’il y avait eu une autre solution, je l’aurais choisie plutôt que de poursuivre ce voyage nocturne vers l’inconnu. La voiture roulait à vive allure en ligne droite, puis nous avons fait demi-tour et avons pris une autre route rectiligne. J’avais l’impression que nous refaisions sans cesse le même trajet, alors j’ai pris note de certains points saillants et j’ai constaté que c’était bien le cas. J’aurais aimé demander au conducteur ce que tout cela signifiait, mais j’avais vraiment peur de le faire, car je pensais que, dans ma situation, toute protestation serait vaine s’il y avait une intention de nous retarder. Peu à peu, cependant, comme j’étais curieux de savoir combien de temps s’était écoulé, j’ai craqué une allumette et, à la lueur de la flamme, j’ai regardé ma montre ; il était minuit moins quelques minutes. Cela m’a quelque peu choqué, car je suppose que la superstition générale concernant minuit avait été renforcée par mes récentes expériences. J’ai attendu avec un sentiment de suspense malsain.
Puis un chien se mit à hurler quelque part dans une ferme loin sur la route, un long gémissement angoissé, comme s’il avait peur. Le son fut repris par un autre chien, puis un autre et encore un autre, jusqu’à ce que, porté par le vent qui soufflait maintenant doucement à travers le col, un hurlement sauvage commença, qui semblait venir de tout le pays, aussi loin que l’imagination pouvait le saisir dans l’obscurité de la nuit. Au premier hurlement, les chevaux ont commencé à tirer sur l’ et à se cabrer, mais le cocher leur a parlé d’une voix apaisante et ils se sont calmés, tout en tremblant et en transpirant comme s’ils venaient de s’emballer sous l’effet d’une frayeur soudaine. Puis, au loin, depuis les montagnes de chaque côté de nous, un hurlement plus fort et plus aigu commença, celui des loups, qui affecta les chevaux et moi-même de la même manière, car j’avais envie de sauter de la calèche et de courir, tandis qu’ils se cabraient à nouveau et plongeaient follement, de sorte que le cocher dut utiliser toute sa force pour les empêcher de s’enfuir. En quelques minutes, cependant, mes oreilles s’habituèrent au bruit, et les chevaux se calmèrent suffisamment pour que le cocher puisse descendre et se placer devant eux. Il les caressa et les apaisa, leur chuchotant quelque chose à l’oreille, comme je l’ai entendu faire par des dompteurs de chevaux, et avec un effet extraordinaire, car sous ses caresses, ils redevinrent tout à fait maniables, même s’ils tremblaient encore. Le cocher reprit place dans son siège, secoua les rênes et repartit à vive allure. Cette fois, après avoir franchi le col, il bifurqua soudainement sur une route étroite qui tournait brusquement à droite.
Bientôt, nous fûmes entourés d’arbres qui, par endroits, formaient une voûte au-dessus de la route, nous faisant passer comme dans un tunnel ; et de nouveau, de grands rochers menaçants nous protégeaient hardiment de chaque côté. Bien que nous fussions à l’abri, nous pouvions entendre le vent qui se levait, car il gémissait et sifflait à travers les rochers, et les branches des arbres s’entrechoquaient tandis que nous avancions à toute allure. Il faisait de plus en plus froid, et une fine neige poudreuse commença à tomber, de sorte que bientôt, nous étions recouverts d’un manteau blanc, tout comme tout ce qui nous entourait. Le vent violent continuait de porter les hurlements des chiens, bien qu’ils s’affaiblissent à mesure que nous avancions. Les aboiements des loups semblaient se rapprocher de plus en plus, comme s’ils nous encerclaient de tous côtés. Je pris terriblement peur, et les chevaux partageaient ma crainte. Le conducteur, cependant, ne semblait pas le moins du monde perturbé ; il tournait la tête à gauche et à droite, mais je ne voyais rien dans l’obscurité.
Soudain, loin sur notre gauche, j’aperçus une faible flamme bleue vacillante. Le cocher la vit au même moment ; il retint aussitôt les chevaux, sauta à terre et disparut dans l’obscurité. Je ne savais que faire, d’autant plus que les hurlements des loups se rapprochaient ; mais alors que je m’interrogeais, le cocher réapparut soudainement, reprit place sans un mot et nous poursuivîmes notre route. Je pense que j’ai dû m’endormir et continuer à rêver de cet incident, car il semblait se répéter à l’infini, et maintenant, avec le recul, cela ressemble à une sorte de cauchemar horrible. À un moment donné, la flamme est apparue si près de la route que, même dans l’obscurité qui nous entourait, je pouvais observer les mouvements du cocher. Il s’est rapidement dirigé vers l’endroit où la flamme bleue s’élevait - elle devait être très faible, car elle ne semblait pas éclairer du tout les environs - et, ramassant quelques pierres, il les a disposées de manière à former un dispositif. Un effet optique étrange est alors apparu : lorsqu’il se tenait entre moi et la flamme, il ne la cachait pas, car je pouvais tout de même voir son scintillement fantomatique. Cela m’a surpris, mais comme l’effet n’était que momentané, j’ai pensé que mes yeux m’avaient trompé en forçant dans l’obscurité. Puis, pendant un certain temps, il n’y eut plus de flammes bleues, et nous avons continué à avancer rapidement dans la pénombre, avec les hurlements des loups autour de nous, comme s’ils nous suivaient en formant un cercle mobile.
Finalement, le conducteur s’éloigna plus que jamais, et pendant son absence, les chevaux se mirent à trembler plus que jamais et à renifler et hurler de peur. Je ne voyais aucune raison à cela, car les hurlements des loups avaient complètement cessé ; mais à ce moment-là, la lune, naviguant à travers les nuages noirs, apparut derrière la crête déchiquetée d’un rocher escarpé couvert de pins, et à sa lumière, je vis autour de nous un cercle de loups, avec des dents blanches et des langues rouges pendantes, des membres longs et musclés et un pelage hirsute. Ils étaient cent fois plus terrifiants dans le silence sinistre qui les enveloppait que lorsqu’ils hurlaient. Pour ma part, je me sentais comme paralysé par la peur. Ce n’est que lorsqu’un homme se trouve face à de telles horreurs qu’il peut en comprendre la véritable signification.
Tout à coup, les loups se mirent à hurler, comme si le clair de lune avait eu un effet particulier sur eux. Les chevaux bondirent et se cabrèrent, regardant autour d’eux d’un air désemparé, les yeux exorbités, ce qui était pénible à voir ; mais le cercle vivant de la terreur les encerclait de tous côtés et ils étaient contraints d’y rester. J’appelai le cocher pour qu’il vienne, car il me semblait que notre seule chance était d’essayer de briser le cercle et de l’aider à s’approcher. Je criai et frappai le côté de la calèche, espérant que le bruit effraierait les loups de ce côté-là, afin de lui donner une chance d’atteindre la calèche. Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais j’ai entendu sa voix s’élever d’un ton impérieux, et en regardant vers le bruit, je l’ai vu debout sur la route. Alors qu’il balayait ses longs bras, comme pour repousser un obstacle impalpable, les loups reculèrent de plus en plus loin. À ce moment-là, un nuage épais passa devant la lune, nous plongeant à nouveau dans l’obscurité.
Quand je pus voir à nouveau, le cocher était en train de monter dans la calèche et les loups avaient disparu. Tout cela était si étrange et si inquiétant qu’une peur terrible m’envahit et que j’eus l e peur de parler ou de bouger. Le temps me parut interminable tandis que nous poursuivions notre route, désormais dans l’obscurité presque totale, car les nuages roulants obscurcissaient la lune. Nous continuions à monter, avec parfois de brèves descentes, mais dans l’ensemble, nous montions toujours. Soudain, je pris conscience que le cocher était en train d’arrêter les chevaux dans la cour d’un vaste château en ruines, dont les hautes fenêtres noires ne laissaient passer aucun rayon de lumière et dont les remparts brisés formaient une ligne irrégulière contre le ciel éclairé par la lune.
CHAPITRE II : JOURNAL DE JONATHAN HARKER — suite
5 mai. — Je devais être endormi, car si j’avais été pleinement éveillé, j’aurais certainement remarqué l’approche d’un lieu aussi remarquable. Dans la pénombre, la cour semblait être de taille considérable, et comme plusieurs chemins sombres en partaient sous de grandes arcades rondes, elle semblait peut-être plus grande qu’elle ne l’est en réalité. Je n’ai pas encore pu la voir à la lumière du jour.
Lorsque la calèche s’arrêta, le cocher sauta à terre et me tendit la main pour m’aider à descendre. Une fois de plus, je ne pus m’empêcher de remarquer sa force prodigieuse. Sa main ressemblait en effet à un étau d’acier qui aurait pu écraser la mienne s’il l’avait voulu. Il sortit ensuite mes bagages et les posa par terre à côté de moi, alors que je me tenais près d’une grande porte ancienne, cloutée de gros clous de fer et encastrée dans un portail en pierre massive. Même dans la pénombre, je pouvais voir que la pierre était massivement sculptée, mais que les sculptures avaient été fortement usées par le temps et les intempéries. Alors que je restais debout, le cocher sauta à nouveau sur son siège et secoua les rênes ; les chevaux se mirent en route, et les bagages et tout le reste disparurent dans l’une des ouvertures sombres.
Je restai silencieux là où j’étais, car je ne savais pas quoi faire. Il n’y avait ni sonnette ni heurtoir ; à travers ces murs austères et ces fenêtres sombres, il était peu probable que ma voix puisse passer. Le temps que j’attendis me sembla interminable, et je sentis les doutes et les craintes m’envahir. Dans quel genre d’endroit étais-je venu, et parmi quel genre de personnes ? Dans quelle sinistre aventure m’étais-je embarqué ? Était-ce là un incident habituel dans la vie d’un clerc de notaire envoyé pour expliquer l’achat d’un domaine londonien à un étranger ? Clerc de notaire ! Mina n’aimerait pas cela. Notaire… car juste avant de quitter Londres, j’ai appris que j’avais réussi mon examen et que j’étais désormais notaire à part entière ! Je me suis frotté les yeux et pincé pour voir si j’étais bien réveillé. Tout cela me semblait être un horrible cauchemar, et je m’attendais à me réveiller soudainement et à me retrouver chez moi, avec l’aube qui se frayait un chemin à travers les fenêtres, comme cela m’était arrivé à plusieurs reprises le matin après une journée de travail intense. Mais ma chair répondit au test du pincement, et mes yeux ne pouvaient être trompés. J’étais bel et bien éveillé et je me trouvais dans les Carpates. Tout ce que je pouvais faire maintenant était d’être patient et d’attendre le lever du jour.
Au moment où j’arrivais à cette conclusion, j’entendis des pas lourds s’approcher derrière la grande porte et vis à travers les interstices la lueur d’une lumière qui se rapprochait. Puis j’entendis le bruit de chaînes qui s’entrechoquaient et le cliquetis de lourds verrous qui s’ouvraient. Une clé tourna dans la serrure avec le grincement bruyant d’un objet longtemps inutilisé, et la grande porte s’ouvrit.
À l’intérieur se tenait un vieil homme de grande taille, rasé de près à l’exception d’une longue moustache blanche, vêtu de noir de la tête aux pieds, sans la moindre touche de couleur. Il tenait à la main une lampe en argent antique, dont la flamme brûlait sans abat-jour ni globe, projetant de longues ombres tremblantes qui vacillaient dans le courant d’air de la porte ouverte. Le vieil homme me fit signe d’entrer de la main droite avec un geste courtois, en disant dans un anglais excellent, mais avec une intonation étrange :
« Bienvenue dans ma maison ! Entrez librement et de votre plein gré ! » Il ne fit aucun geste pour venir à ma rencontre, mais resta debout comme une statue, comme si son geste de bienvenue l’avait figé dans la pierre. Cependant, dès que j’eus franchi le seuil, il s’avança impulsivement et me serra la main avec une force qui me fit grimacer, effet qui ne fut pas atténué par le fait qu’elle semblait aussi froide que de la glace, plus semblable à la main d’un mort qu’à celle d’un vivant. Il répéta :
« Bienvenue dans ma maison. Entrez librement. Partez en toute sécurité et laissez quelque chose du bonheur que vous apportez ! » La force de la poignée de main était si semblable à celle que j’avais remarquée chez le cocher, dont je n’avais pas vu le visage, que pendant un instant, je me suis demandé si ce n’était pas la même personne à qui je parlais ; alors, pour m’en assurer, j’ai demandé :
« Comte Dracula ? » Il s’inclina avec courtoisie et répondit :
« Je suis Dracula, et je vous souhaite la bienvenue, M. Harker, dans ma maison. Entrez, l’air nocturne est frais, et vous devez avoir besoin de manger et de vous reposer. » Tout en parlant, il posa la lampe sur un support mural, sortit et prit mes bagages ; il les avait transportés à l’intérieur avant que je puisse l’en empêcher. Je protestai, mais il insista :
« Non, monsieur, vous êtes mon invité. Il est tard et mes domestiques ne sont pas disponibles. Laissez-moi m’occuper moi-même de votre confort. » Il insista pour porter mes bagages dans le couloir, puis dans un grand escalier en colimaçon, et dans un autre grand couloir, sur le sol en pierre duquel nos pas résonnaient lourdement. Au bout de celui-ci, il ouvrit une lourde porte, et je me réjouis de voir à l’intérieur une pièce bien éclairée dans laquelle une table était dressée pour le souper, et sur la grande cheminée de laquelle un grand feu de bûches, fraîchement alimenté, flambait et crépitait.
Le comte s’arrêta, posa mes bagages, ferma la porte, traversa la pièce et ouvrit une autre porte qui donnait sur une petite pièce octogonale éclairée par une seule lampe et qui semblait dépourvue de toute fenêtre. Après l’avoir franchie, il ouvrit une autre porte et me fit signe d’entrer. Ce fut un spectacle réjouissant, car il s’agissait d’une grande chambre bien éclairée et chauffée par un autre feu de bois, également alimenté récemment, car les bûches du dessus étaient fraîches, qui faisait résonner un grondement sourd dans la large cheminée. Le comte lui-même laissa mes bagages à l’intérieur et se retira, en disant avant de fermer la porte :
« Après votre voyage, vous aurez besoin de vous rafraîchir en faisant votre toilette. Je suis sûr que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous serez prêt, venez dans l’autre pièce, où votre souper vous attendra. »
La lumière, la chaleur et l’accueil courtois du comte semblaient avoir dissipé tous mes doutes et mes craintes. Ayant alors retrouvé mon état normal, je découvris que j’étais à moitié affamé ; je fis donc rapidement ma toilette et me rendis dans l’autre pièce.
Le souper était déjà servi. Mon hôte, qui se tenait d’un côté de la grande cheminée, appuyé contre la maçonnerie, fit un gracieux geste de la main vers la table et dit :
« Je vous prie de vous asseoir et de souper à votre guise. J’espère que vous m’excuserez de ne pas me joindre à vous, mais j’ai déjà dîné et je ne souperai pas. »
Je lui tendis la lettre scellée que M. Hawkins m’avait confiée. Il l’ouvrit et la lut gravement ; puis, avec un sourire charmant, il me la tendit pour que je la lise. Un passage au moins me procura un frisson de plaisir.
« Je regrette qu’une crise de goutte, dont je souffre constamment, m’empêche absolument de voyager pendant quelque temps, mais je suis heureux de pouvoir vous envoyer un remplaçant compétent, en qui j’ai toute confiance. C’est un jeune homme plein d’énergie et de talent à sa manière, et d’un caractère très fidèle. Il est discret et silencieux, et a atteint l’âge adulte à mon service. Il sera prêt à vous servir quand vous le souhaiterez pendant son séjour, et suivra vos instructions en toutes choses. »
Le comte s’avança et ôta le couvercle d’un plat en é , et je me jetai aussitôt sur un excellent poulet rôti. Ce repas, accompagné de fromage, d’une salade et d’une bouteille de vieux Tokay, dont je bus deux verres, constitua mon souper. Pendant que je mangeais, le comte me posa de nombreuses questions sur mon voyage, et je lui racontai peu à peu tout ce que j’avais vécu.
À ce moment-là, j’avais terminé mon souper et, à la demande de mon hôte, j’avais approché une chaise du feu et commencé à fumer un cigare qu’il m’avait offert, tout en s’excusant de ne pas fumer lui-même. J’avais maintenant l’occasion de l’observer et je trouvais qu’il avait une physionomie très marquée.
Son visage était fort, très fort, aquilin, avec un nez fin et haut et des narines particulièrement arquées ; il avait un front bombé et des cheveux clairsemés sur les tempes, mais abondants ailleurs. Ses sourcils étaient très épais, se rejoignant presque au-dessus du nez, et ses cheveux touffus semblaient boucler sous leur propre poids. La bouche, pour autant que je pouvais la voir sous la moustache épaisse, était figée et plutôt cruelle, avec des dents blanches particulièrement pointues ; celles-ci dépassaient des lèvres, dont la rougeur remarquable témoignait d’une vitalité étonnante chez un homme de son âge. Pour le reste, ses oreilles étaient pâles et extrêmement pointues au sommet ; le menton était large et fort, et les joues fermes mais minces. L’effet général était celui d’une pâleur extraordinaire.
Jusqu’alors, j’avais remarqué le dos de ses mains posées sur ses genoux à la lueur du feu, et elles m’avaient semblé plutôt blanches et fines ; mais en les voyant maintenant de près, je ne pouvais m’empêcher de remarquer qu’elles étaient plutôt grossières, larges, avec des doigts trapus. Chose étrange, il y avait des poils au centre de la paume. Les ongles étaient longs et fins, coupés en pointe. Lorsque le comte se pencha sur moi et que ses mains me touchèrent, je ne pus réprimer un frisson. C’était peut-être son haleine fétide, mais un horrible sentiment de nausée m’envahit, que je ne pus dissimuler malgré tous mes efforts. Le comte, qui l’avait manifestement remarqué, se recula et, avec un sourire sinistre qui révélait plus que jamais ses dents proéminentes, il se rassit de son côté de la cheminée. Nous restâmes tous deux silencieux pendant un moment ; et en regardant vers la fenêtre, je vis les premières lueurs de l’aube naissante. Tout semblait étrangement calme, mais en tendant l’oreille, j’entendis comme le hurlement de nombreux loups provenant de la vallée en contrebas. Les yeux du comte brillèrent et il dit :
« Écoutez-les, les enfants de la nuit. Quelle musique ils font ! » Voyant, je suppose, une expression étrange sur mon visage, il ajouta :
« Ah, monsieur, vous qui vivez en ville, vous ne pouvez pas comprendre les sentiments du chasseur. » Puis il se leva et dit :
« Mais vous devez être fatigué. Votre chambre est prête, et demain, vous pourrez dormir aussi tard que vous le souhaitez. Je dois m’absenter jusqu’à cet après-midi ; alors dormez bien et faites de beaux rêves ! » Avec une révérence courtoise, il m’ouvrit lui-même la porte de la pièce octogonale, et j’entrai dans ma chambre…
Je suis submergé par une vague d’étonnement. Je doute, j’ai peur, je pense à des choses étranges que je n’ose pas avouer à ma propre âme. Que Dieu me protège, ne serait-ce que pour le bien de mes proches !
7 mai. — C’est de nouveau tôt le matin, mais je me suis reposé et j’ai apprécié les dernières vingt-quatre heures. J’ai dormi tard dans la journée et je me suis réveillé de mon propre chef. Après m’être habillé, je me suis rendu dans la pièce où nous avions soupé et j’ai trouvé un petit-déjeuner froid préparé, avec du café maintenu au chaud dans une cafetière placée sur la cheminée. Il y avait une carte sur la table, sur laquelle était écrit :
« Je dois m’absenter un moment. Ne m’attendez pas. — D. » Je me suis mis à table et j’ai savouré un copieux repas. Quand j’ai eu fini, j’ai cherché une cloche pour signaler aux domestiques que j’avais terminé, mais je n’en ai pas trouvé. Il y a certainement des lacunes étranges dans la maison, compte tenu des preuves extraordinaires de richesse qui m’entourent. Le service de table est en or et si magnifiquement ouvragé qu’il doit avoir une valeur inestimable. Les rideaux et les tissus d’ameublement des chaises et des canapés, ainsi que les tentures de mon lit, sont faits des tissus les plus coûteux et les plus beaux, et devaient avoir une valeur fabuleuse lorsqu’ils ont été fabriqués, car ils ont plusieurs siècles, bien qu’ils soient en excellent état. J’ai vu des tissus similaires à Hampton Court, mais ils étaient usés, effilochés et rongés par les mites. Pourtant, aucune des pièces ne comporte de miroir. Il n’y a même pas de miroir de courtoisie sur ma table, et j’ai dû sortir le petit miroir de rasage de mon sac avant de pouvoir me raser ou me coiffer. Je n’ai encore vu aucun domestique et n’ai entendu aucun bruit près du château, à part les hurlements des loups. Quelque temps après avoir terminé mon repas – je ne sais pas si je dois l’appeler petit-déjeuner ou dîner, car il était entre cinq et six heures lorsque je l’ai pris –, j’ai cherché quelque chose à lire, car je ne voulais pas me promener dans le château avant d’avoir demandé la permission au comte. Il n’y avait absolument rien dans la pièce, ni livre, ni journal, ni même de quoi écrire ; j’ai donc ouvert une autre porte dans la pièce et j’ai trouvé une sorte de bibliothèque. J’ai essayé la porte en face de la mienne, mais elle était fermée à clé.
Dans la bibliothèque, j’ai trouvé, à ma grande joie, un grand nombre de livres anglais d’ , des étagères entières en étaient remplies, ainsi que des volumes reliés de magazines et de journaux. Une table au centre était jonchée de magazines et de journaux anglais, mais aucun d’entre eux n’était très récent. Les livres étaient des plus variés : histoire, géographie, politique, économie politique, botanique, géologie, droit, tous liés à l’Angleterre, à la vie, aux coutumes et aux mœurs anglaises. Il y avait même des ouvrages de référence tels que le London Directory, les livres « rouges » et « bleus », l’almanach Whitaker, les listes de l’armée et de la marine, et, ce qui me réjouissait particulièrement, la liste des lois.
Pendant que je regardais les livres, la porte s’ouvrit et le comte entra. Il me salua chaleureusement et m’a souhaité une bonne nuit de sommeil. Puis il a poursuivi :
« Je suis heureux que vous ayez trouvé votre chemin jusqu’ici, car je suis sûr que vous trouverez beaucoup de choses qui vous intéresseront. Ces compagnons » — et il posa la main sur certains des livres — « ont été de bons amis pour moi et, depuis quelques années, depuis que j’ai eu l’idée d’aller à Londres, ils m’ont procuré de nombreuses heures de plaisir. Grâce à eux, j’ai appris à connaître votre grande Angleterre ; et la connaître, c’est l’aimer. Je rêve de parcourir les rues bondées de votre puissante Londres, d’être au milieu du tourbillon et de l’agitation de l’humanité, de partager sa vie, ses changements, sa mort et tout ce qui fait d’elle ce qu’elle est. Mais hélas ! pour l’instant, je ne connais votre langue qu’à travers les livres. C’est à vous, mon ami, que je compte pour l’apprendre à parler. »
« Mais, comte, lui dis-je, vous connaissez et parlez parfaitement l’anglais ! Il s’inclina gravement.
« Je vous remercie, mon ami, pour votre estimation trop flatteuse, mais je crains de n’être qu’à un petit pas du chemin que je voudrais parcourir. Il est vrai que je connais la grammaire et les mots, mais je ne sais pas encore comment les prononcer.
« Mais vous parlez très bien », dis-je.
— Ce n’est pas vrai, répondit-il. Je sais bien que si je vivais et parlais à Londres, personne ne me prendrait pour un étranger. Mais cela ne me suffit pas. Ici, je suis noble, je suis boyard, le peuple me connaît et je suis maître. Mais un étranger dans un pays étranger n’est personne, les gens ne le connaissent pas, et ne pas le connaître, c’est ne pas s’en soucier. Je me contente d’être comme les autres, afin que personne ne s’arrête en me voyant, ni ne s’interrompe en entendant mes paroles : « Ha, ha ! Un étranger ! » J’ai été maître si longtemps que je voudrais le rester, ou du moins que personne d’autre ne soit mon maître. Vous ne venez pas seulement en tant qu’agent de mon ami Peter Hawkins, d’Exeter, pour me parler de ma nouvelle propriété d’ , à Londres. Je compte sur vous pour rester ici avec moi un moment, afin que je puisse apprendre l’intonation anglaise en discutant avec vous ; et je voudrais que vous me signaliez la moindre erreur que je pourrais commettre en parlant. Je suis désolé d’avoir dû m’absenter si longtemps aujourd’hui, mais je sais que vous pardonnerez à quelqu’un qui a tant d’affaires importantes à régler.
Bien sûr, j’ai dit tout ce que je pouvais pour montrer ma bonne volonté et j’ai demandé si je pouvais entrer dans cette pièce quand je le souhaitais. Il a répondu : « Oui, bien sûr », et a ajouté :
« Vous pouvez aller où vous voulez dans le château, sauf là où les portes sont fermées, où vous ne voudrez bien sûr pas aller. Il y a une raison pour que tout soit ainsi, et si vous voyiez avec mes yeux et saviez ce que je sais, vous comprendriez peut-être mieux. » Je lui ai dit que j’en étais sûr, puis il a poursuivi :
« Nous sommes en Transylvanie, et la Transylvanie n’est pas l’Angleterre. Nos coutumes ne sont pas les vôtres, et vous trouverez ici beaucoup de choses étranges. D’ailleurs, d’après ce que vous m’avez déjà raconté de vos expériences, vous savez déjà à quoi vous attendre. »
Cela donna lieu à une longue conversation ; et comme il était évident qu’il voulait parler, ne serait-ce que pour le plaisir de parler, je lui posai de nombreuses questions sur des choses qui m’étaient déjà arrivées ou qui avaient attiré mon attention. Parfois, il éludait le sujet ou détournait la conversation en faisant semblant de ne pas comprendre, mais en général, il répondait très franchement à toutes mes questions. Puis, au fil du temps, comme je m’étais quelque peu enhardi, je lui ai posé des questions sur certaines des choses étranges qui s’étaient produites la nuit précédente, par exemple pourquoi le cocher s’était rendu aux endroits où il avait vu les flammes bleues. Il m’a alors expliqué que l’on croyait généralement que, lors d’une certaine nuit de l’année – la nuit dernière, en fait, où tous les mauvais esprits sont censés régner sans partage –, une flamme bleue apparaissait au-dessus de tout endroit où un trésor avait été caché. « Il ne fait guère de doute que ce trésor a été caché dans la région que vous avez traversée la nuit dernière, car c’est là que se sont battus pendant des siècles les Valaches, les Saxons et les Turcs. Il n’y a pratiquement pas un mètre carré de terre dans toute cette région qui n’ait été enrichi par le sang des hommes, patriotes ou envahisseurs. Autrefois, les temps étaient agités, lorsque les Autrichiens et les Hongrois arrivaient en hordes et que les patriotes sortaient à leur rencontre – hommes et femmes, vieillards et enfants aussi – et attendaient leur arrivée sur les rochers au-dessus des cols, afin de pouvoir les anéantir avec leurs avalanches artificielles. Lorsque l’envahisseur triomphait, il ne trouvait que peu de choses, car tout ce qui existait avait été mis à l’abri dans le sol ami.
« Mais comment, dis-je, cela a-t-il pu rester si longtemps inconnu, alors qu’il existe un indice certain si les hommes prennent la peine de chercher ? » Le comte sourit, et lorsque ses lèvres se retroussèrent sur ses gencives, ses longues canines acérées apparurent de façon étrange ; il répondit :
« Parce que vos paysans sont au fond des lâches et des imbéciles ! Ces flammes n’apparaissent qu’une seule nuit, et cette nuit-là, aucun homme de ce pays ne sortira de chez lui s’il peut l’éviter. Et même s’il le faisait, il ne saurait pas quoi faire. Même le paysan dont vous me parlez, qui a repéré l’endroit où se trouve la flamme, ne saurait où chercher en plein jour, même pour son propre travail. Même vous, j’en suis sûr, ne seriez pas capable de retrouver ces endroits ?
— Vous avez raison, dis-je. Je ne sais pas plus que les morts où les chercher. Puis nous passâmes à d’autres sujets.
« Venez, dit-il enfin, parlez-moi de Londres et de la maison que vous m’avez trouvée. » Après m’être excusé de ma négligence, je me rendis dans ma chambre pour aller chercher les papiers dans mon sac. Pendant que je les rangeais, j’entendis un bruit de porcelaine et d’argenterie dans la pièce voisine, et en passant, je remarquai que la table avait été débarrassée et que la lampe était allumée, car il faisait déjà nuit noire. Les lampes étaient également allumées dans le bureau ou la bibliothèque, et je trouvai le comte allongé sur le canapé, en train de lire, parmi toutes les choses du monde, un guide Bradshaw anglais. Quand je suis entré, il a débarrassé la table des livres et des papiers, et je me suis mis à discuter avec lui de plans, d’actes et de chiffres en tout genre. Il s’intéressait à tout et m’a posé une myriade de questions sur l’endroit et ses environs. Il avait manifestement étudié au préalable tout ce qu’il pouvait trouver sur le quartier, car à la fin, il en savait manifestement beaucoup plus que moi. Quand je lui en ai fait la remarque, il m’a répondu :
« Eh bien, mon ami, n’est-ce pas nécessaire que je le fasse ? Quand j’irai là-bas, je serai tout seul, et mon ami Harker Jonathan — non, excusez-moi, je retombe dans l’habitude de mon pays de mettre votre patronyme en premier — mon ami Jonathan Harker ne sera pas à mes côtés pour me corriger et m’aider. Il sera à Exeter, à des kilomètres de là, probablement en train de travailler sur des documents juridiques avec mon autre ami, Peter Hawkins. Alors !
Nous nous sommes plongés dans les détails de l’achat du domaine d’ , à Purfleet. Après lui avoir exposé les faits, obtenu sa signature sur les documents nécessaires et rédigé une lettre à l’attention de M. Hawkins, prête à être postée, il m’a demandé comment j’avais trouvé un endroit aussi approprié. Je lui ai lu les notes que j’avais prises à l’époque et que je retranscris ici :





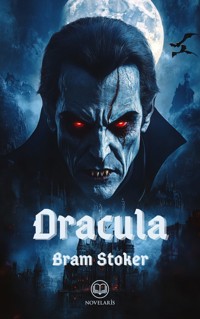

![DRACULA by Bram Stoker [2025 Kindle Edition] - The #1 Classic Vampire Horror Novel that Inspired Nosferatu | FREE with Kindle Unlimited - Bram Stoker - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1519075e598819811bf5aaf3b61c7775/w200_u90.jpg)