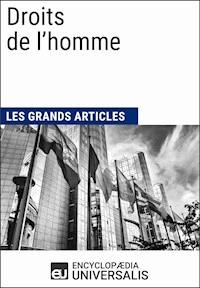
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Il n'est aujourd'hui aucune organisation politique qui ne se prévale de son souci de réaliser les droits de l'homme. Longtemps limitée par les cadres nationaux, cette préoccupation s'est affirmée sur le plan international lorsque, le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a voté, sous le titre de Déclaration universelle des droit...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852298606
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Symbiot/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Droits de l’homme
Il n’est aujourd’hui aucune organisation politique qui ne se prévale de son souci de réaliser les droits de l’homme. Longtemps limitée par les cadres nationaux, cette préoccupation s’est affirmée sur le plan international lorsque, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies a voté, sous le titre de Déclaration universelle des droits de l’homme, la charte proclamant les principes dont devrait s’inspirer la politique de tous les États et qui commanderaient également l’action des organes de la communauté internationale.
Qu’un pareil propos soit trop souvent démenti par les faits, c’est là une observation sur laquelle il est superflu d’insister. En revanche, ce qu’il convient de souligner, c’est que le décalage entre l’intention et les résultats n’est pas seulement un aspect du divorce habituel entre la théorie et la pratique. Il est, au moins en partie, la conséquence de l’ambiguïté qui affecte la notion même de droit de l’homme. On ne saurait en effet énoncer des droits sans prendre parti sur la définition de leur sujet. Quel est cet homme dont les droits sont proclamés ?
À cette question, l’histoire des idées et des institutions propose deux réponses qui, certes, ne sont pas absolument contradictoires sur le plan conceptuel, mais qui, en fait, conduisent à envisager le contenu et la liste des droits de façon sensiblement différente.
Une première conception s’attache à l’immutabilité et à la permanence de la nature humaine. Indépendamment de son origine, de sa condition sociale ou de son milieu, l’homme porte en lui un certain nombre de droits tellement inhérents à sa personne qu’ils ne sauraient être méconnus sans que, du même coup, son essence soit altérée. Ces droits, qui ne doivent rien à la législation positive puisqu’ils lui sont antérieurs, constituent autant de limites à l’action de l’État. À leur endroit, son seul devoir est de ne pas faire obstacle à leur exercice. C’est dans ce contexte philosophique que la Déclaration de 1789-1791 énonça, pour les reconnaître à l’Homme, les droits que l’organisation des institutions avait pour objet de garantir.
Cette interprétation libérale, classique ou traditionnelle des droits de l’homme est apparue insuffisante à partir du moment où l’on prit conscience que la jouissance d’un droit n’était d’aucun profit aux individus qui n’étaient pas en mesure de le mettre en œuvre. C’est alors que, progressivement, s’est dégagée une notion nouvelle des droits de l’homme qui vise à la réalisation concrète des facultés incluses dans les droits classiques. L’expression « droits sociaux » utilisée pour rendre compte de cette extension du droit implique à la fois un changement de perspective dans la manière d’envisager son sujet, une transformation de son contenu et une mutation radicale des devoirs de l’État.
Quant à son objet, le droit est dit social parce que son titulaire n’est pas l’homme en tant qu’incarnation d’une intemporelle nature humaine – que certains, avec le marxisme, considèrent d’ailleurs comme un postulat erroné –, mais l’individu tel que le font les multiples rapports sociaux dans lesquels il se trouve concrètement engagé. Cet homme, que définissent ses conditions d’existence, trouve dans sa situation le fondement des droits qui doivent lui être reconnus. D’où il suit que leur contenu est sensiblement élargi par rapport à celui des droits traditionnels puisque,à la limite, le droit social en arrive à s’identifier avec la consécration juridique des besoins (droit à l’éducation, à l’emploi, au logement, à la santé, etc.). C’est donc en fonction de ceux-ci que le contenu du droit doit être établi ; ce qui ne va pas sans affecter les droits sociaux d’une certaine relativité, car il est clair qu’ils concernent les catégories sociales les moins favorisées. C’est ainsi que, jusque dans les années 1980, dans les législations de nombreux pays, non seulement communistes mais aussi capitalistes, les droits sociaux en sont arrivés à désigner les droits des travailleurs. Les crises économiques et le développement des phénomènes de chômage et d’exclusion ont ensuite poussé à les réaffirmer universellement, indépendamment de la condition de salarié.
Or ces droits, qui sont en réalité des créances sur la société, ne peuvent se réaliser sans une intervention des pouvoirs publics pour créer les conditions nécessaires à leur réalisation. Tandis que les droits traditionnels sont des facultés dont l’optimisme libéral considère qu’il suffit qu’elles ne soient pas entravées pour que l’individu puisse les exercer, les droits sociaux requièrent au contraire une action positive de l’État sur les structures sociales. Les devoirs de l’État par rapport aux droits se trouvent en fait inversés : le droit classique, qui est un droit de..., est satisfait dès lors que les pouvoirs publics en reconnaissent la légitimité et ne mettent pas d’entrave à son exercice ; le droit social, qui est un droit à..., implique que la créance qu’il énonce soit garantie par l’État qui est ainsi tenu de pourvoir à sa réalisation.
Ce changement d’optique que schématise le passage du libéralisme intégral à un interventionnisme plus ou moins socialisant ne suppose pas, sur le plan théorique, une rupture totale de l’unité de la notion de droit de l’homme. Il serait en effet aisé de montrer que le droit social tend à prolonger dans leurs conditions d’exercice les exigences formulées par les droits dont la doctrine classique accorde la jouissance aux individus. Toutefois, dans le domaine du projet politique, le changement fut assez considérable pour former une ligne de clivage entre les régimes. Il suffit, pour s’en convaincre, de mesurer, par exemple, l’écart qui a séparé jusqu’à l’effondrement du bloc communiste les systèmes politiques qui se réclamaient de la liberté inhérente à l’homme de ceux qui se sont proposé sa libération.
Georges BURDEAU
E.U.
1. Déclarations des droits
« Par déclaration des droits, on entend, d’une manière générale, l’affirmation du droit individuel et de ses applications par une autorité constituante qualifiée (chef, peuple ou assemblée) ; peu importe que cette affirmation soit contenue dans un document spécial sous le nom de Déclaration ou qu’elle figure dans le texte constitutionnel proprement dit » (Jean Dabin, Doctrine générale de l’État).
Il y a donc, dans la notion de déclaration des droits, conjonction, sinon confusion de deux idées motrices : d’une part, celle de l’existence, en eux-mêmes, de droits individuels ; d’autre part, l’idée de leur affirmation sous forme écrite, avec la puissance renforcée que confère l’édiction par le pouvoir constituant. La première idée est très ancienne ; si ancienne qu’on ne peut en déterminer exactement l’apparition. Logiquement, l’existence de droits appartenant à l’homme en tant qu’homme se situe à l’origine même de la vie sociale. Historiquement, « l’idée du droit naturel est un héritage de la pensée chrétienne et de la pensée classique. Elle ne remonte pas à la philosophie du XVIIIe siècle, qui l’a plus ou moins déformée, mais à Grotius, et avant lui à François Suarez et à François de Vitoria ; et plus loin à saint Thomas d’Aquin ; et plus loin encore à saint Augustin et aux Pères de l’Église et à saint Paul ; et toujours plus loin à Cicéron et aux stoïciens, aux grands moralistes de l’Antiquité, et à ses grands poètes, à Sophocle en particulier. Antigone est l’héroïne éternelle du droit naturel, que les Anciens appelaient la loi non écrite, et c’est le nom qui lui convient le mieux » (Jacques Maritain, Les Droits de l’homme et la loi naturelle).
En revanche, l’idée de déclaration est nouvelle, et même relativement récente, puisqu’elle date du XVIIIe siècle. Le droit naturel devient, à travers elle, une loi écrite et une loi positive. « Déclarer, c’est non seulement faire connaître ce qui est ignoré. Mais c’est dire les choses exprès et de dessein, pour en instruire ceux à qui on ne veut pas qu’elles demeurent inconnues [...] la déclaration annonce une démonstration claire, une action importante, une volonté décidée » (F. Guizot, Nouveau Dictionnaire universel des synonymes de la langue française).
Ces trois caractères sont, peu ou prou, ceux de toutes les déclarations des droits, mais ils apparaissent avec éclat dans la Déclaration de 1789, archétype de toutes les déclarations. Quand on dit la Déclaration c’est elle que l’on vise. Elle est un événement capital, non seulement de l’histoire de France, mais de l’histoire du monde.
Déclaration des droits de l'homme. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789). Les deux tables de la Déclaration sont surmontées des allégories de la France et de la Justice, sous l'œil de l'Être suprême. Huile sur toile, anonyme, fin du XVIIIe siècle. Musée Carnavalet, Paris. (Erich Lessing/ AKG)
• L’idée et les caractères
Une démonstration claire
Le rôle d’une déclaration est de faire venir à la conscience claire ce qui était jusque-là confusément ressenti. Les droits sont dans la nature. L’intelligence les y trouve, ou plus exactement les y découvre, en énonçant, avec la nature propre de l’individu, ses exigences profondes et leurs implications quant aux rapports qui l’unissent à tous les êtres humains.
Le mérite d’une déclaration des droits consiste, selon La Fayette (Assemblée nationale, séance du 11 juillet 1789), « dans la vérité et la précision ; elle doit dire ce que tout le monde sait, ce que tout le monde sent ». Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, parlant au nom du comité de constitution, le 27 juillet, écarte résolument la rédaction de Sieyès comme trop abstraite, trop profonde, trop parfaite ; elle suppose, dit-il, « plus de sagacité et de génie qu’il n’est permis d’en attendre de ceux qui doivent la lire et l’entendre ; et tous doivent la lire et l’entendre ». Le 19 août, Rabaut-Saint-Étienne développe un vœu pour qu’une « déclaration simple, claire, d’un style qui fût à la portée du peuple, renfermât toutes les maximes de liaison et de liberté qui, enseignées dans les écoles, formeraient une génération d’hommes libres, capables de résister au despotisme ».
Une action importante
La déclaration apparaît à ses auteurs d’une importance capitale. Alors que l’Assemblée est en conflit avec le roi, qu’elle est menacée simultanément par les entreprises de la contre-révolution et les violences populaires, que se développe l’« anarchie spontanée », elle consacre son premier débat constitutionnel, du 17 au 26 août, à une question a priori beaucoup moins urgente que l’organisation nouvelle des pouvoirs publics.
Mounier en indique la raison : « Pour qu’une constitution soit bonne, il faut qu’elle soit fondée sur les droits de l’homme, et qu’elle les protège évidemment ; il faut donc, pour préparer une constitution, connaître les droits que la justice naturelle accorde à tous les individus ; il faut rappeler tous les principes qui doivent former la base de toute espèce de société, et que chaque article de la constitution puisse être la conséquence d’un principe. »
Une volonté délibérée
La déclaration a pour objet de rendre ses principes obligatoires en les constitutionnalisant. Si la Déclaration des droits comporte certaines dispositions de droit constitutionnel, dont la plus fameuse est la séparation des pouvoirs, la plupart de ses articles, en tant que concernant les relations des individus et de l’État, appartiennent matériellement au droit public relationnel. Elles ne relèvent que formellement du droit constitutionnel, en ce qu’elles sont un texte écrit, œuvre du législateur constituant (cf. M. Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel).
Qu’elle soit, suivant les opinions, proprement intégrée à la constitution ou qu’elle la précède, comme une manière de liminaire idéologique, la déclaration fait organiquement partie de la constitution écrite en tant qu’œuvre de l’organe constituant. Ses dispositions bénéficient des avantages dus au procédé de l’écriture. En outre, dans les pays de constitution rigide, elle jouit de la stabilité renforcée qui résulte de l’élaboration et de l’adoption des normes par un organe différent de l’organe législatif ordinaire et supérieur à lui.
• Avant 1789, les antécédents et les sources
Pour porteuse de nouveautés qu’elle soit en elle-même, la Déclaration de 1789 a cependant des précédents et des inspirateurs.
Les premiers textes
Le premier texte dont elle peut se réclamer, la Magna Carta, fut rédigé en 1215, sur le sol français, dans l’abbaye cistercienne de Pontigny, mais par des Anglais émigrés, en révolte contre leur roi, Jean sans Terre ; le deuxième est la Petition of Rights de 1629 ; le troisième le Bill of Rights de 1689. Toutefois, si ces documents, comme la Déclaration elle-même, sont des limitations à l’absolutisme, leurs dispositions sont précises et concrètes, liées aux faits et correspondant à des moments de l’histoire anglaise. Mais déjà Locke, en donnant dans son Pouvoir civil un fondement naturel et général aux droits revendiqués par la « Révolution modèle », établit la transition avec les déclarations américaines.
Bill of Rights de 1689. Quoiqu'il en coûte de l'admettre en France, la première Déclaration des droits de l'époque moderne est anglaise et précède exactement de cent ans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Imposée aux nouveaux souverains Guillaume III d'Orange et Marie II Stuart, elle constitue l'acte de naissance du régime parlementaire, qui trouve ainsi en terre protestante sa première application. Mur des Réformateurs, Paul Landowski et Henri Bouchard, Genève, 1909-1918.





























