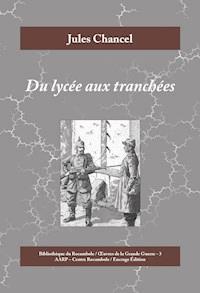
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Œuvres de la Grande Guerre
- Sprache: Französisch
Un roman destiné à la jeunesse valorisant les actions des jeunes soldats français face à l'armée allemande
Dès le début de la Grande Guerre, Jules Chancel s’engage comme beaucoup d’autres de ses confrères dans une littérature militante antigermanique, dénonçant les crimes allemands et valorisants le courage et l’audace des jeunes Français.
Le titre de son premier roman dans cette veine — appartenant à la série « Les Enfants à travers l’Histoire » — est à lui seul un programme
Du lycée aux tranchées. Il paraît chez Delagrave en 1917 — illustré par Louis Bombled.
Lorsque la guerre est déclarée, Guy d’Arlon vient de terminer sa classe de troisième, à Senlis, avec deux premiers prix, en narration française et en gymnastique. Dès septembre, la ville est envahie par l’ennemi et son père, adjoint au maire, est fusillé. Guy le venge immédiatement en abattant l’officier responsable de l’exécution et, dès lors, fait le serment de tuer à lui seul dix Allemands !
D'inspiration autobiographique, cette fiction relate de nombreux épisodes de la Première Guerre mondiale
EXTRAIT
Hennequeville, le 25 juillet 1914.
Guy d’Arlon : 1er prix de narration française ; Guy d’Arlon : 1er prix de sports !
Telles sont les deux nominations que j’ai obtenues cette année dans ma classe de troisième. Je n’en étais pas d’abord très fier, car je m’avouais à moi-même que j’avais été assez paresseux durant l’année scolaire ; mais, en constatant l’accueil qui me fut fait par ma famille et mes professeurs le jour de la distribution, je commençai à comprendre que le résultat de mes modiques efforts était supérieur à celui que j’attendais. Ce prix de français accouplé à ce triomphe sportif constituait, paraît-il, un ensemble parfait, et très moderne.
Après avoir deviné le contentement de mes parents au moment où ils m’embrassèrent, en posant de travers sur ma tête la couronne symbolique ; après avoir surpris sur les lèvres de mes maîtres des sourires satisfaits à mon égard, je conçus instantanément le petit orgueil qui convenait, paraît-il, à un lauréat de français et de gymnastique.
Et quand le préfet des études dit à ma famille : « Voilà donc notre futur homme de lettres ! », je ne protestai pas et trouvai même cette prédiction toute naturelle.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Jules Chancel est né en 1867 et mort en 1944. Correspondant de guerre et journaliste, Jules Chancel s'est illustré principalement pour ses romans destinés aux jeunes lecteurs. Il fut récompensé de nombreuses fois par l'Académie française.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposé dans le cadre des ressources du Centre Rocambole accessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Edition électronique réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de la Grande Guerre - 3
collection dirigée par Alfu
Jules Chancel
Du lycée aux tranchées
1916
AARP — Centre Rocambole
Encrageédition
© 2012
ISBN 978-2-36058-908-1
Avertissement
de Philippe Nivet
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Picardie
Directeur du Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits
Pendant la Première Guerre mondiale, la diffusion de la culture de guerre passe par différents vecteurs : la presse enfantine, à l’image du journalFillette, la presse illustrée, commeL’IllustrationouLe Miroir, ou les estampes, à l’exemple de celles de Jean-Louis Forain.
Le roman populaire, souvent publié d’abord en feuilleton, participe également de cette diffusion.
Exemple notoire : dans L’Eclat d’obus, roman de Maurice Leblanc, initialement publié dans les colonnes du Journal en 47 feuilletons quotidiens à l’automne 1915, on trouve ainsi de multiples dénonciations de la « guerre à l’allemande », marquée par les violations du droit des gens : « Assassiner et espionner, c’est pour [les Allemands] des formes naturelles et permises de guerre, et d’une guerre qu’ils avaient commencée en pleine période de paix ». Guillaume II y est présenté comme « le plus grand criminel qui se pût imaginer », tandis que les actes commis par les soldats allemands lors de l’invasion y sont résumés de manière saisissante : « Partout, c’était la dévastation stupide et l’anéantissement irraisonné. Partout, l’incendie et le pillage, et la mort. Otages fusillés, femmes assassinées bêtement, pour le plaisir. Eglises, châteaux, maisons de riches et masures de pauvres, il ne restait plus rien. Les ruines elles-mêmes avaient été détruites et les cadavres torturés ».
Si son insertion, en 1923, dans la série des Arsène Lupin a donné à ce roman une audience particulière, les thématiques qu’il développe se retrouvent dans d’autres textes de Maurice Leblanc et dans ceux de la plupart des auteurs populaires du temps, depuis Gaston Leroux jusqu’à Delly, en passant par Jules Chancel ou les auteurs des brochures de la collection « Patrie », tel Gustave Le Rouge ou Léon Groc.
Encrage Edition et le Centre Rocambole (centre de ressources international fondé par l’Association des Amis du Roman Populaire) ont la judicieuse idée d’exhumer ces documents et de les republier dans cette période marquée par la célébration du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Le lecteur de ce début du XXIe siècle y verra comment étaient célébrés les soldats français, héroïques quels que soient leur âge et leur parcours antérieur, dénoncés les espions travaillant de longue date au profit de l’Allemagne et condamnées les atrocités de l’invasion. C’est toute une culture de guerre, assimilée par certains à un « bourrage de crâne », que l’on retrouve.
Préface
d’Alfu
Homme de lettres, auteur dramatique et secrétaire général de l’Association des journalistes parisiens, Jules Chancel, né à Marseille le 25 septembre 1867, et décédé à Paris le 18 janvier 1944, est, de nos jours, surtout connu pour ses romans ayant pour héros de jeunes et intrépides adolescents.
En effet, à partir de 1901, il crée plusieurs séries de romans dont les titres sont sans ambiguïté.
La série « Les Enfants à travers l’Histoire » propose, au fil du temps, les exploits de Cocorico, reître d’Henri IV (1901), du Petit fauconnier de Louis XIII (1905), d’un Petit marmiton, grand musicien [Vie de Lully] (1906), des Petits ménétriers de Dugay-Trouin (1903), du Petit jockey du duc de Lauzin (1785-1793) (1910), du Moucheron de Bonaparte (1795-1805) (1908), de Tiarko, le chevrier de Napoléon (1805-1815) (1909), et du Petit roi du masque noir (1867-1870) (1911).
La série « Les Enfants à l’étrangers » incite au voyage avec Un petit émigrant en Argentine (1918), ou Un petit comédien au Brésil (1915).
Enfin, la série « Les Enfants aux colonies », entraîne le lecteur au Soudan à la suite du Prince Mokoko (1912), au Maroc, avec Lulu au Maroc (1913), ou encore en Indochine, avec L’Etreinte de la Main de fer (1925).
Certains de ces romans s’inscrivent dans la lignée des fictions scientifiques verniennes, tels Le Secret de l’émir (1920) ou Le Tour du monde involontaire (1929).
Dès le début de la Grande Guerre, Chancel s’engage comme beaucoup d’autres de ses confrères dans une littérature militante antigermanique, dénonçant les crimes allemands et valorisants le courage et l’audace des jeunes Français.
Le titre de son premier roman dans cette veine — appartenant à la série « Les Enfants à travers l’Histoire » — est à lui seul un programme : Du lycée aux tranchées. Il paraît chez Delagrave en 1917 — illustré par Louis Bombled.
Lorsque la guerre est déclarée, Guy d’Arlon vient de terminer sa classe de troisième, à Senlis, avec deux premiers prix, en narration française et en gymnastique.
Dès septembre, la ville est envahie par l’ennemi et son père, adjoint au maire, est fusillé. Guy le venge immédiatement en abattant l’officier responsable de l’exécution et, dès lors, fait le serment de tuer à lui seul dix Allemands !
Il va donc se jeter dans la mêlée et être témoin des événements les plus étonnants comme les plus révoltants.
Tout d’abord, il constate très vite que la guerre n’est plus celle que l’on s’attendait à connaître. Et il est témoin de scènes anachroniques :
« Ce jeune homme emballé par sa fougue chevaleresque, ce Saint-Cyrien qui, fidèle à la promesse qu’avaient faite, en se quittant, les officiers de sa promotion, avait mis ses gants blancs pour marcher à l’ennemi, ne trouvait pas encore que c’était suffisant. Oubliant, dans cette minute de glorieuse folie, les mesures de prudence qu’impose la guerre moderne, ignorant encore que les officiers étaient surtout visés par les tireurs allemands, il se souvient seulement qu’il est un chef etqu’un chef n’abdique pas l’honneur d’être une cible. » (52)
Les combattants doivent très vite changer de comportement :
« Et tout changeait d’aspect. Les uniformes trop visibles faisaient place aux vêtements inesthétiques, mais plus discrets. » (73)
« A l’imitation des Allemands, les Français furent bien forcés de s’adapter à cette nouvelle et odieuse façon de combattre. Peu à peu, tous nos régiments à leur tour, s’enfoncèrent, eux aussi, dans la terre. » (74)
Ce qui répugne au jeune garçon :
« Devant cette guerre dépouillée de son panache, terne, sale, boueuse, sans beauté apparente, Guy à part lui frémissait de déception et de colère. » (55)
Il traverse des paysages désolés : des villages dont il ne subsiste plus que « des murailles noircies et en ruine », des champs où « il voyait les cadavres amoncelés autour des meules », et « partout des cendres »…
Et puis les morts : « Le uns surpris au repos, les autres en plein combat. Certains corps étaient déchiquetés, sanglants, d’autres intacts et semblant exempts de toute blessure. » Et, pire encore, les blessés : « Ce qui lui était le plus pénible, c’était d’entendre les plaintes des blessés ».
La suite n’est que désolation et Guy d’Arlon pourra — comme le feront tous les héros de notre littérature populaire de l’époque — constater la « barbarie » allemande.
Ainsi, les Allemands détériorent les mines françaises, ce qui leur importe peu puisqu’ils ne les garderont pas et que ce n’est pas eux qui les exploitent :
« Des femmes, des vieillards, des enfants étaient obligés, sous peine de mort, de descendre chaque jour dans ces mines menaçantes et d’y travailler sans relâche pour les Allemands. » (159)
Plus tard, Guy rejoint les troupes alliées. Et l’auteur qui, à n’en pas douter, a été témoin des faits, parle des bases arrières et principalement de la ville de Rouen :
« Il faut avoir parcouru Rouen et sa banlieue pendant la guerre et y avoir découvert, à chaque visite, quelque installation nouvelle de ses hôtes, pour se rendre compte de l’activité anglaise dans l’organisation des services de l’arrière, de l’importance et de la multiplicité de ces services : services de l’armée métropolitaine, de l’armée indienne, australienne, canadienne ; services de l’état-major, de l’intendance, de la santé, de la trésorerie, de la poste, tous nos services, en un mot, augmentés de deux : celui du culte, que nous n’avons plus, et celui des jeux, que nous n’avons pas encore. » (205)
A travers les propos de l’un de ses personnages, il n’hésite pas à dresser un portrait hagiographique du maréchal Joffre :
« Il est vrai que, par sa simplicité et sa modestie, il rappelle les premiers chefs de Rome, quand la République brillait de son éclat le plus radieux. Mais il a aussi toutes les qualités de notre race à nous : il en a la magnifique puissance de travail, l’inaltérable bon sens et le goût profond de l’économie qui le rend avare du sang de ses soldats. Il a aussi la clarté de l’esprit français, la bonhomie de la vie française, la force immuable de l’âme française dans le destin du pays. Il possède, en un mot, tout ce qu’il y a de bon, de supérieur, dans l’intelligence et la pensée françaises. Et c’est pour cela que nous autres, ses subordonnés, ses combattants, nous lui avons donné l’épithète qui le résumait le mieux à nos yeux ; nous l’avons appelé :notre Joffre ;oui,notre,parce qu’il est bien près de nous, parce qu’il est bien ce que nous voulions qu’il fût. » (219)
Il n’aura pas oublié, en passant, de revenir sur le thème — obligé à l’époque — de l’espionnage allemand :
« On sait combien ce service d’espionnage, si développé, si perfectionné par les Allemands avant et pendant la guerre, leur a été utile et a même été la cause véritable de leurs principaux succès. » (223)
Mais la conclusion du roman est claire : à chaque âge son devoir. Pour les lycéens :
« Ce devoir n’est pas aux armées : il est sur les bancs du lycée, où ils doivent travailler à acquérir la force et la science qui contribueront à faire grande et forte la France de demain. La France d’aujourd’hui doit être prévoyante : elle ne veut pas manger le blé en herbe, détruire son espoir. Enfants, vous êtes la véritable réserve du pays, ceux qui doivent profiter de la victoire et la consolider. » (250)
La même année, Jules Chancel publiera un autre roman « de guerre » : Sous le masque allemand, et, encore un autre deux ans plus tard : Un match franco-américain.
Première partie
1.
Le journal de Guy d’Arlon
Hennequeville, le 25 juillet 1914.
Guy d’Arlon : 1er prix de narration française ; Guy d’Arlon : 1er prix de sports !
Telles sont les deux nominations que j’ai obtenues cette année dans ma classe de troisième. Je n’en étais pas d’abord très fier, car je m’avouais à moi-même que j’avais été assez paresseux durant l’année scolaire ; mais, en constatant l’accueil qui me fut fait par ma famille et mes professeurs le jour de la distribution, je commençai à comprendre que le résultat de mes modiques efforts était supérieur à celui que j’attendais. Ce prix de français accouplé à ce triomphe sportif constituait, paraît-il, un ensemble parfait, et très moderne.
Après avoir deviné le contentement de mes parents au moment où ils m’embrassèrent, en posant de travers sur ma tête la couronne symbolique ; après avoir surpris sur les lèvres de mes maîtres des sourires satisfaits à mon égard, je conçus instantanément le petit orgueil qui convenait, paraît-il, à un lauréat de français et de gymnastique.
Et quand le préfet des études dit à ma famille : « Voilà donc notre futur homme de lettres ! », je ne protestai pas et trouvai même cette prédiction toute naturelle.
Et pourquoi, après tout, ne deviendrais-je pas un homme de lettres, puisque j’avais eu le premier prix de français, sans effort ? Oh non !
Telle est souvent l’origine de beaucoup de vocations. Je m’étais levé, le matin, sans savoir le moins du monde ce que j’avais l’intention de faire dans l’existence. Un sourire flatteur, un mot lancé. Il n’en fallut pas davantage je serai homme de lettres !
Et instantanément j’en pris les allures. Je me rappelai la manière lente de parler, les attitudes songeuses, l’œil scrutateur des littérateurs connus que j’avais eu l’occasion d’approcher, et je cherchais déjà à indiquer dans ma personne ces signes distinctifs d’une carrière glorieuse. Déjà j’étudiais mes paroles pour ne laisser sortir de ma bouche que des mots profonds ou spirituels.
Mais comme, malheureusement, je n’en trouvais pas beaucoup, je restais muet, ce qui me fit paraître tout simplement stupide devant les amis de ma famille qui vinrent me féliciter.
Bah ! je me rattraperai par mes écrits ! Et je promis des lettres à tout le monde, car je n’étais pas de ceux qui se contentent de la déplorable carte postale avec ses stupides évocations : « Buffet de Dijon, trois heures. Sommes ici et vous envoyons nos amitiés. »
— Non, me disait-on, quand on a eu un prix de narration, on détaille ses impressions longuement.
— Certes, ajouta mon professeur, et pendant les vacances on écrit même son journal.
Ces paroles me frappèrent et devinrent pour moi presque un ordre.
M. Courtois, qui les avait prononcées, était celui de nos maîtres pour lequel nous avions tous la plus grande admiration. Il était jeune, élégant, moderne. Il sortait de Normale et portait des cravates d’un goût parfait. En classe il nous lisait du Rostand ou du Musset, et devant nous avait envoyé promener le proviseur qui s’était permis une observation à son égard. Tout cela avait fait de lui, pour nous, une manière de héros.
M. Courtois avait dit que je devais écrire mon journal pendant les vacances, et voilà pourquoi je l’écris.
Et puis, n’est-ce pas déjà commencer ma carrière d’homme de lettres ?
— Où est Guy ? demande-t-on.
— Dans sa chambre… répond ma mère avec un sourire orgueilleux ; il écrit son journal.
Et quand je descends, on me demande :
— Eh bien, Guy… l’inspiration était-elle bonne aujourd’hui et la muse propice ?… Vous ne nous avez pas trop abîmés, au moins, dans ce fameux journal ?
Et je prends un air mystérieux en disant avec modestie :
— Bah ! il faut bien s’occuper !… Ça vaut mieux que d’aller au café.
On rit… Ce n’est pas méchant, mais c’est déjà un mot d’auteur.
J’ai expliqué pourquoi j’avais commencé ce journal. C’est quelque chose évidemment, mais ce n’est pas tout, il faut maintenant l’écrire, et l’écrire pour de bon.
Je pense à M. Courtois. A la rentrée, je veux pouvoir lui apporter un gros rouleau de papier, pas un simple petit cahier d’enfant de deux sous, mais un vrai manuscrit sérieux, en lui disant :
— Voilà mon journal, monsieur… si vous voulez bien le parcourir le soir pour vous endormir.
Mais, pour arriver à remplir ce gros manuscrit, il faut avoir des choses à dire. Voyons, entre nous, je ne sais pas trop comment on procède pour faire un journal. J’ai regardé dans un dictionnaire de littérature, et j’y ai lu : « Dépeindre d’abord sa personnalité, le cadre dans lequel on vit et les gens qui vous entourent. » Je me conforme donc à ces préceptes, et je me présente à vous, mes chers lecteurs.
Je m’appelle Guy d’Arlon, un joli nom d’homme de lettres, entre parenthèses ; je crois que plus tard je n’aurai pas besoin de prendre de pseudonyme. Guy d’Arlon, comme ça, tout simplement, de naissance ; décidément j’étais prédestiné ! J’ai quatorze ans pour ma mère, mais en réalité je ne suis pas loin de quinze. Quant à mon portrait physique, je me heurte à une difficulté, Doit-on être modeste dans un journal ? Voilà ce que ne dit pas le dictionnaire de littérature. En réalité, je vous avouerai que je ne me trouve pas mal. Non, décidément. La vieille glace que j’ai en face de moi me renvoie l’image d’un grand diable bien bâti — n’oublions pas que j’ai eu aussi le prix de sports, — mais oui, bien bâti : des épaules qui sont larges, une taille mince, des jambes longues et nerveuses, des cheveux longs ondulés et collés en arrière sur la tête, à l’américaine, un nez un peu fort, — mais depuis Cyrano c’est la mode, — des yeux bleus, mon Dieu ! fort expressifs et énergiques. Ceci, ce n’est pas moi qui le dis. Je l’ai entendu un jour que l’on parlait de moi au salon et que je ne me suis pas pressé d’entrer pour savoir ce qu’on en disait.
En résumé, je suis grand, fort et entraîné. Je joue au tennis, au football : premier avant à Puteaux ; je boxe quelque peu, je nage et je me tiens à peu près sur un cheval de manège. Un cent mètres avec obstacles ne m’effraye pas et j’ai un brevet de préparation militaire, au demeurant le meilleur fils du monde, à condition qu’on ne me contrarie pas. Je suis paresseux et rêvasseur comme il convient à un futur homme de lettres, et voilà. Pour le reste, vous me verrez à l’œuvre au cours de ce journal… si je continue, car je trouve que c’est déjà bien fatigant d’écrire comme ça des pages tous les jours. Mais je continuerai. De la volonté : il faut de la volonté ! Passons donc maintenant, en suivant les préceptes du dictionnaire, aux gens qui m’entourent et au cadre dans lequel je vivais. Faut-il commencer par le cadre ou par les gens ? Je n’en sais rien. Au hasard !
Le cadre est une jolie villa à Hennequeville, près Trouville, où nous sommes venus passer les vacances. Mes parents semblent riches. Papa est directeur d’une compagnie d’assurances, et nous habitons, dans les environs de Paris, une petite ville qui s’appelle Senlis, où nous possédons une vieille maison et des propriétés. Papa est adjoint au maire de Senlis et jouit dans le pays d’une considération très grande.
Je ne comprends pas très bien pourquoi nous n’habitons pas Paris, où papa a ses affaires et maman ses magasins et ses tasses de thé ; mais il paraît que ce n’est pas possible. Il faut conserver ses attaches et rester fidèle à la petite patrie, comme le disent papa et M. Barrès. Moi, comme je suis au collège à Senlis, je n’y vois pas d’inconvénient ; mais je sais très bien que, quand j’aurai fini mes études, je saurai aller habiter Paris pendant l’hiver. Quant à l’été, j’admets très bien qu’on vienne le passer dans une villa comme celle où nous sommes actuellement.
Cette villa est grande, très bien meublée, située au sommet de ces collines verdoyantes qui, en Normandie, dominent la mer… et la plage de Trouville. En vingt minutes de bicyclette on est sur les planches. Le tonneau de papa y va dix fois par jour. Oui, en somme, cette villégiature est très possible, et voici mon cadre établi.
Peut-être ne vous ai-je pas suffisamment dépeint le charme des soleils couchants et levants sur la plage, vu à travers la verdure de nos marronniers, mais je crois que les descriptions sont vieux jeu et pas modernes pour un sou. Or, moi, je suis et veux être le jeune homme très moderne, Vous vous passerez donc de descriptions, et j’en arriverai tout de suite à typer les gens qui m’entourent.
A tout seigneur tout honneur, commençons par papa.
Papa est un monsieur dans toute l’acception du mot. Il est quelque peu bedonnant, pas sport pour un sou, par exemple, mais il a bon air tout de même. Il préside de nombreux conseils d’administration et partout, toujours, reste monsieur le président.
Que ce soit dans son salon de Senlis les jours de grand dîner, ou le matin dans sa chambre quand il prend sa tasse de café au lait, toujours il préside, et personne n’ose émettre un avis différent du sien. Il semble, si on parle après lui, qu’une sonnette va vous interrompre. En somme, je suis très fier de mon papa, qui est décoratif en diable et estimé de tous. Il doit gagner beaucoup d’argent, ce dont je ne m’aperçois guère pour ma part, car il s’obstine à me donner régulièrement vingt sous tous les dimanches en me disant avec son ton présidentiel :
— Surtout, fais-en bon usage !
Dans ses rapports avec moi, il est charmant, doux, mais sévère. Je l’admire et je l’aime… C’est dommage seulement qu’il ne joue pas au tennis et soit aussi peu sport. Il serait complet !
Il paraît que dans sa jeunesse ce n’était pas la mode.
Passons maintenant à maman. Maman, c’est maman, et je ne sais pas pourquoi il m’est trop difficile d’en dire davantage sur son compte. Il me semble que quand j’ai écrit ce mot maman, j’ai tout dit. Elle représente pour moi toutes les qualités, et je plains tous mes camarades d’avoir une mère qui ne soit pas la mienne. Elle est toute petite, mais il semble que :
Dieu la fit ainsi afin de la mieux faire.
Elle a une voix douce qui fait un contraste curieux avec l’autorité de son caractère. Au fond, et ceci entre nous, si papa préside si bien, c’est maman qui tient la sonnette sans qu’on s’en doute.
Enfin maman est jolie, exquise, intelligente et musicienne ; elle sent bon, elle a toutes les qualités : c’est maman !
Comme enfants, nous ne sommes que deux, moi et Colette.
Colette a six ans. C’est un personnage sympathique, c’est la joie de la maison. C’est la joie partout où elle est. Avec ses cheveux d’or, son petit nez en l’air, sa bouche grande, mais qui rit tout le temps, elle dégage de la gaieté et du bonheur : elle rayonne !
Il fait gris, on a mal dormi, la journée s’annonce mal, on ne sait pas ses leçons : Colette apparaît, et on part joyeux pour le collège ou pour ses affaires. Et puis, Colette a des mots délicieux. Voulez-vous le dernier ? Il est d’hier.
On l’a menée prendre son premier bain de mer, et quand elle fut installée dans les bras du baigneur, elle lui dit impérativement :
— Menez-moi bien loin, là-bas, au milieu !
— Pourquoi au milieu ? demanda l’homme étonné.
— Parce que la mer, ça doit être comme la soupe… sur les bords, c’est plus froid.
Et elle en a comme ça toute la journée !
Maintenant, il ne me reste plus à vous présenter que mes oncles.
Ceux-là sont vraiment faciles à typer. C’est l’oncle Tantpis et l’oncle Tantmieux. Le premier grogne tout le temps, trouve tout mal, déblatère sans cesse sur les choses et sur les gens. Il a une maladie de foie, il est jaune, maigre et voûté. Le second est un satané mauvais sujet, paraît-il. Il a mangé toute sa fortune, mais ne s’en porte pas plus mal, au contraire ! C’est ce qu’on appelle en style de théâtre : une rondeur, un sympathique. Il est toujours content et trouve, comme Candide, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sa devise favorite c’est : La vie est belle ! Les choses les plus épouvantables n’ont, affirme-t-il, aucune importance, et il affirme que les plus grands malheurs, vus du haut de Sirius, apparaissent tout de suite comme de fort minuscules événements. Ce n’est pas lui qui a trouvé ça : c’est Renan, paraît-il ; mais il s’en sert fort bien.
Pour ce qui me concerne, j’admire ma chance qui a placé à côté de moi, durant ces vacances, ces deux personnages. Ils vont être pour moi très précieux pour la confection de mon journal. Sur chaque chose je n’aurai qu’à les écouter pour avoir des opinions contraires, entre lesquelles il me sera facile de choisir la vraie.
Exemple : hier soir, après le dîner, on lisait le journal sur la terrasse. La lecture du Temps en hiver, le soir sous la lampe, avant le bridge de papa, est un des rites auxquels je suis habitué depuis mon enfance. Donc on lisait le journal et on commentait les événements du jour.
L’oncle Tantpis annonce par-dessus son lorgnon :
— Ça va de plus en plus mal dans les Balkans. Il paraît que l’Autriche demande des réparations à la Serbie pour l’assassinat du grand-duc héritier.
Mon père hocha gravement la tête.
— On ne sait pas, en effet, dit-il, où cette affaire-là peut nous mener.
Mais voici l’oncle Tantmieux qui bondit.
— Ah çà ! est-ce que vous allez me raser longtemps et nous gâter nos vacances avec votre politique ?… Les Balkans ? mais voici trente ans que j’entends dire que ça va mal aux Balkans… Qu’une bonne fois on les fiche dans la mer Noire, ces satanés Balkans, et la question d’Orient sera résolue.
Puis, ouvrant d’un geste large la porte vitrée du salon, il continua :
— Regardez donc la mer… Ça vaudra mieux que de vous occuper d’un tas de gens qui nous sont complètement indifférents.
Son conseil fut suivi, car l’humanité est ainsi faite que, autant que cela lui est possible, elle se tourne vers ce qui lui est agréable et oublie ce qui peut l’attrister, même la mort.
On oublia donc les Balkans ce soir-là. On écouta l’oncle Tantmieux réciter des vers à la lune, on vanta les charmes de la villa, on organisa une partie de pêche pour le lendemain, et, vers onze heures, tout le monde alla se coucher le cœur léger. Seul l’oncle Tantpis continuait à gémir.
Etait-ce divination, génie, prescience ? Etait-ce tout simplement sa gastrite qui le travaillait ce soir-là ? On ne le saura jamais, mais nous verrons bientôt que, cette fois, c’était l’oncle Tantpis qui avait raison.
2.
Suite du journal de Guy d’Arlon
Une semaine de vacances s’est déjà écoulée, et ce sont les faits et impressions de ces huit jours que je veux essayer de raconter aujourd’hui dans ce deuxième chapitre de mon journal.
L’entreprise me paraît singulièrement difficile, à cause de la banalité des sujets que j’ai à traiter. Je sais bien que le talent, le talent moderne surtout, consiste justement à écrire sur des riens et à en faire des choses charmantes. Les classiques mêmes nous ont donné des exemples de ce genre, et Xavier de Maistre a fait tout un livre de voyages autour de sa chambre. Mais, je ne sais pourquoi, la vie que je mène, l’époque dans laquelle je vis, tout me paraît particulièrement plat, insignifiant, monotone. Dans ce siècle où commencent à s’envoler les aéroplanes, nous manquons, me semble-t-il, complètement d’envolée. Après tout, nous ne pouvons pas tous être aviateurs ; alors, que nous reste-t-il ? Le train-train monotone d’une vie mondaine prévue et banale. Heureusement il y a les sports. Aussi je vous assure que je m’y adonne avec frénésie. Lundi, match de tennis au casino. J’ai été le second de Décugis, et, ma foi ! ce grand ténor de la raquette a daigné me dire que je ferai quelque chose.
L’après-midi, leçon de boxe au stand du club. Deux heures de punching ball. Le soir, le bain de mer avec les camarades : périssoire, water polo, etc. Voilà des journées bien remplies, ou je ne m’y connais pas.
Entre-temps, je pense… Je pense à cette phrase que nous lança, dans son discours de distribution des prix, l’académicien notable qui était venu présider la cérémonie :
— Jeunes gens, nous dit-il, on vous reproche, paraît-il, votre manque d’enthousiasme. Je me suis laissé dire que la jeunesse moderne était froide, calculatrice, spéculative, mais qu’elle ne possède plus l’allant, l’enthousiasme, la joie de vivre des jeunes gens d’autrefois.
« Je me hâte d’affirmer que c’est faux ! La jeunesse française est toujours la même. Les apparences seules sont changées : l’enthousiasme moderne se porte en dedans, voilà tout.
« Vienne une occasion de le sortir, et vous le sortirez, vous le brandirez orgueilleusement. Jeunes gens, vous êtes des forces cachées qui s’ignorent.
Ces paroles me laissèrent rêveur. Aurait-il raison, l’immortel ? Je le croirais assez pour ma part. Il me semble, en effet, que je n’attends qu’une occasion pour manifester une foule de sentiments qui sont là-bas, tout au fond de mon être, que je rougirais de laisser voir maintenant, mais que je meurs cependant d’envie d’étaler au grand jour.
Je tape sur un ballon, je tire sur des élastiques, je saute devant un filet de tennis, mais tout cela a un but : me faire des poumons, des muscles, de l’audace, en vue de quelque chose que j’ignore, mais que j’attends. Mes ressources morales sont pareilles. Je vis doucement, je blague les grands sentiments parce que c’est la mode, je commence à danser le tango, mais, tout au fond de moi-même, je sens quelque chose de caché qui est là et qui attend.
Des forces physiques et morales cachées qui s’ignorent, mais qui n’en sont pas moins là. Pas si bête que ça, tout de même, notre vieil académicien. Je crois qu’il a raison.
N’empêche que, pour le moment, mes forces morales et physiques ne trouvent pour se manifester que des parties de tennis ; ce n’est pas suffisant…
Mais que se passe-t-il donc en bas ? J’entends monter dans l’escalier des voix agitées, on dirait qu’un événement grave vient de se produire. Un accident peut-être ? Non : c’est l’oncle Tantpis qui pérore, un journal à la main. Toujours sa marotte. Je l’entends d’ici.
— Je vous dis que c’est très grave. Ecoutez plutôt le résumé de l’affaire : « Le 28 juin 1914, l’archiduc héritier d’Autriche-Hongrie, François-Ferdinand, tombait sous les coups d’un meurtrier dans les rues de Serajevo, capitale de la Bosnie. L’auteur de l’attentat était un Serbe, et l’on veut voir dans son crime le résultat d’un complot organisé par le gouvernement de Belgrade. La Serbie a protesté, mais l’Autriche, poussée par l’Allemagne, affecte de ne pas croire à la sincérité de ces assurances et demande des garanties contre de nouveaux attentats. Atteinte dans son honneur, la Serbie regimbe et se tourne vers sa protectrice naturelle, la Russie. Enfin voici l’Autriche, toujours sous la pression de l’Allemagne, qui adresse un ultimatum à la Serbie et, en même temps, mobilise ses troupes. C’est le point où l’Allemagne, tapie dans l’ombre, voulait amener les choses. Pendant ce temps la Russie a répondu à la mobilisation autrichienne par une mobilisation parallèle de ses forces, et on annonce ce matin que l’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Nierez-vous cette fois que les choses soient graves ? »
J’ai écouté et noté soigneusement cette lecture et j’écoute encore, attendant un mot de mon père, la boutade habituelle de l’oncle Tantmieux qui remettrait les choses au point et chasserait une fois de plus le pessimisme de l’oncle Tantpis ; mais je n’entends rien. Un silence de mort suit cette lecture du journal.
Décidément, c’est peut-être sérieux cette fois. Est-ce que nous aurions la guerre ? Non, c’est impossible ! Déjà tant de fois j’ai entendu de semblables conversations ! C’est tout de même curieux que l’oncle Tantmieux se tienne coi. Allons voir. Je descends.
* * *
4 août 1914.
« La guerre est déclarée ! La guerre est déclarée. » La petite phrase terrible siffle déjà comme une balle. On se la répète partout dans les maisons et dans les rues, sur la plage. Les femmes ont des regards angoissés, et les hommes lèvent les yeux avec énergie et fierté. Moi, j’avoue ne pas comprendre très bien toute la portée de cet événement. La guerre, j’en ai beaucoup entendu parler dans mes classes. Depuis Annibal jusqu’à la Crimée, car nous en sommes restés là, j’ai toujours vécu dans des descriptions de batailles. Pourquoi est-ce donc une chose si terrible ?
En me disant : « La guerre est déclarée », papa m’a regardé tout à l’heure avec une émotion rare chez cet homme impassible. Quant à maman, elle m’a embrassé en me serrant bien fort et en disant :
— Au moins lui n’ira pas… Il n’a pas l’âge.
Et ces mots m’ont atrocement humilié. C’est vrai, je ne suis qu’un enfant… Je n’irai pas !
Dans le pays, c’est un branle-bas général. Tout le monde s’en va, tout le monde fait ses malles. La foule est affairée, mais non pas affolée. Elle envahit les banques, les bureaux de poste, la gare. Les villas se ferment une à une. Trouville se vide comme sous l’effort d’une machine pneumatique invisible. Nous aussi nous partons ce soir pour Senlis. Il paraît que papa sera peut-être mobilisé, mais il est des dernières classes. Le premier de ses devoirs, c’est d’aller prendre sa place à la mairie.
Quant à l’oncle Tantpis, il triomphe, mais il ne dérage pas tout de même. Il doit rejoindre son corps à Amiens, le Xe de ligne, dans les quarante-huit heures. A l’entendre, tout est perdu d’avance : nous n’avons pas de généraux, pas de canons, pas de munitions. Les Allemands seront à Paris dans huit jours. L’oncle Tantmieux, lui, naturellement, est enchanté.
D’abord il est officier de cavalerie et il adore faire des périodes.
— Ce sera une période comme les autres, dit-il, peut-être un peu plus longue, mais pas beaucoup. Au moins cette fois on va les avoir, ces Allemands, et comment ! Dans trois mois j’irai boire du vin du Rhin du côté de Cologne. Il paraît que c’est excellent pour les rhumatismes. Pauvres Allemands ! Pris entre les Russes, les Anglais et nous, que peuvent-ils faire ?
Allez vous y reconnaître au milieu d’avis si opposés. J’observe papa. Lui ne dit rien, comme à son habitude, mais je distingue le petit tremblement de sa lèvre supérieure qui est chez lui la seule manifestation de ses émotions. Or il ne cesse pas, le petit tremblement. Maman, admirable comme à son ordinaire. Elle trottine partout, pense à tout, sourit et ferme les malles. En partant elle a remis son inventaire au propriétaire, en lui faisant remarquer que deux de ses verres étaient fêlés.
Nous voici à la gare. Quel voyage, Seigneur ! un train bondé, toutes les classes mêlées, des soldats envahissant toutes les voitures, chantant, hurlant, buvant. Tout le monde se parle, tout le monde fraternise.
On lance des nouvelles hâtives et sensationnelles :
« Une division de uhlans avait franchi la frontière près de Lunéville et elle avait été bousculée par nos dragons, laissant entre nos mains deux mille prisonniers. — Brindejonc des Moulinais avait lancé son aéroplane contre un zeppelin dont les vingt-quatre passagers étaient morts. »
A chaque station, on courait aux journaux. L’enthousiasme était général. Il faisait chaud et on transpirait patriotiquement.
L’oncle Tantpis, seul, grommelait froidement. Il supportait avec quelque impatience un gros réserviste qui s’obstinait à s’asseoir sur ses genoux pour essayer ses chaussures de campagne.
Quant à l’oncle Tantmieux, il se pendait aux barres de soutien dans le couloir des wagons et faisait des bras carrés pour voir s’il était encore en forme.
— Chouette ! disait-il, demain je serai à cheval et je gagnerai deux cent vingt-cinq francs par mois, au lieu d’en dépenser mille à Trouville, sans compter les louis de la salle de baccarat.
Quant à moi, blotti contre maman dans un coin du wagon, je pensais à ces fameuses forces que je possédais et qui attendaient une occasion pour se manifester.
Serait-elle venue, l’occasion ?
Mais non, hélas ! puisque je suis trop jeune ; mais, dans tous les cas, mon journal de vacances ne sera peut-être pas aussi banal, aussi nul que je le craignais…
3.
Inutile !
Elle avait bien changé d’aspect, notre tranquille ville de Senlis, quand nous y arrivâmes. L’antique petite cité, qui, en temps ordinaire, savait si bien réunir le charme de la province au mouvement parisien, était en effervescence. La vie ordinaire était interrompue. Artisans et propriétaires, cultivateurs et châtelains, fraternisent et discutent en groupes : c’est un continuel mouvement de départ. Epouses et mères escortent jusqu’à la gare les maris ou les fils qui s’en vont. Des cortèges défilent, drapeaux déployés, en chantant la Marseillaise. Toutes les divisions de la veille sont oubliées, et les commerçants, qui ne quittent pas les seuils de leurs boutiques, ne s’étonnent pas de voir le curé passer, bras dessus, bras dessous, avec l’instituteur.
Papa, qui, dès son arrivée, était allé faire régulariser sa situation militaire, nous apprit, avec regret, qu’il n’était pas appelé encore ; mais, par contre, l’oncle Tantpis n’eut que le temps de passer chez lui avant de se mettre en route. Bien entendu, nous l’accompagnâmes à la gare, et ce départ fut la note comique de cette période angoissante.
Il gémissait, il grognait, il fulminait, le malheureux ; mais comme, après tout, c’était un excellent homme et un bon Français, il s’interrompait tout à coup au milieu de ses lamentations pour lancer un vigoureux :
— Nous les aurons tout de même, les crapules !
Et puis aussitôt il se répandait de nouveau en plaintes amères sur l’administration qui l’empêchait d’emporter plus de trente kilos de bagages. Il était parti équipé de façon invraisemblable, avec des bottes de chasse, un certain costume de velours à trente-six-poches et un feutre boer qui lui donnait un aspect des plus irrésistiblement drôles. Bien entendu, l’oncle Tantmieux ne rata pas une telle occasion de se moquer de lui, et, furieux, l’oncle Tantpis lui répondit :
— Parbleu ! ça t’est facile, à toi qui ne pars pas, de faire de l’esprit à mes dépens.
L’onde Tantmieux éclata à son tour.
— Comment ! je ne pars pas ! criait-il en montrant son uniforme de lieutenant de hussards dont il était déjà revêtu, mais tu ne vois donc pas que je suis militaire avant toi ! J’ai pris mon service au quartier hier, et demain soir au plus tard le régiment aura quitté la ville.
— N’empêche, concluait amèrement l’oncle Tantpis, que tu es toujours là à te balader avec ta cravache et tes bottes vernies, tandis que moi, pauvre biffin de deuxième classe, je vais m’enfiler dans un wagon à bestiaux pour filer Dieu sait où !
— Eh ! tu n’avais qu’à faire tes périodes de réserve, riposta l’oncle Tantmieux, agacé, tu serais officier comme moi.
— Jamais de la vie ! fit avec dignité l’oncle Tantpis, je ne me reconnais pas les qualités nécessaires pour conduire les hommes. J’aurai déjà bien assez de peine à me conduire moi-même.
Et, sur ce mot, l’excellent homme grimpa en grognant dans son wagon, s’assit sur la paille et ne bougea plus. Ce fut à peine si, au moment où le train s’ébranla, il daigna nous saluer d’un geste de la main.
Le départ de l’oncle Tantmieux, qui eut lieu deux jours après, fut plus brillant.
Le régiment de hussards, qui se préparait depuis la mobilisation, reçut vers six heures du soir l’ordre de se mettre en route vers la frontière. A la nuit, les escadrons s’alignèrent dans la cour du quartier. Les chevaux s’ébrouaient, piaffaient, rompaient les alignements qui commençaient à s’établir dans le silence, coupé seulement par les ordres brefs des gradés. Accrochés aux portes des écuries, des pâles falots luisaient dans la nuit sombre. Le colonel, debout devant la grille du corps de garde, causait avec les capitaines.
Une petite fille se fraye un chemin dans la foule jusqu’à lui. Elle porte un énorme bouquet presque aussi gros qu’elle-même.
Elle tend ses fleurs au colonel et commence son petit compliment.
— Mon colonel ! au nom des habitants de la ville…
Mais le colonel ne la laissa pas achever : il saisit l’enfant dans ses bras, la hissa jusqu’à lui et l’embrassa vigoureusement sur les deux joues. Puis un ordre retentit :
— A cheval !
Le régiment s’ébranla, sortit du quartier et, par la rue de la République, se dirigea vers la gare. Les rues étaient pleines de gens qui criaient et couvraient même de leurs clameurs et de leurs ovations les sons cuivrés des trompettes sonnant une marche en tête du régiment.
— Vive l’armée !
Ce cri, sans cesse réitéré, suivait la colonne et résumait l’âme populaire.
Bien entendu, j’étais venu avec mon père et ma mère assister à ce départ et nous regardions défiler les pelotons bien alignés avec leurs paquetages de campagne, cherchant de l’œil l’oncle Tantmieux, que nous finîmes par découvrir à la tête de l’avant-dernier peloton. Il nous salua de son sabre d’un geste large et sourit, heureux et gai comme à son ordinaire.
— Au revoir, Guy, me dit-il en passant près de moi… Quel dommage que tu n’aies pas deux ans de plus ! je t’aurais emmené, et je t’assure qu’on ne se serait pas embêté tous les deux là-bas, de l’autre côté du Rhin.
— Oh oui ! m’écriai-je avec conviction. C’est bien dommage, en effet, et je vous assure que je le regrette plus que vous.
Quand nous rentrâmes à la maison, après le départ de l’oncle Tantmieux, mon père, me voyant triste et rêveur, m’embrassa et me dit :
— Je comprends tes regrets, mon garçon… J’approuve même ton désir de servir ta patrie, mais songe que tous, et à tout âge, nous devons maintenant la servir selon nos moyens et nos aptitudes. Ce ne sont pas les rôles les plus brillants qui sont toujours les plus nobles et les plus utiles. Vous êtes, vous autres, les enfants, l’avenir du pays comme ton oncle en est le présent, et moi, hélas ! presque le passé ; tous nous avons notre devoir à remplir, et nous le remplirons, n’est-ce pas, mon garçon ?
— Ah oui, papa !
Je ne sais pas pourquoi, en retrouvant dans mon journal cette conversation avec mon père, je me sens oppressé, assailli de tristes pressentiments.
* * *
Les jours qui suivirent ne contribuèrent pas à les chasser. Les nouvelles arrivaient mauvaises. C’était l’envahissement si rapide de la Belgique, la chute des forts de Liège, de Namur, de Maubeuge, l’entrée des ennemis à Bruxelles, puis la marche foudroyante à travers nos départements du nord après la désastreuse bataille de Charleroi. Et cependant, d’après ce que nous a raconté un officier blessé évacué à Senlis, cette bataille, livrée par quatre cent mille Français contre sept cent cinquante mille Allemands, fut moins une défaite qu’une opération manquée. Notre offensive ne réussit pas à rompre les forces ennemies, mais celles-ci à leur tour, malgré leur nombre, ne purent entamer notre armée, qui reculait, mais qui reculait en combattant, sans désordre, sans hâte, en parfaite liaison de toutes ses parties, frémissante de tous les pas faits en arrière et n’attendant que l’ordre du généralissime pour attaquer à nouveau et refouler l’adversaire.
Cette victoire allemande leur a coûté horriblement cher. Sur certains points, des régiments entiers ont été anéantis ; le lit de la Meuse était comblé de cadavres allemands au point de la faire déborder. Ils ne pourront pas continuer longtemps ce jeu-là.
Malgré ces consolations, nous apprenions chaque jour que la marche des Allemands continuait.
A toutes ces angoisses venaient se joindre nos appréhensions sur le sort de mon père, dont le départ avait été retardé à la suite de sa visite médicale ; mais il tenait à être pris et finit par y réussir.
Nous avions cependant l’espoir de le garder encore quelque temps auprès de nous, car il avait été désigné comme chef du poste des gardes-voies de la gare de Creil. Maman, naturellement, n’avait pas voulu rester inactive au milieu de l’effort général. Elle faisait partie avant la guerre des dames de la Croix-Rouge de Chantilly, et, presque chaque jour, se rendait dans cette ville pour y prendre le service qui lui était désigné.
Je restais donc seul inoccupé et humilié de ce désœuvrement. J’étais dans la situation atroce dont souffrirent tous les enfants de treize à dix-huit ans durant ces terribles années 1914 et 1915. J’étais trop jeune pour faire un soldat, et plus assez enfant pour regarder en spectateur amusé le spectacle dramatique qui se déroulait devant nous.
Toutes mes occupations habituelles, mes plaisirs les plus aimés me paraissaient déplacés et sans intérêt. Je traînais partout le sentiment d’une inutilité absolue, d’autant plus pénible quand on sent vibrer autour de soi l’action générale et intense.
Ma mère, pour essayer de me distraire, de m’occuper, de me donner un semblant d’utilité, me menait avec elle dans les hôpitaux de Chantilly, où je la voyais avec admiration remplir son ministère sous le sarrau blanc de l’infirmière. J’étais chargé, par l’administration de la Croix-Rouge, d’aller faire les commissions de l’hôpital à la gare ou ailleurs. J’avais la joie de porter un brassard qui me donnait une consécration officielle. Je faisais toutes mes courses à bicyclette, et tout le monde admirait avec quelle promptitude je m’en acquittais.
— Parbleu ! disais-je ironiquement quand on me félicitait, ce n’est pas pour rien que j’ai eu un prix de sports.
Ce qui me plaisait le plus dans ma nouvelle situation de planton de l’hôpital, c’était qu’elle me donnait le droit de pénétrer partout dans la gare de Chantilly. Or cette gare de Chantilly, située sur la grande ligne du Nord, était traversée sans relâche par des trains de troupes montant ou descendant du front.
C’était pour moi me rapprocher de la bataille, et j’y passais la plus grande partie de mes journées. Tantôt je portais les cruches de lait ou de tisane destinées au ravitaillement des trains, tantôt j’aidais au transport des blessés que l’on descendait des trains et qui étaient dirigés sur nos hôpitaux. Quelle angoisse furent pour moi ces premiers trains de blessés, avec leurs fourgons remplis de malheureux !
Ils arrivaient presque toujours la nuit, et le spectacle offert par ces wagons mal éclairés, dans lesquels gisaient pêle-mêle des hommes accablés de fatigue, anéantis par la souffrance, était inoubliable.
Bien entendu, quand ils pouvaient parler je les interrogeais sans relâche.
— Eh bien ! que se passe-t-il là-bas ?
Certains hochaient tristement la tête sans répondre et se contentaient de demander à boire, mais d’autres étaient heureusement plus bavards. Ils nous racontaient tous les détails des combats auxquels ils avaient assisté.
Le 31 août, — je me souviendrai toujours de cette date, — comme j’arrivais à la gare, un employé me, dit :
— Tu ne sais pas, petit ? Les Allemands sont à vingt kilomètres d’ici. Ils marchent sur Senlis. Si on ne les arrête pas, ils y seront demain.
Je sautai sur ma bicyclette et courus à l’hôpital annoncer cette nouvelle à ma mère, qui, en m’écoutant, devint pâle, mais resta froide et muette.
— Rentrons à la maison, me dit-elle simplement.
Elle prit à peine le temps de jeter un grand manteau sur son costume blanc d’infirmière, et nous courûmes à la gare prendre le train du soir qui allait à Senlis.
Dès que nous y arrivâmes, nous vîmes les habitants affolés qui couraient dans les rues, d’autres qui empilaient des malles dans des voitures, prêts à fuir.
Que se passait-il ?
— On se bat à quelques kilomètres d’ici à peine, du côté de Crépy-en-Valois, nous dit-on. Cette nuit, demain au plus tard, l’ennemi peut être chez nous.
Comme pour confirmer ces sinistres paroles, nous entendîmes à ce moment la voix du canon. C’était la première fois, et je me rappellerai toujours l’émotion que j’éprouvai à l’entendre.
Ainsi c’était vrai. Cet ennemi, que nous avions eu pendant quelques jours l’illusion de vaincre, arrivait en masse, bousculant tout sur son passage ; il venait vers nous, vers notre paisible petite cité. Au moment où nous nous dirigions en hâte vers la mairie, pour aller demander des nouvelles à mon père qui devait s’y trouver sûrement, nous vîmes des gamins accourir en criant :
— Les voilà ! les voilà ! Des uhlans arrivent au galop du côté d’Ermenonville… nous les avons vus !
A ces mots, ma mère me prit le bras. Elle ne dit pas un mot, mais je sentais ses doigts qui se crispaient sur ma manche et ses ongles qui entraient dans ma chair.
Les uhlans !… Ils étaient là ! Pauvre pays !
4.
La mort d’un brave
Ils sont là, chez nous, dans notre ville. Le 2 septembre 1914 est pour moi une date inoubliable. Journée lugubre dès le matin, par la fuite précipitée d’une grande partie de la population. Les uns partaient à pied, à bicyclette, d’autres en voiture, des charrettes sur lesquelles ils avaient empilé leurs objets les plus précieux. Vers onze heures on entendit le canon, et chez nous l’émotion était à son comble quand l’artillerie redoubla d’activité. C’est le combat qui se livre aux environs de Senlis. O spectacle navrant, quand nous vîmes de nos fenêtres les troupes françaises battre en retraite et traverser la ville dans la direction de Paris !
A quatre heures, c’étaient les Allemands qui entraient. Je les ai vus arriver par la route de Compiègne et par celle de Crépy. Ils venaient de tous les côtés à la fois. Infanterie, cavalerie, il y a de tout. Ils ont l’air fatigués, mais triomphants et heureux ; la victoire les grise. Malgré l’effort terrible qu’ils viennent de fournir, ils ont fait dans la ville une entrée triomphale, pendant que les tirailleurs marocains qu’ils ont refoulés s’enfuyaient du côté d’Aumont.
L’état-major est installé à l’hôtel du Grand-Cerf. D’autres sont tout près de notre maison à une autre auberge. De ma chambre j’entends leurs cris et le bruit du piano sur lequel ils jouent des valses viennoises.
Maman m’a défendu de sortir ; elle est avec papa à la mairie, où le conseil est réuni dans l’attente du général ennemi.
Quelle épouvantable chose !…
Mais alors nous sommes vaincus !…
J’ai promis à maman de ne pas sortir et je lui obéirai, mais je meurs de rage et d’inquiétude dans ma chambre. A tout instant je vais avec les domestiques à la fenêtre de la cuisine, qui donne sur la rue, et, par les volets entrebâillés, je regarde. Des officiers passent en examinant avec soin chaque maison, comme s’ils craignaient quelque embuscade. Des patrouilles circulent sans relâche dans les rues, des hommes marquent à la craie sur les portes des signes cabalistiques.
Et toujours ce piano qui joue, ces rires, ces cris de joie, là à côté ! On emmène une femme et l’épicier de la rue de l’Apport-au-pain. Qu’ont-ils fait ?…
Oh ! mes parents ne vont-ils pas bientôt rentrer ? Je ne peux pas rester plus longtemps ainsi, prisonnier, dans l’incertitude… Pourvu qu’ils ne leur fassent pas de mal à eux, les bandits !
Maman est rentrée vers cinq heures du soir et m’a annoncé que papa ne viendrait pas dîner. Il était gardé comme otage.
Je me fis expliquer ce mot, dont je ne comprenais pas très bien le sens, et maman m’affirma qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Des otages étaient des gens notables de la ville que les ennemis gardaient pour répondre, dans le cas où quelques habitants s’aviseraient de tirer sur les envahisseurs.
Mais il n’y avait rien à craindre, se hâta d’ajouter ma mère, toutes les armes avaient été retirées et déposées à la mairie ; les gens de Senlis étaient de braves bourgeois paisibles qui, sachant surtout qu’un certain nombre d’entre eux seraient rendus responsables de leurs actes, ne s’aviseraient pas de se livrer à la moindre menace contre les Allemands.
Malgré ces explications, je n’étais pas tranquille, et je demandai à ma mère l’autorisation d’aller rejoindre mon père.
Elle s’y opposa d’abord, mais j’insistai.
— Maman, lui dis-je, je veux être à côté de mon père en ce moment. Vous me dites vous-même qu’il ne risque rien… A plus forte raison, moi, un enfant, je n’ai rien à craindre de ces bandits.
Ma mère réfléchit un moment, et, devant ma volonté bien arrêtée, elle finit par céder.
— Va, me dit-elle, après tout tu as peut-être raison, et ta présence auprès de ton père ne pourra qu’augmenter sa sécurité. Et puis, tu reviendras de temps en temps me porter des nouvelles. On te délivrera sans doute un laissez-passer à la mairie.
Je vais rejoindre mon père…
Ici est interrompu le court journal de Guy d’Arlon ; mais nous ne voulons pas laisser nos lecteurs en suspens, et si, comme nous l’espérons, les quelques pages écrites par notre jeune héros leur ont donné envie de le suivre à travers les aventures qu’il va courir, nous allons faire de notre mieux pour les leur raconter à sa place.
Guy d’Arlon, en quittant la maison paternelle, se dirigea tout droit vers la mairie, où il comptait trouver son père.
Il fut arrêté, dès le porche, par des sentinelles qui lui demandèrent en mauvais français où il allait et ce qu’il désirait.
Il répondit qu’il venait faire une commission à son père, l’adjoint au maire d’Arlon, otage des autorités militaires allemandes.
Un jeune officier à monocle qui fumait un énorme cigare à quelques pas de là s’était rapproché de l’enfant ; quand il sut ce dont il s’agissait, il réprima un mauvais sourire et dit à Guy :
— Mon garçon, votre père et le maire de la ville ne sont pas en ce moment à la mairie. On les a emmenés pour les interroger à la Kommandantur, parce que des gens de votre ville ont tiré sur nos soldats.
— Et où se trouve la kommandantur ? demanda le petit garçon.
— Là-bas ! fit l’officier, d’un geste vague du côté de Chamant.
Guy n’en demanda pas davantage, et déjà il tournait les talons pour filer dans la direction indiquée, quand le jeune officier monoclé le rappela et, très aimablement, lui dit :
— Attendez donc, mon jeune ami, que je vous donne un laissez-passer, autrement vous ne pourrez pas circuler dans la ville.
Et, déchirant une page d’un carnet, il y écrivit quelques mots, la timbra avec un cachet qu’il portait en breloque et la tendit à l’enfant, en lui disant avec son sourire de plus en plus mauvais :
— Vous avez raison d’aller là-bas, mon jeune ami. Je crois que vous y verrez des choses intéressantes.
L’amabilité exagérée de l’officier ne disait rien de bon à Guy d’Arlon. L’interrogatoire de son père, cette nouvelle que des gens de la ville avaient tiré sur les Allemands, tout cela l’inquiétait, et ce fut en courant qu’il s’élança vers l’endroit qu’on lui avait indiqué. A l’entrée de la route de Compiègne, il tomba sur un barrage de troupes, mais, grâce à son laissez-passer, il put continuer sa route.
En moins d’un quart d’heure il arrivait aux premières maisons du village de Chamant. Il n’eut pas besoin de demander beaucoup de renseignements pour trouver la kommandantur, car il aperçut de loin, attaché à la grille d’une des plus belles propriétés du pays, un fanion de général. De plus, un attroupement était formé devant la porte.
Il s’approcha et entendit des lambeaux de phrases qui immédiatement lui serrèrent le cœur.
— Ils viennent de fusiller le maire.
Guy n’en entendit pas davantage ; il fendit la foule et entra bravement dans le jardin de la villa. Le maire ! ils ont fusillé le maire ! Mais alors papa… qui sait ?
Mais non, voici son père. Il l’aperçoit là-bas, devant la maison, au milieu d’un groupe de militaires, avec lesquels il semble discuter.
C’est en vain qu’on essaye de l’arrêter ; l’enfant court comme un fou vers le groupe au milieu duquel il voit son père, et il entend sa voix frémissante qui crie :
— Messieurs, ce que vous avez fait est inique… Le maire n’était pas coupable ; pas plus qu’aucun des habitants de la ville… Vous savez très bien, du reste, que votre accusation n’est qu’un prétexte.
— Taisez-vous, monsieur, interrompit brutalement un officier en s’adressant à M. d’Arlon, ou bien il pourrait vous arriver à votre tour quelque désagrément.
Guy assistait pétrifié à cet entretien menaçant. Il allait s’élancer vers son père qui lui tournait le dos, le supplier de se calmer, d’être prudent, mais il en fut empêché par des soldats qui l’avaient rejoint. Ceux-ci s’étaient emparés de lui, attendant eux aussi que leur chef en eût terminé avec l’adjoint pour lui demander ce qu’il fallait faire de cet impudent petit Français qui avait osé pénétrer, comme chez lui, dans la maison de M. le général commandant en chef.
Hélas ! la discussion entre l’adjoint et M. le général, loin de s’arrêter, ne faisait que s’aggraver. Guy apercevait avec effroi sur la figure de son père la colère froide d’un homme que l’injustice a affolé et qu’aucune force humaine ne pourra retenir.
— Non ! non et non ! criait-il, j’affirme que personne n’a tiré sur vos troupes… Je vous défie de me désigner la maison où cet attentat aurait eu lieu ; par conséquent vous venez de commettre, en tuant mon collègue et ami le maire de Senlis, un véritable assassinat.
Le général s’était avancé vers l’adjoint, frémissant de colère et d’indignation.
— Maintenez-vous ce mot ? demanda-t-il.
— Je le maintiens.
— Ça suffit.
Le général fit un signe ; aussitôt quatre soldats accoururent, fusil à la main, et se rangèrent sur une ligne au commandement d’un sous-officier.
Guy ne comprit pas tout de suite ce qui allait se passer, mais le silence des officiers, la pâleur de son père, l’air fier avec lequel il avait croisé ses bras sur sa poitrine, lui firent deviner l’horrible vérité : on allait fusiller son père là, devant ses yeux. Il poussa un cri.
— Papa ! papa !
A cette voix, M. d’Arlon se tourna brusquement et aperçut son enfant maintenu par deux soldats, qui s’efforçait vainement de s’élancer vers lui. Le général demanda à l’adjoint :
— C’est votre fils, cet enfant ?
— Oui, répondit simplement M. d’Arlon.
— Vous pouvez lui faire vos adieux, car vous allez être fusillé… Vous pouvez également lui confier vos dernières commissions ; je vous donne un quart d’heure.
Après avoir prononcé ces paroles tranchantes comme un couperet de guillotine, le général fit un signe à ses soldats, qui laissèrent à l’enfant sa liberté. Puis tout le groupe se retira un peu, laissant ensemble le père et le fils, mais sans cependant les perdre de vue. Quant au général, il tourna les talons et monta lentement les degrés du perron pour rentrer dans la maison.
Guy était dans les bras de son père qui l’embrassait en lui disant :
— Mon fils, mon grand chéri, je suis heureux d’avoir pu t’embrasser une dernière fois avant de mourir. Tu apporteras à ta mère mes dernières pensées, et tu te souviendras que je meurs en bon Français pour mon pays, auquel je suis fier de donner ma vie.
« Puisse mon sang assouvir ces bandits et épargner celui des habitants de cette malheureuse ville.
Guy était fou de douleur. Il n’avait pas pu croire d’abord à la réalité de ce qu’il avait entendu. C’était impossible ! On n’allait pas fusiller son père, cet honnête homme, comme un malfaiteur ! Quel crime avait-il donc commis ?
Mais maintenant il fallait bien se rendre à l’évidence. Le calme effrayant de M. d’Arlon, les regards qu’il tenait fixés sur lui lui prouvèrent que toute cette horrible scène n’était pas un cauchemar, mais une triste réalité. Les soldats étaient là, l’arme au pied, qui attendaient, et le général avait dit : un quart d’heure.
Dans quelques minutes ces bandits allaient lui tuer son père !
Il pensa à aller se jeter aux pieds du général, mais l’adjoint devina son intention.
— Non, dit-il avec autorité à son fils, c’est inutile, pas de supplications, pas de faiblesse. Je veux mourir fièrement, en Français.
Puis, avec un sourire triste, il ajouta plus bas :
— C’est d’ailleurs une petite perte… Je peux te le dire maintenant. Les médecins m’avaient condamné avant cet Allemand. Si je n’étais pas encore militaire, c’est que je suis très malade, une angine de poitrine très grave… Tu vois bien, mon chéri, que je peux leur faire sans regret le piètre cadeau de ma vie. Dis-moi une dernière fois adieu et va-t’en… va-t’en vite !… Va trouver ta mère et porte-lui mes tendresses et mon dernier souvenir.
Ce disant, M. d’Arlon tendait à son fils sa montre, son portefeuille, ses clefs ; puis, comme Guy restait devant lui, pâle, tremblant, il ajouta :
— Allons, mon fils… du courage, et plus tard dans la vie, conduis-toi honnêtement comme ton père… Tu verras alors combien on meurt facilement, sans difficulté, sans remords, avec le seul regret de quitter ceux qu’on aime, mais avec la certitude qu’on les retrouvera.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















