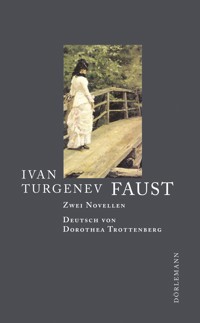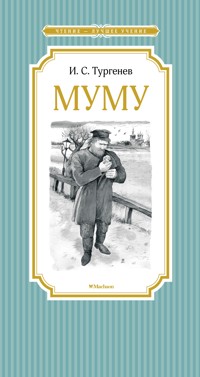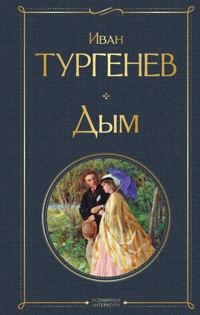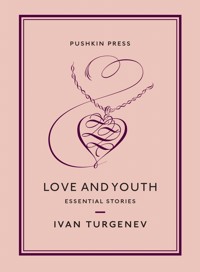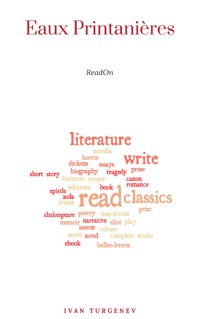
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: WS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Seul et triste, Sanine voit approcher la vieillesse et se souvient. Il avait vingt ans quand il fit étape à Francfort, au retour d'un voyage en Europe. La première fois qu'il vit Gemma, dans la confiserie de sa mère, il en tomba follement amoureux. Gemma est belle, brune, parée de toutes les vertus et, très vite, partage son inclination. Pour elle, Sanine est prêt à tout: il se bat en duel, il l'arrache à son fiancé, un premier commis infatué de lui-même, obtient sa main et décide de vendre ses terres pour assurer à sa belle une vie confortable. Sûr de régler l'affaire en trois jours, il part à Wiesbaden où se trouve en villégiature la femme - riche - d'un de ses amis. C'est là que le destin dérape. Sanine ne reviendra jamais à Francfort, pris dans un piège grossier qui lui coûtera son bonheur...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Eaux Printanières
Ivan Sergeyevich Turgenev
Copyright © 2018 by OPU
Avertissement
Plus de dix années ont déjà passé sur la tombe du grand romancier russe, Ivan Tourgueneff[1] . De son vivant, ses romans avaient été connus et appréciés par les lettrés, mais sans pénétrer jusqu’au grand public.
Ivan Tourgueneff avait débuté par les Récits d’un Chasseur, qui l’avaient d’emblée classé hors de pair.
« Il acheva de s’insinuer dans les cœurs, dit M. Melchior de Voguë[2] , avec d’exquises petites nouvelles du même ordre, avec des romans sentimentaux, comme la Nichée de Gentilshommes, dont le charme reste toujours jeune pour nous, grâce à la discrétion, à la sobriété des moyens qui le produisent. Dans Roudine, il analysait le manque de volonté, l’absence de personnalité morale qu’il reprochait à ses compatriotes, plaisamment et trop sévèrement, quand il disait : « Nous n’avons rien donné au monde, sauf le samovar ; encore n’est-il pas sûr que nous l’ayons inventé. » Dans Pères et Fils, il sondait le fossé infranchissable qui s’était creusé entre la génération du servage et celle de 1860 ; il diagnostiquait et baptisait le premier le mal qui allait ronger les nouveaux venus, le nihilisme. Il en suivit les progrès croissants dans Fumée ; il en décrivit les manifestations extérieures dans Terres vierges.
» Tourgueneff n’a pas poussé aussi loin que Tolstoï la connaissance et la domination de l’âme humaine ; mais il ne le cède à personne pour la divination des nuances de sentiments ; il demeure supérieur à tous ses rivaux par la force du génie plastique ; instruit à notre discipline intellectuelle par la longue fréquentation de nos écrivains, il est le seul Russe qui satisfasse pleinement les exigences du goût classique ; il est l’artiste par excellence. Les courts récits de cet inimitable prosateur ont fait dire à M. Taine que depuis les Grecs, aucun artiste n’a taillé un camée littéraire avec autant de relief, avec une aussi rigoureuse perfection de forme. »
Le moment est venu de réunir les œuvres du plus parfait écrivain de ces derniers temps en une collection complète, que son prix modique rendra accessible à toutes les bourses même les plus modestes.
La traduction de l’œuvre de Tourgueneff a été confiée à M. Michel Delines, dont les travaux sur la littérature russe sont depuis longtemps appréciés par le public.
Les ouvrages paraîtront dans l’ordre annoncé en tête de ce volume.
Eaux Printanières
… Joyeuses années,
Heureuses journées,
Vous avez passé
Comme des eaux printanières.
(Une vieille romance russe.)
Vers deux heures du matin, Sanine rentra dans sa chambre. Dès que son domestique eut allumé les bougies, il le congédia – et se jetant dans un fauteuil, au coin de la cheminée, il enfouit son visage dans ses mains.
Jamais il n’avait ressenti une telle lassitude corporelle et morale.
Il venait de passer la soirée en compagnie de femmes agréables, d’hommes instruits ; quelques-unes de ces femmes étaient belles, presque tous les hommes se distinguaient par leur intelligence et leur talent, – lui-même avait soutenu la conversation avec succès et même brillamment, et cependant jamais encore ce tædium vitæ dont parlent déjà les Romains, jamais encore cette « horreur de la vie » ne l’avait si impérieusement dominé, si violemment étreint.
S’il avait été un peu plus jeune, il aurait pleuré d’angoisse, d’ennui, de surexcitation ; une incisive et cuisante amertume, une saveur d’absinthe pénétrait toute son âme. Un sentiment de dégoût, de douleur l’oppressait, l’enveloppait de toutes parts dans un brouillard de nuit d’automne ; – et il ne savait comment se délivrer de cette obscurité ni de cette amertume.
Il ne pouvait pas attendre l’apaisement du sommeil ; il savait qu’il ne dormirait pas.
Il se mit à réfléchir,… avec paresse, lourdement, méchamment.
Il songea à la vanité, à l’inutilité, à la banale fausseté de tout ce qui est humain.
Il passa en revue tous les âges, – lui-même venait d’entrer dans sa cinquante-deuxième année – et il n’en épargna aucun. Toujours le même effort dans le vide, toujours fouetter l’eau avec des bâtons, toujours se mentir à soi-même, à demi-sincère, à demi-conscient. – Puis, tout à coup, sur la tête tombe la vieillesse, comme la neige… et avec la vieillesse la crainte de la mort qui va toujours en augmentant, qui dévore et qui ronge… et après, le saut dans l’abîme !
Et c’est pour les privilégiés que la vie s’arrange ainsi !… Heureux qui ne voit pas avant la fin s’étendre sur lui, comme la rouille sur le fer, les maladies, les souffrances…
La vie lui apparaissait non comme une mer houleuse, ainsi que les poètes la décrivent, mais comme un océan imperturbablement calme, immobile et transparent jusque dans ses profondeurs les plus obscures ; lui-même il est assis dans une barque vacillante, – tandis que là-bas, sur ce fond sombre et vaseux, on aperçoit comme d’énormes poissons, des monstres difformes : tous les maux de la vie, les maladies, les douleurs, la folie, la misère, la cécité…
Il regarde et voit un de ces monstres surgir des profondeurs, monter à la surface, devenir plus net et en même temps plus horrible. Encore une minute, et la barque soulevée par le monstre va chavirer !…
Mais le monstre s’efface, il s’éloigne, il retourne au fond de la mer… il s’y tapit, et l’eau forme un remous autour de lui… Pourtant son heure viendra… il fera chavirer la barque…
Sanine secoua la tête, et s’élançant hors de son fauteuil, arpenta deux fois la chambre, puis il s’assit à sa table à écrire, et ouvrant les tiroirs l’un après l’autre, il se mit a fouiller dans ses papiers, surtout parmi ses vieilles lettres de femmes.
Il ne savait pas lui-même pourquoi il remuait ces tiroirs, il ne cherchait rien, il voulait seulement, par une occupation quelconque, se délivrer des pensées qui le tourmentaient.
Après avoir au hasard ouvert quelques lettres, – dans l’une, il trouva une fleur séchée, retenue par une faveur dont la couleur était passée, – il haussa les épaules et, regardant le foyer, mit les lettres de côté avec l’intention évidente de brûler tôt ou tard toute cette paperasse inutile.
Passant à la hâte les mains dans tous les tiroirs, il ouvrit tout à coup largement les yeux ; il sortit lentement un petit coffret octogonal, de forme ancienne, et lentement souleva le couvercle. Dans la boîte, sur une double couche d’ouate jaunie se trouvait une petite croix de grenat.
Il considéra quelques instants avec surprise cette croix, puis, tout à coup, il poussa un faible cri.
Ses traits exprimèrent du regret et de la joie.
C’était l’expression d’un homme qui rencontre subitement un ami, qu’il a longtemps perdu de vue, mais qu’il a tendrement aimé, et qui tout à coup lui apparaît, toujours le même, mais changé par l’âge.
Sanine se leva et, revenant à la cheminée, s’assit de nouveau dans le fauteuil, et pour la seconde fois se couvrit le visage de ses deux mains.
« Pourquoi cela arrive-t-il aujourd’hui ? » se demanda-t-il.
Et il se rappela des choses depuis longtemps passées. Voici les souvenirs évoqués par Sanine.
Chapitre1
Pendant l’été de 1840, Sanine, qui venait d’atteindre sa vingt-deuxième année, se trouvait à Francfort, revenant d’Italie, pour retourner en Russie.
Il ne possédait pas une grande fortune, mais il était indépendant et presque sans famille.
À la mort d’un parent éloigné, il avait hérité de quelques milliers de roubles, et il se décida à les dépenser à l’étranger, avant de devenir un fonctionnaire, avant de s’atteler définitivement à ce service de l’État, sans lequel l’existence ne lui semblait pas possible.
Sanine exécuta si ponctuellement ce plan, que le jour où il arriva à Francfort, il ne lui restait que juste assez d’argent pour rentrer à Saint-Pétersbourg. À cette époque, il y avait encore peu de chemins de fer ; les touristes voyageaient en diligence. Sanine prit son billet pour le beiwagen, mais la voiture ne partait qu’à quatre heures du soir. Il avait donc beaucoup de temps à perdre.
Par bonheur, il faisait très beau et Sanine, après avoir dîné à l’hôtel du Cygne Blanc, célèbre à cette époque, se mit à flâner dans la ville. Il alla voir l’Ariane, de Danneker, qui ne lui plut pas beaucoup, et fit un pèlerinage à la maison de Gœthe, dont il ne connaissait du reste que le Werther, et encore dans une traduction française. Il fit une promenade sur les bords du Mein et commença à s’ennuyer un peu, comme il sied à un touriste qui se respecte ; enfin, vers six heures du soir, fatigué, les bottines poudreuses, il se trouva dans une des plus petites rues de Francfort.
Sur une des maisons espacées il aperçut l’enseigne : « Confiserie italienne. Giovanni Roselli. »
Sanine entra pour prendre un verre de limonade, mais dans la première boutique il ne trouva personne. Derrière le modeste comptoir, sur les rayons d’une armoire vernie, étaient alignées, comme dans une pharmacie, des bouteilles portant des étiquettes dorées, et surtout des bocaux renfermant des biscuits, des pastilles de chocolat, du sucre candi, mais le magasin était vide ; seul un chat gris, sur une chaise haute, placée près de la fenêtre, clignait des yeux et ronronnait, remuant les pattes, teinté de rouge éclatant par le rayon oblique du soleil couchant ; sur le plancher un grand peloton de soie écarlate avait roulé à côté du panier de bois sculpté qui était renversé.
Un bruit confus venait de la pièce voisine.
Sanine resta immobile, tant que tinta la sonnette de la porte d’entrée, puis haussant la voix, il cria :
– Il n’y a personne ?
Au même instant la porte de la pièce voisine s’ouvrit, et Sanine resta frappé d’admiration…
Chapitre2
Une jeune fille de dix-neuf ans, avec ses cheveux bruns déroulés sur ses épaules nues, et les bras tendus en avant, s’élança dans la confiserie ; ayant aperçu Sanine, elle courut à lui, le saisit par la main et l’entraîna, criant d’une voix haletante :
– Venez vite, par ici, venez à son secours !
Le saisissement de Sanine ne lui permit pas de répondre aussitôt à cet appel, il resta cloué à la même place.
Il n’avait jamais vu une telle beauté.
La jeune fille se tourna de nouveau vers lui et lui dit :
– Mais venez donc, venez !
Sa voix, son regard, et le geste de sa main crispée qu’elle portait convulsivement à ses joues pâles, exprimaient un désespoir si intense, que Sanine la suivit précipitamment par la porte restée ouverte derrière elle.
Dans la chambre où il pénétra à la suite de la jeune fille, il vit, étendu sur un divan de crin de forme ancienne, un garçon de quatorze ans. Sa ressemblance avec la jeune fille frappait ; évidemment, c’était son frère.
Il était tout blanc avec des reflets jaunes, couleur de cire ou de marbre antique. Les yeux étaient fermés ; l’ombre de ses cheveux touffus et noirs faisait tache sur son front pétrifié et sur ses fins sourcils immobiles ; entre les lèvres bleuies, on apercevait les dents serrées.
La respiration semblait interrompue ; un des bras pendait sur le plancher, l’autre était rejeté derrière la tête.
L’enfant était tout habillé et boutonné jusqu’au menton, sa cravate étroite lui serrait le cou.
La jeune fille courut vers lui avec des sanglots.
– Il est mort, il est mort ! cria-t-elle. – Il y a un instant, il était assis ici, causant avec moi, – lorsque tout à coup il est tombé et, depuis, il n’a plus fait un mouvement… Mon Dieu ! Ne pouvez-vous pas le sauver ? Et maman qui n’est pas à la maison ?
Puis vivement, elle cria en italien :
– Eh bien, Pantaleone, le médecin… As-tu ramené le médecin ?
– Signora, j’ai envoyé Louise chez le médecin, répondit une voix enrouée derrière la porte.
Un petit vieux en frac lilas orné de boutons noirs, le col enfermé dans une haute cravate blanche, avec une culotte de nankin, et des bas de laine bleus, entra dans la chambre en boitant à cause de ses pieds ankylosés.
Son petit visage disparaissait complètement sous une forêt de cheveux gris, couleur de fer. Cette chevelure en broussailles, qui se hérissait par touffes et retombait dans toutes les directions, donnait au vieillard l’air d’une poule huppée ; la ressemblance était rendue plus complète par le fait qu’on ne pouvait distinguer sous cette sombre masse grise qu’un nez pointu et des yeux jaunes, tout ronds.
– Louise arrivera plus vite, moi je ne peux pas courir, continua le vieillard en italien.
Il soulevait l’un après l’autre ses pieds endoloris de goutteux, chaussés de souliers hauts attachés par des rubans.
– J’ai apporté de l’eau, ajouta-t-il.
Et de ses doigts secs et noueux il serrait le long goulot de la bouteille.
– Mais en attendant le médecin, Émile peut mourir, cria la jeune fille, et elle étendit la main du côté de Sanine.
– Oh ! Monsieur, oh ! mein Herr ! vous ferez quelque chose pour nous venir en aide !
– Il faut le saigner – c’est une attaque d’apoplexie, dit Pantaleone.
Bien que Sanine ne possédât aucune connaissance médicale, il savait pertinemment que des garçons de quatorze ans ne peuvent pas avoir des attaques d’apoplexie.
– C’est un évanouissement, ce n’est pas une attaque d’apoplexie, dit-il à Pantaleone. Avez-vous des brosses ? ajouta-t-il.
Le vieux releva son minois ratatiné.
– Qu’est-ce que vous demandez ?
– Des brosses, des brosses, répéta Sanine en allemand et en français.
– Des brosses, ajouta-t-il en faisant le geste de brosser son habit.
Le vieillard comprit enfin.
– Ah ! des brosses, Spazzette ! Pour sûr nous avons des brosses !
– Eh bien, donnez-les-moi vite, nous déshabillerons l’enfant et nous le frictionnerons.
– Bien… Benone ! Et de l’eau sur la tête ? Vous ne trouvez pas nécessaire de lui verser de l’eau sur la tête ?
– Non… Nous verrons plus tard… Allez vite prendre des brosses.
Pantaleone posa la bouteille à terre, trottina hors de la chambre et revint peu après muni d’une brosse à habits et d’une brosse à cheveux.
Un caniche à poils frisés entra en agitant vivement sa queue, et regarda plein de curiosité le vieux, la jeune fille et même Sanine, de l’air de quelqu’un qui se demande ce que signifie tout ce remue-ménage.
Sanine, d’un tour de main, eut déboutonné la jaquette du jeune garçon, ouvert le col de la chemise et retroussé les manches, puis saisissant une brosse, il se mit à frictionner de toutes ses forces la poitrine et les mains.
Pantaleone s’empressa avec non moins de zèle à frictionner les bottes et le pantalon de l’enfant, tandis que la jeune fille, à genoux, près du divan, prenait entre ses mains la tête du malade, et sans remuer une paupière couvait du regard le visage de son frère.
Sanine frictionnait sans relâche, mais du coin de l’œil observait la jeune fille.
– Dieu ! qu’elle est belle ! pensait-il.
Chapitre3
Le nez de la jeune fille était un peu grand, mais d’une belle forme aquiline ; un léger duvet ombrait imperceptiblement sa lèvre supérieure ; son teint était uni et mat – un ton d’ivoire ou d’écume blanche ; – les cheveux étaient onduleux et brillants comme ceux de la Judith d’Allori au palais Pitti, – les yeux surtout étaient remarquables, d’un gris sombre, l’iris encadré d’un liseré noir – des yeux splendides, triomphants, même à cette heure où l’effroi et la douleur en assombrissaient l’éclat.
Sanine songea involontairement au beau pays d’où il revenait.
Cependant, même en Italie, il n’avait pas rencontré une telle beauté !
La jeune fille respirait à de longs intervalles inégaux ; elle retenait son souffle et semblait attendre chaque fois pour voir si son frère ne commençait pas à respirer.
Sanine continuait à frictionner le malade, sans pouvoir s’empêcher d’observer aussi Pantaleone dont la figure originale appelait son attention.
Le vieillard était épuisé de fatigue et haletait ; à chaque coup de brosse il laissait échapper une plainte, pendant que les longues touffes de ses cheveux trempés de sueur se balançaient lourdement en tous sens, comme les tiges d’une grande plante mouillée par la pluie.
– Retirez-lui au moins ses bottes, allait dire Sanine à Pantaleone, lorsque le chien, évidemment surexcité par la nouveauté de cette scène, se dressa tout à coup sur ses pattes de derrière et se mit à aboyer.
– Tartaglia – Canaglia ! lui cria le vieillard.
Au même instant le visage de la jeune fille se transforma, ses sourcils s’arquèrent, ses yeux devinrent encore plus grands et la joie éclata dans son regard.
Sanine examina le malade et distingua sur le visage une légère coloration, les paupières remuèrent… les narines se dilatèrent. L’enfant aspira de l’air entre ses dents toujours serrées et soupira…
– Emilio, cria la jeune fille… Emilio mio. Les grands yeux noirs de l’enfant s’ouvrirent lentement. Ils regardaient encore confusément mais commençaient à sourire faiblement. Le même sourire languissant joua sur ses lèvres pâles, puis il remua son bras pendant, et d’un seul mouvement le ramena sur sa poitrine.
– Emilio, répéta la jeune fille en se levant.
Son visage exprimait un sentiment si intense, qu’il semblait à tout instant qu’elle allait fondre en larmes ou éclater d’un rire fou.
– Emilio ! Qu’est-ce qu’il a ? Emilio ! cria une voix derrière la porte.
Dans la chambre entra à pas précipités une dame proprement vêtue, au visage brun entouré de cheveux d’un blanc d’argent. Un homme d’âge mûr la suivait, et la servante avançait la tête par-dessus son épaule.
La jeune fille courut à leur rencontre.
– Il est sauvé, maman, il vit ! dit-elle en embrassant convulsivement la dame qui venait d’entrer…
– Mais qu’est-il arrivé ? dit la nouvelle venue… Je rentrais… lorsque près de la maison j’ai rencontré le médecin et Louise.
Pendant que la jeune fille racontait à sa mère tout ce qui s’était passé, le médecin s’approcha du malade qui revenait à lui de plus en plus complètement, et qui souriait toujours. Il paraissait commencer à se sentir honteux de toute la peine qu’il avait donnée à tout le monde.
– Comme je vois, vous l’avez frictionné avec des brosses, dit le médecin en s’adressant à Sanine et à Pantaleone… Vous avez très bien fait… C’était une excellente idée… Maintenant nous allons voir ce que nous pouvons encore lui administrer…
Il tâta le pouls du jeune homme.
– Hum ! montrez-moi votre langue !
La mère se pencha soucieuse sur le malade ; l’enfant sourit franchement, fixa ses yeux sur elle et rougit…
Sanine jugea que sa présence était devenue superflue et voulut se retirer, mais avant qu’il eût sa main sur le bouton de la porte d’entrée, la jeune fille se trouva de nouveau devant lui et l’arrêta :
– Vous nous quittez, dit-elle, je ne vous retiens pas, mais vous viendrez nous voir ce soir, n’est-ce pas ?… Nous vous devons tant d’obligations… Vous avez probablement sauvé mon frère de la mort… Nous voulons pouvoir vous remercier… Maman tient à vous exprimer elle-même sa reconnaissance… Il faut nous dire votre nom… Vous devez venir partager notre joie…
– Mais… c’est que je pars ce soir pour Berlin, objecta Sanine.
– Vous avez tout le temps de partir, répéta vivement la jeune fille.
– Venez dans une heure prendre avec nous une tasse de chocolat, ajouta-t-elle. Vous me le promettez ?… Je dois vite retourner auprès du malade… Nous comptons sur vous !
Que pouvait faire Sanine ?
– Je viendrai ! répondit-il.
La belle jeune fille lui serra vivement la main et courut rejoindre son frère. Sanine se retrouva dans la rue.
Chapitre4
Lorsque Sanine, une heure et demie plus tard, revint à la confiserie Roselli, il fut reçu comme un parent.
Emilio était assis sur le divan où il avait été frictionné le matin ; le médecin lui avait ordonné une potion et recommandait « beaucoup de prudence dans les impressions, car le sujet est nerveux avec une propension aux maladies de cœur. »
Emilio avait déjà eu des évanouissements, mais jamais la crise n’avait été si longue ni si forte. Pourtant le médecin assurait que tout danger avait disparu.
Emilio était habillé, comme il convient à un convalescent, d’une ample robe de chambre ; sa mère lui avait entouré le cou d’un fichu de laine bleue. Le malade était gai, il avait presque un air de fête ; et tout autour de lui était à la joie.
Devant le sofa, sur une table ronde, recouverte d’une nappe blanche, se dressait une énorme chocolatière de porcelaine, remplie de chocolat odorant, et tout autour des tasses, des verres de sirop, des gâteaux, des petits pains et jusqu’à des fleurs. Six bougies de cire brûlaient dans deux candélabres de vieil argent ; à côté du divan se trouvait un moelleux fauteuil voltaire, et c’est là qu’on invita Sanine à prendre place.
Toutes les personnes de la confiserie dont Sanine avait fait la connaissance dans la journée étaient réunies autour du malade, sans en excepter le chien Tartaglia ni le chat ; tous semblaient être fort heureux ; le caniche reniflait de plaisir, seul le chat continuait à minauder et à cligner des yeux.
Sanine fut obligé de décliner son nom, de dire d’où il venait, de parler de sa famille. Quand il avoua qu’il était Russe, les deux femmes furent un peu étonnées et laissèrent échapper un : « Ah ! » tout en déclarant qu’il parlait très bien l’allemand, mais elles l’invitèrent à continuer la conversation en français si cela lui était plus agréable, car toutes deux comprenaient cette langue et la parlaient.
Sanine s’empressa de profiter de cette aimable proposition.
« Sanine ! Sanine ! » La mère et la fille n’auraient jamais cru qu’un Russe pût porter un nom aussi facile à prononcer. Le petit nom de Sanine, Dmitri, leur plut de même beaucoup.
La mère de Gemma s’empressa de remarquer que dans sa jeunesse elle avait vu un opéra : « Demetrio et Polibio », mais que « Dmitri » sonnait infiniment mieux que « Demetrio ».
Sanine passa aussi une heure en conversation avec les deux Italiennes, qui, de leur côté, l’initièrent à tous les événements de leur vie.
La mère tenait généralement la parole. Sanine apprit d’elle son nom, Leonora Roselli. Elle était veuve de Giovanni Battista Roselli, qui était venu vingt-cinq ans auparavant à Francfort en qualité de confiseur. Giovanni Battista était de Vicenza ; c’était un excellent homme bien qu’un peu emporté et orgueilleux, et par-dessus tout cela, républicain !
En prononçant ces mots, madame Roselli désigna un portrait à l’huile placé au-dessus du divan.
– Il faut croire que le peintre, – « un républicain aussi ! » ajouta madame Roselli en soupirant, – n’avait pas su saisir parfaitement la ressemblance, car sur son portrait, Giovanni Battista apparaissait sous les traits d’un sinistre et féroce brigand, comme un Rinaldo Rinaldini !
Madame Roselli elle-même était née dans la belle et antique cité de Parme, où se trouve cette divine coupole peinte par l’immortel Corrège. Une partie de sa vie pourtant avait été passée en Allemagne, et elle s’était presque germanisée.
Elle ajouta, en branlant tristement la tête, qu’il ne lui restait plus que cette fille et ce fils, et du doigt elle les montrait tour à tour, puis elle dit que sa fille s’appelait Gemma et son fils Emilio, et que tous les deux étaient d’excellents enfants, obéissants, surtout Emilio…
– Et moi, je ne suis pas obéissante ? interrompit Gemma.
– Oh ! toi aussi tu es républicaine ! répondit la mère.
Madame Roselli déclara pour conclure qu’assurément elle gagnait de quoi vivre, mais que les affaires allaient beaucoup moins bien que du temps de son mari, qui était un grand artiste en fait de confiserie.
– Un grand’uomo ! affirma Pantaleone d’un air grave.
Chapitre5
Gemma, tout en écoutant sa mère, tantôt riait, soupirait, caressait l’épaule de la vieille dame, la menaçait du doigt, puis la regardait. Enfin, elle se leva, prit sa mère dans ses bras et la baisa sur la nuque à la naissance des cheveux, ce qui fit rire beaucoup la bonne dame tout en poussant de petits cris effarouchés.
Pantaleone, à son tour, fut présenté au jeune Russe.
Pantaleone avait été autrefois un baryton d’opéra, mais il avait depuis longtemps terminé sa carrière artistique et occupait dans la famille Roselli une place intermédiaire qui tenait de l’ami de la maison et du domestique. Bien qu’il fût depuis un grand nombre d’années en Allemagne, il n’avait appris qu’à jurer en allemand et cela en italianisant impitoyablement ses jurons.
– Ferroflucto spitcheboubio ! (maudite canaille), disait-il de presque tous les Allemands.
En revanche, il parlait l’italien en perfection, car il était originaire de Sinigaglia, où l’on peut entendre la lingua toscana in bocca romana.
Emilio faisait le paresseux et s’abandonnait aux agréables sensations d’un convalescent qui vient d’échapper à un grand danger. Du reste il était facile de voir qu’il avait l’habitude d’être gâté tant et plus par tous les siens.
Il remercia Sanine, d’un air confus, mais son attention se concentrait sur les sirops ou les bonbons.
Sanine fut obligé de prendre deux grandes tasses d’excellent chocolat et d’absorber une quantité fabuleuse de biscuits ; à peine venait-il d’en grignoter un, que déjà Gemma lui en offrait un autre, – et comment aurait-il pu refuser ?
Au bout de quelques instants Sanine se sentit dans cette famille comme chez lui ; le temps s’envolait avec une rapidité incroyable.
Sanine parla beaucoup de la Russie, de son climat, de la société russe, du moujik, et surtout des cosaques, de la guerre de 1812, de Pierre-le-Grand, des chansons et des cloches russes.
Les deux femmes avaient une notion très vague du pays où Sanine était né, et Sanine fut stupéfait, lorsque madame Roselli, ou, comme on l’appelait plus souvent, Frau Lénore, lui posa cette question :
– Le palais de glace qui avait été élevé à Saint-Pétersbourg au siècle dernier, et dont j’ai lu dernièrement la description dans un livre intitulé : Bellezze delle arti, existe-t-il encore ?
– Mais croyez-vous donc qu’il n’y a jamais d’été en Russie ? s’écria Sanine.
Et alors madame Roselli avoua qu’elle se représentait la Russie comme une plaine toujours couverte de neiges éternelles, et habitée par des hommes vêtus toute l’année de fourrures et qui sont tous militaires : – il est vrai, ajouta-t-elle, que c’est le pays le plus hospitalier de la terre, et le seul où les paysans sont obéissants.
Sanine s’efforça de lui donner, ainsi qu’à sa fille, des notions plus exactes sur la Russie. Lorsqu’il en vint à parler de musique, madame Roselli et sa fille le prièrent de leur chanter un air russe, et lui montrèrent un minuscule piano, dont les touches en relief étaient blanches et les touches plates noires. Sanine obéit sans faire de façons, et s’accompagnant de deux doigts de la main droite et de trois doigts de la main gauche (le pouce, le doigt du milieu et le petit doigt), il se mit à chanter, d’une voix de ténor un peu nasale, le Saraphan, puis Sur la rue, sur le pavé.
Ses auditrices louèrent fort sa voix et sa musique, mais s’extasièrent surtout sur la douceur et la sonorité de la langue russe, et le prièrent de leur traduire les paroles. Comme ces deux chansons ne pouvaient donner une très haute idée de la poésie russe, Sanine préféra déclamer la romance de Pouchkine : Je me rappelle un instant divin, qu’il traduisit et chanta. La musique était de Glinka.
L’enthousiasme de madame Roselli et de sa fille ne connut plus de bornes. Frau Lénore découvrit une ressemblance étonnante entre le russe et l’italien. Elle trouva même que les noms de Pouchkine (elle prononçait Poussekine) et de Glinka sonnaient comme de l’italien.
Sanine à son tour obligea la mère et la fille à lui chanter quelque chose : elles ne se firent pas prier. Frau Lénore se mit au piano et chanta avec Gemma quelques duettini et stornelli. La mère avait dû avoir dans le temps un bon contralto ; la voix de la jeune fille était un peu faible, mais agréable.
Chapitre6
C’était Gemma et non sa voix que Sanine admirait.
Il était assis un peu en arrière et de côté, et pensait qu’un palmier ne pourrait pas rivaliser avec l’élégante sveltesse de la taille de la jeune Italienne, et lorsqu’elle levait les yeux dans les passages expressifs, il semblait au jeune homme que devant ce regard le ciel devait s’ouvrir.
Le vieux Pantaleone lui-même, qui écoutait gravement, d’un air de connaisseur, une épaule appuyée au battant de la porte, le menton et la bouche enfouis dans son ample cravate, subissait le charme de ce beau visage, bien qu’il le vît tous les jours.
Le duettino terminé, Frau Lénore dit qu’Emilio possédait une très belle voix – un timbre d’argent, mais qu’il était à l’âge où la voix change et qu’il lui était défendu de chanter. C’était à Pantaleone de se ressouvenir, en l’honneur de leur hôte, des airs qu’il chantait si bien autrefois.
Pantaleone fit la mine, se renfrogna, ébouriffa ses cheveux et déclara que depuis des années il avait abandonné le chant, bien qu’il fût un temps où il pouvait être fier de son talent. Il ajouta qu’il appartenait à cette grande époque où il y avait encore de vrais chanteurs classiques – – qu’on ne saurait comparer aux glapisseurs de nos jours. Alors il y avait vraiment ce qu’on est en droit d’appeler une école de chant, et quant à lui, Pantaleone Cippatola de Varèse, ne lui avait-on pas jeté à Modène une couronne de lauriers et n’avait-on pas lâché en son honneur des pigeons blancs sur la scène ? Enfin, un certain prince Tarbousski – il principe Tarbusski – avec lequel il était intimement lié, ne le tourmentait-il pas chaque soir pour l’engager à faire une tournée en Russie, où il lui promettait des montagnes d’or, des montagnes d’or !… Mais Pantaleone était bien décidé à ne pas quitter l’Italie, le pays de Dante, il paese del Dante !…
Ensuite vinrent les malheurs, il avait été imprudent…
Ici le vieillard s’interrompit, poussa deux profonds soupirs, baissa les yeux puis se remit à parler de l’époque classique du chant, et en particulier du célèbre ténor Garcia, pour lequel il nourrissait une admiration sans bornes.
– Voilà un homme ! s’écria-t-il. Jamais le grand Garcia – « il gran Garcia » – n’a condescendu à chanter comme les petits ténors – tenoracci