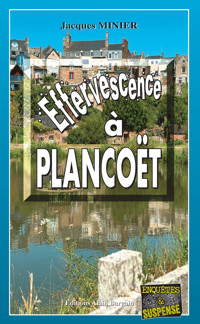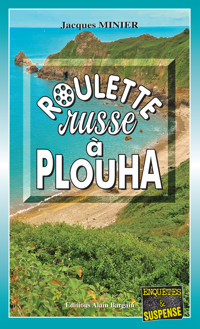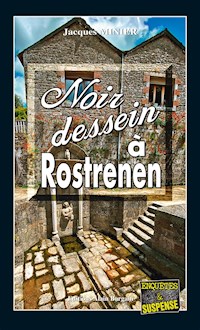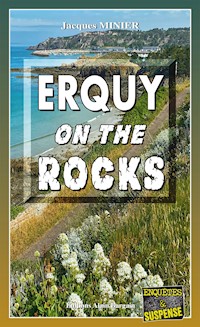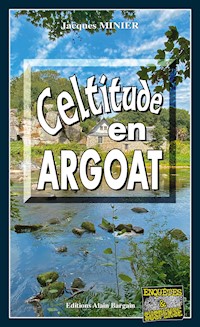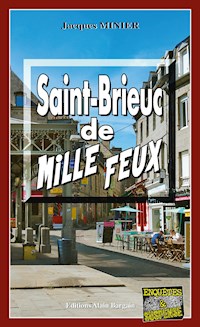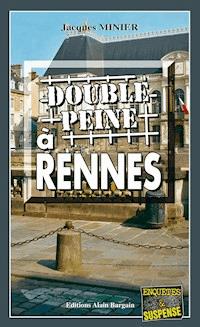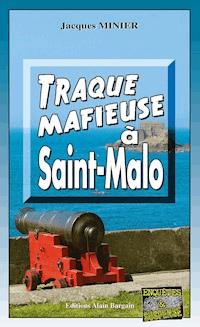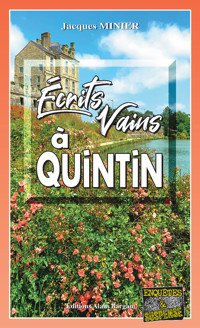
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Audrey Tisserand, capitaine de police
- Sprache: Französisch
Quintin, juillet 2023. Le décès d’un vieillard, dernier d’une lignée de négociants en toiles. Une chute mortelle d’un de ses neveux dans un escalier vermoulu. Un mystérieux tableau disparu qui réapparaît soudain, puis disparaît encore…
Plongés au cœur de l’énigme en répondant à la sollicitation d’un ami, Audrey et Jonathan se perdent en conjectures en tentant de démêler les fils de cet écheveau inextricable.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jacques Minier, Breton né à Saint-Brieuc en 1958, vit à Trégueux. Ancien professeur des écoles, il mêle dans ses romans sa passion pour les récits à suspense à son profond attachement à sa terre bretonne, si riche en contrastes. Dans ce huitième volume, Audrey et Jo, notre couple d’enquêteurs, assistent un ami dans l’affliction en le suivant à Quintin, jolie ville des Côtes-d’Armor, dotée d’un riche passé historique marqué par la fabrication et le commerce lucratif de la toile de lin sous l’Ancien Régime.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À mes chers disparus
REMERCIEMENTS
J’adresse mes profonds remerciements à tous les membres de l’équipe des Éditions Alain Bargain pour leur confiance et pour l’ensemble du travail accompli, à la correction, à la réalisation et à la distribution de mes livres.
J’exprime également toute ma reconnaissance à ma femme Michèle pour ses relectures et ses conseils avisés.
Je remercie les lecteurs d’avoir choisi de vivre avec Audrey et Jo les péripéties de cette nouvelle enquête. Je vous souhaite un agréable moment en leur compagnie.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
I
Lundi 3 juillet 2023, 14 heures – Sur la RN12
Au volant de sa voiture, Jo roulait sur la voie express en direction de Saint-Brieuc. À côté de lui, son ami Jean Berthonnier ne tenait plus en place sur son siège, de plus en plus fébrile à mesure qu’ils se rapprochaient du but de leur déplacement : Quintin, à une quinzaine de kilomètres au sud de Saint-Brieuc.
— Non, je vous le redis, Jo : ça ne peut pas être un accident. Pierre-Yves n’est pas tombé tout seul dans cet escalier. Il a été poussé, les marches vermoulues ont cédé et il s’est brisé le cou.
Jo haussa les sourcils, passablement agacé par la énième variation sur le même thème : la mort, suspecte selon Jean, de son cousin Pierre-Yves dans la maison de leur oncle Robert, lui-même décédé un mois plus tôt. Il préféra garder le silence, plutôt que de relancer une discussion qui n’apporterait rien de plus.
Il repensa à la manière dont Jean avait fait irruption, vendredi dernier vers 17 h 30, dans son bureau au siège de “Celarbrobreizh”, le groupe de PME qu’ils dirigeaient tous deux. Son ami, l’air égaré, lui avait annoncé la mort de son cousin : la femme de celui-ci, en pleine détresse, venait de lui téléphoner.
Il avait prévenu Jo qu’il allait devoir s’absenter pour aller auprès d’elle. Jo lui avait dit de prendre tout le temps dont il aurait besoin.
Ce matin, Jean était de retour au siège du groupe. Il était aussitôt allé trouver Jo dans son bureau pour lui exposer ses doutes sur le caractère accidentel du décès de son cousin.
— J’ai appelé la gendarmerie de Quintin, avait-il raconté, très agité. Le chef de brigade m’a dit que le médecin qui a signé le certificat de décès a conclu à une rupture des cervicales, consécutive à un violent traumatisme à la base de l’occiput. Il a ajouté qu’une enquête était en cours, comme toujours en pareil cas, que des prélèvements avaient été effectués sur place, qu’ils étaient en cours d’analyse, et que, vraisemblablement, tout concordait avec la thèse de l’accident. Je lui ai répondu que je n’y croyais pas du tout. Sa femme non plus n’y croit pas : il était très sportif, il faisait de la course à pied, il avait un poids léger, il était suffisamment tonique pour amortir sa chute et éviter un choc mortel !
Jo avait tenté de le raisonner :
— Jean, malheureusement, de telles chutes dans des escaliers se produisent parfois, sans que ce soient des actes criminels…
— Alors, pour vous aussi, c’est un accident ? Vous vous rangez de leur côté ? avait rétorqué Jean, l’air farouche.
— Je ne me range du côté de personne ! J’évite de conclure trop vite, c’est tout. L’enquête suit son cours ; il faut attendre.
Jean avait haussé les épaules, déçu de la réserve de Jo.
— Je vais aller à Quintin cet après-midi. Les gendarmes m’ont dit qu’ils avaient fini leurs investigations sur place et que l’accès était maintenant ouvert partout dans la maison.
— Vous voulez aller mener votre propre enquête ?
Jean avait à nouveau haussé les épaules.
— Je veux m’en rendre compte par moi-même. Et puis, il va y avoir du travail sur place : la maison est à vider. Je veux voir ce qu’il faudra trier, quelles vieilleries évacuer, vendre ou donner ce qui peut l’être… Jo, vous voudriez m’accompagner sur place ?
Jean était passablement désemparé. Après son éclat, il était en quête de soutien. Jo, peu tenté par cette visite qui ne donnerait pas grand-chose selon toute vraisemblance, avait cependant pris la décision de suivre son ami à Quintin. Il avait toutefois tenu à prendre sa voiture, car Jean avait une réputation de conducteur maladroit solidement établie. On ne lui connaissait plus le nombre d’accrochages, certes bénins, que son étourderie au volant avait causés. Jean n’avait pas protesté ; il en avait même été soulagé.
*
Peu avant Saint-Brieuc, ils quittèrent la RN12 pour emprunter la voie de contournement de l’agglomération par le sud. Suivant les indications du GPS de bord, Jo prit la direction de Quimper pour atteindre les abords de la jolie cité de Quintin vingt minutes plus tard. La descente de l’Arrivée leur offrait une jolie vue sur l’étang sur la gauche et sur la ville nichée en contrebas sur la droite. En surplomb, la silhouette altière du château se dressait au-dessus des remparts. Jo se rendit au centre-ville et put se garer sur la place 1830. Il fourragea dans la boîte à gants et parvint à mettre la main sur le disque zone bleue nécessaire à cet emplacement.
En sortant de l’auto, il jeta un coup d’œil tout autour de lui et fut tout de suite conquis par le charme du centre-ville avec ses magnifiques maisons à pans de bois, témoignant de la prospérité passée de cette cité médiévale. De nombreuses boutiques aux devantures alléchantes bordaient la place et les rues adjacentes, signe de sa vitalité commerçante.
Jo se hâta de rattraper Jean qui trottait déjà vers la rue principale. Peu après, son ami s’arrêta devant une grande et haute demeure bourgeoise à la façade de granite gris.
— C’est ici, annonça Jean, la maison de mon oncle Robert Bourget, dite « Maison Bourget », sise bizarrement au 102 de la Grande-Rue, un numéro qui ne suit absolument pas l’ordre des autres numéros de la rue. Elle appartient à la famille Bourget sans doute depuis le XVIe siècle, mais a été reconstruite au XVIIe siècle, afin de rivaliser avec les demeures des autres riches négociants toiliers de Quintin.
Jean introduisit la clé que lui avait remise le notaire de son oncle après la mort de celui-ci. Il ouvrit la porte et fit faire à Jo un tour rapide des pièces, réparties sur trois niveaux, sans compter la cave. Au rez-de-chaussée, de part et d’autre du vestibule d’entrée, se trouvaient une cuisine spacieuse à l’équipement vieillot sur la droite et un vaste séjour, composé d’une salle à manger et d’un salon-bibliothèque meublés à l’ancienne. Un large escalier menait au palier du premier étage desservant trois chambres austères au mobilier rustique de bois sombre, ainsi que le charmant bureau pourvu de meubles de style classique du feu maître des lieux. Une salle de bains avait été aménagée depuis quelques années à chaque étage. Jo suivit Jean au deuxième étage, où se trouvaient trois autres chambres.
L’œil de Jo fut aussitôt attiré par l’escalier d’en face qui conduisait au grenier. Il s’agissait d’un escalier de meunier dans un état de vétusté avancée, s’appuyant sur la gauche contre le mur sur lequel était fixée une rampe de bois. Sur la droite, une rambarde branlante offrait une protection illusoire. Plusieurs marches étaient rompues et l’on distinguait çà et là des traces d’un brun rougeâtre. Des étais métalliques de chantier avaient été placés pour soutenir la structure et des planches avaient été fixées pour renforcer les marches vermoulues.
— Voici le théâtre du drame, dit Jean en montrant l’escalier. Le menuisier l’a bien consolidé. Il est maintenant possible de monter au grenier. Les gendarmes ont pu procéder à l’examen de l’escalier et effectuer leurs prélèvements.
— Eh bien ! constata Jo. Quand on en voit l’état, on se dit qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que des marches se soient brisées sous le poids d’une personne !
— Et voilà ! Vous dites comme les gendarmes ! Personne ne semble vouloir comprendre que la chute de mon cousin a été provoquée ! Pourtant, j’ai téléphoné au menuisier qui n’a pas été aussi affirmatif que les enquêteurs : il m’a dit que les marches auraient pu supporter le poids d’un homme pas très lourd, en marchant sur le côté, près du mur.
Jo s’abstint de répliquer : Jean était pour l’instant incapable d’admettre une autre opinion que la sienne.
Ils montèrent tous deux en s’accrochant à la rampe qui, elle, était vissée solidement au mur, et en serrant sur la gauche pour éviter de marcher sur les traces brunâtres.
— Vous voyez ces taches rouge-brun ? montra Jean. C’est le sang de Pierre-Yves qui a coulé de sa blessure derrière la tête.
Ils prirent pied dans le vaste grenier. Jo leva la tête et fut aussitôt saisi par l’ampleur du désordre qui y régnait. Il y avait là un monstrueux bric-à-brac : du vieux mobilier, de la vaisselle usagée, un enchevêtrement d’objets hétéroclites, des reproductions de tableaux abîmées par le temps, des malles emplies de draps, de vieux vêtements, d’anciens livres, ou encore d’antiques valises en carton pleines de vieux papiers.
Jo émit un long sifflement marquant sa surprise.
— Eh bien ! Il va y avoir un peu de travail à ranger tout ça !
— Oui, admit Jean. Avec mes cousins, nous avons décidé de recourir aux services d’une entreprise pour tout enlever, mais auparavant, il faut effectuer un tri. Certaines choses peuvent avoir de la valeur. Justement, je me disais…
« Et voilà ! se dit Jo en voyant son ami chercher ses mots.
Il a prévu de m’embarquer dans ses affaires et il réfléchit à la meilleure façon de me présenter la chose. »
— Je me disais que mes quatre cousins et moi pourrions nous retrouver le week-end prochain pour effectuer du tri dans ce capharnaüm. Euh… Vous pourriez venir aussi, ainsi que votre charmante épouse Audrey. Comme cela, vous enquêteriez discrètement sur la mort de Pierre-Yves.
— Merci pour la sympathique invitation, se moqua gentiment Jo. Je vois que vous avez bien mijoté votre coup. Vous êtes sûr que vos cousins vont y répondre ?
— Oui, je les ai déjà contactés. Je leur ai dit qu’il y avait un certain mystère dans la mort de Pierre-Yves et qu’il était nécessaire qu’on se retrouve. Ils ont accepté ces retrouvailles, peut-être par goût du mystère ou peut-être simplement par respect pour Pierre-Yves.
— Donc, il ne vous restait plus qu’à me convaincre, moi ! Et puis Audrey, par mon intermédiaire.
— Je ne vais pas insister, puisque vous pensez qu’il s’agit d’un accident, répliqua Jean, la mine contrite.
Jo lisait la déception sur le visage débonnaire de son ami. « Après tout, se dit-il, à défaut d’enquêter sur un meurtre très hypothétique, ma présence ici serait un soutien pour un ami dans l’affliction. »
— D’accord, Jean, je viendrai. Mais je ne promets rien pour Audrey.
Les traits de Jean s’illuminèrent aussitôt.
— Merci, Jo ! Je suis touché.
— Jean, dites-moi : est-ce que vous soupçonneriez un de vos cousins d’avoir poussé Pierre-Yves dans l’escalier ?
— Aucun d’entre eux ne peut être écarté d’office, mais le responsable de sa chute peut aussi être quelqu’un d’extérieur à la famille.
II
Vendredi 7 juillet 2023, 16 heures – Maison Bourget – Quintin
Jean déverrouilla la porte et entra. Audrey et Jo le suivirent à l’intérieur de la demeure.
— Mes cousins n’arriveront pas avant 17 heures. Vous allez pouvoir vous installer tout de suite dans votre chambre, au deuxième étage. La mienne s’y trouve aussi. Mes cousins occuperont celles du premier. Elles sont prêtes. J’ai contacté Annie, l’employée de maison de mon oncle pour qu’elle reprenne du service : je l’ai chargée de s’occuper de notre accueil et d’engager des extra en cuisine pour le week-end.
Les trois amis montèrent avec leurs bagages. Lorsqu’ils atteignirent le palier du deuxième, Audrey remarqua aussitôt l’escalier de meunier en piteux état, renforcé par des étais. Elle lança un coup d’œil dubitatif vers son mari.
— On va voir ça de plus près après notre installation, temporisa Jo en ouvrant la porte de la chambre.
Le cadre austère de la chambre avec son ameublement d’antan amena une grimace comique sur le gracieux visage d’Audrey. Jo ne put s’empêcher de rire devant sa moue dépitée.
— Un week-end de rêve dans un décor d’autrefois ! plaisanta Jo.
— Toi, je te retiens ! maugréa-t-elle, l’œil sombre. M’entraîner là-dedans sous prétexte d’une énigme à résoudre ! Tu parles ! L’escalier, là, il est pourri ! Accident, fin de l’enquête, point ! Quand est-ce qu’on repart ? Quand je pense qu’on a laissé Nora à mes parents, au lieu de passer ce premier week-end des vacances scolaires avec nous !
Nora était leur petite fille, âgée de six ans.
— Audrey, s’il te plaît, implora Jo. On ne pouvait quand même pas emmener Nora. Et Jean a besoin de nous. Son cousin Pierre-Yves était son préféré ; le coup est rude pour lui. Il a besoin de croire qu’il n’est pas tombé tout seul.
Audrey fit non de la tête, faisant voleter ses cheveux auburn.
— Tu ne lui rends pas service en le confortant dans cette idée.
— Je ne lui ai jamais dit que j’étais d’accord avec lui.
— Allons voir de près cet escalier ! coupa Audrey.
Sur le palier, ils furent aussitôt rejoints par Jean, impatient de reprendre le fil de son obsession.
Audrey s’approcha de l’ouvrage en péril ; elle effectua une sorte de sondage à l’aide de quelques tâtonnements, constata l’état du pourrissement du bois des marches.
La policière finit par rendre son verdict.
— Jean, vous voulez à tout prix que sa mort soit autre chose qu’un accident, mais il faut bien admettre que cet escalier est pourri. Regardez, les renforts installés par le menuisier n’empêchent pas de voir que là où le bois s’est cassé, c’est plein de petits trous de bestioles ! À ce que j’ai cru comprendre, votre cousin portait un objet encombrant. Une marche cède, puis la suivante, il ne peut pas se retenir à la rampe…
— D’accord, mais il était en excellente forme physique, coupa Jean. Il aurait dû pouvoir amortir sa chute et éviter, au moins partiellement, un choc si violent qu’il en a eu le cou brisé !
— Des chutes graves dans les escaliers, il y en a assez souvent malheureusement. Ce sont des accidents ! Parfois mortels, hélas ! D’ailleurs, les constatations du médecin et le rapport de gendarmerie concluent à un accident…
— Conclusion trop rapide ! rétorqua Jean. Et vous vous dépêchez d’approuver vos collègues gendarmes !
Audrey sentait la moutarde lui monter au nez.
— C’est le procureur qui décide s’il y a matière à ouvrir une information judiciaire en fonction du rapport des enquêteurs… Mais, j’y pense ! La brigade de recherche de Saint-Brieuc est sans doute intervenue ici. Je vais appeler le capitaine Danic, le chef de cette brigade, avec qui j’ai travaillé sur plusieurs enquêtes. Il acceptera peut-être de fournir quelques détails.
— Ah ! Bonne idée ! Enfin ! se réjouit Jean, tandis qu’Audrey lançait son appel.
Elle lui adressa un regard agacé, alors que son correspondant décrochait.
— Bonjour, Capitaine ! fit Danic. Que me vaut la bonne surprise de vous entendre ?
Audrey lui expliqua l’objet de son coup de téléphone.
Il mit quelques secondes à répondre, avec une certaine réticence dans la voix.
— Vous savez que je n’ai pas le droit de parler d’une enquête en cours…
— Elle est donc toujours en cours ?
— Oui, mais le proc’ va la classer, sans doute dès le début de la semaine prochaine. Son substitut nous l’a laissé entendre ce midi au téléphone. Il a dit : « C’est un malheureux accident… Il n’y a pas à chercher plus loin. » Moi, ce que je peux dire, c’est que le bois des marches était pourri. Avec les gars de mon équipe, on a fait notre travail habituel…
— Et vous n’avez rien relevé de particulier ?
— Rien… Rien qui soit susceptible de remettre en cause la thèse de l’accident.
Audrey leva les yeux, capta le regard de Jo. Lui aussi avait senti la très légère hésitation de Danic.
— Mais quelque chose vous chiffonne. Je me trompe ? l’encouragea Audrey.
— Pas vraiment… Les prélèvements sur le corps correspondent aux conclusions du rapport médical. On a recueilli quantité de fibres de bois sur ses vêtements à l’arrière des jambes, au niveau du fessier et du dos et à l’arrière de la tête, au niveau de la nuque et du crâne : il est tombé de tout son long sur le dos et il s’est brisé les cervicales.
— Vous avez envoyé les fibres de bois au labo ?
— Non, ça, on peut le faire nous-même à notre labo de la gendarmerie à Saint-Brieuc. Euh… On n’avait pas vraiment l’intention de le faire, vu que le substitut nous a dit avoir tous les éléments pour conclure à un accident. On a déjà plein d’autres choses à traiter dans des affaires bien plus complexes, alors…
— D’accord, je comprends… Donc, ce ne sont pas les fibres de bois qui vous gênent. Quoi alors ?
— Les empreintes des chaussures peut-être… Et encore, c’est loin d’être évident. C’est plutôt une impression, mais juste sur un détail mineur… un truc un peu bizarre.
— Dites toujours, le pressa Audrey.
— On a effectué des relevés d’empreintes de chaussures sur les marches montant au grenier.
— OK, et alors ?
— Côté mur à gauche, on a des empreintes de tennis d’une seule et même paire, pied droit, pied gauche en alternance sur le bord gauche de chaque marche dans le sens de la montée… La victime portait ces tennis.
— Donc, une seule personne : la victime. Elle est montée en prenant appui à l’endroit des marches le plus solide.
— Oui, et elle s’est obligatoirement accrochée à la rampe. Or, la rampe est nickel, toute propre.
— Et alors, si la victime portait des gants…
— Elle avait des gants effectivement, mais la rampe était toute propre, bien astiquée, expliqua Danic. Même avec des gants, il aurait dû y avoir des traces d’anciennes empreintes digitales ou palmaires.
— Peut-être que le ménage avait été fait peu de temps auparavant ?
— Peut-être, mais vu l’état de l’escalier, ça m’étonnerait que l’employée de ménage soit allée se risquer sur ces marches.
— D’accord, c’est très improbable. Autre chose ?
— Les empreintes absentes dans le sens de la descente. Il n’y en a aucune, même sur les marches du haut sur lesquelles elle aurait dû en laisser. Davantage vers leur centre puisqu’elle portait une lourde pendule et qu’elle ne pouvait pas se tenir à la rampe.
— Elle sera tombée du haut de l’escalier, non ?
— Dans ce cas, on aurait trouvé des traces de la chute dès les premières marches, ce qui n’est pas le cas. Et puis, il y a le grenier aussi… On n’a relevé que les seules empreintes de tennis de la victime…
— Normal ! Elle était seule et a donc laissé ses seules empreintes.
— … sur un parquet anormalement propre, termina Danic. Quand on voit tout le fatras poussiéreux là-dedans, c’est curieux.
— Vous voulez dire que le parquet a été soigneusement nettoyé avant ?
— Peut-être que c’est la victime qui l’a nettoyé. Mais avec quoi ? On n’a pas retrouvé d’ustensiles de ménage dans le grenier ni sur le palier où elle est tombée ; même pas un chiffon. Et ensuite, elle a allègrement piétiné le parquet, vu les multiples empreintes.
— Donc, ça fait quelques petits détails qui clochent, mais vous avez raison : est-ce qu’on peut les considérer comme suffisants pour suspecter autre chose qu’un accident ?
— C’est dans mon rapport. Mais à mon avis, les services du proc’ risquent de ne pas en tenir compte.
— Je vous remercie beaucoup pour vos explications, Capitaine, conclut Audrey avant de raccrocher sur un échange de politesses.
Jean dardait sur Audrey un regard plein d’espoir.
— Vous voyez ! dit-il. Des détails interpellent !
— Je n’ai pas dû entendre exactement la même chose que vous, répliqua Audrey. Il a surtout dit que le proc’ allait classer l’affaire.
À ce moment, la sonnerie de la porte d’entrée retentit, annonçant l’arrivée du premier des cousins.
III
Vendredi 7 juillet 2023, 18 heures – Maison Bourget – Quintin
À la demande de Jean, ils étaient tous réunis dans le grand salon, dans les confortables fauteuils et canapés de vieux cuir. Chacun avait précédemment pris possession de sa chambre et était descendu à l’heure dite. L’ambiance était maussade, ce qui se comprenait aisément au vu des circonstances : ils avaient perdu en peu de temps leur oncle et leur cousin. De la salle à manger contiguë leur parvenait le tintement de la vaisselle que les extra disposaient sur la table.
Jean se chargea des présentations. Il s’adressa à ses cousins :
— Voici mes amis Audrey et Jonathan Fauvel. Jo, médecin de formation, est le président de notre groupe industriel Celarbrobreizh ; autrement dit, il est mon patron. Son épouse Audrey est capitaine de police au SRPJ de Rennes.
À l’annonce de la profession d’Audrey, Jo crut déceler quelques signes de surprise ou de crispation sur certains visages. Ce qui ne voulait d’ailleurs rien dire, ce type de réactions étant habituelles.
Jean présenta ensuite ses quatre cousins aux Fauvel.
— Ils portent tous le même patronyme de Bourget, dit-il. Christian et Alain sont frères. Franck et Simon le sont aussi. Il y avait aussi Pierre-Yves qui portait ce même nom. Ils sont les fils de trois frères de ma mère, son quatrième frère étant notre oncle Robert.
Audrey et Jo portaient leur attention sur chacun d’entre eux au fur et à mesure des explications de Jean. Tous deux remarquaient leur grande ressemblance physique, tout au moins dans leur stature : ils étaient tous bruns, sensiblement de même taille, plutôt moyenne, et de même corpulence, assez mince, aux épaules étroites. Il y avait : Alain, cinquante-quatre ans, marié, deux enfants, vivant à Brest, responsable de l’antenne régionale d’une compagnie d’assurances ; Christian, cinquante et un ans, marié, un enfant, habitant Pont-l’Abbé, cadre d’entreprise, chargé des achats de matériel et fournitures ; Franck, quarante-sept ans, marié, Rennais, un enfant, cadre d’entreprise chargé de la prospection ; Simon, quarante-cinq ans, vivant en union libre depuis peu, demeurant à Dinan, architecte.
Après les présentations, le silence tomba sur la petite assemblée. Audrey le rompit :
— Je constate que je suis la seule femme présente. Je suis un peu gênée. Vos conjointes n’ont pas été invitées à participer à ce week-end ?
Il y eut des raclements de gorge, des changements de position dans les fauteuils : la question dérangeait. Alain prit la parole :
— Suivant la proposition de Jean, nous nous étions mis d’accord pour nous retrouver entre cousins, à la fois pour faire revivre nos moments partagés ensemble, ici dans cette maison de famille, et pour nous mettre à la rude tâche qui nous attend, à savoir trier, jeter, répartir ou vendre les objets entassés dans le grenier. Jean nous a parlé d’amis qui, peut-être, viendraient nous prêter main-forte, mais je ne m’attendais pas à une présence féminine.
Jean jugea qu’il était temps d’intervenir :
— Mes amis ont accepté mon invitation, alors qu’ils n’y étaient pas enclins au départ. Ils ont compris mes affres et je les en remercie.
— Mon cher Jean, intervint Simon, il serait quand même bon de nous préciser si la profession de cette charmante jeune femme serait en rapport avec sa présence. J’ai cru comprendre qu’il y avait une sorte d’énigme entourant la mort de Pierre-Yves.
À ce moment, Annie, l’employée de maison, apparut et, s’adressant à Jean, indiqua que le repas était prêt. Jean en profita pour interrompre la discussion et déclara que le moment était venu de passer à table. Tous se levèrent et allèrent prendre place autour de la vaste table joliment dressée et ornée de charmantes compositions florales. La question restée en suspens ne fut reposée que lorsque l’entrée eut été servie, lorsque les extra eurent quitté la salle.
— Alors, cette énigme ? Quelle est-elle ?
— L’enquête de routine menée à la suite du décès de Pierre-Yves s’oriente vers un constat de chute accidentelle. Mais plusieurs éléments observés viennent perturber cette conclusion.
— Quels éléments ? questionna Alain.
Audrey toussota afin de prévenir Jean de ne pas trop en dire.
— Des petites anomalies, tenta d’éluder Jean.
— Lesquelles ? Parle, Jean ! On est en droit de savoir, non ? Il s’agit de notre cousin aussi ! le pressa Franck.
— Euh… Par exemple, il n’y a aucune empreinte sur la rampe d’escalier : elle a été essuyée comme s’il fallait effacer des traces. Le plancher du grenier était tout propre, ne laissant apparaître que les empreintes de pas de la victime, alors que par ailleurs, tout est recouvert de poussière…
— C’est vous qui avez fait ces observations ? demanda Christian à Audrey.
— Disons que j’ai eu ces détails par un collègue qui s’occupe de l’affaire, indiqua Audrey en lançant un regard incendiaire à Jean. Mais il ne fait guère de doute que le parquet classera l’affaire au rang des accidents.
— Donc, vous avez bien été invitée ici pour apporter votre expertise, releva Alain.
Audrey haussa les épaules.
— Personnellement, mon opinion rejoint celle des enquêteurs : il y a trop peu d’éléments discordants pour envisager un homicide, éléments qui ont peut-être d’ailleurs une explication toute simple.
— Moi, personnellement, insista Jean, je pense qu’il y a eu meurtre : quelqu’un a poussé Pierre-Yves dans cet escalier fragilisé, et a ensuite effacé ses propres traces pour faire croire que notre cousin était seul.
— De toute façon, même si c’est un crime, c’est impossible à prouver, émit Christian.
— Sans doute, acquiesça Simon. Mais soyons joueurs ! Partons de l’hypothèse qu’il y ait eu crime, Audrey, qui serait alors suspecté ?
La policière posa un regard peu amène sur le cadet des cousins Bourget. Les traits harmonieux, le sourire carnassier, Simon avait tout du séducteur, sûr de son charme. Elle détestait ce genre d’individu, persuadé qu’aucune femme ne peut lui résister. S’il la replaçait au centre de l’attention générale par sa question, ce n’était pas par goût d’un éventuel mystère, mais bien parce qu’il pensait s’attirer ainsi sa sympathie. Ce en quoi il se trompait lourdement : elle n’avait nulle envie de tenir le premier rôle dans ce qui pouvait s’apparenter à une sorte de Cluedo.
— Il me semble que les circonstances n’incitent guère à la légèreté, répliqua-t-elle en contenant son agressivité. Nous ne sommes pas dans un jeu. La mort de votre oncle et celle de votre cousin sont bien réelles et il me semble déplacé de nous laisser entraîner vers de telles distractions. Une enquête de police est en cours, et ça, c’est la réalité.
Connaissant bien le caractère de sa femme, Jo se réjouit de voir le bellâtre renvoyé magistralement dans les cordes. Remplissant à nouveau son verre de vin, Christian voulut intervenir, mais les serveurs apparurent de nouveau, apportant le plat principal, un rôti de veau à la crème et aux morilles.
Quand chacun fut servi, Christian but une nouvelle large rasade de vin, avant de reprendre :
— Pour ma part, même si je désapprouve que l’on puisse considérer cela comme un jeu, je souscris à l’interrogation de Simon : qui serait suspect en cas de meurtre ?
Un moment de gêne silencieuse s’installa. Christian, qui avait déjà bu plusieurs verres, n’avait sans doute pas senti qu’il valait mieux passer à un autre sujet de discussion. Il insista :
— Audrey, nous aurions besoin de vos lumières.
— Vous pouvez généraliser vos propos, renchérit Franck. Dans ce genre d’enquêtes, quels sont les premiers suspects ?
Alain approuva du chef.
— En général, les premiers suspectés sont les gens de l’entourage proche, lâcha Audrey en soupirant.
Tous échangèrent des regards soudain plus acérés.
— Donc nous autres, les cousins de Pierre-Yves, crut bon de préciser Christian. Et alors, vous les interrogez, ces proches ?
— Oui, répondit Audrey, nous cherchons à établir l’emploi du temps de chacun au moment du crime.
— D’accord, fit Alain. Donc, dans notre cas, qu’est-ce que nous faisions tous le vendredi… combien déjà, à quelle heure ?
— Le certificat de décès établit la mort de Pierre-Yves le vendredi 30 juin entre 14 h 30 et 15 heures, informa Jean. Le corps a été découvert par Annie, l’employée de ménage vers 17 heures.
— Moi, j’étais au travail, affirma Alain, en déplacement dans le Finistère nord. C’est facilement vérifiable.
— Moi aussi, j’étais en visite chez les fournisseurs de ma boîte, entre Carhaix et Quimper, dit Christian.
— Moi, j’étais en rendez-vous sur Lamballe dans la matinée ; j’y ai déjeuné assez tard, déclara Franck. Mon rendez-vous de l’après-midi à Guingamp ayant été annulé, je suis allé à la plage aux Rosaires à Plérin.
— Moi, j’avais des rendez-vous avec des clients sur le secteur de Dinan le matin, sur Saint-Brieuc l’après-midi. J’ai déjeuné sur le port de Dinan, énonça Simon.
Tous, spontanément, avaient livré leur emploi du temps le jour du décès de Pierre-Yves.
Audrey enregistra mécaniquement que chacun avait un alibi, mais qu’il était seul à plusieurs moments de la journée, entre les rendez-vous notamment.
— Chacun d’entre nous a apparemment un alibi, commenta Alain. Toutefois, nous n’avons pas encore entendu celui de Jean. Mais peut-être s’estime-t-il exonéré d’avoir à répondre ?
Le ton acerbe d’Alain fit sursauter Jean.
— Non, bien sûr ! répondit ce dernier sèchement. Puisque chacun a répondu sans la moindre obligation de le faire, je n’ai pas du tout l’intention de me défiler. Vendredi après-midi dernier, j’étais au siège du groupe Celarbrobreizh. Entre 13 h 30 et 15 heures, Jo et moi-même étions en réunion avec les dirigeants de nos entreprises pour effectuer un bilan à la moitié de cet exercice.
— Exact, confirma Jo. Je puis en témoigner. C’est environ une heure après la fin de cette réunion que Jean est entré dans mon bureau pour m’annoncer l’affreuse nouvelle de la mort de votre cousin.
— Et Annie ? s’enquit Franck. Elle peut aussi être considérée comme une proche, non ?
— Elle m’a dit qu’elle était allée en consultation chez l’ophtalmologiste à Saint-Brieuc, expliqua Jean. C’est une attente souvent très longue : le rendez-vous était à 14 h 15 et elle n’est ressortie qu’à 15 h 45. Elle est hors de cause.
— C’est quand même curieux, constata Audrey. Vous vous êtes empressés de donner votre emploi du temps, en réponse à la première question que vous avez posée « Qui sont les premiers suspectés ? », alors que la question du mobile est fondamentale.
Tous regardèrent Audrey en écarquillant les yeux.
— Autrement dit, « À qui profite le crime ? » reformula Jo avec un petit sourire en coin.
Le silence revint ; chacun réfléchissait à cette question, récurrente dans de nombreuses enquêtes. Puis, survint le moment du service du dessert, apportant un répit dans la conversation. Alors qu’ils entamaient la dégustation d’une délicieuse pâtisserie confectionnée par Annie, Alain se lança :
— Personnellement, je ne vois pas vraiment de raison possible. Un mobile lié à l’héritage de notre oncle Robert ? Nous avons tous des situations financières aisées, sinon florissantes.
— Et puis, il faudrait que l’assassin tue plusieurs d’entre nous pour faire grossir sa part ! renchérit Simon sur le ton de la plaisanterie.
Si le trait d’humour était loin d’être d’une grande subtilité, il eut le mérite de détendre l’atmosphère. Les sourires égayaient maintenant les visages.
— Un assassin si idiot qu’il tuerait jusqu’à rester l’unique héritier et seul coupable possible ! s’esclaffa Franck.
Et tous de rire franchement, à présent. Annie arriva sur ces entrefaites, son visage affichant une expression pincée devant un tel manque de convenances. Jean s’en aperçut aussitôt et, réclamant le silence, adressa à la fidèle gouvernante de l’oncle Robert ses plus vifs remerciements pour l’excellent dîner qu’elle leur avait concocté. Les convives joignirent leurs compliments à ceux de Jean et Annie s’en fut, rougissante et apaisée, vers sa cuisine. Le café leur fut bientôt servi et la discussion reprit son cours.
— Il n’y aurait donc aucun mobile sérieux, fit observer Christian d’une voix rendue incertaine par l’excès de bon vin.
— Je suis de cet avis, opina Simon, tandis que les autres cousins, hormis Jean, approuvaient du chef.
— Ou alors un mobile beaucoup moins évident à identifier, nuança Jo en haussant les épaules.
Il ne pouvait s’empêcher de penser à ces détails : une rampe trop propre, un parquet bien nettoyé pour ne laisser apparaître qu’une seule marque de chaussures… C’était bien peu, mais pour Jo et son goût pour le mystère, c’était une atteinte à la logique, et déjà son esprit analytique était en éveil.
— Et si c’était quelqu’un d’extérieur qui se serait introduit dans la maison alors que Pierre-Yves était au grenier ? proposa Jean.
— Un voleur ? dit Alain. Qui aurait dérobé un ou plusieurs objets dans le bric-à-brac du grenier ? Il est surpris par Pierre-Yves et il le pousse dans l’escalier.
— Il faudrait que cet objet ait une grande valeur pour être capable de tuer, dit Jean. Ou alors simplement la peur d’être pris.
— Dans ce cas, intervint Audrey, il y a peu de chance de parvenir à identifier le coupable. À moins qu’un témoin ait vu quelqu’un s’introduire ici. Mais une enquête de voisinage ne sera possible que si le parquet décide d’ouvrir un complément d’information.
— Dites-nous, Audrey, selon vous, Pierre-Yves a-t-il été tué ? questionna Franck, visiblement lassé d’un sujet qui n’aurait pas de conclusion dans l’immédiat.
En plein doute, elle secoua la tête :
— Je n’en sais pas plus que vous. Il n’y a pas de mobile apparent, il n’y a pas de preuves directes d’un homicide, pas la moindre preuve d’une tentative de vol, juste quelques détails qui clochent… Alors, j’aurai tendance à me montrer prudente, et de toute façon, c’est le parquet qui décidera.
Sur ces paroles en demi-teinte, chacun se retira dans sa chambre.
IV
Samedi 8 juillet 2023, 8 h 30 – Maison Bourget – Quintin
Après un solide petit-déjeuner, tous se mirent au titanesque travail d’inventaire et de tri des affaires entreposées au grenier. Tâche fastidieuse : tout ce qui n’avait pas ou peu de valeur était à écarter, c’est-à-dire la grande majorité des objets. Quelques vieux bibelots ou vieux meubles étaient peut-être dignes d’intérêt ; il fallait se renseigner auprès d’un antiquaire ou d’un brocanteur. Apparemment, rien de ce qui était stocké ici n’était d’importante valeur.
Les documents étaient rapidement étudiés, essentiellement de la correspondance des ascendants du vieil oncle, lesquels étaient des négociants prospères du temps de l’âge d’or de l’industrie toilière à Quintin, sous l’Ancien Régime. En remontant dans le temps, la lecture de lettres reçues de divers clients ou de fournisseurs livrait une mine d’informations sur l’activité du lucratif négoce de la toile de lin que menaient les ancêtres Bourget depuis le XVIe siècle jusqu’à son déclin au XIXe, durant lequel, devant les difficultés croissantes et l’endettement important, la famille finit par stopper cette activité.
La découverte d’un dossier laissé par le vieil oncle leur permit de mettre la main sur un arbre généalogique dressé par ses soins et d’un cahier dont chaque page présentait un de ses ascendants dirigeants de l’entreprise de négoce en remontant les époques. C’était intéressant parce que ces documents permettaient de situer dans le temps les lettres constituant l’abondante correspondance entreposée là. Les héritiers ne l’entendaient pas tous de cette oreille, récriminant devant toute cette paperasse à classer, labeur inutile selon eux.
Audrey, passionnée par l’histoire plus que par la possibilité d’un crime, piochait des lettres au hasard, les parcourait, consultait le cahier pour situer la date de la rédaction. Elle déclara à ceux qui voulaient l’entendre que ces documents avaient une grande valeur patrimoniale. Christian haussa les épaules, Simon souffla son ennui, les deux autres n’eurent aucune réaction.
Alain avait remarqué une malle de cuir, bardée de fer dans un recoin ; il plaisanta en s’exclamant qu’il y avait peut-être un trésor à l’intérieur. Il la tira à lui et l’ouvrit : il découvrit d’un œil attristé de nombreux rouleaux de papier épais et jauni, partiellement rongés par l’humidité, mais tout de même relativement bien conservés. Alors qu’il faisait part de sa déception en fourrageant parmi les papiers, Audrey lui reprocha son manque de précaution à l’égard de documents certainement précieux ; il lui céda la place, trop content d’échapper à l’inventaire du coffre. Elle déroula prudemment un premier rouleau, constata qu’il datait de 1621 ; il s’agissait d’un contrat commercial signé entre l’ancêtre des Bourget, négociant en toile de lin, et une société espagnole de Séville concluant l’achat d’une grande quantité de toile chaque année pendant dix ans. Les acquéreurs espagnols destinaient cette toile à leurs nouvelles colonies d’Amérique latine ; la demande était très forte pour cette toile de lin de très haute qualité.
D’autres rouleaux étaient des contrats du même genre. Au fond de la malle se trouvaient plusieurs lettres dépliées et posées à plat : des fragments de cachets de cire adhéraient encore à certaines. Les lettres écrites en langue française de l’époque étaient difficilement compréhensibles par des non-initiés, mais il était tout de même possible de les lire partiellement. Il s’agissait d’une correspondance personnelle entre les épouses du négociant quintinais et du dirigeant de la société sévillane.
Mue par une curiosité purement féminine, Audrey photographia quelques-unes des lettres, puis descendit sur le palier pour téléphoner à Sabrina, une amie de lycée avec laquelle elle était toujours en relation. Sabrina était historienne, spécialiste de la Renaissance et de la période baroque. Audrey lui demanda si elle pouvait lui soumettre la lecture de documents du début du XVIIe siècle. Sabrina accepta ; Audrey lui envoya les photos de quelques-unes des lettres par courriel.
Une heure plus tard, Sabrina rappela, débordante d’enthousiasme :
— Audrey ! Tu as déniché là des écrits d’une réelle valeur historique. Ce sont d’authentiques témoignages de la vie de cette époque à travers la relation épistolaire que ces deux femmes entretenaient. L’Espagnole Isabella et la Quintinaise Gwendoline s’appréciaient beaucoup. Elles abordent dans leurs lettres bien des sujets : l’industrie du lin, les échanges commerciaux, la conquête du Nouveau Monde, mais aussi des choses plus personnelles. La Bretonne fait souvent référence à un voyage effectué en compagnie de son mari en 1621 en Espagne et évoque l’accueil chaleureux que son hôtesse et son mari leur avaient réservé : c’est lors de ce voyage qu’elles ont fait connaissance. Dans sa première lettre, écrite au retour de ce périple en Espagne, elle remercie Isabella pour le séjour passé et le magnifique cadeau qu’elle a reçu de sa part, un portrait d’elle-même – flattant très généreusement son physique fort quelconque, écrit-elle – réalisé par, je cite, « ce jeune peintre sévillan, Diego Vélasquez, si talentueux, qui joue si bien de la lumière que toute la toile semble illuminée d’une aura céleste. »
— Vélasquez ? s’étonna Audrey, intriguée. Le grand peintre espagnol du XVIIe siècle ?
— Lui-même, j’en suis quasiment certaine, confirma Sabrina. Dans la réponse à la lettre de son amie Gwendoline, Isabella la remercie d’avoir accepté de poser pour le peintre et loue sa patience lors des longues séances de travail. Et, écoute bien ! Elle explique ensuite que les œuvres du jeune artiste Diego Vélasquez ont été remarquées des plus éminentes personnalités du royaume et qu’il a été appelé à la cour de Philippe IV, roi d’Espagne, à Madrid pour devenir peintre du roi. Il doit prendre sa charge dans les prochains mois.
Intarissable, Sabrina se lança dans une évocation de la vie de Vélasquez, le grand maître baroque espagnol, qui développa la technique du clair-obscur, qui fut appelé à vingt-quatre ans à la cour d’Espagne et obtint quatre ans plus tard la charge de peintre de la Chambre du roi, la plus importante charge des peintres royaux.
— Tu te rends compte, Audrey ? Si ce peintre a peint le portrait de dame Gwendoline, cette œuvre vaut une fortune, si elle existe toujours ! Car cette œuvre ne se trouve apparemment dans aucun musée ni dans aucune collection privée référencée. J’ai fait une rapide recherche par Internet : aucune trace. Mais l’artiste, comme bon nombre de peintres de cette époque, ne signait pas ses toiles, alors les investigations peuvent s’avérer compliquées. Peut-être que cette toile est restée dans la famille ? Vous ne l’avez pas découverte dans votre inventaire ?
— Si tu voyais le bric-à-brac indescriptible du grenier ! On commence à peine ! On ne sait jamais, on va peut-être tomber dessus.
— Tiens-moi au courant de la suite !
— Je n’y manquerai pas, promit Audrey. Je te remercie pour ton aide précieuse.
Elles raccrochèrent et Audrey remonta au grenier, plongée dans ses réflexions. Quelle découverte passionnante ! Un Vélasquez, propriété de la famille Bourget, mentionné dans ces lettres ! Incroyable ! Cette œuvre avait-elle été vendue ? Avait-elle subi les outrages du temps, et été remisée dans ce grenier, sans qu’on lui eût accordé une quelconque valeur ? Si personne n’avait mis le nez dans ces vieux documents depuis un siècle ou deux, il se pouvait que ce portrait fût tout bonnement tombé dans l’oubli.
Soudain, une pensée fulgurante lui traversa l’esprit : et si ce portrait était la cause de la chute dans l’escalier ? Et si, en fin de compte, cette chute n’était pas accidentelle ? Le tableau était-il encore là, dans tout ce fatras… ou avait-il été emporté par un voleur conscient de sa valeur ?
Elle se morigéna en se disant qu’elle laissait trop la bride sur le cou à son imagination. Elle regarda les autres s’affairer au tri, couverts de poussière et de toiles d’araignée, véritables fourmis laborieuses. Elle réclama leur attention pour leur faire part de sa conversation avec Sabrina. L’information délivrée provoqua, on s’en doute, l’étonnement général : un tableau de si grande valeur dans la famille, c’était extraordinaire !
— Mais, pour l’instant, nous n’avons trouvé aucun tableau, tempéra Alain. Et il ne fait pas partie des portraits de nos aïeux accrochés un peu partout dans la maison.
— Il a peut-être été vendu depuis longtemps, supposa Christian.
— Ou simplement perdu ou détruit. Cette maison a été rebâtie à la fin du XVIIe siècle, ajouta Simon, l’architecte. Donc, Gwendoline et son mari habitaient dans l’ancienne maison. Qu’est-il advenu du tableau au moment de la reconstruction ?
— On verra bien quand on aura avancé dans notre inventaire, conclut Alain en haussant les épaules. En attendant, c’est l’heure d’aller casser la croûte.
Ils descendirent tous dans la salle de séjour où les attendait un joli buffet préparé par Annie et les extra.
V
Samedi 8 juillet 2023, 13 h 30 – Maison Bourget – Quintin
Après un rapide mais roboratif déjeuner, le travail de tri et d’inventaire reprit au grenier. Durant le repas, il avait été évidemment beaucoup question du Vélasquez, mais le premier moment de stupeur passé, personne ne semblait particulièrement obsédé par le fait que le tableau pût être encore présent dans la maison. Pour ces gens ayant tous des situations aisées, la perspective d’en hériter ne semblait pas les émouvoir outre mesure. Par ailleurs, leur connaissance très limitée dans le domaine de la peinture les privait d’apprécier le privilège immense de posséder une telle œuvre, alors qu’un passionné en eût ressenti un bonheur infini.
Alors qu’à la fin de la journée environ la moitié du gigantesque bazar avait été traitée, le portrait de dame Gwendoline n’avait toujours pas été retrouvé. Il restait cependant plusieurs coffres ou malles à inventorier. Vers 18 heures, ils décidèrent d’arrêter leur âpre besogne. Tous étaient las de manipuler des objets sales ou moisis et de respirer de la poussière. Ils convinrent de se retrouver à la salle de séjour pour l’apéritif, car plusieurs d’entre eux avaient prévu de s’absenter pour la soirée.
*
De retour dans leur chambre, Audrey et Jo, requinqués par une bonne douche, firent le point sur leur journée. Jo complimenta Audrey pour sa remarquable découverte dans les lettres de Gwendoline.
— Sans toi, dit-il, Jean et ses cousins seraient sans doute passés à côté. Même si on ne trouve pas ce tableau, savoir qu’une telle œuvre a été ici, c’est quand même fantastique.
Audrey hésita, puis finalement se lança :
— Jo ? Je sais que l’inventaire n’est pas terminé, mais est-ce que tu penses que ce tableau d’une si grande valeur aurait pu être volé, et que ce serait peut-être un mobile de meurtre ? Quelqu’un qui aurait fouillé le grenier et trouvé le tableau : il est surpris par Pierre-Yves, il l’élimine.
— Peut-être… répondit Jo, dubitatif. En ce cas, ce serait quelqu’un d’extérieur à la famille, parce que je ne vois pas l’intérêt d’un des cousins d’aller tuer Pierre-Yves pour s’approprier un tableau de valeur inconnue, appartenant à leur héritage commun.
— Exact, convint Audrey. Mais si ce n’est pas un des cousins, il fallait que Pierre-Yves le connaisse bien pour ne pas s’en méfier et se laisser pousser dans l’escalier.
— Toi qui croyais à un accident ! Tu as donc changé d’avis ?
— Non, mais je m’interroge. Je trouve qu’il y a de plus en plus d’éléments bizarres.
— En attendant, allons rejoindre les autres !
*
Au salon, tous s’installèrent confortablement, pendant que Jean servait l’apéritif, un kir cassis au crémant d’Alsace. Annie vint apporter les petits fours.
Ils trinquèrent à la mémoire de l’oncle Robert et du cousin Pierre-Yves. Jean poursuivit son laïus en ajoutant avoir une pensée pour Aurélie, la femme de Pierre-Yves, et ses deux enfants. Il marqua un silence, puis reprit :
— Je viens d’avoir Aurélie au téléphone. Je lui ai fait part de l’avancement de notre tâche, et aussi de la découverte de lettres anciennes évoquant un vieux tableau, un portrait de femme, ancêtre de la famille. C’est alors qu’elle m’a dit : « Ah oui ! Le vieux portrait très abîmé ! Pierre-Yves se demandait ce qu’il devait en faire. »
Cette remarque les fit tous sursauter.
— Le tableau est donc toujours là-haut ! clama Alain.
— On pourrait retourner tout de suite au grenier et fouiller encore ! suggéra Franck.
— C’est ça ! répliqua son frère Simon. Et encore se salir ? Tu plaisantes ? On verra demain !
— Laissez Jean raconter la suite de sa conversation avec Aurélie ! Il n’a pas terminé ! s’écria Christian.
— Merci, Christian, reprit Jean. Pour faire court, elle m’a dit qu’elle avait accompagné Pierre-Yves pour sa première visite après la mort de notre oncle. Ils ont fouillé un peu dans le fatras du grenier et sont tombés par hasard sur ce tableau. Pierre-Yves est – je devrais dire “était” – plutôt amateur d’art. Sans être un grand connaisseur, il avait quand même quelques solides notions. Sans se douter de l’origine extraordinaire de l’œuvre, quelque chose de spécial l’attirait dans sa composition, différente des portraits qu’il y a un peu partout dans la maison. Il a dit à Aurélie qu’il le ferait expertiser, pour savoir sa valeur et si une remise en état s’avérait possible. Il avait lu ou entendu dire que certaines peintures anciennes d’intérieur breton par des artistes locaux, trouvées dans des caves ou des greniers, pouvaient atteindre de jolies sommes, sans toutefois se vendre des fortunes. Il l’a laissé dans le grenier, le temps de trouver un spécialiste. Voilà, en gros, ce dont elle m’a parlé.
— Donc, d’après Aurélie, Pierre-Yves pensait que ce tableau avait une certaine valeur, souligna Alain. Peut-être qu’il a été volé ?
— Ce serait un bon mobile ! approuva Jean. Un individu, peut-être informé par Pierre-Yves d’une quelconque valeur de l’œuvre qui aurait voulu s’en emparer ! Mais voilà, ça ne se passe pas comme prévu : il est surpris par notre cousin et il le pousse dans l’escalier !
— Que de suppositions ! s’exclama Simon. Alors qu’il est peut-être encore là-haut !
— Allez, nous verrons demain ! coupa Franck. Moi, je dois y aller ! Je vais dîner chez des amis à Lamballe. Et toi, Simon ?
— J’ai quelqu’un à voir, éluda Simon.
Son frère hocha la tête d’un air entendu : pour lui, Simon allait profiter de sa soirée pour exercer ses talents de séducteur.
— J’y vais aussi ; je mange chez des amis à Guingamp, précisa Christian.
— Moi, je vais faire un billard avec des copains de Saint-Brieuc que je n’ai pas vus depuis longtemps, dit Alain.
Quelques minutes plus tard, ils avaient tous les quatre quitté la maison. Jean, Audrey et Jo descendirent à la cuisine. Jean donna sa soirée à Annie, disant qu’ils se débrouilleraient bien sans elle. Ils dînèrent tous trois des restes du buffet du midi, discutant de l’hypothèse d’un meurtre lié au vol du tableau. Ils finirent par convenir qu’il fallait d’abord finir d’explorer le grenier avant de se lancer dans toute interprétation.
Après le repas, ils sortirent se promener dans la ville. Il faisait bon ; en ce samedi soir d’été, l’atmosphère était agréable dans les rues du centre, où touristes et gens du coin déambulaient, une glace ou une crêpe à la main. Désireux d’une petite pause, tous les trois s’installèrent à la terrasse d’un café. À la tombée de la nuit, une légère fraîcheur se fit sentir ; ils quittèrent les lieux et rentrèrent.