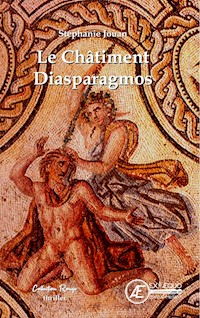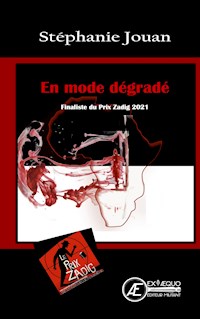
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Ouagadougou, Afrique de l’ouest. Malau Théophanie, commandante de police coopérante, commence à regretter son choix de carrière. Le poste diplomatique, les collègues, la vie en micro-société, tout lui pèse. Jusqu’à ce matin où elle découvre le cadavre de son voisin, officier militaire et homme secret. Un meurtre sordide qui réveille enfin son instinct de flic. Sauf que dans ce pays en crise du Sahel, elle n’a ni les prérogatives, ni les moyens technologiques pour agir. Et que la tension monte vite dans le milieu diplomatique.
Dans ce milieu particulier où rien ne fonctionne comme ailleurs, la commandante risque gros. Faux semblants et passions interdites des uns et des autres peuvent inexorablement conduire à la faute. Sans compter sur les policiers locaux avec lesquels elle doit péniblement composer. Comment s’y prendre ? Sur qui compter ? Pallet, gendarme coopérant et binôme de circonstances, va lui souffler la réponse. Ensemble, ils vont enquêter en mode dégradé et laisser s’échapper des vérités que tous auraient pourtant préféré taire.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Historienne de formation, professeure et aujourd’hui personnel de direction de l’Education nationale, Stéphanie Jouan a exercé de nombreuses années dans des établissements français à l’étranger et travaillé étroitement avec les acteurs du monde diplomatique et de la coopération, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stéphanie Jouan
En mode dégradé
Nouvelle policière Prix Zadig
ISBN : 979-10-388-0274-2
Collection Rouge
ISSN : 2108-6273
Dépôt légal : janvier 2022
© couverture Ex Æquo
© 2022 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
Toute modification interdite.
Préface
Né en 2018, le Prix Zadig de la nouvelle policière est un prix organisé par les Éditions Ex Æquo. Le nom de Zadig personnifie ce prix parce que c’est, en littérature française — et même universelle —, le texte qui est considéré comme étant la première enquête, la première recherche d’indices et de preuves. C’est aussi le texte d’un érudit, Voltaire, qui mettait la liberté de penser au-dessus de toutes les autres possessions. Notre maison d’édition ayant implanté son siège social à Plombières-les-Bains où Voltaire a séjourné et a écrit, l’ensemble faisait sens.
Le jury est composé de professionnels de la répression du crime (avocats, juges, gendarmes, policiers, médecins légistes, journalistes, criminologues et auteurs de romans policiers). Nous avons changé la donne habituelle des prix littéraires qui convoquent autour de la table des libraires, des écrivains, des gens du monde du livre ; nous, nous avons réuni ceux par qui la connaissance du crime parvient au grand public au travers de leur expertise.
Nous tenons particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette édition 2021 : tout d’abord les membres du jury : Laurence Schwalm (Directrice de la Maison d’Édition), Karine Jain, Isis Senchet, Fabien Denis, Philippe Charlier, Thierry Dufrenne, Laurent Greilsamer, Rémy Lasource, Maître Laurent-Franck Lienard, le Professeur Paul Fornès et Jérôme Decours.
Merci à nos partenaires
Le Groupe Rivolier et Zadig Le Mag.
Félicitations aux 3 finalistes de cette année : Stéphanie Jouan, Gabriel Couble et Cécile Dubard.
Longue vie au Prix Zadig et rendez-vous dès mars pour Zadig 2022
Catherine Moisand,Présidente du Jury Prix Zadig
Plus d’informations sur :
prixzadig-editions-exaequo.com/
ou sur notre page Facebook PrixZadig.
Historique de la société RIVOLIER
Partenaire du Prix Zadig
La famille RIVOLIER a débuté ses activités de « faiseurs de fusils » en 1830 dans la ville de Saint-Étienne, berceau de l’armurerie française.
Du petit atelier familial, l’entreprise s’installe en 1903 dans des bâtiments industriels, typiques de l’époque, en plein centre-ville. Elle y restera 90 ans avant de déménager en 1993 dans les locaux actuels, plus modernes et beaucoup mieux adaptés à l’expansion rapide des activités de la société.
Sous la raison sociale complète de « Manufacture Spéciale d’Armes Fines et Cycles RIVOLIER père et fils », la « maison » RIVOLIER, comme il est coutume de dire à l’époque, fabrique dans ses ateliers fusils de chasse, bicyclettes, lits à armature métallique tubulaire pour les hôpitaux militaires pendant la Grande Guerre.
Sous l’occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, les ouvriers de la manufacture réparent et entretiennent les fusils de guerre saisis aux forces françaises et reversés aux troupes allemandes, notamment aux forces allemandes de seconde ligne.
Au début des années cinquante, la paix retrouvée et le goût (et le droit) de chasser revenant en force sur tout le territoire, Monsieur Alexis RIVOLIER, souhaitant satisfaire la demande pressante des chasseurs, part aux États-Unis négocier un contrat de distribution avec le fabricant américain REMINGTON.
Zadig le Mag
Partenaire du Prix Zadig
Tout comme Candide, Éric Fottorino n’en finit plus de cultiver son jardin. Après avoir cofondé Le 1 et America, l’ancien directeur du Monde s’est inspiré d’un autre héros de Voltaire pour lancer au printemps 2019 Zadig, une revue haut de gamme, vendue sans publicité au prix de 19 euros. Zadig est un trimestriel inspirant de 196 pages créé pour rendre lisible un pays devenu illisible : la France.
Le premier numéro s’est vendu à plus de 55 000 exemplaires, le deuxième à 40 000 et le troisième à 32 000.
La dimension régionale est illustrée par une carte de la France et de son Outre-mer que Zadig sillonne numéro après numéro.
N°1 : Réparer la France
N°2 : La Nature et nous
N°3 : Le Travail, pourquoi faire ?
N°4 : Heureux comme Dieu(x) en France
N°5 : Ces maires qui changent la France
N°6 : Besoin d’Outre-mer
N°7 : Changer de vie
N°8 : Mieux manger
N°9 : Femmes, une révolution française
N°10 : Au cœur du complotisme
N°11 : Ces banlieues qui réinventent la France
N°12 : Quand l’écologie nous gagne
Compliqué d’être conseillère technique en coopération dans cette capitale étouffante et poussiéreuse d’Afrique. Surtout ici, où la confusion, opposé exact de la rigueur, est érigée en modèle et où personne ne s’en étonne. Sauf que l’on n’a pas vraiment le choix : ou on s’en accommode, ou l’on devient dingue. Peut-être, d’ailleurs, est-ce pour cette raison que tant d’entre nous se sont égarés dans cette affaire : parce que les uns s’accommodaient trop, et que les autres étaient déjà trop abîmés. Trop. C’est bien l’adverbe qui convient, ici. Trop chaud, trop sale, trop agité, trop dangereux : chacun son « trop ». Pour moi, commandante de police chargée de conseiller mes pairs locaux en matière « d’optimisation des méthodes d’investigation », le « trop » était celui de l’apathie d’un système où, dès que l’on avait atteint un niveau de responsabilité et de salaire suffisants, on entendait peu se bouger les tapettes{1} pour faire avancer les choses. Et lors des réunions de service hebdomadaires organisées dans la salle de la Chancellerie, j’avais bien du mal à faire état de quelconques avancées concernant mon projet, qui stagnait désespérément depuis mon arrivée, huit mois auparavant.
D’abord déroutée, puis irritée par le manque total de réactivité, voire d’intérêt, de nombre de mes partenaires, j’évitais de penser à « ma vie d’avant », lorsque j’étais une OPJ de la Crim’ réputée pour son efficacité et ses résultats rapides. L’inverse complet de ce qui m’attendait ici, et dont mon prédécesseur, davantage familier de la piscine de la résidence que de son bureau, avait largement omis de me parler. Souvent le soir, sous les pales vrombissantes de la terrasse qui brassaient inutilement la touffeur de l’air maintenant lourd de l’hivernage, aussi inutilement que j’avais passé ma journée à tenter de secouer quelques capitaines assommés par la chaleur et par mes mots, je me prenais à redouter que mon enthousiasme qui, déjà, s’effilochait, ne se transforme insidieusement en une paresse désabusée, à l’image de nombre de ceux que je croisais au gré des réceptions et autres réjouissances locales qui rythmaient l’ennui des expatriés. À vrai dire, je commençais à regretter le choix de cette expérience de la « coop ».
Ce matin-là était comme tous les autres à cette époque de l’année : cuisant, déjà, alors que le soleil s’abattait sans pitié sur les âmes et les corps à peine éveillés.
Dans la résidence réservée aux membres élus de la coopération française, ça s’agitait tranquillement comme à l’accoutumée : les vigiles saluaient, rigolards, les « gouvernantes » accortes ou les « mamans » expérimentées qui se présentaient au compte-gouttes devant le portail de l’entrée, sur lequel lorgnaient les gamins du quartier, curieux de cette enclave pour les (forcément) riches nassaras{2}, et où les plantes étaient toujours vertes.
« Gouvernante » était un joli terme pour désigner ces jeunes femmes aux compétences multiples auxquelles on confiait le soin de traquer cette saloperie de poussière de latérite qui revenait sans cesse, de préparer les repas, de laver, de repasser, en un mot, de laisser l’expatrié libre de se consacrer entièrement à la mission pour laquelle l’État français lui octroyait une prime considérable.
La gouvernante de mon voisin d’en face était de celles qui connaissaient par cœur les exigences du Patron ou de Monsieur. De mission en mission, elle était attribuée au nouveau venu au même titre que l’appartement et les meubles. Ça lui allait, à Biba. Et plus grand monde ne l’impressionnait, après toutes ces années passées au service de militaires, parfois en couple, parfois « célibataire géographique », selon l’expression irritante consacrée. Presque aussi large que haute, Biba imposait sa masse et son rythme au nouveau qui n’avait qu’à s’y faire. Ses talents de cuisinière et sa voracité à faire avaler à tout son attirail les scories rouges qui s’agrippaient partout achevait de convaincre le plus rétif de tous, et Biba régnait en maîtresse dans le décor sans charme de l’antre de militaires qui, bien souvent, enterraient là leur gloire et leur passé. Elle, son obsession, c’était de garder son emploi, dans cet endroit privilégié, propre et calme, où tout le monde était poli, où le salaire était intéressant et toujours payé sans faute le dernier jour du mois, où ceux qu’elle croisait parfois le matin quand ils partaient au service un peu en retard étaient toujours bien habillés, en costume, en tailleur ou en uniforme. Placide et discrète Biba, ici, ne redoutait rien et s’exprimait peu. C’est pour cette raison que ses couinements, ce matin-là, furent presque encore plus étonnants pour moi que la découverte du cadavre du lieutenant-colonel Éric Lambert.
Je n’eus qu’à ouvrir ma porte et franchir le palier de l’appartement d’en face.
Au beau milieu d’une pièce à vivre dépouillée, dans le prolongement d’un petit couloir qui menait aux chambres, le militaire s’étalait sur le carrelage, imposant crûment à la malheureuse Biba le spectacle plus obscène qu’érotique d’une nudité velue et d’un sexe minuscule, qu’elle ne soupçonnait probablement pas.
Le Patron gisait sur le dos, sur un sol atrocement maculé, à la vue peut-être aussi insoutenable pour la reine du ménage que celle du cadavre. D’où les piaillements qui m’avaient alertée et donné une occasion inespérée d’interrompre la rédaction du fastidieux compte-rendu d’une réunion stérile, épreuve que, exceptionnellement, je m’étais décidée à achever chez moi, avant de rejoindre directement une nouvelle réunion, à l’initiative du chef que je me devais de conseiller. Mon chef à moi, l’attaché de sécurité intérieure, commissaire général à l’humour et l’empathie relatifs, considéra, mais bien plus tard, que ma présence avait été une chance inouïe. Un peu comme celle des types des Forces spéciales à l’Ambassade quelques années plus tôt, au moment de l’attentat du 2 mars. Les mânes burkinabè protégeaient décidément la cocarde et les financements qui allaient avec.
Biba, pétrifiée, mais tenant fermement serré contre elle son sac à main en skaï, émettait en continu des sons étranges, assez forts pour que je les entende de chez moi, et trop faibles pour s’apparenter réellement à des cris. Elle se tenait à une distance respectable du cadavre dénudé de son Patron, ultime abomination pour une femme qui n’avait jamais caressé le corps de son mari, pour qui l’acte sexuel consistait en quelques va-et-vient, pantalon baissé et de dos.
Elle ne m’entendit pas arriver, et tressaillit lorsque je la saisis précautionneusement pour la faire reculer et quitter ce qui était désormais une scène de crime en même temps qu’un cataclysme annoncé. On ne vient pas impunément perturber la vie feutrée et facile de la communauté des expatriés ; on ne vient pas troubler la quiétude de la résidence des nassaras ; on ne vient pas trucider un officier militaire qui sert son pays et celui des autres ; en un mot ce que, je vis ce matin-là s’étaler devant moi, se mêlant à la flaque de sang qui auréolait le futur passager de la soute d’un vol Air France en aller simple gratuit, c’était une kyrielle d’ennuis, problèmes, soucis, complications… au choix. Mais aussi (et enfin) l’opportunité d’éprouver de nouveau mon savoir-faire. En négligeant, crânement, le facteur confusion.
Le commissaire général Curie n’avait aucun lien avec la famille de l’illustre chimiste, ce que, pourtant, il tentait de faire croire lorsqu’il se présentait. Oh, bien sûr, pas un lien direct, minaudait-il, mais pas vraiment éloigné non plus. C’était bien entendu parfaitement inexact et aisé à vérifier : quelques sites de recherches généalogiques bien renseignés suffisent. Je le sais, j’ai tout examiné. J’aime bien connaître mes chefs, surtout quand ils ont l’envergure et l’ego de Curie. Et, sans vouloir offenser ma hiérarchie, une certaine propension à une suffisance pénible, fondée sur des récits de gloire passée dont il gavait systématiquement l’assemblée. Mais il fallait faire avec, même si l’on se réjouissait de faire sans, lorsque le patron quittait le territoire pour une mission des plus essentielles dans la sous-région. Encore un qui sauvait l’Afrique, pauvre continent qui déjà luttait avec bien d’autres fléaux. Nonobstant le peu d’estime que je lui portais, il demeurait, à défaut de l’incarner, le chef ; ce fut donc à lui qu’une fois Biba écartée à bonne distance et suffisamment calmée pour éviter qu’elle n’alerte la terre entière, je passai mon premier appel : « OK Théophanie, vous me gelez la scène et vous neutralisez l’accès à la résidence. Personne ne rentre ni ne sort. Je préviens immédiatement Xanour. Je suis en déplacement, mais je rentre ce soir. Vous me tenez au jus. »
Clémence Xanour, la première conseillère, officier de sécurité et chargée d’affaires en l’absence de l’Ambass, hors du territoire pour cause de congés nécessaires. C’est à elle qu’échouerait la gestion de ce qui était une sacrée tuile pour la diplomatie française. Et je m’en réjouissais. L’arrivée à un poste clé de cette femme dans un monde éminemment masculin et encore archaïquement machiste contribuait un peu à bousculer l’ordre établi par les mâles égotiques du sanhédrin diplomatique, ce qui, avouons-le, nous faisait parfois jubiler. Clémence Xanour et Marie-Clémence Théophanie, Malau, ne faisaient cependant pas jubiler tout le monde. Et cela n’allait pas s’arranger.
Je pris quelque peu sur moi afin de rester polie et professionnelle, l’envie me taraudant de répondre assez vertement à Curie que je savais ce que j’avais à faire. Ne possédant néanmoins pas le don d’ubiquité, protéger la scène de crime tout en condamnant l’accès à la résidence demandait au mieux du renfort, au pire une réactivité imaginative et, le cas échéant, pas si compliquée. J’avisai Biba, un peu tremblotante et plantée à l’abri des regards au fond du jardin. Bien entendu, elle possédait les clés de l’appartement. C’est avec ce trousseau qu’elle avait déverrouillé la serrure, fermée à double tour, comme tous les matins après le départ de Monsieur, affirma-t-elle. Je récupérai la clé ainsi que le surprenant châle en crochet rose vif que la coquette matrone portait ce matin-là. Inutile d’ajouter mes empreintes à celles de Biba sur la poignée de porte. Je verrouillai la serrure et confiai à la gouvernante secouée la mission de ne laisser approcher personne, le temps que je revienne. Puis, téléphone vissé à l’oreille, je détalai vers l’entrée de la résidence.