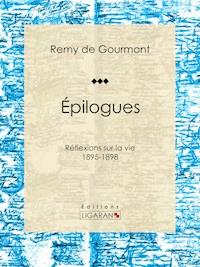
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Religion. - Le jour historique où un clergé ne se dresse plus, élite au-dessus des têtes respectueuses ou craintives ; s'il a perdu l'influence intellectuelle ; si son pouvoir exorciste et magique est contesté, en même temps que l'origine des délégations divines dont jadis il s'auréola ; s'il s'en réduit au rôle de pasteur du troupeau inférieur, des brebis qui pâturent les tristes pâturages de la médiocrité..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335041569
©Ligaran 2015
À
Madame B. de Courrière
Il y a au Thibet un arbre magique dont chaque feuille porte, écrite en caractères sacrés, une sentence bouddhiste.
Je pense qu’on a voulu, par cette fable, donner l’image du philosophe et insinuer qu’il est pareil à un arbre qui serait chargé d’opinions autant que de feuilles.
Mais les feuilles tombent, quand la saison l’exige, et sur celles qui reviennent, et qui ont l’air toutes pareilles, se gravent de nouvelles écritures.
Il faut lire les feuilles, chaque année, jusqu’à la mort de l’arbre, si l’on veut comprendre le secret de sa philosophie.
R.G.
Avril 1903.
Novembre.
Religions. – Le jour historique où un clergé ne se dresse plus, élite au-dessus des têtes respectueuses ou craintives ; s’il a perdu l’influence intellectuelle ; si son pouvoir exorciste et magique est contesté, en même temps que l’origine des délégations divines dont jadis il s’auréola ; s’il se sent réduit au rôle de pasteur du troupeau inférieur, des brebis qui pâturent les tristes pâturages de la médiocrité ; – à ce moment il devra, ou se décourager, ou s’unir aux chefs des autres bergeries, ou s’entêter dans l’orgueil même de sa stérilité candide. Ceux qui s’entêtent peuvent finir dignement, invulnérables sous leur bouclier imaginaire et dressant haut l’affligeante image de celui qu’ils ont peint à leur ressemblance ; ceux qui se découragent (du moins de la lutte) peuvent espérer un enlisement doux dans la discrète habitude des pratiques pieuses et des devoirs anodins : il y a de tels reclus, ils sont sages, ayant d’écrits ces seuls mots au mur de leur cellule : sacrum silentium. Les autres se veulent réunir en congrès.
Ne semble-t-il pas qu’on ait vu cela, déjà, non pas à Chicago – qui est plus loin que le pôle nord – mais à Alexandrie, qui fut en Égypte, et à Rome, qui fut à Rome ? « Unissons nos dieux », songeaient les prêtres menacés par les nouveautés galiléennes ; « Unissons nos morales, demande M. l’abbé Charbonnel, afin de montrer au monde qu’il n’y a qu’une morale et que, sous la diversité des cultes, l’instinct de l’homme s’élève vers un seul Dieu. » Cette préoccupation eût surpris les pieux Isiaques et les dévots Corybantes, mais pourtant, Brahma, Fô, Jéhova, Jésus, ne les verra-t-on pas planer, Olympe, au-dessus de l’assemblée des évêques, brahmes, lamas et talapoins ? Y aura-t-il un Bouddha vivant ? Le P. Huc eut l’heur de boire une tasse de thé avec un Bouddha vivant et il garda de ce dieu familier un bon souvenir. Aurons-nous cette joie et cette stupeur ? À vrai dire, le catholicisme, le protestantisme et le jéhovisme nous sont très suffisamment connus ; ces trois religions, professées en majorité par des peuples de civilisation européenne, n’ont pour nous que des secrets qu’un congrès de discours ne nous dévoilera pas. La théologie sue, il n’y a d’important dans une religion que son folk-lore : ses superstitions traditionnelles, les surprises de sa liturgie, ses contes religieux, la vie légendaire de ses saints et de ses martyrs, toute la partie populaire d’une religion, tout ce qui fait qu’une religion est vivante et tenace. Ni la croyance en un seul Dieu, ni la morale ne sont les fondements vrais de la religion. Une religion, même le christianisme, n’eut jamais sur les mœurs qu’une influence dilatoire, l’influence d’un à ras levé ; elle doit recommencer son prêche non pas seulement avec chaque génération humaine, mais avec chaque phase d’une vie individuelle. N’apportant pas de vérités évidentes en soi, son enseignement oublié, elle ne laisse rien dans les âmes que l’effroi du peut-être et la honte d’être asservi à une peur ou à une espérance dont les chaînes fantomales entravent non pas nos actes, mais nos désirs. Pas davantage le monothéisme n’est une conquête – ou une découverte religieuse ; les religions, et surtout le catholicisme, entourent cette foi de tant d’accessoires que ces croyances adventices deviennent des objections contre le dogme même. L’essence d’une religion, c’est sa littérature. Or la littérature religieuse est morte.
Madame Boulton. – Qu’une femme tue son mâle, ou un mâle sa femelle, – qui cela peut-il émouvoir ? Et qui cela peut-il intéresser hormis les statisticiens et quelques philosophes ? Je veux bien que l’on me protège contre des ennemis inconnus, l’escarpe ou le cambrioleur, – mais contre moi-même, vices ou passions, non. L’intervention de la justice en de tels cas est absurde. On n’oserait pas dire qu’il s’agît – ici et partout – de punir ; cette prétention baroque est abandonnée ; il s’agit d’empêcher une récidive ; or, quelle apparence que Mme Boulton déclenche un second coup de son revolver sentimental ! Les substituts, avant de requérir, devraient lire l’histoire de Molly Bliss, par l’abbé Prévost ; cela tient en six pages et c’est fort édifiant. Aujourd’hui, les hommes ne sentent pas assez la mort autour d’eux ; ils s’habituent à vivre avec la sécurité du cloporte tapi sous une écorce d’arbre ; c’est pourquoi il est bon qu’un cloporte soit taraudé de temps à autre : cela fait réfléchir les autres cloportes.
Cosmopolitisme. – Vraiment, ces aveux, que voici, M. Brunetière les eût-il écrits, il y a cinq ans ? Le kangurou a pris l’éléphant sur son dos et a bondi plus haut peut-être et plus loin que l’éléphant n’eût voulu. Ses idées (celles de l’éminent critique) s’émancipent et donneront de l’inquiétude aux prudents, mais M. Brunetière a prouvé assez de bravoure et avoué assez de mépris pour dédaigner les prudents.
Donc il proclame l’unité littéraire universelle et raille, en passant, ceux qui ne pardonnent pas à Ibsen et à Tolstoï d’avoir écrit « hors de France ». Sa conclusion, qui n’est qu’un espoir, est vraiment d’un noble esprit : « … Si le cosmopolitisme littéraire gagnait encore et qu’il réussît à éteindre ce que les différences de race ont allumé de haine de sang parmi les hommes, j’y verrais un gain pour la civilisation et pour l’humanité tout entière. » Malheureusement les littératures n’ont plus guère d’influente ; elles ne parviennent au peuple qu’à l’état de relavures, – ces bonnes relavures dont s’est si âprement réjoui Carlyle – et elles ont plus d’effet sur le ventre que sur le cerveau.
Décembre.
Nayve. – Ce qui fut amusant surtout le long de ce procès : la naïve course de bons magistrats, avocats, jurés, public et journalistes à la recherche de la vérité. Deux ans, ils ont couru, presque deux ans, pour finir par avouer, tout essoufflés, leur impuissance et leur sottise. On dira que la justice fut instituée pour cela, la recherche de la vérité. – Est-ce bien sûr ? Il faudrait en tout cas opérer cette manœuvre pénible avec moins de foi et ne pas s’imaginer qu’en interrogeant sur un fait cinquante témoins on trouvera la Vérité ; cinquante témoignages font cinquante vérités, voilà tout. Mais pas plus que la philosophie, la justice n’en démord. Elle cherche la Vérité. Tot capita, tot sensus, Messieurs, et chaque opinion est une vérité, et chaque opinion et chaque vérité est la bonne et la vraie Vérité. Pour jouer la tragi-comédie humaine il faut un sérieux mitigé de soupir.
Augier. – Augier, augiesque. Voici le Maître, car viennent de choir les derniers voiles de lustrine. Augier en marbre ! Augier en bronze ! Jamais tel affront ne fut fait à la gloire, – mais il fallait bien compléter les vers mnémotechnique :
Augier, Chappe, Dolet, Raspail et Bobillot.
Augier ! Tous les lucratifs rêves de la bourgeoise économe ; tous les soupirs des vierges confortables ; toutes les réticences des consciences soignées ; toutes les joies permises aux ventres prudents ; toutes les veuleries des bourses craintives ; tous les siphons conjugaux ; toutes les envies de la robe montante contre les épaules nues ; toutes les haines du waterproof contre la grâce et contre la beauté ! Augier, crinoline, parapluie, bec-de-corbin, bonnet grec…
Janvier.
L’année littéraire. – Si renseigné que l’on se prétende sur la littérature de l’année, c’est vers la fin de novembre, ni avant, ni après, qu’on s’instruit définitivement et officiellement. À cette époque, il jaillit des lueurs ; une coupole s’embrase de gloire, et une trompette (qui a pris dorénavant la forme de M. Gaston Boissier) mugit des noms. Comment nier la trompette ? Elle est terrible, elle est impérative ; à son appel, le troupeau se rassemble pendant que les échos redisent : Borelli ! Borelli ! Ces syllabes forment le nom d’un grand poète, et unique en son genre au point que les échos n’en sont pas encore fatigués : toutes les gloires passent et s’en vont mourir, murmure, sous la paix des forêts ; Borelli sonne et rebondit de montagne en montagne. Ce vicomte, qui mériterait au moins d’être comte, sinon duc, a donc remporté, cette fois encore, le prix de poésie française. Ah ! que c’est juste ! Ah ! qu’il fait bien les mauvais vers.
Borelli tu et pu, il s’agit d’alimenter les gloires moindres, les gloires de vingt à cinquante louis, et c’est alors que commence l’instructif défilé. Voici les chefs-d’œuvre de l’année : voici Sœur Jane, voici Zozo, voici Toit de Chaume, par M. du Campfranc, et les Fille du Pope, par Mme Poranowska. Retenez ces noms : Jean de la Brète, Jean Breton, Jean de la Bretonnière… Mais c’est trop se moquer de ces bonnes demoiselles qui brodent, sous un pseudonyme, des romans pour l’Académie, comme d’autres bonnes demoiselles, en secret, brodent des bandes de tulles pour le Bon Marché.
Ce n’est pas leur faute – à qui, la faute ? – s’il y a aujourd’hui un tel désaccord entre l’art et les mœurs, que ce qui est beau est rarement moral, que ce qui est moral est rarement beau.
L’enterrement théâtral. – Un homme a ou pas des croyances ou habitudes religieuses ; un citoyen a la religion de la cité, et si la cité n’a pas de religion, humblement, citoyennement, il obéit à l’irréligiosité civique. Fort bien pour le commun. Mais comment M. Dumas fils n’a-t-il pas songé à ceci : que si l’Église n’est pas tout à fait désintéressée, le théâtre est ce qu’il y a de plus lucratif, – et comment ne s’est-il pas ordonné des funérailles théâtrales ? Ah ! le beau et larmoyant spectacle, et quelle salle ! si – en matinée, naturellement – la Comédie se fût prêtée à une cérémonie à la fois funéraire et jubilatoire. Le catafalque en plein milieu, vers le fond ; devant, des fleurs et des masques ; la troupe rangée de part et d’autre ; le doyen en grand prêtre de Némi ; musique de Mendelssohn, cantates de Jean Aicard, Silvestre ; monologues, compliments, palmes, feux, – et, tombant des frises, une émouvante pluie de larmes. Bravos, rappels, rideau ! rideau ! Bis ! bis ! Hélas, on ne meurt qu’une fois.
Rachel II. – Sarah Bernhardt écrivit ces jours-ci une curieuse et incohérente lettre sur Alexandre Dumas fils ; et elle y avoue une admiration pieuse pour l’auteur de l’Étrangère, Femme, elle fut hypnotisée par le succès et dominée par la gravité voulue d’un sphynx très conscient, – et peut-être par le désir de rôles qu’elle imaginait glorieux et qui lui furent refusés ; mais, cette Sarah de génie (autant que femme peut avoir du génie), si elle n’a pas mesuré Dumas, a-t-elle mesuré Sardou ? Ni l’un ni l’autre ; elle les aime par des raisons qui ne sont pas celles pourquoi nous les estimons. Elle est femme, elle est Rachel : hormis Racine, qui est un peu ancien, elle n’a jamais joué que des indignités (relativement à son talent de tragédienne) ; comme Rachel, son souvenir sera lié à celui d’une décadence littéraire ; elle protège les Casimir Delavigne. Talma jouait Ducis ; c’est une loi que deux beautés ne peuvent s’unir ; il en naîtrait de la divinité : les hommes savent s’épargner cela. Si j’étais des amis de Sarah Bernhardt, je lui enverrais pour ses étrennes les œuvres d’Ibsen. Si elle les lisait, les ayant lues, elle voudrait les faire vivre de la vie qu’elle donne libéralement aux galathées inférieures et qu’elle doit aux galathées modelées par le génie. Elle voudrait, mais elle ne lira pas Ibsen. Rosmersholm joué par Sarah Bernhardt, quelles trompettes de Jéricho, quels écroulements et quelle édification ! Nous ne verrons pas cela. D’ailleurs, demain il sera trop tard.
Le Dieu des Belges. – Saint Denis l’Aréopagite (ou plutôt le théologien merveilleux qui écrivit sous ce nom) savait ce que Dieu n’est pas : Dieu n’est ni âme, ni intelligence, ni parole, ni substance, ni perpétuité, ni temps, ni vie, ni science, ni vérité, ni non-être, ni être. C’est déjà, et en un langage inégalé depuis, la théorie de l’inconnaissable. Mais un tel aveu satisfait mal l’ardente curiosité des publicistes belges, et l’un deux, qui opère à Louvain, vient de nous ouvrir sur la psychologie divine un aperçu inédit. Cela pourrait s’appeler « Dieu et la musique ». Dieu aime-t-il la musique ? Quelle musique préfère-t-il ? Dieu veut-il qu’on lui joue toujours le même air ? Est-il partisan de la musique classique, de la musique moderne, de la musique de l’avenir ? Que pense-t-il du plain-chant et de la mélodie grégorienne ? Enfin quels sont ses maîtres favoris ? En moins d’une demi-page le publiciste belge répond à toutes ces questions, – mais il le fait d’une façon indirecte, et ironique, ayant l’air de jeter aux passants la poignée de vérités d’un homme trop riche. Voici : Dieu aime la mélodie grégorienne, mais avec modération. Il a soin de varier le programme quotidien des concerts célestes, dont le fond reste le plain-chant liturgique, par des auditions de Bach, Mozart, Haendel, Haydn, « et même de Gounod ». Dieu ignore Wagner, mais il aime la variété.
« Si les concerts des anges dans le ciel en étaient réduits à la psalmodie et à la doxologie liturgiques, croit-on que l’oreille de Dieu et des saints en serait éternellement ravie ? » C’est net. Évidemment M. Ferdinand Loise a reçu des confidences. Qu’il soit remercié. L’opinion de Dieu est toujours bonne à connaître. On se fait de l’infini l’idée qu’on peut ; celle qu’en a Monsieur Loise n’est pas méchante. Le voyez-vous, ce bon Vieillard, majestueusement assis dans sa loge de face, au-dessus d’un parterre de saints ? Les derniers hosannahs viennent de s’éteindre, les anges de l’orchestre éprouvent d’un coup d’ongle les cordes de leurs violes, un bâton se lève, la tempête éclate. À l’entracte on distribue de la rosée indulgenciée, pendant que Dieu se fait lire dans la Revue Générale Belge, l’entrefilet qui lui est consacré. Il approuve et dit : « Si je n’étais le Dieu de tous les hommes, je voudrais être le Dieu des Belges. »
Février.
La Scission. – M. Fouquier écrit des Flaireurs, détachement admirable d’une nonchalance couchée sur des peaux de bêtes : « Je n’ai rien compris à cette fantaisie ennuyeuse et macabre. Est-ce de la réalité ? Mais où a-t-on vu les Pompes funèbres arriver la nuit avant qu’on les fît chercher ?… Est-ce un symbole ? Mais de quoi ? Je n’y ai rien compris, absolument rien, si ce n’est qu’un vent de folie, etc… » Mais est-ce vrai ? Sont-ils vraiment candides, ou bien abusent-ils du public pour savoir jusqu’à quel point un public peut être asinesque ? M. Fouquier est instruit et intelligent ; telles de ses chroniques dissertations sont agréables à lire et même rémunératrices. Alors, comment expliquer par les voies droites qu’il nie l’évidente beauté du petit poème de M. Van Lerberghe ? Non, j’efface toutes les autres suppositions, et j’admets qu’il est authentique que M. Fouquier n’ait « rien compris aux Flaireurs ». Il a donc raison de le dire ; il doit le dire, même en rougissant, et avouer, même de mauvaise grâce, sa nette et puérile pensée. Alors nous pouvons, pendant trois minutes – nous entendre, sur l’idéal terrain de ce méridien fantastique où l’heure est nulle et où s’annihile la contradiction des horloges. J’admets, moi, que M. Fouquier comprenne peu Maeterlinck, pas du tout Van Lerberghe et encore moins Mallarmé et quelques autres ; j’admets qu’il n’aime ni Villiers de l’Isle-Adam, ni Barbey d’Aurevilly, ni Hello, ni quelques autres ; or, moi, je comprends et j’aime les uns et les autres, – et quelques autres, – et je n’aime ni ne comprends Dumas où je ne trouve rien à aimer ni rien à comprendre. Est-ce clair ?
Admettons donc une scission intellectuelle. Je crois que la solution de tous ces conflits littéraires serait qu’on ne fît juger dans les journaux les écrivains d’une génération ou d’une lignée que par des écrivains d’une même génération ou d’une même lignée. S’il est absurde que je juge Dumas – qui m’est en somme totalement indifférent – il est non moins absurde que M. Sarcey ou M. Fouquier jugent d’Axël ou de la Princesse Maleine. Car il faut le redire, dût-on le redire cent mille fois, la critique doit être positive et explicative. C’est à ceux qui aiment de parler, et non à ceux qui haïssent ; c’est à ceux qui comprennent et non à ceux qui ne comprennent pas. Que le Figaro invite M. Vielé-Griffin quand il sera opportun d’estimer les Flaireurs, et s’il s’agit de Marcelle, nous prierons M. Henry Fouquier – ou son secrétaire.
Depuis cette note écrite, M. Paul Adam a bien résumé la question. Il appelle cela le conflit du sentiment et de l’idée, et dit que nous sommes voués à une littérature idéiste et que nos prédécesseurs l’étaient à une littérature sentimentiste. La petite bourgeoise mal mariée et mal satisfaite des joies conjugales – thème perpétuel de théâtre à la Dumas : M. Paul Adam réplique : qu’elle se démarie avec franchise, si elle se croit destinée à un bonheur irrégulier. Mais ses plaintes ! La prisonnière du Devoir est pour nous aussi désuète et aussi ridicule que la captive romantique qui gémit derrière les barreaux d’une geôle ogivale. Un devoir nié par le désir personnel de se réaliser euphoniquement n’est plus un devoir ; c’est un préjugé, – et cela devient du vaudeville : tout l’intérêt est dans l’oscillation de la recette.
Mars.
Monsieur Zola. – A-t-il l’âme aussi stercoraire que ses écrits ? En vérité, il y a bien de la bassesse, bien de la haine et bien de l’envie en ses derniers articles du Figaro. Il y a de la bassesse à conseiller à la populace bourgeoise le mépris pour des êtres qui, comme Villiers et Verlaine, furent trois fois sacrés par le génie, la pauvreté et la souffrance ; il y a de la haine dans ces invectives contre une jeunesse qui professe de l’ignorer encore plus qu’elle ne l’ignore vraiment ; et c’est la haine la plus sotte, la haine contre une collectivité, et quelle ! vague, instable, flottante ; et cette haine est aveugle, puisque – malgré ses dires – il n’a lu ni Paul Adam, ni Eekhoud, ni quelques autres qui sont, comme lui, des violents, et plus aigus ; et cette haine est injuste, car de ce que l’on n’aime pas le genre de talent d’un écrivain, il n’est pas permis d’inférer que ce talent n’existe pas. M. Zola croit nous rendre coup pour coup ; il se croit nié ; pas en dehors des heures de nécessité polémique et pas de ceux qui assument, certains jours, des opinions critiques. Nier ? Nie-t-on Rochefort ou Drumont ? Ils ont leur public auquel ils sont nécessaires. M. Zola a son public ; il a même, lui aussi, ses badauds. Une œuvre énorme ; oui, arithmétiquement, mais peut-on compter dans une œuvre des saloperies tristes comme La Terre, ou des platitudes exaspérées comme La Bête humaine ? M. Zola demande-t-il un tri ? Ses lecteurs les mieux enchaînés le font déjà. Étonnés par la niaiserie de Lourdes, ils n’ont qu’un espoir petit de se reprendre au cours des fastidieuses pages appelées Rome.
Appeler un livre Rome ! Il y a en ce moment une femme (maison Malot ; sa veuve continue le commerce), qui intitule un roman : La Beauté. Tout simplement. Et M. Zola, avec une vanité parente de la naïveté de la bonne dame, se figure que Rome, c’est un mélange confus d’archéologie et de piété superstitieuse ; ajoutez quelques rengaines sentimentales et les rêvasseries d’un séminariste romantique, et voilà la Rome dite par le colosse d’ignorance et de vanité qu’est M. Zola. Il est peu probable que cela fasse oublier Madame Gervaisais. Et j’écris ces deux mots, d’abord parce qu’ils sont le titre d’un chef-d’œuvre, et ensuite parce que : il y a aujourd’hui un écrivain qui ne professa aucun des évangiles chers aux nouveaux venus, et qui pourtant, malgré toutes sortes de différences d’intellectualité et de sentiment, malgré son naturalisme avéré, proclamé, prôné, est unanimement tenu pour un grand écrivain et pour un maître par cette même jeunesse à qui M. Zola répugne ; c’est Edmond de Goncourt. S’il faut vraiment entre les vivants élire un Empereur des Lettres, que l’on couronne Goncourt. Celui-là gagna noblement sa gloire.
Et si l’on comparait les deux œuvres et les deux gloires ! Il est arrivé pour M. Zola ce qui arriva pour Alexandre Dumas : sa réputation a été faite et surfaite par les journaux. Pressés de juger, désireux de se ménager des patrons, heureux de hautes références et de Larousses vivants qui s’ouvrent et disent n’importe quoi sur n’importe quoi, les journalistes – les vrais, les agités – acceptent volontiers les réputations de la pile et de la recette, ceux qui font le maximum ; et un écrivain ou un dramaturge doué d’évidents mérites, fécond, laborieux, orgueilleux, un homme destiné à une large et honorable célébrité, ils le transforment, par quelques interviews, en un grand homme. Cependant ils attendent muets, la nécrologie au croc, la mort de Verlaine. Dumas était assez discret ; la réaction n’est venue qu’après sa mort : quelques jours ont épuisé les lamentations productives et voici le grand silence. M. Zola est trop bruyant ; il crie trop haut ses vieilles haines qui sont devenues des envies ; il prend trop de place ! On s’en apercevra, – et il verra la fin de sa gloire avant la fin de son œuvre. Comme d’autres entrèrent vivants dans l’immortalité, il entrera vivant dans le grand silence.
Car son œuvre a, dès maintenant, tous les signes de la caducité : elle est vulgaire et sans style ; c’est une Avenue de l’Opéra ; au bout du profil des massives piles de bouquins ou de moellons on n’aperçoit qu’un monument d’une médiocrité gigantesque. M. Zola de tous les dons qui font le grand écrivain n’en aura eu que deux et au degré accessoire, les dons de l’imagination et de l’assimilation ; ce sont plutôt des qualités d’architecte ; c’est un créateur de palais de rapport. Quant aux idées, son style aux mailles larges et lâches laisse passer toute la flottille des poissons d’argent. Qui se souvient de s’être arrêté, anxieux, sur une de ses pages ? Qui jamais y trouva prétexte à réflexion, à rêve, à retour sur soi, à voyage vers ailleurs ? Ibsen et Tolstoï nous emmènent où ils veulent ; ils ont toute puissance sur les âmes ; on n’échappe à leur étreinte que par la fuite ; M. Zola a si peu de force attractive, qu’un cercle de désert s’est tout naturellement et tout logiquement dessiné autour de lui. Il est obligé de crier pour qu’on s’aperçoive de son existence ; si les journaux cessaient de s’occuper de lui, il cesserait d’être, car son rôle est fini. Il n’a même plus d’ennemis : nul ne conteste ce que son œuvre laborieuse a de mérites. Elle est vaste, elle est haute, elle est massive ; c’est un lourd et gros pâté de maisons habité par d’honorables commerçants, de sérieux bourgeois, des filles riches, des coulissiers, des ecclésiastiques, des militaires, des bonnes et M. Alexis, une petite ville ; seulement elle se trouve dans l’axe de prolongement du boulevard de l’Idée Nouvelle, – et l’enquête vient de commencer, les locataires font leurs paquets, l’entrepreneur des démolitions rassemble ses pioches et ses tombereaux ; demain la palissade se fleurira d’affiches.
Lettre à M. d’Annunzio. – Ce qu’il y a de plus grave en votre aventure, Monsieur, c’est l’amitié littéraire que vous a vouée M. Gaston Deschamps, écrivain léger et dont les jugements font sourire. Ce critique n’a aucune autorité parmi nous, car nous jugeons qu’il y a un plagiat bien plus répugnant que celui des phrases, c’est le plagiat des formes intellectuelles. Naturellement amorphe, M. Gaston Deschamps a eu la patience, tel un plâtrier italien, de mouler sur le vif différentes parties de plusieurs cerveaux et de se composer ainsi, au moyen de pièces rapportées, un habitacle qui n’eût pas l’air, tout d’abord, d’avoir été dérobé ; les morceaux les plus gros de cette construction alvéolique sont la bonhomie féline de M. Jules Lemaître et le détachement dédaigneux de M. Anatole France. Il fait, comme le premier, profession de s’intéresser à tout en laissant deviner, comme le second, qu’il méprise tout : mais sa véritable nature est celle des faibles et des impuissants, l’esprit d’imitation, avec son revers, l’esprit de contradiction. S’il vous a mis dans ses prônes, ce fut pour faire comme M. de Vogüé, et ce fut encore pour singer cet ancien ambassadeur qu’il se donna en Italie la mission que M. Thovez vient d’écourter si brusquement. La part de l’esprit de contradiction, c’est ceci : qu’il songeait moins à vous exalter pour vous-même qu’à se servir de votre gloire pour écraser, comme d’une roue, les nouveaux écrivains français indociles à ses manipulations d’apothicaire. Car si j’ai dit roue, Monsieur, c’est que la gloire est un orbe, figurativement, mais vous n’étiez entre ses mains qu’un pilon avec lequel il rêvait de broyer dans le même mortier toutes les cervelles mal pensantes.
Je vous crois trop intelligent pour admettre la sincérité d’un enthousiasme touchant la Renaissance latine ; vous savez, ayant lu Tolstoï, Nietzsche, Ibsen, et les Français et les Anglais, vous savez qu’il n’y a pas plus, à cette heure, d’esprit latin, qu’il n’y a d’esprit russe ou d’esprit scandinave ; il y a un esprit européen et, ici et là, des individus qui s’affirment uniques, personnels et entiers. Alors la prétention d’une Renaissance latine se dévêt et la voici nue : joujou mal fait avec lequel on voulait amuser le publia et l’empêcher, ne fût-ce que durant quelques heures, de prendre garde à l’étrange sensation de l’idée qui lui souffle dans les cheveux… Renaissance latine : la volupté pure et simple, la beauté plastique, quelques-uns de ces mots qui ne simulent le mystère que par ce qu’ils contiennent de peur, l’amour, la mort, un dosage heureux de Pétrarque et de Léopardi, Enfants, semez des roses, voici la mort qui passe. Mais sèmerez-vous assez de roses pour assourdir les pas de la foule qui se rue vers le grand désastre, assez de roses pour boire le sang des veines écrasées, assez de roses pour que l’odeur des roses étouffe dans des gorges les sanglots de la joie et les cris de la haine ?…
Renaissance latine ! Ainsi c’était vous, Monsieur, qui du fond de l’Italie désolée, ravagée par les recors, effeuillée par la folie sénile d’un Mazarinet, vous qui du fond de la terre des morts alliez surgir, chêne dodonique, sonore de prophétiques œuvres ? Vous qui alliez, seul debout en face de l’universelle angoisse, réduire à des jeux d’amour et à des pluies de fleurs tout le spectacle intellectuel ? Prenez un lys et mettez-vous à la tête du cortège : nous célébrerons dignement les funérailles de la Renaissance latine.
Pour ce que l’on vous reproche ? Non ; c’est si peu de chose. M. de Vogüé haïssait les Fleurs du mal, mésestimait la Tentation, ignorait Maeterlinck, méprisait l’Éthopée totalement, jugeait que Verlaine en vérité revêtait des toges de trop peu de cérémonie : – et voici que, transportés en votre jardin, il admire ces œuvres, il aime ces hommes ! Cette aventure ne vous grandit pas, mais elle déprécie peut-être moins votre talent qu’elle ne diminue l’autorité professionnelle d’un jardinier si mal instruit. Quant à M. Gaston Deschamps, il fut penaud ; il ne fut que cela.
N’ayez pas de chagrin d’un tel malentendu et croyez que si nous goutâmes les autres en vous, nous y goûtons aussi vous-même, et avec moins de défiance que vous ne pourriez le supposer. Est-ce donc un crime que d’avoir vulgarisé en Italie quelques belles phrases ? À quoi donc, depuis qu’il prit sa retraite, s’occupa M. de Vogüé, sinon à vulgariser la pensée d’autrui ? Besogne honorable, même ; mais enfin, besogne et rien de plus. Et que fait M. Gaston Deschamps et que font tous les doumiculets sinon de vivre à même autrui, en dépeçant l’organisme qui les fait vivre ? Si à cette heure. Monsieur, vous surpreniez à rougir de vous quelqu’un de ces parasites, laissez-les rougir et laissez-les dire : entre vous et le critique il y a encore la différence qu’il y a entre le fondeur de la cloche et le bedeau qui la sonne.
Cependant, ne recommencez pas et triez vos Amis : les Thovez sont les moins dangereux, – cave canem. Songez à n’être que vous-même ; ne prétendez pas, comme votre pays, vous enrichir par des emprunts étrangers ; ne rêvez pas d’une gloire immodeste, de toute une forêt de lauriers : celui qui vous est dû suffira à vous tenir en joie avec ses petites fleurs roses et ses belles feuilles vertes. Enfin n’intitulez pas un roman le Triomphe de la Mort, cela appartient à Pétrarque ; ou les Vierges aux Rochers, c’est du Léonard ; ni une trilogie, les Romans de la Rose : on croirait que vous avez plus d’ambition que d’imagination.
Avril
Les Césars fainéants. – Je me réservais l’agrément d’une petite note sous ce titre, mais on m’a devancé, – tant la comparaison s’impose entre les tristes Chilpérics que l’on traînait en des chars à bœufs, et les lamentables Faures, que, riches d’avoir vendu les peaux du vieil attelage démodé, on promène en des sleeping-cars le long des populations indifférentes. En pendant aux soudards stipendiés par les Maires du Palais on noterait foute la Sûreté mobilisée et qui hurle pendant que le paysan, songeant à l’impôt, baisse la tête, et pousse dans la terre lourde sa pensive charrue.
Le Style. – L’Annuaire de la Presse signale environ 10 000 journaux de la langue française : à quatre rédacteurs par journal, en moyenne, cela fait, je crois, 40 000 écrivains qui devraient avoir chacun un genre de talent différent, visible comme une nuance entre des nuances, – tout au moins, et sinon comme une couleur entre les couleurs. – Or, je lis (hélas ! je lis tout !) des lignes où voici : « Succès de vente… Concert d’éloges… Des considérants tout à fait étrangers à la littérature… Le cœur humain… orgueil prodigieux… égoïsme étroit… pas un atome de vie et d’humanité… fort tirage… forcer les ressorts de la langue… s’engloutir dans l’oubli… ouvrir une période de décadence… la réaction est inévitable… Notre pays est encore vivant… Retour vers le bon sens, le naturel et la simplicité… » C’est en ces termes qu’un malheureux « critique littéraire » essaie de bafouer le style. En passant, il recommande Paul et Virginie, parce que c’est émouvant, – mais il est constant que M. Dennery détient encore de plus énergiques oignons.
Les Styles. – M. Sarcey écrivit naguère : « Comment, il y a un style d’oraison funèbre, de discours académique, d’histoire, de conte libertin, et il n’y aurait pas un style de théâtre ? » Quel ingénu ! Mais s’il y eut un style d’oraison funèbre, c’est parce que Bossuet ayant fait de très belles oraisons, elles furent insatiablement imitées. Dites, vénérable critique, qu’il y eut (car le genre est bien mort) un style d’imitation d’oraison funèbre. Un autre Bossu et aurait oraisonné tout différemment, puisqu’il aurait eu un génie différent. Le même raisonnement est bon pour le reste des exemples et au-delà : le style d’un genre, c’est l’imitation de ce qui a eu du succès en ce genre. À cette heure, le dernier ton de la poésie intime avant été donné par Verlaine, tous les mauvais poètes font du Verlaine, comme ils firent du Musset, du Lamartine. D’ailleurs la vieille plaisanterie des genres en littérature est vraiment trop vieille et les catalogues sont déconcertés. Ainsi, hier, les Histoires Naturelles de Jules Renard exaspéraient un bibliothécaire : « Quel livre absurde ! Mais c’est inclassable ! » – « À tout hasard, dis-je, mettez-le donc au chapitre des chefs-d’œuvre. »
Conscience Administrative. – Rue de Grenelle, une pierre tomba ; une vieille femme fut endommagée ; cette vieille femme était le bœuf d’une petite voiture à bras (la charrue avant les bœufs) ; alors on posta deux sergots à l’endroit du désastre, l’un veillant sur l’amont, l’autre sur l’aval, et ils avaient comme consigne de laisser passer toutes bêtes et toutes gens, tous fardeaux et tous attelages, – mais de barrer la route funeste aux petites voitures à bras ! Pour bien s’amuser, remonter le long de ce raisonnement administratif : il est beau comme une page de la Logique de Port-Royal.
Conscience littéraire. – Au premier dénouement de Thermidor, Fabienne marchait au supplice et son amant était tué en voulant la défendre. « Ce dénouement parut trop noir pour la Porte Saint-Martin », – et maintenant la charrette est arrêtée, et Fabienne délivrée tombe dans les bras de son bon ami. – La recette avant tout. Sauvons la caisse. Faire le maximum. Le caissier se frotte les mains. Décidément, il y a un style de théâtre.
Mai.
Anaïs Fargueil. – Il sera peut-être bon, à propos de la mort de cette tragédienne, de rappeler aux nécrophores le seul épisode important d’une vie vouée, pour le reste, à incarner de déplorables, quoique fructueuses héroïnes. On a cité toutes les pièces ou successivement elle prostitua son talent et sa beauté, et rien n’est plus sinistre que ce résumé des gestes inutiles où se dévora toute une existence ; voici la Marquise, Alexandre chez Apelle, les Filles de Marbre, la Vie en rose, le Mariage d’Olympe, Lucie Didier, Rédemption, les Diables noirs, les Femmes fortes, Maisons neuves, les Brebisde Panurge, Miss Multon, les Pattes de mouche, Patrie, l’Arlésienne, l’Oncle Sam, Rose Michel, la Comtesse de Lérins, Madame de Maintenon. Là elle se retira dans l’oubli, pauvre et pas fière, sinon d’avoir imposé, pendant six soirées, au public du Vaudeville, la Révolte de Villiers de l’Isle-Adam. Les chroniqueurs qui se sont souvenus de Rose Michel, drame célèbre de M. Blum, ont négligé la Révolte : mais, à leur point de vue, ce dédain est juste et sage, car on sait qu’ils distinguent sévèrement deux genres de théâtre : le théâtre lucratif et l’autre. Il faut en convenir, la Révolte





























