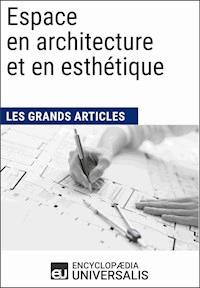
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
En Occident, l'espace de l'œuvre d'art a longtemps tendu à se confondre avec sa représentation, telle qu'elle a pu être pensée à travers la perspective. Ce que celle-ci inventait, en effet, c'était un sujet théorique capable de maîtriser l'espace et, en l'inscrivant dans un cadre, donc en le calculant, de le proposer au spectateur comme pure visibilité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 56
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341003421
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Kaspars Grinvalds/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Espace en architecture et en esthétique
En Occident, l’espace de l’œuvre d’art a longtemps tendu à se confondre avec sa représentation, telle qu’elle a pu être pensée à travers la perspective. Ce que celle-ci inventait, en effet, c’était un sujet théorique capable de maîtriser l’espace et, en l’inscrivant dans un cadre, donc en le calculant, de le proposer au spectateur comme pure visibilité.
La révolution du regard induite par l’art moderne a pour une part consisté à rendre l’œuvre à elle-même, à faire en sorte que celle-ci puisse à nouveau susciter son espace propre, au lieu de se donner comme une simple forme dont la perception dépendrait d’une grille préexistante. La peinture, la sculpture, l’architecture aussi, y ont acquis une vérité renouvelée : car ce n’est pas seulement l’espace concret qui se trouve alors reconquis, mais aussi sa dimension psychique, seule à même de permettre un dialogue fructueux entre l’œuvre, l’artiste et celui qui la contemple
E.U.
1. Architecture
Le substantif « espace » appartient aujourd’hui au langage courant concernant l’urbanisme (espace urbain, espace public, espace vert) et l’architecture (espace classique ou baroque, statique ou dynamique... et, plus spécifiquement, espace de séjour, espace de repos). Mais cet usage est récent. Il ne s’est généralisé qu’après les années 1940, lorsque la locution « arts de l’espace » a remplacé, sans s’y substituer, la locution « arts du dessin » consacrée par Vasari.
En architecture, c’est le « mouvement moderne » qui, depuis les années 1920, a introduit l’usage systématique du concept d’espace. Toutefois, celui-ci avait déjà été élaboré dans une perspective architecturale par des historiens d’art de langue allemande que marquaient la philosophie critique de Kant et l’Esthétique de Hegel, et qui avaient assimilé les premiers travaux de la psychologie de la forme (Christian von Ehrenfels, 1890). Par la suite et jusqu’à maintenant, la réflexion architecturale sur l’espace a continué de puiser aux sources de l’histoire de l’art et de la psychologie, tout en faisant appel aux recherches de l’épistémologie et de la phénoménologie.
Il en est résulté un corpus de travaux, vaste et touffu, qu’on ne peut prétendre aborder exhaustivement. On privilégiera ici deux perspectives. D’une part, d’un point de vue historiographique, en s’appuyant sur un échantillon d’ouvrages fondamentaux, on montrera trois aspects de la valeur opératoire et heuristique du concept d’espace, conçu comme champ de l’expérience humaine, déterminé par l’architecture. Sa dimension esthétique a permis d’étayer les analyses et les périodisations des historiens d’art, de Aloïs Riegl et August von Schmarsow à Sigfried Giedion, en passant par Heinrich Wölfflin et P. Franckl. Sa dimension symbolique a servi à éclairer la vision du monde de différentes cultures et de différents moments de la culture, à travers le monde formel de l’architecture et des architectures (de Riegl et Worringer à Spengler et Giedion). Enfin, sa dimension polémique a intégré le concept d’espace dans la théorie de l’architecture du mouvement moderne. D’autre part, d’un point de vue critique, on tentera d’apprécier le rôle de la notion d’espace dans la recherche architecturale. On se demandera, en particulier, si un procès involutif ne minerait pas l’architecture qui, au profit de nouveaux objectifs médiatiques, semble opérer un retour réducteur au dessin et renoncer à la création de l’espace-temps rêvé par les C.I.A.M. (Congrès internationaux d’architecture moderne).
• Généalogie : de l’architecture art du dessin à l’architecture art de l’espace
Selon le Dictionnaire universel (1690) de Furetière, espace « signifie en général estendüe infinie de lieu : „la puissance divine remplit un espace infini“ [...]. Espace se dit en particulier d’un lieu déterminé, étendu depuis un point jusqu’à un autre, soit qu’il soit plein, soit qu’il soit vuide. Espace purement local est l’intervalle qui est entre les trois dimensions [...] quand même le corps que nous concevons qui l’occupe seroit détruit et qu’il en seroit entièrement vuidé. „Il fait beau bastir dans cette place, il y a bien de l’espace. Cette rue est fort étroite, il n’y a que l’espace d’une charrette“ ». Aucune référence à l’architecture, et pas davantage quatre ans plus tard dans le Dictionnaire de l’Académie française, encore moins disert (et qui, dans son édition de 1932, continue d’ignorer toute connotation architecturale du terme espace). Comme l’indique G. Matoré, « pour la pensée classique, le monde se limitait à un espace vu, mais avec la raison davantage que par le regard, ou analysé et non réellement observé ».
L’usage commun des dictionnaires est corroboré par les traités et par l’ensemble de la réflexion spécifique sur l’architecture depuis le XVe siècle. Spatium, ignoré de Vitruve, ne figure ni dans l’inaugural De re aedificatoria d’Alberti ni chez ses successeurs des siècles suivants. Non que des espaces architecturaux, au sens actuel, n’aient été consciemment élaborés à ces époques. Mais les concepts directeurs de la théorie et de la pratique architecturales sont ceux de proportion, d’harmonie, de convenance, d’effet, d’ordre, de distribution, plus tard de type, et, bien sûr, toujours de perspective, dans la mesure même où l’architecture est conçue comme appartenant aux arts du dessin. Au XVIIIe siècle, ni Blondel ni Milizia, ni Laugier ni même Ledoux ne nous parlent d’espace.
Au XIXe siècle, plus curieusement, le terme est absent des chapitres de l’Esthétique que Hegel consacre à l’architecture et qui marqueront cependant les travaux sur l’espace architectural des historiens de l’art et de la culture de la fin du XIXe et du XXe siècle. On ne le rencontre pas davantage chez Quatremère de Quincy, ni même chez Viollet-le-Duc, qui fut pourtant, dans ses Entretiens sur l’architecture, l’un des premiers à mettre en relation la spécificité des cultures et celle de ce que nous appelons aujourd’hui leurs espaces. Mais le problème spatial est chez lui abordé en termes de systèmes constructifs et, comme l’a bien remarqué Henri Focillon (1945), de formes. En revanche, à la même époque, Haussmann, bientôt suivi par les urbanistes, utilise couramment le terme espace pour désigner, dans les deux dimensions du plan urbain, les surfaces libres et à aménager.
En fait, ce ne sont pas les architectes qui ont les premiers associé espace et architecture, mais les historiens d’art de langue allemande de la fin du XIXe et du début du XXe





























