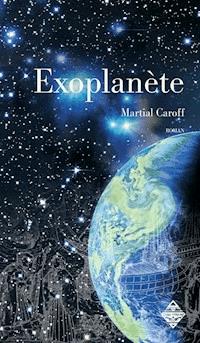
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Terre de Brume
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
12 janvier 2030. L’information court déjà sur tout le réseau NewNet : depuis 19h32, une nouvelle étoile resplendit dans la constellation d’Orion.
Le mystère s’épaissit le 19 janvier lorsque l’astre s’éteint subitement, pour réapparaître le lendemain soir et devenir, cette fois, l’objet extrasolaire le plus brillant du ciel, visible même en plein jour ! L’observatoire de Meudon est en effervescence. Le médiatique professeur Morgenstern veut être le premier à proposer une explication à ce prodigieux phénomène. Pour cela, il convient de terminer au plus vite la mise au point de l’hypertélescope spatial, un outil révolutionnaire capable de produire des images détaillées de lointains systèmes planétaires. Dans le même temps, le libraire Marc Chouviac découvre une série d’indices qui lui font penser que l’étoile est déjà apparue dans le passé… C’est ainsi que débutent deux enquêtes convergentes, l’une scientifique, l’autre historique, qui déboucheront sur la découverte la plus fantastique de tous les temps !
Plongez-vous dans cette investigation scientifique au cœur de l’espace !
EXTRAIT
Les deux amis marchaient dans les rues de Tours. Quelques voitures silencieuses déversaient leurs flots de braillards. Depuis l’avènement des piles à combustible, l’atténuation de la pollution sonore des moteurs avait été compensée par un accroissement du tapage vocal. Les villes humaines se devaient d’être bruyantes, c’était l’une de leurs fonctions sociales. Marc se demanda s’il en était de même sur les autres planètes. Il se souvint du chat de Tex Avery qui quittait une Terre trop turbulente à son goût pour la Lune et découvrait là une société encore plus assourdissante…
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
De la « hard science » comme il s’en écrit peu en France. Un mélange de « hard science provinciale », puisque le roman met volontairement en scène des personnages ancrés dans leur terroir, et de « hard science internationale » puisqu’il aborde des thématiques clés de l’histoire universelle. [...] Ce roman devrait plaire à tous les amateurs d’astronomie et d’astrophysique ainsi qu’aux lecteurs de Tintin, nostalgiques de « L’étoile mystérieuse ». - Marc Alotton, Actusf
[... ] un roman passionnant, riche, autant romanesque qu'anticipatif et que vous aurez du mal à lâcher. - Herveline, Librairie Soleil vert
De l'analyse du ciel au décryptage de documents anciens, des observatoires français jusqu'aux sables du Soudan, la plume talentueuse de Martial Caroff nous embarque dans un thriller d'anticipation singulièrement documenté, qui s'achève en toute simplicité sur la réponse à la question : sommes-nous seuls dans l'Univers ? - Laurent Payot, Librairie Payot-LaChaux-de-Fonds
Comme dans une enquête policière, chaque chapitre commence par une indication de lieu, de date et d’heure précise, ce qui permet de suivre pas à pas et presque minute par minute le processus qui va nous conduire à enfin élucider l’énigme. Le suspense est maintenu jusqu’aux toutes dernières pages... - Peregrinne
À PROPOS DE L’AUTEUR
Enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale, Martial Caroff est spécialisé dans l’étude des magmas. Il étudie en particulier les processus de genèse et de mise en place des laves basaltiques formant les volcans polynésiens et les dorsales océaniques [sic]. Spécialiste du polar anticonformiste, il est l’auteur de la tétralogie des Quatre Saisons d’Ys et de la trilogie de science-fiction Intelligences.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÉFACE
Les révolutions célestes sont toujours silencieuses. Sans doute parce qu’entre les planètes, les étoiles et les galaxies règne… le vide. Et que dans ces espaces-là, « on ne vous entend pas crier » clame l’affiche de cinéma du premier Alien de Ridley Scott ! C’est bien dommage car, en 1995 de notre ère, après plus de deux millénaires de questionnement et de recherche, deux hommes ont poussé un grand cri : « On a trouvé ! » Depuis l’Observatoire de Haute-Provence et à l’aide d’un télescope de modeste diamètre, les astronomes suisse — Michel Major — et français — Didier Queloz — détectaient la signature d’une planète extrasolaire dans la lumière d’une étoile. Un monde étrange et improbable qui, tel un premier cèpe découvert par le cueilleur de champignons dans la forêt, signe le début de la collecte. Des dizaines, puis des centaines d’exoplanètes vont rapidement pointer le bout de leur nez. D’abord des « Jupiter chauds », planètes de gaz tournant en quelques jours autour de leur soleil. Puis des systèmes à plusieurs corps. Et enfin, des « exoterres » dont la masse ne cesse de diminuer.
La prochaine annonce attendue avec impatience c’est évidemment celle d’une planète extrasolaire de masse terrestre, circulant dans la zone d’habitabilité de son étoile. Là où il ne fait ni trop chaud, ni trop froid ; là où l’eau peut circuler sous ses trois formes physiques : solide, liquide et gazeuse. « C’est pour demain » affirment les astronomes. Et, dans les couloirs des observatoires, on susurre que des candidates au titre de « sœurs de la Terre » seraient déjà prises dans les filets…
Il n’est plus un seul scientifique pour douter que l’Univers est peuplé de planètes. La preuve est faite qu’elles sont le sous-produit de la formation des étoiles. La comptabilité cosmique a alors de quoi donner le vertige. Dans notre seule Galaxie, la Voie Lactée, il pourrait exister plus d’un milliard de Terre. Et comme il existe des milliards de galaxies dans le cosmos…
Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Passée cette première étape, fondamentale, de découverte de berceaux à la vie, s’organise déjà la recherche de ses signes. On peut s’amuser à inverser notre point de vue pour mieux mesurer les défis qui nous attendent : comment savoir depuis Véga de la Lyre par exemple, à 25 années lumière d’ici, et en supposant que soit connue l’existence de la Terre tournant autour du Soleil, que la vie y a prospéré sous de multiples formes ? Microbienne, végétale, animale et humaine…
La Vie, quelle signature ? Est-elle décelable à distance ? Les moyens dont disposent les scientifiques sont malheureusement inversement proportionnels aux gouffres cosmiques qui nous séparent des terres lointaines. Il faudra beaucoup d’astuces, de chance et d’imagination pour répondre à ces questions mais dans ce vaste champ des possibles qu’est l’Univers rien n’est écrit d’avance et la nature, elle même, peut nous réserver des surprises. Ainsi, grâce aux transits planétaires — le passage d’un corps devant le disque de son étoile — on est déjà capable de détailler une météo extraterrestre. De décrire les couleurs d’un coucher de soleil à des années lumière de là. Toutes les informations et tous les secrets de ces mondes lointains se cachent dans leurs lumières, fragiles fils d’Ariane liant les communautés stellaires. Il reste à les faire parler !
Des philosophes de la nature aux scientifiques des temps modernes, la nature du questionnement n’a pas varié. Ce qui fait révolution, c’est que nous pouvons espérer à un horizon historique découvrir d’autres terres autour d’autres étoiles. Et peut-être même savoir, à distance, si la vie — dont les biologistes remarquent qu’elle est expansionniste — s’y est implantée. Jamais la question « sommes-nous seuls dans l’Univers ? » n’a eu autant de chances de trouver une réponse. Et l’aventure dans laquelle nous plongent avec bonheur les héros d’Exoplanète, sous la plume talentueuse de Martial Caroff, nous pousse à trouver cette fiction… fort crédible. C’est vrai que le charme d’Astrée n’y est pas étranger !
ALAIN CIROU,le 11 novembre 2008
Pourquoi les astres ont-ils abandonné leur cours et se meuvent-ils obscurs à travers le monde, tandis que le flanc d’Orion porte-glaive brille d’une lueur excessive ?
Lucain (39-65 ap. J.-C.)La Pharsale, Livre I, v. 663-665
PROLOGUE Amanishakhéto
Soudan, octobre 2026 Dans le désert nubien, entre la sixième cataracte du Nil et Méroé
En ce milieu d’après-midi, la Land Rover roulait sur une large chaussée en relativement bon état. Normal. Sa construction à la fin du siècle passé avait été financée par le légendaire Oussama Ben Laden, un homme qui avait les moyens de répandre sans lésiner du bitume de qualité.
La route, en s’éloignant du Nil, s’était enfoncée dans la gorge de Sabaloka, puis avait traversé la bourgade animée de Shendi, bariolée des couleurs de son marché. Depuis, elle traçait une ligne presque droite sur le tapis orange du désert, çà et là percé par l’ergot noir d’un rocher pointu, maculé d’éclaboussures glauques, buissons d’acacias. Le véhicule croisait de temps en temps un groupe de Soudanaises voilées, parfois précédées d’un bardot lourdement chargé. Quand le vent capricieux soulevait une nuée de sable, la voiture s’enfonçait aussitôt dans une brume de bronze qui embrouillait le paysage pendant quelques instants.
Seul dans son 4x4 climatisé, Jacques Kieffer était bien et se sentait libre. Enfin délivré de l’étouffant intégrisme qui paralysait Khartoum, il voulait tout transgresser d’un coup : flacon de whisky entre les cuisses, il fumait un énorme cigare en accompagnant à tue-tête la rengaine de son lecteur mp7.
Getrennt von uns unendlich weit
Sie müssen sich an Sterne krallen
Ganz fest
Damit sie nicht vom Himmel fallen1.
L’archéologue s’approchait du site antique de Méroé. La cuvette désertique était abandonnée. Depuis la dernière prise de pouvoir des islamistes à Khartoum, le Soudan s’était vidé de ses touristes. Seuls quelques baraquements délaissés de marchands de souvenirs rappelaient l’engouement qu’avait suscité le site des nécropoles nubiennes ces dernières années. La destruction en 2018 de la totalité des pyramides égyptiennes par le régime dictatorial du Caire avait incité les égyptologues en manque à s’intéresser enfin à la civilisation méroïtique, au carrefour des influences ptolémaïques, romaines, asiatiques et africaines. Les travaux scientifiques avaient passionné la presse, ce qui avait drainé une foule considérable de touristes dans la seconde capitale de l’ancien royaume koush. Mais de même que la Nubie avait autrefois subi l’influence de son grand voisin du Nord, le Soudan moderne avait, un an plus tôt, suivi l’exemple de l’Égypte et, à son tour, plongé dans le chaos du fondamentalisme le plus sombre.
Jacques Kieffer était le seul Occidental à oser encore fréquenter les courbes du Nil !
Soudain, au sommet des deux petites collines qui fermaient la cuvette à l’est, il vit se dresser parmi les dunes rousses les pyramides de la nécropole royale. Saisissant spectacle, sous un ciel rouillé par les particules volantes du désert ! Ému par la majesté du site, qu’il connaissait pourtant si bien, Kieffer ralentit pour se faufiler à petite vitesse entre des constructions aux pentes raides, abrasées par les giclées de sable que des siècles de vent avaient déversées sur leurs flancs. Elles étaient plus petites et pointues que feu leurs royales cousines égyptiennes. Les plus hautes culminaient à une trentaine de mètres. S’y adossait invariablement à l’est une petite chapelle funéraire, précédée d’un ou de deux pylônes. La plupart des chapelles étaient richement décorées de bas-reliefs : on voyait ici une reine obèse en plein combat, là une autre assise sur son trône, recevant des offrandes. Il y avait aussi quelques scènes inspirées du Livre des Morts. En passant devant les deux pylônes de la reine Shanakdakhété, Jacques se rappela avoir admiré lors d’un précédent passage un impressionnant troupeau de bœufs buriné sur les pierres de sa chapelle.
Toutes ces pyramides avaient pour objet de signaler la présence des dépouilles royales dans les chambres mortuaires aménagées dans le sous-sol.
Jacques Kieffer poursuivit longuement son circuit motorisé entre les monuments royaux, un second havane entre les lèvres. Il y avait plusieurs dizaines de pyramides dans cette nécropole. Il voulait les flairer toutes, se frotter à leur ombre antique comme pour dépurer ses frusques imprégnées de la mauvaise haleine du XXIe siècle.
Toutes ces pyramides avaient été répertoriées et numérotées. Il gara sa voiture près de celle portant le numéro onze. Dès qu’il ouvrit la portière, il fut agressé par l’infernale touffeur du climat soudanais, « génétiquement modifié » par la pollution humaine. Il se couvrit d’un large panama dentelé, ce qui apporta une note surannée à sa tenue d’aventurier des temps plus que modernes. Chaussures de randonnée légères, jean vert et veste en toile bistre, ceinture cloutée portant holster, fins gants de cuir grenat, foulard jaune, Ray-Ban et barbe grise, il était l’homme invisible dans le costume d’Arlequin.
Jacques se fit humble fourmi devant la taupinière géante, à demi effondrée, toujours majestueuse. Il marcha. Le sol sableux, les pyramides, le ciel, tous les éléments du paysage conjuguaient la palette des ocres. Pourtant les contours étaient d’une netteté surréelle.
Son cigare achevé, il retourna à la voiture pour prendre sa sacoche, compulsa les documents qu’elle contenait, saisit une feuille. Il s’agissait de la reproduction d’un plan ancien du secteur de la nécropole où il se trouvait. Le papier était couvert de notes quasi indéchiffrables. Pas pour l’archéologue, qui parut satisfait de sa lecture. Il garda le feuillet à la main et remit la sacoche dans la Land Rover. Il prit ensuite une pelle pliable dans le coffre, puis longea à pied l’alignement des pyramides. La plupart des sommets avaient été arasés par les pillards et rares étaient les chapelles qui avaient survécu à la course des siècles. Quelques édifices avaient été relevés peu avant la dictature actuelle par le service archéologique du Soudan. Telles ces deux petites pyramides immaculées, à l’est de l’alignement principal. Elles ressemblaient à des offices du tourisme occidentaux. Mais Jacques n’aimait pas cette perfection artificielle. Il préférait les ruines. Voir les entrailles de ces fabuleux monstres de pierre étalées sous un soleil déréglé le bouleversait. Le moindre souffle de vent pouvait faire tomber des blocs. Les monuments ouverts étaient vivants. Blessés, mais vivants.
L’homme se faufila entre les pyramides numéro neuf et dix, petites et plutôt bien conservées. Le sable sous ses semelles était brûlant. Le soleil pesait sur son chapeau comme une masse. Des pierres taillées, parfois porteuses d’un message gravé dans l’énigmatique langue méroïtique, étaient éparpillées dans le désert orange.
La huitième pyramide ressemblait à la onzième : même taille, même ventre ouvert, mais contrairement à sa jumelle, la chapelle s’était ici écroulée sur ses secrets. Jacques n’aimait pas quand le bâtiment d’entrée était manquant. C’était comme si ses rêves n’avaient plus de porte. L’archéologue ralentit pour consulter son document. Ce qu’il cherchait n’était plus très loin. L’arête du pylône nord-est de la chapelle n° 6 était marquée d’une croix sur son plan.
Il leva les yeux.
Le flanc oriental de la septième pyramide était particulièrement bien conservé. Ce n’était pas le cas de la sixième, dont il ne restait rien, sinon les pylônes reconstitués de la chapelle et un gros tas de gravats derrière. Jacques Kieffer savait qu’à cet endroit s’était pourtant dressée l’une des plus belles constructions de la nécropole royale : la pyramide de la candace Amanishakhéto, la reine qui avait su résister à l’oppression romaine au premier siècle avant Jésus-Christ ! Le Nantais Frédéric Cailliaud en avait fait le premier une description et une représentation en 1822. À l’époque, le monument se dressait presque intact, toisant ses voisins du haut de ses vingt-huit mètres. Douze ans plus tard, un aventurier italien, Giuseppe Ferlini, obtint l’autorisation de procéder à des fouilles dans la nécropole royale. En se basant sur les travaux de Cailliaud, il choisit de s’attaquer à l’une des pyramides les mieux conservées, celle d’Amanishakhéto. Il la démantela complètement et ce ne fut pas en vain : il y découvrit un fabuleux trésor, à présent conservé dans des musées allemands.
Mais foin du passé, l’heure était à l’action ! Jacques déplia sa pelle et s’approcha, le cœur battant, du pylône droit. Il toucha de la paume la pierre brûlante, peut-être pour accroître son potentiel de chance, puis il enfonça le métal dans le sable. À grandes pelletés rageuses, il expédiait la poussière au loin. Mais excaver le désert est tâche digne de l’enfer grec. Les parois du trou s’effondraient à mesure qu’il creusait. Et le soleil, pourtant couchant, pesait de plus en plus lourd sur ses épaules ruisselantes. Il insista, élargit la fosse, sonda le plus profondément possible. Il était persuadé que là gisait ce qui le rendrait heureux et célèbre. Il en avait trop bavé ces dernières années pour échouer si près du but, à cause d’une coulure de quartz orange.
Soudain, le métal de la pelle cogna contre une surface dure, tout au fond du trou. Kieffer poussa un petit cri de joie. Il touchait au but. Il creusa encore plus fiévreusement dans la lumière rasante, rouge sang, de cette fin de journée. Après un effort surhumain, il parvint à dégager une plaque de pierre rectangulaire d’une cinquantaine de centimètres de long. Elle portait une gravure montrant Apedemak, le dieu méroïtique de la guerre et de la fertilité, protecteur de la Nubie, représenté de profil sous les traits d’un lion. Mais ce n’était pas là ce qu’il cherchait. Il devait y avoir autre chose. Cette plaque n’était qu’un couvercle pour protéger…
Il reprit son labeur. Cette fois, il n’eut pas à creuser longtemps avant de toucher une autre pierre. Son excitation était à son comble. Tout à sa découverte, il ne se souciait plus de son environnement. Il ne perçut pas les bruits de moteur, ne remarqua pas les faisceaux de phares qui balayaient le désert de plus en plus près de la nécropole.
Il profita des derniers rayons de soleil pour dégager une seconde plaque gravée, légèrement plus petite que la première.
C’était la bonne !
Il parvint à y distinguer la représentation d’une grosse femme couronnée debout devant une foule et, près d’elle, d’un notable qui montrait quelque chose du doigt…
Tout à coup, une horde de véhicules déboucha de derrière une pyramide. En sortirent des hommes en armes, déguenillés, vaguement habillés en soldats. Ils se précipitèrent en criant vers Kieffer et lui arrachèrent la pierre des mains.
– Mais foutez-moi la paix, bande d’ignares ! hurla-t-il en français. Puis il lâcha une bordée d’injures en arabe. Les miliciens le frappèrent à coups de crosse, le jetèrent à l’arrière d’un camion.
Leur chef, un grand barbu au visage osseux, saisit la plaque des griffes d’un soldat. Il l’examina longuement, un rictus à la bouche. Puis il cracha sur la reine antique et balança la pierre dans un autre véhicule, ce qui la fendit.
La caravane militaire repartit bruyamment. Le site fut rendu à sa sérénité.
Le soleil s’était couché.
1. « Séparés de nous, infiniment loin, ils doivent s’agripper aux étoiles très fortement pour ne pas tomber du ciel. » Rammstein.
PREMIÈRE PARTIE α-2 ORIONIS
CHAPITRE PREMIER
Observatoire de Meudon, vendredi 18 janvier 2030, 20 h 20
La fille n’était vraiment pas frileuse. Se promener dehors en robe légère et gilet de laine un soir anticyclonique de janvier, il fallait le faire ! Mais Astrée Lahille était de celles qui n’avaient froid ni aux yeux ni au corps.
Enfin, il faisait un peu frisquet tout de même… En quête de chaleur, elle s’enroula comme un lierre autour de son chêne de copain, Marc Chouviac. Pas très costaud pour un chêne, mais brûlant comme la braise, le gars l’accueillit à bras ouverts, qu’il referma sur elle. Il lui dégela le dos de ses paumes, lui ranima les lèvres de sa langue.
– C’est bon, Marc, c’est bon ! Faudrait quand même pas que je sois trop chaude…
– Moi, ça ne me dérange pas…
Elle se dégagea. La bagatelle attendrait, ils avaient mieux à faire ce soir. Le couple continua à marcher main dans la main le long de la petite route boisée qui bordait l’extrémité méridionale de l’étang du Bel Air. L’Observatoire de Meudon était posé dans un écrin de verdure remarquable, surtout si près de Paris. C’était la première fois que Marc s’y rendait. Astrée avait insisté pour laisser leur voiture à l’extérieur afin que son compagnon pût découvrir le site à pied à la lueur des nombreux lampadaires alignés le long des chemins du parc. Elle voulait que son ami eût la meilleure impression possible en découvrant l’Observatoire.
– Drôle de lieu. Il y a des coupoles partout ! C’est quoi celle-là ? demanda-t-il en désignant du doigt un édifice trapu aux murs rayés surmonté d’un dôme gris et prolongé par un bâtiment rectangulaire.
– La table équatoriale, répondit Astrée, enthousiaste. Elle abrite un vieux télescope. J’y ai fait mes balbutiements en spectroscopie au début de ma thèse. Et là, c’est le grand sidérostat !
Elle désignait un parallélépipède assez quelconque, à gauche du chemin.
Marc sourit. Il se dit qu’à cette minute sa compagne ne pensait plus ni au froid, ni aux câlins. Elle était dans ses chères étoiles. Il la prit par les épaules pour la forcer à se tourner vers lui. Oui, les étoiles brillaient dans son regard bleu comme l’eussent fait des paillettes d’or dans un ciel de printemps. Ou le contraire, peu importe.
N’empêche, le grand sidérostat, ça ne disait pas grand-chose à Marc. Il trouvait le mot joli et la bâtisse moche. Libraire, tourangeau, trente-sept ans, le nouvel ami d’Astrée était plus sensible à la beauté de la langue française qu’à celle des profondeurs célestes. Cet amour des lettres se percevait d’ailleurs dans sa tenue de littérateur militant, faite de solides godillots, d’un large pantalon de toile rouge et d’une grande veste beige, d’un genre disparu des rayonnages depuis, disons, le milieu du XXe siècle. De longs cheveux bruns dégoulinaient sur son col et il avait les yeux gris, un peu tristes.
Le couple s’était rencontré trois semaines plus tôt, à Drouot, lors d’une vente de livres anciens. Il cherchait des ouvrages du XVIIe, elle passait par là, c’était son quartier. Ils s’étaient plu sur le champ et s’étaient aimés dans la foulée.
– Tu travailles où précisément ? demanda-t-il.
Astrée — ingénieur de recherche, parisienne, vingt-huit ans — lui montra entre les branches dégarnies une sorte de grand château d’eau qui dominait le parc de l’Observatoire au sud.
– En haut de cette drôle de construction qu’on appelle la Tour Solaire, précisa-t-elle. À son édification en 1969, il s’agissait d’un dispositif révolutionnaire pour étudier le soleil. Mais maintenant, le système n’est plus fonctionnel. La partie supérieure a été élargie depuis et entièrement réaménagée pour pouvoir accueillir le labo de Morgenstern. Je te dis pas la vue qu’on a de là-haut…
Ils étaient presque arrivés au bâtiment allongé où devait avoir lieu la conférence, près de la tour, à l’ouest.
– On est un peu en avance, constata Marc. On s’en grille une avant d’entrer ? À la lueur de la nouvelle étoile…
– Si tu veux.
Ils allumèrent leurs cigarettes debout près de la porte d’entrée de la salle de conférences, se couvant du regard. Ils se caressèrent les cheveux, pas encore habitués l’un à l’autre.
Des gens leur souriaient en passant.
– Regardons-la ! murmura Astrée à l’oreille de son ami.
Ils levèrent les yeux ensemble.
Plein sud, Orion constellait. Normal à cette époque et à cette heure, dans un ciel dégagé. Mais ce qui l’était moins, c’est que depuis six jours, l’essaim d’étoiles comprenait un astre supplémentaire. L’intrus était situé près de l’alignement dit des « Trois Mages » formant le « Baudrier » d’Orion, à droite de Mintaka (Delta Orionis). Une étoile extrêmement brillante. Elle s’était allumée précisément à 19h32, le douze janvier. Depuis, aucune théorie n’avait su expliquer de manière convaincante cette troublante apparition.
Le couple était coi. Ils se tenaient la main, les yeux dans la voûte à travers un nuage de fumée.
Mais il était l’heure. Ils écrasèrent leurs mégots et pénétrèrent dans la grande salle.
Il y avait beaucoup de monde. Tous les sièges étant déjà occupés, une trentaine de personnes devaient rester debout au fond de la pièce. Heureusement, Marc et Astrée avaient deux places réservées sur le côté. D’un coup d’œil rotatif, la fille évalua la composition de l’auditoire. Un tiers de membres de l’Observatoire et deux tiers de curieux, analysa-t-elle, dont une dizaine de journalistes installés au premier rang. Son patron, Célestin Morgenstern, avait soigné sa com pour attirer un large public. Une conférence sur les exoplanètes par l’un des meilleurs spécialistes du sujet, normal que la foule fût appâtée. Et puis le mystère de la nouvelle étoile d’Orion avait joué en faveur de Morgenstern : les gens étaient depuis peu devenus friands d’informations astronomiques.
L’artiste faisait d’ailleurs son entrée à l’instant même. L’homme était grand, la soixantaine fringante. Il était habillé bizarrement, tennis, pantalon rayé et jaquette noire ouverte sur une chemise hawaiienne, tel un savant de l’ancien régime qui se serait abreuvé de culture californienne. Son bouc soigneusement taillé en pointe et ses lunettes portées à bout de nez complétaient un accoutrement sournoisement étudié pour se donner le genre « lunaire-génial-sympathique ». Mais Marc devinait que tout cela n’était que poudre aux yeux. D’ailleurs, Astrée lui avait révélé que Morgenstern était un autocrate extrêmement dur. Pas le moins du monde le professeur Tournesol actualisé qu’il feignait d’être. Même s’il se montrait parfois aussi brillant que son confrère de papier…
Le conférencier entra rapidement dans le vif du sujet. Commença par définir le concept d’exoplanète (tout corps planétaire gravitant autour d’un astre autre que le soleil), rappela que l’exoplanète tellurique la plus proche connue se situait à un peu moins de quinze années-lumière de la Terre, ce qui rendait vain tout espoir de voyage habité.
Morgenstern maniait avec l’art consommé du marionnettiste toutes les ficelles du métier de tribun pour captiver son auditoire. Il illustrait ses propos d’un diaporama animé projeté sur un mur-écran concave.
Il aborda ensuite le problème de l’observation des exoplanètes. Elles étaient non seulement lointaines, mais aussi sombres et situées à proximité d’étoiles extrêmement lumineuses.
– Une planète est en moyenne un milliard de fois moins brillante que son soleil, expliqua-t-il. Distinguer les grands traits du paysage d’une exoplanète localisée à quelques dizaines d’années-lumière revient à étudier depuis Paris ou New York — je néglige la rotondité de la Terre — les détails des ailes d’un papillon posé de nuit sur le bord du phare du Créac’h à Ouessant.
Murmure d’ébahissement. Il continua sur sa lancée.
– Évidemment, si l’on considère un objet encore plus lointain, situé à plusieurs centaines d’années-lumière, le papillon devient fourmi, puis ciron… Bref, jusqu’à ces dernières années, l’étude des exoplanètes s’est faite de manière indirecte, sans qu’il soit possible de réellement les observer. En fait, il s’agissait plutôt de les détecter. Pour ce faire, il existe plusieurs techniques : la spectroscopie, qui révèle la variation des longueurs d’onde d’une étoile quand celle-ci est attirée par sa planète ; l’astrométrie, qui repère l’oscillation de l’astre sous ce même effet gravitationnel ; la photométrie, qui guette la légère éclipse d’une étoile quand sa planète passe devant elle. Durant la première phase de l’exploration, entre 1995 et 2007, moins de deux cent cinquante exoplanètes ont été identifiées, la plupart par spectroscopie. Puis la photométrie et l’astrométrie ont peu à peu pris leur essor grâce à la mise en orbite de satellites spécialement dédiés à cette quête : Corot, Kepler, Gaia, puis Pascal, Brahe… À ce jour, le compte s’établit précisément à deux millions trois cent deux mille cinq cent dix-huit planètes extrasolaires repérées ! Mais il en reste des dizaines de milliards à trouver, dans notre seule galaxie !
Marc se tourna vers sa voisine. L’esprit d’Astrée n’était plus dans la salle : il s’était envolé dans son cher cosmos. Le libraire n’était venu ici que pour faire plaisir à sa nouvelle compagne. La perspective de devoir écouter un scientifique discourir pendant plus d’une heure ne l’avait pas enchanté lorsque, la veille, elle lui avait proposé de l’accompagner. Pourtant, chose étonnante, Marc sentait son intérêt croître à mesure que le conférencier faisait défiler diagrammes et figures. Celui-ci passait de temps en temps une petite animation pour illustrer un point technique ou faire rêver le public en lui montrant des reconstitutions artistiques de mondes fabuleux.
– Quant à l’imagerie directe, continua-t-il, elle a été pour le moment très décevante. Quand on fait les observations depuis la terre, les remous de l’atmosphère forment une sorte de halo autour de l’astre, qui empêche de distinguer un éventuel système planétaire. C’est pourquoi, les exoplanétologues ne travaillent qu’avec des télescopes spatiaux. Pour régler le problème de la luminosité de l’étoile, qui empêche d’observer sa proche banlieue, on utilise une astuce, le coronographe. Il s’agit d’une sorte de cache qui masque l’éclat de l’astre. Ceci nous a permis d’obtenir des images directes de quelques milliers de planètes, mais franchement, rien d’excitant : ce sont de tous petits points à peine visibles. Impossible de connaître avec ça la géographie des nouveaux mondes !
Astrée revint sur terre pour souffler à l’oreille de son ami :
– C’est maintenant que ça devient intéressant ! Écoute bien.
Marc acquiesça d’une bise. Célestin Morgenstern but une gorgée d’eau.
– Mais après tout, poursuivit-il, pourquoi s’intéresser à ces bouts de cailloux disséminés dans le Grand Tout ? La réponse n’est-elle pas évidente ? Leur intérêt vient bien sûr de ce qu’ils sont susceptibles de receler la vie. Et peut-être même, qui sait, une forme de vie intelligente… Vous savez tous que depuis la mission GanyDrill, dont je fus le concepteur, il est démontré que la vie existe bel et bien au-delà de notre globe. Je rappelle rapidement les conditions de la découverte. Une sonde automatique de nouvelle génération s’est posée en février 2023 sur Ganymède, le plus grand satellite de Jupiter, en vue de forer la calotte glaciaire sur une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. Trois mois après le début des opérations, lors de la quatrième campagne de forage, une poche d’eau liquide fut percée à trente-cinq mètres de profondeur, à la limite entre la glace et un sol silicaté. Des cheminées hydrothermales produisent en ce lieu chaleur et nutriments, ce qui a permis à la vie de se développer. À l’intérieur de la poche chaude, on a pu filmer ceci.
Sur l’écran apparut une foule de bestioles à la géométrie extravagante : des sortes de vers plats bioluminescents ondulaient au-dessus d’un fond marin où se dressaient des polypes à ornementations pétaloïdes, où se baladaient des espèces de tubes à pattes et à piquants, ainsi que des machins cuirassés dotés d’un long appendice. Des animaux transparents à squelette interne nageaient à l’arrière-plan.
Marc était ému, même s’il avait vu déjà plusieurs fois les photos des bêtes. Ces documents avaient provoqué une immense émotion à travers le monde à l’époque de la découverte et fait de Morgenstern une sommité internationale. Mais c’était la première fois que le film originel était montré au public.
Le scientifique reprit le cours de son exposé.
– Il s’agit là de la seule preuve de vie extraterrestre qu’on ait jamais trouvée. Mais elle est fondamentale : on sait maintenant que la vie n’est pas une exception et qu’elle prend des formes voisines de celles qui existent ou ont existé sur la Terre. Cette faune est en effet étonnamment proche de la population fossile des schistes cambriens de Burgess, en Colombie britannique, vieille d’un peu plus de cinq cents millions d’années. Reprenons à présent le fil de notre réflexion sur les exoplanètes. Comment détecter des traces de vie sur des objets aussi lointains et à peine visibles ? Là encore, ce sont des méthodes indirectes qui ont été développées. Un premier tri a permis d’éliminer les corps gazeux, de type Jupiter ou Saturne, pour ne conserver que les planètes dites telluriques, c’est-à-dire à surface rocheuse. Si l’on part de l’hypothèse réputée raisonnable que la vie est partout carbonée et hydratée…
Un journaliste barbu se dressa soudain au premier rang et interrompit l’orateur :
– Un peu rapide, comme postulat ! osa-t-il. Le fait d’avoir trouvé une exopopulation organique proche d’un ancien écosystème terrestre ne vous autorise pas à rejeter purement et simplement l’hypothèse alternative d’une vie basée sur un autre atome que le carbone et un autre environnement que l’eau ! Et dans ce cas-là, que chercher, où chercher ? Plus la moindre référence sur laquelle s’appuyer ! Par exemple, pourquoi une planète géante de type Jupiter ne deviendrait-elle pas un bon candidat pour accueillir une vie… métallique ?
L’homme se rassit. Il était satisfait de sa sortie. Morgenstern hocha la tête, reconnaissant implicitement la justesse de la remarque. Il réfléchit quelques instants, puis fit la réponse suivante :
– Je ne sais pas si vous avez raison, mais je dois reconnaître qu’il est possible que vous n’ayez pas tort ! (Le scientifique découvrit ses dents de carnassier :) Il y aurait donc des journalistes intelligents ? (Sourires crispés d’une partie de l’auditoire ; Morgenstern continua :) La vie a besoin de briques moléculaires et d’un solvant au sein duquel les assembler. Sur la Terre et sur Ganymède, la vie est basée sur la chimie du carbone et le liquide qui permet les réactions, c’est l’eau. Peut-on envisager un autre type de briques élémentaires et un autre solvant ? La réponse est clairement oui, même si les chances sont faibles ! L’avantage du carbone, c’est qu’il peut développer des liaisons solides avec d’autres éléments, solides mais pas trop, ce qui permet un grand nombre de réactions chimiques, nécessaires au fonctionnement des cellules. C’est ce compromis entre solidité et souplesse des liaisons chimiques qui est le véritable secret du vivant. Et l’eau, avec son pouvoir de polarisation, sa capacité à former des liaisons hydrogène, intervient dans une multitude de réactions biochimiques. C’est le solvant idéal pour la vie. On peut néanmoins en envisager d’autres. Le solvant alternatif le plus souvent proposé est l’ammoniac. Il s’agit d’une molécule constituée d’un atome d’azote et de trois atomes d’hydrogène, sous forme liquide à basse tempérture. Les propriétés physiques de ce milieu liquide sont proches de celles de l’eau. Les réactions pouvant s’y dérouler sont plus lentes que dans l’eau car il y fait plus froid, mais elles sont comparables. Quant à la brique élémentaire qui pourrait remplacer le carbone, pourquoi pas le silicium ? C’est incontestablement le meilleur candidat ! Propriétés structurales analogues au carbone, capacité de s’entourer d’autres atomes pour former des molécules… Mais les liaisons sont beaucoup plus solides. Les rompre pour autoriser les réactions chimiques indispensables au vivant exigerait une colossale quantité d’énergie. La vie autour de cet atome ne pourrait se concevoir que dans un milieu très… dantesque et probablement dépourvu d’ammoniac liquide ou d’eau ! (Morgenstern se tourna vers le barbu qui l’avait interrompu.) Faudrait-il alors réhabiliter certaines planètes gazeuses, comme vous le suggériez ? Peut-être. En tout état de cause, il faudrait renoncer à chercher du dioxyde de carbone dans l’atmosphère des planètes candidates, puisqu’un organisme basé sur le silicium et utilisant de l’oxygène rejetterait du dioxyde de silicium, c’est-à-dire du… sable !
La salle s’agita. Elle bruissait de contentement. Les gens recevaient ce qu’ils étaient venus chercher : de la belle émotion !





























