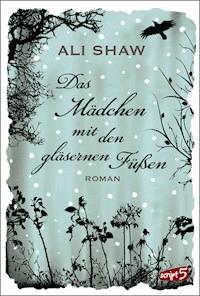Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
"Les fenêtres" s’ouvrent sur le tragique destin de Piotr/Pierre, un enfant victime de la misère, qui traverse une vie marquée par la maltraitance et la délinquance. Son adoption par des parents bienveillants permettra-t-elle, après un parcours judiciaire tumultueux, de refermer le récit sur la rédemption ? Cela reste à découvrir.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Martine Jolly, enseignante et assesseur au Tribunal pour enfants, a créé le personnage de Piotr/Pierre pour faire entendre la voix de tous les jeunes défavorisés, témoigner des enjeux de l’adoption et du travail remarquable effectué par la juridiction des mineurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martine Jolly
Fenêtres
Roman
© Lys Bleu Éditions – Martine Jolly
ISBN : 979-10-422-2074-7
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Ce livre n’est qu’une fiction. Le lecteur voudra bien excuser les anachronismes et autres approximations, volontaires, car nécessaires à la narration.
Préface
La littérature n’a pas la prétention de révolutionner le monde, mais elle peut s’enorgueillir de se faire le porte-parole des incompris, des sans voix et d’être parfois écoutée.
La juridiction pour mineurs depuis les ordonnances de 1945 est une juridiction à part dans le monde judiciaire, même si elle a beaucoup évolué depuis ; une juridiction totalement méconnue d’autant plus qu’elle se pratique à huis clos.
Le roman Fenêtres à mes yeux a un double intérêt. Celui, d’abord de mettre en scène l’exceptionnel travail de cette juridiction particulière – des magistrats, aux avocats –, et de faire connaître les difficultés, les efforts de ces professionnels pour sauver ces jeunes toujours en grande précarité matérielle et morale.
Maître E.B, avocate à la cour,
spécialiste de la justice des mineurs.
Partie I
Chapitre 1
Perm (Russie). Avril 2000
Perm : Russie encore européenne ; pas pour très loin. L’Oural perchée derrière, guette et annonce l’Asie toute proche. Perm : ses églises, son opéra, la Kama, lascive et large. Perm, et son goulag, du temps qu’elle s’appelait Molotov.
Perm, aussi comme la promesse d’un repos pour le brave.
***
An 2000, Liza a 16 ans, petit visage qui hésite entre la rondeur de l’enfance et la sévérité de la rancœur. Liza est grosse, mais grosse ! Grosse d’une vie qu’elle n’a pas réclamée, qu’on lui a imposée, là après une soirée de beuverie, de trucs illicites qui font tourner la tête, oublier qui on est, que la vie est moche et que celui qui te touche est un gars comme toi, un paumé. Enfin, c’est ce qu’elle croit. Alors Liza est grosse, ne sait plus où poser son ventre, énorme, qui bouge de cette vie qu’elle déteste déjà. Elle s’étale sur le vieux canapé défoncé comme elle, pour faire passer la chose, elle s’enfile une bière, une autre. Une voix crie : « Mais qu’est-ce qui m’a foutu cette fille de rien ? » C’est sa mère, Ékatérina. Un nom, trop long pour ce siècle qui doit aller à toute vitesse. On l’appelle Ka, comme un pied de nez ironique au puissant mythe égyptien. Une grande femme maigre, négligée, au regard éteint. Toute façon, elle n’est qu’une silhouette terne dans cette histoire, on ne la verra plus beaucoup.
Pas plus heureuse que sa fille. Le cœur mité, elle aussi. Ça fait longtemps qu’elle voulait se débarrasser de son bon à rien de mari. Heureusement, il est mort l’année passée à 40 ans et des broutilles, d’un trop-plein de quelque chose. C’est comme ça la misère. Mais il lui reste, sa fille, une traînée et ce qu’elle s’est glissé dans le tiroir.
Ah ! Le communisme ! On l’a dégommé. On va pas se plaindre. Mais si, tiens quand même. Nous on s’en foutait de la liberté et de tout le saint-frusquin, du goulag et tutti quanti. Même si Perm en garde quelques souvenirs. Mais, ça c’est bon pour les intellos.
Nous on avait à manger et les gosses, y allaient à l’école. Et y avait des docteurs, au moins, quand on était malade. Maintenant, tu peux toujours courir pour avoir du boulot. La misère, que je te dis. Et puis cette traînée sur le lit. Manquait plus de que ça. Qu’est-ce qu’on va en foutre de cet avorton ? Qui c’est qui va le nourrir ? se lamente-t-elle en regardant les lézardes qui veinent le mur fatigué et blême.
Derrière la vitre sale se dresse une quinzaine d’étages, droits comme un I d’imprimerie, sans fantaisie, sans mystère. L’horizon, le destin. Quelques secondes d’égarement et :
« Ferme-la, répond Liza. Donne-moi une bière plutôt. Toute façon, celui-là, dit-elle en pointant son ventre, il va pas faire long feu. J’espère seulement qu’il va pas tarder, parce que j’en peux plus de porter ce paquet. »1
Perm, Russie, un jour – comme un autre – d’avril 2000. Un petit soleil très frais tente, vainement d’égayer cette grisaille urbaine.
Liza ne se lève plus. La grossesse sans doute et l’alcool sûrement alourdissent sa silhouette et sa démarche maladroite. Tout juste aller faire un brin de toilette, pour chasser les odeurs tenaces, odeurs qui mêlent indistinctement une vaisselle négligée, des restes de tabac froid, d’alcools, des restes d’une vie à moitié, d’une vie en miettes.
Et puis, cette nuit du 6 avril, Liza n’en peut plus. Elle souffre, elle crie, appelle sa mère :
« Je crois, que c’est bon, là ça va y être. Va chercher Natalia. »
Natalia est une brave fille qui habite sur le même palier et qui leur rend des services. Beaucoup de services même. D’autant que, comme elle est infirmière à la polyclinique X, Liza la sollicite toujours pour qu’elle lui fournisse certaines substances. Toujours, mais en vain. Il faut dire. Et comme elle a les clés (Ka lui en a donné un jeu – on ne sait jamais avec cette foldingue de Liza), combien de fois elle est intervenue quand les voix se faisaient trop acérées, pour séparer la mère de la fille, calmer le père quand il était encore là, jeter les bouteilles, panser les lendemains de guerre ou d’extasie.
« Non, faut aller à l’hôpital.
— Pas question. Pas d’argent. Et puis, je ne veux pas qu’il soit déclaré. Plus vite oublié, plus vite effacé.
— J’en veux pas de ton mioche, mais quand même. On a pas le droit. C’est pas correct.
— Fais ce que je t’dis. Merde. Va chercher Natalia. Elle peut bien faire ça. C’est son rayon quand même, les mômes. Y en a pas pour longtemps. Et puis si ça rate, ça sera tant mieux. On sera débarrassé sans rien faire. »
Ka, vaincue par cette « éloquence », quitte son tablier, arrange une mèche de ses cheveux déjà bien blanchis (pourquoi, au fait ? Un reste de dignité, peut-être) et s’en va sonner à la porte de Natalia. Un beau brin de fille, cette Natalia, silhouette gracile toujours en mouvement, regard clair et vif, mais surtout Natalia, c’est une bonne môme ; certes, elle travaille dans le service de néo- natalité, mais elle n’est pas médecin et elle le rappelle :
« Mais là, non, vraiment, ce n’est pas de mon ressort… Il faut la conduire à l’hôpital. Je ne sais pas faire. S’il y a des complications…
— T’occupe pas de ça. Y a juste qu’à l’aider à faire sortir le polichinelle. Après tu rentres chez toi. Et on t’embête plus », répond Ka, presque sur le ton de la menace.
Est-ce son regard muet et dérangeant, est-ce sa voix rugueuse encombrée par des restes de tabac ? Tout en elle incommode Natalia, qui, malgré elle, se soumet à ses injonctions. Alors, elle prend sa trousse, se lave les mains et franchit, non sans crainte le seuil du terrain d’intervention.
Stupeur, dans le salon-salle à tout – faire, elle découvre Liza, à peine consciente baignant dans un liquide jaunâtre.
« Réveille-toi, allez, bouge-toi. »
Elle la frictionne, la secoue. Liza ouvre les yeux et hurle soudain :
« Il me fait mal ce con. C’est bientôt fini ?
— Oh ! Non ce n’est pas bientôt fini. »
Il en faut des bassines, des serviettes, des cris pour que, enfin, vienne au jour, un tout petit au duvet couleur poussin.
« C’est un garçon, s’écrie Natalia, fière de son travail. Il est tout beau, tout mignon, ajoute-t-elle, presque étonnée. Tu vas l’appeler comment ?
— Je l’appelle pas, j’en veux pas. Prends-le si tu veux. Appelle-le comme tu veux. »
Natalia est à peine surprise ; Liza l’avait suffisamment répété. Mais quand même, elle gardait l’espoir d’un prodige. On ne sait jamais.
Elle pense à ce pauvre enfant, dont la ligne de vie se présente déjà comme une ligne brisée. Comprenant que rien ne convaincra Liza qui refuse de s’attendrir, Natalia propose d’aller elle-même le déclarer.
« M’en fous, souffle Liza acerbe.
— Bon, faisons autrement. C’est quoi le nom du père ?
— Pff, mais je te répète : tu fais ce que tu veux ; je te dis, même que tu peux le prendre. Toute façon, j’ai rien pour lui. Et le père, je sais même pas qui c’est. C’était une soirée de dingue ! Je me souviens que de son odeur, une odeur bizarre comme de l’éther… Remarque c’était pas pour me déplaire.
Natalia réfléchit rapidement :
— Alors, je lui donnerais bien le prénom de mon oncle, il s’appelait Piotr. C’était un homme solide et bon. Si tu en es d’accord. »
Liza ne prend pas la peine de répondre.
« J’irai demain », conclut Natalia.
Natalia, optimiste, en posant le petit sur le ventre de sa mère, pense que celle-ci va s’émouvoir, va révéler quelque chose comme un sentiment maternel, un sentiment tout court. Qui sait ?
Elle enveloppe le bébé dans une couverture sans couleurs, loqueteuse – il n’y a que ça dans cette maison – le dépose au côté de sa mère, déjà endormie et se retire discrètement. L’enfant hurle.
Pendant tout ce temps, Ka est restée dans la cuisine, ne voulant pas assister à cette scène qui la trouble. En effet, il lui reste un peu d’humanité, que les jours sans pain et sans lendemain et que les poings de l’autre pochard ont réduit en lambeaux.
Le robinet mal fermé perd ses gouttes une à une. La monotonie de cette rengaine régulière finit par endormir l’enfant.
C’étaient ses derniers cris avant longtemps.
Chapitre 2
Paris – 15 novembre 2002
« Asseyez-vous s’il vous plaît ! »
La voix qui prononce cette injonction semble pour une fois un peu plus affable que les fois précédentes ; la voix qui prononce cette injonction vient de cette petite personne grise, habituée à réciter des formules sans émotion, sans empathie, sans pathos. Et le bureau qui lui sert de décor s’accorde très bien avec la couleur de sa voix et de sa silhouette.
Jeanne et Bastien la connaissent trop bien cette Madame Tessier. Combien de fois, elle les a fait revenir pour demander un document supplémentaire, signer un papier, réclamer une attestation ? À croire que le dossier de demande d’adoption est un goinfre insatiable qui ne se lasse jamais d’engloutir papelards, énergie et patience. Juste pour complexifier les démarches, pour faire attendre, pour jouer sur les nerfs, pour dissuader surtout.
Et cette Madame Tessier, encore, inquisitrice, qui fouille dans l’intimité de ces deux là, comme de tous les autres, on suppose aussi. Et de poser des questions sur leurs habitudes alimentaires, sexuelles (mais de quoi je me mêle), leur façon d’exercer leur métier (au fait Madame Demaison : comment ça se passe avec vos élèves ? Pas trop chahutée ? Et Monsieur, pas trop dur le boulot ? Les horaires ? La clientèle ?). Mais quel pouvoir elle a cette petite femme grise ! De la façon dont on va lui répondre, du sourire qu’on va lui accorder, ou pas, dépend presque, le bonheur de « porter » un enfant. Ils la détestent. Mais ils font bonne figure. Bien obligés.
Jeanne, nerveuse, tord son morceau de mouchoir (qu’elle prend toujours avec elle, on ne sait jamais, on pleure toujours en sortant de ce bureau) ; pour éviter de penser, elle regarde distraitement par cette fenêtre qui s’ouvre sur la perspective d’autres fenêtres. Enfin rien, qui n’incite à la rêverie. Mais bon, pour le moment, ces cubes et ces triangles apaisent la fébrilité de l’attente. La voix un peu grinçante de Madame Tessier la fait revenir dans le cadre du bureau :
« Si je vous ai convoqués aujourd’hui, c’est parce qu’il faudrait que vous m’apportiez…
— Je crois, Madame, interrompt Bastien, excédé, que nous devrions avoir un dossier archi-complet, si on compte le nombre de fois où vous nous avez rappelés pour apporter ceci, cela, en 5 ans.
— Laissez-moi finir, s’il vous plaît. Nous sommes sur le point de finaliser votre demande…
Bastien se tourne vers Jeanne, il lui prend la main ; il la serre.
— Mais ? Et ? Que manque-t-il ? ne peut-il s’empêcher d’interrompre à nouveau.
Elle pousse un soupir d’agacement :
— Nous avons besoin de photos. Celles que vous nous avez données datent d’il y a 5 ans ; il faudrait les renouveler. »
Cette fois, silence. Gorge nouée, sanglots. Soudain, ils la trouvent presque belle, cette Madame Tessier.
Et après quelques secondes d’intense émotion :
« C’est bon ? Nous pouvons espérer, enfin, demande Jeanne.
— Oui, je crois. Je vais vous montrer quelques photos de la petite… Ah ! Oui, au fait, c’est une fille. Elle s’appelle Fatou. Elle aura 9 mois dans quelques jours. Vous savez que c’est le délai légal avant adoption ! Elle est Malienne. Orpheline. Ses parents sont morts dans un attentat. Elle doit avoir deux grands frères qui sont placés dans des orphelinats au Mali. Elle arrivera en France dans quelques semaines. Nous allons envoyer vos photos à la directrice de la pouponnière.
— Elle est en bonne santé, qu’est-ce que faisaient ses parents ? »
Tellement de questions, pourvu qu’on en oublie aucune. En attendant, on se passe les clichés, on les caresse, on les embrasserait presque. Petite boule noire sur fond de couffin clair. Elle s’appelle déjà Demaison.
« Toute façon, dès qu’elle arrive en France, vous serez convoqués et vous aurez l’opportunité de venir la voir au début, une heure ou deux, puis un peu plus, etc. Le temps de l’adaptation. Mais d’ores et déjà, vous pouvez préparer la chambre, les vêtements. Une assistante sociale passera vous voir quelque temps avant l’arrivée de l’enfant. »
Jeanne et Bastien se lèvent, jambes fragiles et molles, mains tressées l’une dans l’autre en épissure serrée, cœur chaviré. Ils s’apprêtent à prendre congé de Madame Tessier avec – pour une fois – un sourire béat et des remerciements sans limites.
Bastien, pose la main sur la poignée de la porte.
Elle les rappelle :
« Vous savez, il vous faudra beaucoup de patience et d’amour ; c’est une petite fille qui a connu des tragédies ; je dis bien DES tragédies. »
Mais ils sont déjà partis, ils n’écoutent plus la petite femme grise, qui l’est bizarrement un peu moins aujourd’hui.
Il y a un café, au coin de la rue, à point nommé : « Café de la Joie ». Ça tombe bien, aujourd’hui, y a de la joie… pas seulement dans les ruelles et par-dessus les toits, y a de la joie aussi chez ces deux là !
« Allez champagne ! chante presque Bastien.
— Mais il est 10 h et demie ! proteste très mollement Jeanne. Si on se fait choper par la dame Tessier, elle est foutue de nous prendre pour des alcoolos et nous rayer des listes.
— On s’en fiche. C’est signé. À Fatou !
— Cool, cool. Attends, elle n’est pas là encore. »
Y a de la joie enfin, pour ce couple, dont le parcours a été jusqu’ici celui d’un GR 20, sévèrement ingrat.
Déjà leur histoire d’amour, ce n’était pas évident. Une prof de lettres avec un coiffeur. « T’es dingue ma pauvre fille », lui disaient ses amis, ses collègues, et sa cousine, surtout, toujours très optimiste : « Il y a un fossé entre vous et ça ne s’arrangera pas avec le temps. » Certains jours, elle entendait ces conseils et elle s’en voulait de se fragiliser pour cet homme d’un autre monde. Parfois, elle se cachait, elle avait honte, même. De son côté, Bastien se reprochait cette tension qui annihilait son bon sens : mais mon pauvre type, tu fais pas le poids. Tu vas au-devant des emmerdes et des humiliations.
Mais ils avaient tenu bon et étaient restés sourds à ces sirènes criardes et malveillantes. Ils avaient tenu bon, parce que, entre eux deux, ça avait été un coup de foudre immédiat. Indiscutable, incontrôlable, inévitable. Depuis le jour où Bastien avait passé les mains dans ses cheveux (des mèches, vous croyez ? Mademoiselle, ils sont déjà tellement lumineux !), ils s’étaient sentis parcourus tous deux de frissons incandescents. C’était physique, il la troublait, elle le fascinait.
Et donc « aucun oiseau de mauvaise envergure », comme disait Bastien pour plaisanter, n’était venu à bout de cette folle passion.
Jusqu’à cet instant où tout a vacillé, instant fatal où tout a failli se briser.
Ils se souviendront longtemps de cet homme en blouse blanche, lunettes sévères et carrées, la mine rogue des mandarins, prononcer une phrase sombre comme un catafalque dont ils n’avaient retenu qu’un mot : « stérilité ».
Chapitre 3
Perm – novembre 2002
Il y a bien longtemps que Piotr ne pleure plus, ne crie plus, enseveli, qu’il est, sous ces guenilles raides et puantes. Et même s’il criait, qui pourrait l’entendre ? Enfermé ainsi dans le réduit étroit, obscur qui sert plutôt de placard !
Il avait bien fait quelques tentatives dans les premiers mois de sa jeune vie, mais aussitôt, sa mère lui imposait le silence en écrasant une couche sur ses gencives tendres, ou en lançant ses vieilles savates dans les jambes scarifiées, brûlées de ce petit martyr.
Tout bébé qu’il est, il a compris que le silence est son meilleur allié.
Cela fait presque trois ans, que Piotr vit dans ce réduit sans fenêtre. Mais comment a-t-il pu survivre ?
C’est Ka, qui se souvient parfois qu’elle a été mère, qui le nourrit, le fait marcher, le lave. Enfin, n’exagérons rien. « La toilette » consiste le plus souvent en douches froides – faut pas déconner, l’eau chaude, ça coûte –. Et puis pas tous les jours quand même ; seulement quand sa feignasse de fille sort avec les marlous du bâtiment C.
Alors, quand elle revient, il faut mettre le môme à l’abri. Surtout qu’elle ne le voie pas ! Sinon, il passe un mauvais quart d’heure. Combien de fois Ka, accaparée par le sort de la captive amoureuse de son bourreau sur petit écran, a oublié de rentrer « le paquet » ? Alors Liza fond sur le gosse avec toute la force de son ivresse.
Piotr est tout petit : il n’a pas appris à grandir. Piotr ne parle pas, Piotr ne pleure plus.
Natalia, passe de temps en temps, dire bonjour, faire la causette avec Liza quand elle est sobre ; mais ne s’attarde pas. Elle ne s’inquiète plus de Piotr, puisque, quelque temps après la naissance, un matin, revenant d’une garde de nuit passant prendre des nouvelles :
« Alors comment va notre petit bonhomme ? Il est bien discret, je ne l’entends pas beaucoup. Je peux aller le voir ? Je suis un peu sa marraine après tout, c’est moi qui l’ai mis au monde. Et qui l’ai déclaré. J’ai fait des photos de lui à la naissance et j’aimerais continuer pour lui donner un album quand il sera plus grand.
Liza à peine embarrassée :
— Pas étonnant que tu ne l’entendes pas, Ka l’a emmené à la campagne chez une tante. Il est mieux qu’entre les quatre murs d’ici. Il est au milieu des champs et des coqs. Et moi, il faut que je trouve du travail… Et puis j’en voulais pas de ce bâtard.
— Ben, dis-moi quand même où il est, j’irai le voir ; ça me ferait plaisir.
— Hum », répond Liza dans un soupir peu convaincant.
Mais pourquoi Natalia, ne prête-t-elle pas plus attention à ce peu d’enthousiasme, pourquoi ne s’interroge-t-elle pas sur cette drôle d’odeur qui vient du couloir ? Natalia est gentille, mais elle est pressée, toujours pressée : le boulot, le boulot, le boulot. En plus, depuis quelques semaines, elle vit quelque chose qui ressemble à un début d’histoire d’amour avec Sergueï, l’infirmier de la « réa ». Tignasse jaune, mèche tintinesque (c’est la moto, argue-t-il, quand on le met en boîte), regard bleu polaire, cerclé de petites lunettes rondes, démarche solide d’un homme rassurant. Pas très beau, mais c’est pas grave. Il est tellement tendre et prévenant. Ça faisait si longtemps qu’elle n’avait pas eu quelqu’un pour s’intéresser à elle, ainsi.
En bref, Natalia est amoureuse. Du coup, le monde est beau, lisse et il sent bon. Elle y pense, pourtant souvent au petit Piotr, c’est sa fierté, son histoire. Justement, c’est en racontant cette naissance à Sergeï, un jour à la machine à café du 2e, qu’elle s’est rapprochée de lui.
Bon, la semaine prochaine, j’insiste auprès de Liza pour qu’elle me donne l’adresse de la tante, se dit-elle, en ce jour de novembre et en traversant à pas menus, la grand-rue qui la rapproche de l’hôpital.
La journée va être longue et dure. Mais en néonatal, c’est moins sinistre qu’en oncologie ou en gériatrie. Au moins, là, on voit des gens heureux. Pas toujours, certes, mais globalement, c’est une belle histoire professionnelle. Tiens, pas plus tard qu’il y a deux jours : la mère qui avait ramé pour avoir des enfants ; elle avait tout essayé avec son mari : les FIV, la demande d’adoption, un chien… Eh ! bien figurez-vous que c’est le chien qui a tout déclenché. Sans rien d’artificiel, sans l’aide du bon Dieu. Ce sont des jumeaux qui sont nés. Enfin, plutôt des jumelles : une paire de petites nanas roussettes et rondelettes. Le bonheur ! Ça lui fait penser à Piotr. C’est bizarre quand même. Sûr que celui-là, il n’a pas cette chance. Plus le temps passe, plus elle pense à lui, et se dit que c’est curieux quand même qu’elle n’ait pas de nouvelles. Elle s’en veut, même de ne pas s’être inquiétée plus tôt. Il va avoir trois ans dans quelques mois ; ça, pour sûr, elle se souvient bien de cette date du 6 avril 2000. À quoi peut-il ressembler à presque trois ans ? Certaine qu’elle ne le reconnaîtrait pas, il était si petit. Un nourrisson, ça ne ressemble à rien.
Bon demain, c’est promis, je force le rideau de fer. Qu’elle le veuille ou non, Liza me conduira à Piotr.
Chapitre 4
Janvier – février 2003
La journée a été éprouvante. Qu’est-ce qu’elle disait au fait, la Tessier « Pas trop chahutée ? » Si elle avait vu aujourd’hui le remue-ménage en 1ère 3 !
Il a suffi que Jeanne leur soumette un texte intitulé « De l’esclavage des nègres » pour que les invectives envahissent le champ sonore :
— Eh ! Ça se fait trop pas, ça m’dame, c’est raciste !
— Ben c’est vrai, ça, embraye un autre, il dit que leur nez est « si épaté », et qu’on doit pas les plaindre. C’est pas cool.
— Vous avez pas le droit de nous donner ça M’dame.
— Stop, stop ! s’écrie Jeanne qui n’a pas trop du reste de la séance pour leur expliquer les astuces de Montesquieu pour dénoncer ce qu’ils croyaient être un réquisitoire contre les « nègres ».
Elle sort du lycée, épuisée, et un peu désabusée, ce soir sombre de janvier.
Il faut dire que Noël n’a pas tenu ses promesses. On avait pourtant réuni tous les clichés qui font les jours de fête. Non, vraiment l’ambiance n’y était pas. Chacun avait même remarqué l’humeur piquante et orageuse de Jeanne qui, d’entrée de jeu, avait prévenu : « ON NE PARLE PAS DE FATOU ».
Et même avec Bastien, c’est plus ça. Le soir, on essaie de lire. En vain. On éteint la lumière un peu trop tôt et on se tourne en soupirant vers la table de chevet. Envie de rien.
Envie de rien.
Pourtant, tout le début de décembre avait été radieux. On avait mis le cap sur Fatou. Objectif : no limit à la niaiserie. Chambre rose, dégoulinante de ringardises et de lapins. On avait même acheté un sapin en avance, très en avance. Un sapin tellement différent des précédents. Un sapin qui sentirait le bébé. Mais le 25 décembre, il était tout déplumé et ne sentait plus que l’os de l’épicéa comme une métaphore du moral.
Vers la mi-décembre, on a commencé à ralentir cette frénésie de rose et de lapins et à se poser des questions : pourquoi aucune nouvelle de Madame Tessier ? Rien. Silence.
Ils sont passés plusieurs fois devant la plaque « AFA2 » sertie dans la pierre de l’immeuble Haussmannien.
Elle reluit ; il y a quelqu’un qui doit l’astiquer au Miror régulièrement, mais la porte, elle, est obstinément fermée. Heures d’ouverture : de 13 à 15 h ; lundi, mardi, vendredi.
Mais qui peut être dispo dans ce créneau ?
Bastien ne peut quitter son salon. Alors Jeanne décide de demander une autorisation d’absence pour en avoir le cœur net. Pourquoi aucune nouvelle de Fatou ? Que se passe-t-il ?
Le proviseur, M. Fournier, connaît bien Jeanne, ses compétences, son dévouement et n’oppose aucun refus à cette demande « à condition bien sûr de récupérer vos heures, Madame Demaison ». Il ne perd pas le nord. Le règlement, c’est le règlement.
Lundi 12 h 55, Jeanne se regarde dans la plaque qui reluit – petite mine – en attendant l’heure promise sur la pierre.
13 h 5 : une haute femme noire, protégée par un tablier coloré, finit par ouvrir la lourde et belle porte en bois sculpté de cet immeuble parisien hiératique.
« Vous désirez, Madame ?
— Je voudrais voir Madame Tessier. Nous avons essayé de la joindre par téléphone. Mais impossible. Pas de réponse. Or nous étions sur le point d’accueillir notre petite fille en décembre.
— Ah ! Ma pauvre dame, Madame Tessier, n’est plus là depuis le 26 novembre. Elle est partie d’un seul coup, et personne ne sait pour quelle raison. Vous imaginez tous les problèmes que ça pose à la direction.
— Personne ne la remplace ?
— Si, c’est Monsieur Marquet qui a pris sa suite.
— Je peux le voir ?
— Vous pensez bien qu’il est débordé. Il faut prendre rendez-vous.
— Mais j’ai pris mon après-midi. Je ne peux pas me permettre de m’absenter tout le temps. Or vu, vos horaires, comment voulez-vous faire ?
— Je suis désolée, mais vous n’êtes pas la seule. Les dossiers s’empilent sur le bureau. »
Jeanne remarque qu’ici, les enfants sont appelés « dossiers » ! Ça veut tout dire !
« Écoutez Madame, je vous en supplie, faites quelque chose. Dites-moi, au moins quand on peut rencontrer ce M. Marquet.
— Restez là, bougez pas, je vais chercher son agenda. »
Quelques petites minutes plus tard, la haute dame au tablier coloré, revient essoufflée : « C’est que le bureau est au 1er étage, je n’arrête pas de monter et descendre, dit-elle, comme pour s’excuser.
Bon alors, il a un créneau, dans un mois et demi, le 14 février. »
Jeanne serre les dents. Un mois et demi, c’est dans l’éternité. Mais pas le choix. Je serai en vacances, pense-t-elle, pour trouver un argument qui soulage un peu. Bastien pourra peut-être venir aussi ?
— 14 février à 13 h.
— Oui, 13 h si vous voulez. Je note. Madame… ?
— Demaison. Et notre petite fille (elle se refuse à parler de dossier) s’appelle Fatou, elle devait venir du Mali.
« Tout ça pour ça, lance-t-elle à Bastien, le soir. J’ai l’impression qu’on est revenu à la case départ. Je n’en peux plus. Je me demande si un jour, on pourra être parents. »
Bastien s’approche de Jeanne. Il la prend dans ses bras. Il y avait un petit bout de temps qu’ils ne s’étaient pas touchés ainsi. Elle avait oublié la chaleur de sa peau, la force de ses mains et la petite couture, souvenir d’un ratage de lame (un comble quand même pour un coiffeur) qui lui chatouille le nez quand elle l’embrasse à l’orée de l’oreille. En fait, rien depuis « le café de la joie », en novembre.
« Ne baissons pas les bras. On y était presque. Tout a été validé. C’est un coup de malchance. Mais peut-être que le nouveau… comment s’appelle-t-il déjà ? Va reprendre “le dossier”. Allez, viens, on va ouvrir une bonne bouteille. Je viendrai avec toi. En plus c’est une jolie date le 14 février ! »
Jeanne s’abandonne ; elle veut croire en sa parole.
Alors ce soir, elle souffle sur la poussière qui commence à ensevelir ce Roi sans divertissement. Jusque-là, il lui était difficile de se concentrer, sur ces pages magnifiques et cruelles, mais petit à petit, elle se laisse gagner par l’écriture qui finit par la « divertir » de ses préoccupations.
Ce mois « du blanc » s’étire avec une infinie lenteur. C’est comme ça que petite, elle entendait sa mère évoquer janvier. Dès le début du mois, elle s’excitait à l’idée de changer les couleurs et l’odeur des draps.
Ah ! Oui, tiens je pourrais trouver des petits draps pour le berceau. Non, non, non, il ne faut plus y penser ! Et ce mois de janvier qui n’en finit pas !
Si bien que le 1er février est accueilli comme une primevère, même s’il faut attendre encore une quinzaine de jours. Alors déchiffrer ce hêtre qui s’enracine sur la première page du roman de Gionoest une vraie partie d’échecs, un plaisir d’enquêteur.
« C’est vraiment sympa ce travail de réflexion collective avec les ados, s’exclame-t-elle, dans la salle des profs à la récréation.
Son enthousiasme n’est pas accueilli avec la même ardeur, par tous.
— Mouais… Tu dois être heureuse, toi pour voir les choses comme ça, lui répond un collègue à la lippe noire de café, plus circonspect.
— C’est peut-être ça, pense-t-elle. »
Le 14 février, c’est un vendredi. Tous les deux s’habillent de frais, comme s’ils allaient à un rendez-vous d’amour.
« Faut pas trop s’emballer, freine Bastien. Ce n’est qu’un rendez-vous avec un porteur de “dossiers”.
— Peut-être, peut-être, mais laissons-nous quelques heures de légèreté.
— Tiens, tu sais quoi ? À ce propos, allons faire une petite bouffe dehors. Tu te souviens, il y a une brasserie sympa dans la rue derrière l’agence ? »
Un peu grisés par le rosé et alourdis par le burger-frites, ils sont là devant l’imposante porte en bois du majestueux immeuble haussmannien, dès 12 h 50. Elle voit son reflet dans la plaque : meilleure mine que la fois précédente.
Monsieur Marquet est en retard, mais la haute Dame au tablier coloré, les fait patienter dans cette pièce au papier peint à grosses fleurs, très années 70. Jeanne connaît chacune de ces fleurs, pour les avoir scrutées, étudiées toutes les fois qu’elle attendait Madame Tessier. Se concentrer sur elles, une fois encore. Ne pas penser. Surtout ne pas penser.
Enfin sur les coups de 13 h 20, arrive en trombe, toute porte tremblant, un jeune homme ébouriffé, essoufflé, casque à la main :
« Excusez-moi, dit-il. C’est infernal, je n’arrive pas à être à l’heure. Entrez, je vous prie. Monsieur et Madame Demaison, je présume ? »
Monsieur Marquet n’a pas encore eu le temps, sans doute, d’apposer sa griffe : le bureau porte en ses murs les mêmes grosses fleurs marron et jaunes que celles de la salle d’attente.
« Bon, alors, commence Monsieur Marquet, j’ai cru lire que vous étiez sur le point de finaliser votre “dossier” d’adoption avec la petite Fatou ». Sur le mot « Fatou », sa voix s’assombrit, s’estompe, même jusqu’à devenir presque inaudible.
Jeanne, absorbée par les motifs floraux aux grotesques inquiétants, n’y prête pas attention, Bastien plus présent, frémit :
« Oui, c’était une question de semaines, voire de jours. Et puis, plus de nouvelles.
— Oui, je sais ; j’ai appris que Madame Tessier qui s’occupait de votre affaire (tiens, il ne dit plus “dossier”) est partie précipitamment, sans donner de raison. Je viens juste de reprendre ses dossiers (Ah ! si quand même : dossier !). Et je vous avoue que je n’ai pas de bonnes nouvelles. »
Jeanne a remarqué une gargouille dans la corolle de cette fleur hypertrophiée. Autant dire qu’elle a débranché.
— C’est-à-dire ? demande Bastien, inquiet.
— C’est-à-dire, que nous avons perdu la trace de la petite Fatou. Elle était dans une pouponnière au Mali. Elle devait arriver en France, quelques jours après votre dernier rendez-vous, mais comme la personne responsable de son accueil en France n’a pas donné signe de vie, nous ignorons où se trouve l’enfant maintenant. Est-elle arrivée en France ? Est-elle restée au Mali ? Nous n’avons aucun moyen de le savoir.
« Mais après quoi je cours ? pense Jeanne, soudain tirée de son jardin vénéneux. Quelle est cette exigence impérieuse de maternité qui m’impose tant d’abnégation ? La vie ne prend-elle sens que dans un ventre plein ? Après quoi je cours ? se répète-t-elle. Quelle farce que ces moulins à vent que j’actionne à tout va, et quel divertissement ! Fatou : un divertissement ? C’est sordide, c’est moche. »
Et dans un sursaut, elle tire Bastien par la manche :
« Viens, on s’en va ! J’en ai marre. Tout cela ne sert à rien. Qu’à se faire du mal un peu plus chaque fois…
— Attendez Madame, je n’ai pas fini. Votre demande a été validée. Tout est en règle (formidable ce vocabulaire administratif : dossier, validé, règle). Je vais m’occuper de vous personnellement. Vous pouvez être optimistes. Je vous appelle dès que j’ai du nouveau. Ne désespérez pas. On y est presque. »
J’aime bien le « on », pense Jeanne.











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)