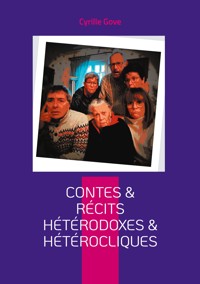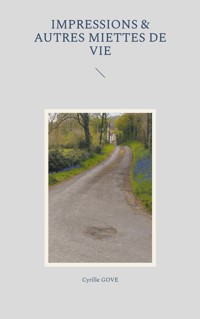Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans sa tête, en boucle, elle ne cessa plus de se répéter pendant des heures les mêmes phrases: "Ce n'est pas possible que ce soit moi... Que ce soit déjà mon tour, que je sois celle qui doit sauter dans le vide, plonger déjà, dans l'inconnu, dans la nuit, dans le plus rien du tout, moi, seule, toute seule, sans mon homme... Entourée d'étrangers."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À ma sœur Marie-France
Sommaire
ORTHOGRAPHE DE 1990
FIGURES TROUBLES
JADIS & NAGUÈRE
LE SORT DE PIERRE BIET
LES EAUX BLANCHES
SAINT-HILAIRE-DES-NOYÉS
LE LOUP
PÉRIPÉTIE
L’ESTRE DES CHAMPS
VIE & MORT D’AUGUSTA MÉZAC
LE CHOIX DE LA VIEILLE
L’ÉVADÉ
AUJOURD’HUI
L’ANTÉPOSITION HONORIFIQUE
DONATION À ILLIERS-COMBRAY
RENDEZ-VOUS
COMBATS DE MORTS
LES ABBAYES-DU-LOIR
ULTIME BÉNÉDICTION
LA GLOIRE TARDIVE D’ÉMAN MARTIN
LA VOIX
TROIS SOLITUDES
RUE DE LA PORTE-MOUTON
LA CHAMBRE
TROIS VARIATIONS SUR UN MÊME THÈME
LE TRAIN DE LA NUIT
COURTALAIN, TERMINUS
LA VIEILLE MAISON
ORTHOGRAPHE DE 1990
FIGURES TROUBLES
JADIS & NAGUÈRE
Le Sort de Pierre Biet
Les Eaux Blanches
Saint-Hilaire-des-Noyés
Le Loup
Péripétie
L’Estre des Champs
Vie et mort d’Augusta Mézac
Le Choix de la vieille
L’Évadé
AUJOURD’HUI
L’Antéposition honorifique
Donation à Illiers-Combray
Rendez-Vous
Combats de morts
Les Abbayes-du-Loir
Ultime Bénédiction
La Gloire tardive d’Éman Martin
La Voix
Trois Solitudes
Rue de la Porte-Mouton
La Chambre
TROIS VARIATIONS SUR UN MÊME THÈME
Le Train de la nuit
Courtalain, terminus
La vieille Maison
JADIS & NAGUÈRE
LE SORT DE PIERRE BIET
Il avance sur le petit chemin sableux que les herbes folles commencent à envahir.
C’est le début de la deuxième quinzaine d’aout. Il fait beau. Les grandes chaleurs, suivies des quelques pluies froides, sont oubliées les unes comme les autres. N’était la brièveté — encore relative — des jours, on aurait l’impression que l’été va recommencer et, avec lui, la douceur de vivre.
Il avance. Lui aussi est content de respirer plus tranquillement, de pouvoir prendre le temps de marcher sans chercher, pantelant, l’ombre des arbres rares. Il se sent un peu moins fatigué. S’il était sûr de ne rencontrer personne, il déboutonnerait le haut de sa soutane, tant l’envie de sentir l’air doux sur son cou est forte. Le blé, l’orge et l’avoine ont été coupés ; les petits champs à sa droite et à sa gauche se reposent. Aux Trois-Setiers, là-bas à main droite, les deux Gaspard, le père et le fils, ont déjà retourné leur terre. Une autre saison se prépare. Verra-t-il une nouvelle fois les blés murir ? La douceur de l’air et celle des couleurs, délicieusement automnales déjà, le poussent à le croire. Mais il sait, il sent, que c’est peu vraisemblable. La prière. Reste la prière : la sienne et celle des fidèles, à qui il n’a pas pu cacher son état de santé.
— Allons, maitre Biet, à votre âge, personne ne meurt ! Vous verrez que, l’hiver prochain terminé, vous renaitrez en même temps que le reste de la nature !
« À mon âge, répète-t-il pour lui… Oui, c’est vrai, après tout ! »
Pierre Biet a eu 25 ans en juin. Un bien bel anniversaire, le premier dans sa première paroisse, et une belle cérémonie : des fleurs, des mots amicaux, des enfants souriant qui ont voulu sa bénédiction et qu’il a pris plaisir à bénir.
C’est à la fin de mars qu’il a été ordonné prêtre. Ils étaient tous allongés face contre terre dans le chœur de la sombre et mystérieuse cathédrale de Chartres, éclairée de tous ces flambeaux qui ont fini par noircir une partie des vitraux, quand Monseigneur des Montiers de Mérinville leur a donné l’onction… C’est en se relevant qu’il avait senti la douleur pour la première fois. Il avait même failli pousser un cri. Pourquoi l’évêque avait-il cru bon, dans son prône interminable, d’évoquer le Roi-Soleil, mort pourtant depuis douze ans ? Pierre Biet ne s’en souvient plus. Mais la douleur, oui, il s’en souvient : elle ne l’a guère quitté depuis lors, il faut le dire. Il était arrivé à Illiers le mardi suivant, le 1er avril 1727. Exactement quatre mois et demi plus tôt. Le curé et le premier vicaire l’avaient accueilli très aimablement et il avait célébré sa première messe, une messe basse, évidemment, le même jour, à sept heures du soir. Les gens étaient venus assez nombreux, surtout des femmes, et il avait tenu, après la messe, à saluer, sur le parvis, la plupart des fidèles, plutôt surpris par son âge : de mémoire d’homme, on n’avait vu vicaire si jeune à la paroisse Saint-Jacques.
Il fait bon vivre à Illiers, se dit maitre Biet, comme il va s’assoir sur un gros caillou. Mais c’est le mot « vivre » qui, en même temps que la douleur un instant oubliée, arrête son mouvement. Certes : il fait bon vivre, reprend-il en se redressant vivement, ayant tronqué sa phrase et son geste. Mais après ? Après, regrette-t-on ce qu’on a aimé ici-bas ? Faire confiance au Très-Haut, c’est tout ; le reste viendra en sus. Le pardon. La guérison.
Le 25 juillet, à la grand-messe pour la fête de saint Jacques, à six heures et demie du matin, Pierre Biet s’était écroulé. Il avait perdu connaissance, cette fois. Passé une stupeur silencieuse de plusieurs secondes, des fidèles s’étaient précipités vers lui, suivis du premier vicaire en vêtements liturgiques : c’est à partir de ce jour-là que tout le monde avait compris que le jeune prêtre était malade, gravement sans doute. Trois hommes l’avaient déposé sur son lit étroit ; on avait attendu qu’il revienne à lui, lui faisant respirer des sels en lui maintenant la tête plus haute que le corps. « C’est depuis lors que les gens m’aiment tant. Le lendemain, la veuve du marguiller, qui avait demandé à maitre Chassériau, le curé, si elle était autorisée à me rendre visite, est venue dans ma chambre. Elle m’a demandé si je souffrais et j’ai répondu oui. Pouvait-elle faire quelque chose pour moi ? Oui : passer de l’eau sur mon visage. Elle a ôté le premier bouton de ma soutane pour ne pas la tacher, mais j’ai retenu sa main, qui était petite et fraiche ; elle m’a souri. Je n’avais plus mal ; comme un enfant réconforté, je lui ai rendu son sourire. Dieu, que cette femme a gardé un beau visage ! Avais-je le droit de le penser ? Ai-je le droit de le penser, aujourd’hui, encore ? »
Pierre Biet reprend sa marche sur le chemin sableux. D’autres pensées lui viennent, sans suite.
« Comment fera Gaspard le jeune pour s’occuper de ses terres quand son père sera mort ? Trouvera-t-il une femme pour l’aider (pour l’aimer) alors qu’il a déjà quarante ans ? Il y a encore des glaneuses aux Galernes : elles coupent les épis perdus sans un mot, les yeux rivés au sol. Un rossignol a chanté sur le rebord de ma fenêtre ce matin à l’aurore. Et la veuve du marguiller se nomme Marie, comme notre mère du Ciel : j’ai entendu sa belle-sœur l’appeler le lendemain de sa visite, devant le café Joseph. J’espère qu’elle n’a pas dans l’idée d’épouser Gaspard. Elle m’avait dit, tout doucement : " fermez les yeux, je vais mouiller un linge pour vous rafraichir le visage". Ma tête était retombée sur l’oreiller comme une masse ; elle l’avait délicatement soulevée et maintenue, faisant montre de plus de force que je n’aurais cru. Je me sentais mieux, presque bien. " Où souffrez-vous ? " Au lieu de répondre à sa question, je lui avais dit "encore, je vous prie." Et elle avait recommencé. Sa sollicitude et sa gentillesse n’ont pas de prix, comme celles, dit-on, de notre mère céleste ; je n’osais pas ouvrir les yeux car je savais son visage tout près du mien. "Encore, je vous prie." Je savais qu’elle souriait et voulait s’en cacher. »
Maitre Chassériau, le curé, lui a ordonné de se reposer. Il l’a dispensé de sa messe quotidienne, à l’exception de celle du dimanche. Il peut, s’il s’en sent capable, rendre visite à des paroissiens, ce qu’il va commencer tout de suite : au bout du chemin sableux se tient la dernière maison d’Illiers, une chaumière écartée de tout, dont le terrain descend jusqu’au Loir. Il ne se rappelle pas le nom de la famille qui y habite. Pierre Biet toque à la porte ouverte et entre. Au fond de l’unique pièce, près de la cheminée éteinte, une femme, sa grande fille et des marmots.
— Je suis la petite-nièce de Gaspard le vieux, dit la femme. Ne restez pas debout, maitre Biet, on sait bien que vous êtes souffrant !
Elle lui tend une belle tranche de pain et le pot de beurre.
— Nous avons trois vaches, ici, et un cheval. Voyez que nous ne sommes pas à plaindre.
Elle n’a pas d’âge. Sa grande fille peut avoir douze ans. Pierre Biet met un peu de beurre sur le pain, mais il sait qu’il n’aura pas assez d’appétit pour honorer l’offrande de la femme. Il se force pourtant d’une bouchée, qu’il mâche en hochant la tête et en regardant son hôtesse, comme pour remercier.
— Quel âge ont les petits ?
— Deux, trois et six ans.
— Sont-ils baptisés ?
— Point encore ; juste ondoyés. On les baptisera tous les trois à la Noëlle.
« À la Noëlle », se répète à part lui le jeune prêtre. « Y serai-je ? Oui, si Dieu veut. »
Il a l’impression que la femme a lu sa pensée. Elle dit :
— Vous verrez que vous serez rétabli pour Noël. Si c’est le cas, il faudra vous tenir bien chaudement : l’hiver est froid, à la campagne.
Pierre Biet bénit les enfants et leur mère en se remettant debout. Il demande :
— Quels sont vos voisins les plus proches ?
— Eh bien si vous pouviez longer la rive du Loir en volant par-dessus les chardons et les taillis d’églantiers, vous auriez le manoir de Mirougrain, mais ça ne compte pas, parce qu’il faudrait encore traverser le gué du Cochon — sauf votre respect — pour y accéder. Non, les plus proches de nous, ce sont les Giraud : vous savez, lui, c’est le frère du boulanger. Ensuite, en arrivant au bourg, passé le pont, vous avez à droite la veuve du marguiller, Marie Chaussat, et à gauche la vieille Victorine Proust, veuve elle aussi, évidemment, mais depuis longtemps.
Il remercie la femme. Mais son cœur a sauté quand elle a évoqué Marie Chaussat. Pourquoi ne pas lui rendre sa visite du mois dernier ? En cheminant, sans qu’il sache exactement pourquoi, il sort son bréviaire de sa poche, le garde serré dans sa main gauche et vérifie machinalement si sa soutane est bien boutonnée jusqu’en haut.
— Marie ? Marie Chaussat ? Il s’aperçoit qu’il n’a même pas utilisé une quelconque salutation ni la moindre tournure courtoise.
Un bruit ; une porte qui s’ouvre.
— Tiens ! Mais c’est mon petit vicaire ! Quelle heureuse surprise de le voir debout et vaillant !
Pierre Biet sourit, même s’il ne se sent pas réellement vaillant, et peut-être même à cause de cela.
— Il vient me faire réciter mon catéchisme ? ajoute-t-elle en montrant le bréviaire. Puis : vous ne m’avez pas dit l’autre fois où se trouve le siège de votre douleur. Savez-vous que j’ai un don de guérisseuse ?
— Je souffre des reins, d’une douleur qui peut irradier jusqu’aux genoux. Toute position, pendant les crises, m’est insupportable.
Pierre Biet se surprend lui-même : il n’a pas hésité une seconde avant de répondre à cette femme qu’il connait peu, mais pour qui il éprouve un sentiment où se mêlent la confiance et l’affection et peut-être d’autres choses qu’il ne cherche pas à définir.
— Je vais vous masser.
— Et comment cela serait-il possible ? Comment pourrais-je agréer votre offre ?
— Mon petit vicaire : d’abord, j’ai l’âge canonique puisque je viens de fêter mes quarante ans ; ensuite nous allons faire en sorte que ni la religion ni la morale n’aient quoi que ce soit à redire sur ce qui se passera. Vous vous allongerez sur la table de la petite pièce qui sert à cet usage, et je tirerai les volets, comme je fais toujours quand on vient me consulter. Moi-même je ne vous verrai pas.
— Ce n’est malheureusement pas possible ; vous voyez bien où je souffre…
— N’avez-vous pas confiance en moi ?
La voix de la veuve du marguiller est douce et apaisante comme était doux et apaisant son geste, dans sa chambre, le mois dernier. Si, il a confiance en elle. La torture physique dont le jeune homme est l’objet de plus en plus souvent lui donne une avidité de soulagement et de compassion.
Il est allongé dans l’obscurité ; la veuve du marguiller a disposé des oreillers sur la table de sorte qu’il ne souffre pas trop de la position, qui lui rappelle, mutatis mutandis, celle de son ordination. Seule la région du bas de son dos est à l’air libre. Elle lui parle :
— Je vais vous masser avec une serviette imbibée d’huile tiède. Ne craignez point…
Maitre Biet ne craint rien. La main est douce. La douleur semble s’estomper. Les minutes s’écoulent, bienheureuses, en présence de Marie Chaussat qui le soigne, dans l’obscurité de cette petite pièce où des fleurs invisibles exhalent en secret un parfum léger.
Et puis :
— J’ai trouvé le point sensible, n’est-ce pas ?
— Oui, fait-il dans une plainte.
Elle masse encore puis s’arrête.
— Levez-vous, maitre Biet, dit-elle d’une voix qu’il a du mal à reconnaitre. Elle quitte la pièce. Il se rhabille complètement et la rejoint dans la cuisine. Elle le regarde d’un drôle d’air, évitant son regard à lui.
— Merci, commence-t-il…
— Maitre Biet, lui coupe-t-elle la parole. Je ne peux rien contre ce mal-là. Sauf venir prier à l’église avec vous à chaque fois que vous direz la messe…
L’espoir qu’il avait jeté violemment dans les mains de la veuve du marguiller vient de se briser en mille morceaux. Il comprend. Il comprend ce qu’elle n’a pas dit. Il lui semble que la douleur est revenue, tellement forte qu’il aura du mal à rejoindre sa chambre.
— Combien de temps ? murmure-t-il en mettant sa main sur la clenche de la porte.
Sans un mot, elle s’approche de lui et dépose un baiser sur sa joue. Il voudrait bien… Sait-il ce qu’il voudrait ? De toute façon, il est déjà dehors. Seul absolument. Seul avec son mal. Il aimerait savoir que Marie, par la fenêtre, le regarde cheminer ; de peur d’être déçu, il ne se retourne pas.
« Encore, je vous prie ». Mais Marie n’est pas revenue à son chevet.
— Mes bien chers frères. Je ne monterai pas en chaire, en ce dimanche 28 septembre de mon premier automne à la paroisse Saint-Jacques. Mon état de santé ne me le permet pas encore. Mais votre prière a fait (et fait encore) merveille auprès de la miséricorde divine ; je sais l’amitié que vous m’avez toujours portée et j’en rends grâce quotidiennement au Très-Haut, le suppliant de vous combler à votre tour…
Marie Chaussat est là, parmi beaucoup d’autres fidèles. Mais il ne retrouve pas sur son visage ses traits habituels, qu’il aime tant. Elle lui parait austère, presque lointaine, au milieu de l’allégresse générale. Oui. Les paroissiens l’aiment comme ils n’ont jamais aimé un prêtre jusqu’à cette heure…
— Il y a 15 jours, je ne pouvais plus bouger ; regardez : je peux aujourd’hui célébrer la sainte messe sans presque avoir besoin de m’assoir !
« Marie Chaussat, pourquoi ne souris-tu pas avec les autres ? Pourquoi tes yeux sont-ils rougis ? N’es-tu pas heureuse de me voir en cet état, presque guéri ? »
— Quel jour est-ce, je vous prie ? demande-t-il dans un souffle.
— Mercredi. Mercredi 8 octobre.
— Depuis quand ai-je perdu connaissance ? Qui êtes-vous ?
— Je suis Marie ; vous ne me remettez donc pas ? Ne vous agitez pas. Vous êtes tombé le lendemain de votre messe, le 29 septembre. De grâce, restez tranquille. Les fidèles vous avaient applaudi, quand vous êtes venu les bénir sur le parvis…
« Oui, Marie. À présent je reconnais ton visage. Ton beau visage. Suis-je si mal en point pour que tu me souries ainsi sans en avoir envie, sans me quitter des yeux ? Je n’ai pas la force de lever le bras. Je voudrais tant caresser sa joue… Non, pas déjà ! Encore, je Vous prie… »
Dans l’église Saint-Jacques d’Illiers (actuellement Illiers-Combray), il ne reste qu’une seule dalle funéraire, ce qui n’est pas fréquent, à droite en entrant. Humble (sur le seuil) et émouvante à force d’être précise. On peut y lire :
CY GIST ET REPOSE LE CORPS DE MAITRE PIERRE BIET PRESTRE ET VICAIRE DE CETTE EGLISE ET QUI FUT ORDONNE PRESTRE LE XXIX MARS MDCCXXVII ET DECEDA LE VIII OCTOBRE DE LA MESME ANNEE AGE DE XXV ANS ET IIII MOIS. UN DE PROFUNDIS.
LES EAUX BLANCHES
Quand on descend puis remonte de Brunelles vers La Gaudaine par la Petite Vallée, on ne peut pas manquer, à la croisée de la grand-route de Nogent, de traverser un lieudit bizarrement dénommé les Eaux Blanches. Les Eaux Blanches, me direz-vous, un nom plutôt banal. Non pas : je n’ai pas dit « les Eaux Claires » ni les « Eaux Pures », pas plus que « les Eaux Transparentes » ; j’ai dit les Eaux Blanches et vous allez comprendre le pourquoi et le comment de l’origine de ce nom.
Voici toute l’affaire. C’était l’année de la folie du roi Charles, l’an 1392, pour être précis. Le roi était en route punitive pour la Bretagne, où le duc cachait le félon Pierre de Craon qui s’y était réfugié après avoir voulu assassiner le connétable de France. L’armée était passée par Chartres pour que le roi y recommande sa santé fragile à Notre Dame, puis par Illiers, et naturellement, se trouvait sur le chemin de Thiron à Nogent. C’était l’été, comme il se devait pour guerroyer à l’aise, et cet été-là était chaud. Le convoi s’étirait mais les chevaliers de queue ne perdaient pas de vue ceux de tête, de l’entourage du roi. Au reste, ce dernier n’était toujours pas au mieux de sa forme : voilà bien des jours, en effet, qu’on le trouvait dolent et qu’il avait tendance à déparler, et plus d’un parmi ses proches lui avait respectueusement conseillé de rester bien abrité du soleil plutôt que de se mettre en campagne.
À deux lieues environ devant Nogent, Charles VI, que l’on sentait fiévreux, voulut s’arrêter pour boire au gué d’un ruisseau, qu’aux dires d’un couple de paysans de la ferme voisine de Souainzay, on nommait le ru de Larsis (ce qui ne peut manquer d’être l’Arcisses actuel, à côté du hameau de Souazé, et le gué du ruisseau, les Eaux Blanches d’aujourd’hui). Le roi, sans descendre de cheval, se fit apporter de l’eau de l’Arcisses et en but et sembla aussitôt se porter beaucoup mieux : il descendit même de son cheval, s’agenouilla et, se frottant le visage à l’eau fraiche, en but encore, se redressa et sourit avec une satisfaction et un air de santé qu’on ne lui avait point vu depuis des semaines au moins. Ordre fut aussitôt donné de remplir gourdes et outres du précieux liquide afin qu’on n’en perdît goutte pour les besoins du voyage ; après quoi le cortège se remit en route pour Nogent et, de là, pour Le Mans.
Mais l’eau du ru, bien qu’on l’eût gardée à l’usage exclusif du roi, finit par s’épuiser. Bien avant l’arrivée au Mans, il n’en restait plus. Et c’est justement au sortir de cette ville (où l’on trouva à nouveau Charles VI tourblé & desvoyé — entendons par là sensiblement perturbé), que se produisit le drame. C’était le 5 aout. Il faisait de plus en plus chaud. La troupe, ayant quitté la ville sous le soleil, entrait à présent dans la forêt. Un vieillard hirsute, jaillissant tout à coup on ne sait d’où, arrêta le cheval du roi et lui déclara d’une voix forte qu’il était trahi et qu’il devait faire demi-tour… Charles VI, amolli et impressionné, se remit en route quand on eut écarté le manant, cuva sa stupeur quelques minutes, puis commença l’effroyable crise de folie furieuse qui le rendit tristement célèbre, assénant des coups d’épée à son entourage qu’il ne reconnaissait plus. On dut l’attacher sur un charriot, le ramener à la ville et s’attendre au pire.
Mais Charles VI ne mourut pas ; il ne mit même que quelques jours à récupérer de ce premier accès, qui, pour être le plus bref, ne fut malheureusement pas le dernier : les crises, en effet, se répétèrent, de plus en plus longues, de plus en plus fréquentes. Curieusement, et en dépit des catastrophes que l’état du roi causait au pays, le peuple le prit en pitié et l’aima davantage à cause de sa grande faiblesse.
Le 27 juillet 1397, Charles VI sentit encore une nouvelle crise approcher : ce n’était hélas pas la première de l’année ; cette fois, c’est lui-même qui demanda qu’on l’enfermât dans la pièce de son Hôtel Saint-Pol de Paris, laquelle pièce, au fil des mois, avait fini par jouer le rôle de cellule en pareille occurrence. Au moment où on l’y conduisait, il s’écria soudain :
— L’eau du ru !
Louis d’Orléans, son frère cadet, qui avait failli être estourbi cinq ans plus tôt au Mans lors de la première crise, se souvint du grand bienêtre que l’eau d’un certain ruisseau avait apporté au souverain, mais trop peu précisément de l’endroit, que, vu la gravité des évènements qui avaient suivi, on avait eu tendance à oublier depuis lors. Une fois le roi soigneusement enfermé, Louis d’Orléans, manda ses oncles et quelques grands du royaume pour leur rappeler la chose. Deux chevaliers évoquèrent aussitôt le nom de Souainzay ainsi que celui du ruisseau de Larsis. Il fut immédiatement décidé qu’on partirait sans perdre plus de temps retrouver l’endroit pour y puiser l’eau salvatrice en abondance ; Louis d’Orléans se chargea lui-même de l’affaire. Le lendemain, il voulut, avant de se mettre en route sous discrète escorte, avertir le roi de la bonne nouvelle, mais celui-ci, déjà retombé en folle agitation, ne reconnut même pas son jeune frère et ne sut évidemment pas prêter le moindre entendement à ce qu’on lui conta, tout occupé qu’il était à mettre en pièces les deux dernières chaises qui restaient dans sa cellule… Tout un chacun, bien sûr, portait grand espoir en l’expédition, tant ceux qui y participèrent que ceux qui restaient à Paris.
Alors que commençait la grande descente des Sablons dont le point le plus bas est le gué sur l’Arcisses, aujourd’hui couvert d’un petit pont, le charriot qui transportait les tonneaux, bien que vides encore, cassa sa roue avant gauche. Des hommes retournèrent en hâte à Thiron pour y quérir un artisan, tandis que Louis d’Orléans poursuivait son chemin, accompagné de trois autres chevaliers. Il n’était que six heures du soir au soleil lorsqu’ils mirent pied à terre et constatèrent avec soulagement que le ruisseau n’était pas tari, car il faisait plus chaud encore cette année-là que cinq ans auparavant. Un des chevaliers, celui-là même qui avait naguère empli la gourde du roi, en souvenir de l’épisode d’alors répéta son geste et offrit à boire à Louis d’Orléans qui se trouvait être le plus haut personnage présent en l’absence du petit dauphin Charles qui, âgé de cinq ans, n’était évidemment pas du voyage. Mais le prince déclina l’offre en disant :
— Mille mercis, messire, mais je ne suis pas… Il hésita, mal à l’aise sur ce qu’il s’apprêtait sans doute à dire, et finit sa phrase ainsi : je ne suis pas le roi…
Le chevalier, ayant compris ce que le prince avait dit et sans doute aussi ce qu’il avait manqué dire, reversa l’eau de la gourde dans le ru et à la stupeur de tous les quatre, elle s’écoula sans la moindre transparence, blanche de couleur, assez semblable à du lait ; comme le ruisseau coulait clair et frais et transparent dans son lit, on pensa un instant que le récipient était sale ; les hommes s’agenouillèrent, rincèrent soigneusement chacun le sien, puis les remplirent en léger amont du lieu de rinçage : or l’eau, s’échappant de chacune des gourdes, coula à nouveau blanche et opaque.
Les quatre hommes suivirent l’amont du ruisseau jusqu’à La Gaudaine, renouvelant plusieurs fois la tentative avec à chaque fois le même résultat. Au prieuré, les frères lais, qui réparaient en silence et avec une lente application le linteau du portail de leur église, leur dirent qu’ils ne descendaient plus de longue date chercher leur eau au gué de la route de Nogent attendu qu’ils avaient un puits, un peu plus bas, à la ferme forte du hameau de la Fontaine aux Bordiers, qui leur appartenait. Les plus vieux d’entre eux exposèrent qu’ils avaient ouï causer d’un antique pèlerinage à l’endroit du gué où, au jour le plus long de l’année, on priait saint Méen, patron et guérisseur des fous et des ensorcelés, mais que saint Marcoul, vénéré ici au prieuré de toute éternité et qui guérissait des écrouelles, avait heureusement supplanté l’autre dans les dévotions locales.
Le surlendemain, le charriot arriva, réparé ; le charron faisait partie du cortège car on lui avait promis une belle récompense. Louis d’Orléans le remercia grandement pour sa rapidité et la qualité de son entreprise et lui fit donner deux pièces d’or. Comme l’homme baisait la main du prince, celui-ci fit signe qu’on lui remplisse une gourde du ru. Le charron, portant l’eau à sa bouche, recracha aussitôt un liquide blanchâtre, frotta ses lèvres et dit en manière d’excuse :