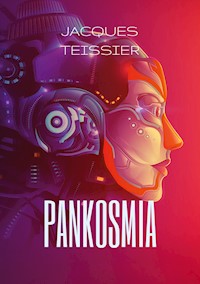Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Julia, artiste plasticienne renommée, vit en recluse depuis douze ans en recluse à Clairbrume, au coeur des Cévennes, et partage sa vie entre ses deux passions, la sculpture et les araignées. Sa virtuosité à associer étrangement les toiles de « ses filles » et ses oeuvres, lui confère une place unique dans le monde de l'art. Miguel est meilleur joueur d'échecs de sa génération. Ancien Champion du monde, admiré ou haï par ses pairs, il est recherché par toutes les polices, que vient-il faire chez Julia ? Ana, journaliste échiquéenne et ex-compagne de Miguel, rejoint elle aussi Clairbrume. Pourquoi trouve-t-elle la maison déserte ? Alors qu'elle commence à percer les secrets du passé, le danger rôde autour d'elle. La découverte de la vérité aura pour Ana des conséquences terrifiantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2 : JULIA
Chapitre 3 : MIGUEL
Chapitre 4 : JULIA
Chapitre 5 : MIGUEL
Chapitre 6
Chapitre 7 : JULIA
Chapitre 8 : MIGUEL
Chapitre 9 : JULIA
Chapitre 10 : MIGUEL
Chapitre 11
Chapitre 12 : JULIA
Chapitre 13 : MIGUEL
Chapitre 14 : JULIA
Chapitre 15 : MIGUEL
Chapitre 16
Chapitre 17 : MIGUEL
Chapitre 18 : JULIA
Chapitre 19 : MIGUEL
Chapitre 20 : JULIA
Chapitre 21
Chapitre 22 : MIGUEL
Chapitre 23 : JULIA
Chapitre 24 : MIGUEL
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
1
Dans l’étroit sentier parsemé de pierres qui roulaient sous ses pieds, Ana trébucha deux fois. Manque de visibilité, la nuit arrivait et ça n’allait pas s’arranger. Normalement, Clairbrume devrait être proche, peut-être un kilomètre selon son évaluation sommaire. Le seul problème se situait à l‘embranchement où elle avait laissé sa voiture, elle n’était pas certaine d’avoir choisi la bonne direction. Ana pesta un peu contre Ludeck, mais elle en voulait surtout à elle-même d’avoir suivi son conseil. Il craignait que les flics ne l’aient placée sur écoute, et sur sa demande insistante elle avait fini par laisser son iPhone chez elle, alors qu’elle aurait très bien pu l’utiliser. Il lui aurait suffi d’éviter toute parole compromettante et ce soir, elle aurait pu repérer son chemin sur une appli de randonnées, au lieu de se fier aux indications données par la vieille femme qui l’avait obligeamment renseignée à Albarat, une heure plus tôt.
Un autre embranchement. Elle se souvint qu’il fallait prendre le chemin de droite, celui qui démarrait par une pente raide et traversait un bois de châtaigniers. La femme avait achevé son explication par ces mots : « Il vous faudra être en forme, ça grimpe dur. Mais bon, vous êtes jeune ! »
Certes, sa jeunesse pourrait lui permettre de passer une nuit à la belle étoile si elle s’égarait, mais elle se sentait tout de même éreintée par les 1700 kilomètres de route qu’elle venait d’avaler en deux jours, depuis Lisbonne jusqu’à ce coin paumé des Cévennes. Sans compter un manque de sommeil récurrent depuis une semaine.
Vingt minutes plus tard, à la sortie d’un tournant, une bâtisse massive se dressa devant elle. Elle masquait plusieurs corps de bâtiments qu’elle commença à découvrir en s’avançant sur une large terrasse recouverte de dalles de schiste irrégulières. Elle sut qu’elle était arrivée. La nuit s’était maintenant installée, aucune lueur ne sortait de la maison. Elle frappa sur la porte, puis le volet, et appela plusieurs fois. Comme elle s’y attendait, elle n’eut aucune réponse. Elle se décida à actionner en douceur le pêne de l’ouverture principale qui s’entrebâilla sans difficulté, trouva plutôt étrange pour une maison vide d’occupants de n’être pas fermée à clé. Elle ouvrit en grand et les gonds grincèrent dans un decrescendo plaintif. Ana tâtonna, ne parvint pas à repérer l’interrupteur et laissa la porte ouverte pour profiter de la lumière de la lune.
Elle se trouvait dans la pièce aux statues décrite par Miguel dans l’unique lettre envoyée à Ludeck. Les statues étaient bien là. Elles sont toujours immobiles, pensa-t-elle, comme si elle s’était attendue à les voir brusquement bouger. Les toiles d’araignées étaient là elles aussi, qui les enveloppaient entièrement. Pour ce qu’elle pouvait observer dans cette semiobscurité, aucune déchirure ne les déparait, aucune poussière n’alourdissait leurs voiles. Elle se dirigea vers un étroit escalier en bois. Dans la pénombre, elle repéra un interrupteur fixé contre le poteau d’angle – un endroit improbable – et l’actionna, puis monta les marches grinçantes en essayant d’atténuer le bruit de ses pas. Sur le palier, quatre portes se répartissaient sur la longueur du couloir. Ana ouvrit la plus proche et entra dans une chambre minuscule. Un lit étroit, une petite armoire, une table et une chaise constituaient tout le mobilier. Elle s’écroula sur le lit sans même le défaire, n’aspirant plus qu’à dormir, dormir encore… et rêver, peut-être.
Il faisait encore nuit quand elle s’éveilla brusquement. Une ombre furtive se glissait hors de la chambre et refermait la porte doucement, sans la faire grincer. Un homme ou une femme ? Après un instant de saisissement, elle se leva, quitta la pièce et arriva sur le palier. Trop tard. L’apparition avait eu le temps de descendre l’escalier, sortir de la maison et se fondre dans la nuit. Elle se rallongea sur le lit, ne put se rendormir et resta immobile en pensant à Miguel, à Ludeck, à Gotschal. Dans un interminable ressassement, elle revivait sans cesse la même histoire depuis plusieurs mois, essayant toujours d’évaluer sa part de responsabilité dans le drame qui s’était déroulé. Elle ne s’en inquiéta pas, elle savait que son questionnement nocturne serait, comme toujours, gommé par la clarté du jour.
L’aube arriva. Ana était toujours allongée sur le dos et parfaitement éveillée lorsque le premier rayon de soleil apparut à travers un orifice du volet. Sa décision était prise : elle ne partirait pas avant d’avoir retrouvé la trace de Miguel. Elle sortit de la maison, s’éloigna d’une dizaine de mètres, arriva jusqu’au muret marquant l’extrémité de la terrasse, et compara ce qu’elle observait avec la description de la lettre. Elle énuméra à voix haute les éléments indiqués : la treille, le banc de pierre, le grand châtaignier dominant l’ancienne bergerie, la vigne vierge qui s’accrochait aux murs par larges plaques dentelées… Tout paraissait concorder, et pourtant quelque chose manquait. Les hauts murs de la maison vide semblaient appeler Julia.
Ana ne connaissait d’elle que ce que Miguel avait écrit à Ludeck, à vrai dire peu de choses. Elle ignorait tout des raisons qui l’avaient poussée à vivre comme une recluse dans cet endroit sauvage. Était-elle partie avec Miguel ? Dans ce cas, pourquoi avoir laissé la maison ouverte en son absence ?
Le soleil rendait le lieu moins inquiétant que la veille, Ana finit par se persuader que la visite de la nuit n’était qu’un rêve provoqué par la fatigue du trajet et le malaise que suscitait chez elle cette maison trop isolée. Elle se dirigea vers un bâtiment voisin, sans doute l’ancienne bergerie où devaient se trouver les araignées de Julia. La porte était fermée à clé. Elle n’insista pas. De toute façon, ce genre de bestioles l’angoissait. Avant de chercher les indices éventuels qui pourraient la mettre sur la piste de Miguel, elle devait se rendre au village. Elle avait besoin de ravitaillement.
Le ciel commença à se couvrir de nuages, puis devint uniformément gris et triste. En empruntant le sentier pour la deuxième fois, elle découvrit ce qu’elle n’avait vu la nuit dernière qu’à la seule clarté de la lune. Elle avait mal perçu la végétation envahissante, presque étouffante, cette vie foisonnante excessive : trop d’arbres, trop de rapaces, de rongeurs, d’insectes, trop de hululements, de bruissements, de chuintements, de sifflements dans les branches, de craquements sourds sous ses pieds pendant sa marche, et surtout aucune présence humaine proche. La campagne de son enfance était sage, domestiquée, humanisée. Rien de tel ici. Dès que l’on s’éloignait de la maison, la seule trace humaine visible était celle du sentier qui se dirigeait par mille détours abrupts et apparemment inutiles vers la petite route communale le plus souvent déserte.
L’arrivée à la voiture fut un soulagement. Elle se retrouvait dans un cocon, un endroit vivable et humain, presque chez elle, il lui fut même possible d’écouter sur la station radio Antena 3 les deux artistes portugais Boss AC et Valete, qu’elle appréciait particulièrement ces derniers temps. Les vitres closes et la musique la préservaient des bruits extérieurs et la coupaient de ce monde qui n’était pas le sien.
Après une longue descente et un virage très sec vers la gauche, Albarat apparut en contrebas, avec le clocher de son église et ses maisons alignées sur le cours de la rivière, en une longue rue en enfilade sans âme et sans caractère. Aucun bistrot dans cette rue principale, c’était un bon révélateur de la décrépitude du lieu. Un seul magasin avait résisté à l’exode rural, à la fois épicerie, dépôt de pain et de journaux, il devait être le véritable cœur du village. Sur l’enseigne, à côté du mot Alimentation, le nom de Joseph Calment se détachait en lettres noires et en italique sur un fond jaunâtre délavé.
Joseph Calment était un petit homme gras et chauve, dont le regard et le sourire semblaient naturellement bienveillants. Il était visiblement heureux de voir dans son magasin une tête nouvelle. Tout en cherchant dans les rayonnages, Ana tenta de glaner quelques renseignements sur Julia Bourgeais. Il prétendit être la seule personne du secteur à la voir régulièrement, mais en dehors de sa réputation de sculptrice renommée, il savait en réalité peu de choses d'elle. Julia évitait au maximum tout contact avec les habitants, ne descendait au village que pour passer une commande, ne s’y arrêtait que le strict temps nécessaire, parlait peu et jamais d’elle-même. Une fois par mois, Joseph montait à Clairbrume pour livrer les produits commandés. Récemment, il avait appris que les gendarmes étaient venus chez Julia. Ils semblaient chercher deux personnes disparues, mais Joseph ne savait pas qui étaient ces personnes. Midi-Libre n’en avait même pas parlé, ce n’étaient peut-être que des racontars.
Ana effectua deux allers-retours entre sa voiture et Clairbrume avec ses deux cartons remplis de victuailles. Elle déposa les courses sur la table de la terrasse, répugnant à occuper trop ostensiblement l’intérieur de la maison en l’absence de la propriétaire. La pensée que Julia pourrait arriver à tout moment et découvrir qu’elle squattait la mettait mal à l’aise. Elle décida de dormir dans la petite chambre et de manger dehors tant qu’il ne pleuvrait pas. Un demi-squat, en somme. Elle s’assit sur la table face à la vallée, avala distraitement une barquette de taboulé oriental mélangé à une boîte de thon à l’huile d’olive, et termina son repas par un yaourt de brebis à la vanille et une orange. Pas de café, elle avait oublié d’en acheter.
Le repas achevé, Ana revint dans la chambre où elle avait dormi. Sur le lit encore défait, plusieurs feuilles manuscrites avaient été déposées et soigneusement rangées pendant sa brève absence. Elle eut la sensation désagréable d’être observée, épiée, sans savoir par qui ni pourquoi. Si c’était Julia, pour quelle raison ne se montrait-elle pas ? Et si ce n’était pas Julia, alors… qui ?
L’écriture sur la première page était élégante et sans ratures. Deux formats différents constituaient les feuillets, et un coup d’œil rapide lui permit de distinguer deux récits entremêlés, l’un rédigé sur des feuilles de format A4, l’autre sur du papier de taille plus réduite provenant d’un cahier. En lettres majuscules, les noms de Julia pour le premier, et Miguel pour le suivant, avaient été visiblement rajoutés après coup.
Ana s’installa sur le lit, posa les feuillets sur sa droite et commença la lecture.
2
JULIA
Depuis plusieurs mois, la simple idée de me remettre à écrire était comme une brûlure de l’âme. Je devinais que des souvenirs non désirés s’infiltreraient dans ma tête, envahiraient mes pensées, prendraient possession de mon corps et finiraient par dominer ma volonté. Ce matin, tout a changé. Même s’il subsiste encore une certaine crainte, j’ai l’intuition qu’un élément nouveau va émerger de ce long silence cicatriciel. Comme la sculpture, l’écriture peut redevenir une fenêtre de créativité qui me permettra d’écarter ce que je cherche à fuir.
Les volets de ma chambre sont encore clos. Quand je les ouvrirai tout à l’heure, le ciel sera déjà bleu, et ce bleu va s’approfondir au lever du soleil pour créer une rupture avec le chatoiement des multiples tons verts de la forêt. Un ciel bleu, sans nuages, n’est jamais apaisant. C’est une maison sans toit, un lit sans couverture sous laquelle on peut se glisser et se cacher. Contrairement à la nuit, un ciel bleu est capable d’exposer un corps difforme et dénudé à toutes les ironies, à toutes les moqueries, alors que la nuit le protégerait tout comme un matin de décembre embrumé, percé par une bruine déposant sur le corps sa pellicule fine et douce, enveloppe purificatrice qui rendrait ses contours incertains et flous.
Oui, décidément, je préfère l’hiver à l’été, la nuit au jour, et plus encore une brumeuse nuit d’hiver à une sèche journée d’été écrasée par le soleil. C’est pourtant une telle journée qui s’annonce, une de plus, alors que je viens à peine de terminer ma toilette dans la salle de bains sommaire aux pierres de granit apparentes jointoyées avec un ciment gris grossièrement appliqué.
Bientôt, j’irai préparer le petit-déjeuner, que je prendrai sous la treille, à quelques pas de la maison. Après, je m’assiérai sur le banc de pierre, à côté du puits, et déposerai quelques céréales sur la margelle. J’attendrai un instant les oiseaux, ils ne tarderont pas à m’entourer avant d’aller picorer et entreprendre d’incessants allers-retours entre le puits et la treille.
Ensuite, je passerai une seconde fois dans la grande salle, déjà percée par le premier soleil du matin traversant les volets fatigués et toujours clos. Je me recueillerai devant les statues à la recherche du silence méditatif qui m’apportera la sérénité douce et calme à laquelle j’aspire, mais que je parviens rarement à conserver. Puis je retournerai sous la treille chercher le plateau, où seront posées, toujours aux mêmes places, la tasse, la cuillère, la théière. Ce cérémonial quotidien est nécessaire à ma survie à Clairbrume, il me permet d’assumer ma solitude. Ces gestes ordinaires et répétés sont des repères qui m’accrochent à un réel toujours plus évanescent et fragile, ils me permettent de le côtoyer sans peur.
Quand j’aurai déposé le plateau dans la cuisine, il sera six heures trente. Je me couche tard pour mieux profiter de la nuit, et me lève tôt le matin, mes insomnies sont toujours victorieuses… Après la brève vaisselle, je sortirai pour m’occuper du jardin. Je sarclerai et désherberai la partie que je n’ai pas terminée hier, puis j’arroserai minutieusement en prenant tout le temps nécessaire.
Il fera déjà chaud et pourtant le soleil sera encore près de l’horizon. S’il n’est pas tout à fait huit heures, je me laverai encore le visage et les mains. Il ne faut pas sortir avant ni après le moment prévu. Ce n’est pas que je sois maniaque, ce n’est pas non plus de la superstition, ni même un fétichisme de l’heure, mais il est si important de s’en tenir à ce qui a été décidé, de ne confier au hasard que la plus petite part possible… D’ailleurs, maîtriser l’heure, c’est dominer le flux du temps, ce temps qui est mon adversaire le plus impitoyable.
Le goût de l’exactitude, je l’avais déjà quand j’étais enfant, en tout cas il me semble, car je n’ai que peu de souvenirs de cette époque. Ils restent le plus souvent enfouis, refusent d’émerger, s’enfoncent dans un trou noir où je suis tentée de me perdre tout entière, tournoyant et tombant sans jamais atteindre le fond ; parfois l’un d’eux surgit, semblable à un voile qu’il ne faut pas soulever sous peine de laisser émerger des remugles fangeux, des exhalaisons putrides… À quoi bon ? Je sais que j’ai besoin de me créer une protection, et que seul le présent peut me l’accorder avec son ordre méticuleux et son rituel immuable. Dans l’idéal il faudrait que rien ne change, que demain soit comme aujourd’hui, que je retrouve les mêmes parfums, les mêmes rythmes cotonneux des différents éléments de la nature, les mêmes bruits assourdis et lointains. Tant que je ne bougerai pas, je me sentirai à l’abri, mais cet ordre ne doit pas être dérangé.
Après avoir terminé ma toilette, j’irai retrouver les araignées. Mes filles. La pièce restera dans la pénombre, car la plupart d’entre elles préfèrent l’obscurité à la lumière vive. Je déposerai quelques insectes, des mouches, des blattes, des criquets, pris dans les pièges pendant la nuit. Quand ma vue se sera adaptée à la semi-obscurité, je resterai accroupie, attentive à leur moindre mouvement. Sur l’épais cahier cartonné, je noterai les observations intéressantes, et si rien ne me semble passionnant, je me contenterai de les regarder. Car il y a tant de choses à voir ! Depuis la Cladomelea, qui laisse pendre de sa filière un fil terminé par une boule visqueuse et s’en sert pour attraper au passage un mille-pattes ondoyant, jusqu’à la Menneus, laissant tomber sa toile élastique sur une blatte aux mouvements trop lents qui va s’y engluer, en passant par mes préférées, les mygales Atypus, qui paraissent si bien me connaître, parfois cachées dans leur tube-piège posé sur le sol et s’apprêtant à saisir au passage à travers les parois soyeuses et fines un insecte qui oserait s’aventurer près d’elles. Je triche avec elles en déposant directement sur leur repaire des criquets, des mantes religieuses, et même un jour un minuscule souriceau, et c’est grâce à ces gestes qu’elles se sont peu à peu apprivoisées. Comme tous les jours, j’aurai du mal à me libérer de leur emprise, mais je sortirai tout de même à dix heures de la bergerie spécialement aménagée pour elles, éblouie par la lumière vive.
Et je retrouverai mon atelier, le seul endroit où le temps ne passe pas, où je ne le mesure pas. J’y créerai des formes nouvelles, imaginerai des êtres et des corps qui n’existent nulle part ailleurs. Ils vont se modifier de façon imprévue lorsque je commencerai à les façonner, à reprendre la première esquisse, à les affiner, les peaufiner, les détruire partiellement ou totalement pour chercher une autre piste. J’aime ces moments où une idée émerge, avant de partir dans une direction nouvelle pour donner naissance à une création impossible qui me surprendra en modifiant, même imperceptiblement, ma façon de voir le monde.
La journée s’achève bientôt, scandée comme toujours par des tâches programmées. Aujourd’hui comme hier, demain comme aujourd’hui, plus rien ne bouge, ne change, ne se transforme, la maison reste figée dans son attente tranquille, aucun souffle ne la modifie, ma peau reste aussi lisse et mes yeux aussi clairs, les statues sont là pour figer le temps. Et pourtant…
Pourtant, aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres : l’ordre monotone et rassurant s’apprête à être brisé à nouveau. Je sais bien que ma solitude voulue, toutes ces semaines passées sans voir un seul visage, tous ces mots absents de mes lèvres et toujours si présents dans mes rêves favorisent l’émergence de cette intuition. N’ayant personne à qui parler et ne le désirant pas, je reste à l’écoute des pulsations intimes de mon corps, des cheminements tortueux de mon esprit, et j’ai acquis la conviction qu’à travers eux c’est la nature qui s’exprime dans ce qu’elle a de plus profond, de plus cosmique. Mais je n’ai jamais eu cette naïveté heureuse qui rend la vie facile à accepter, je sais aussi que certaines de mes prémonitions ne se réaliseront pas et seront vite effacées de ma mémoire. Malgré cela, il me plaît de faire semblant.
Faire semblant, c’est toute ma vie. Depuis longtemps je m’invente des histoires, je vis en elles jusque dans leurs moindres recoins, cherchant avec minutie le plus petit détail qui fera vrai au point de rendre fade ma réalité quotidienne. Au fil des jours, elles accompagnent chacun de mes gestes et finissent par avoir une vie autonome, une logique propre échappant à ma volonté. Après être arrivées à maturité, elles finissent par mourir de façon naturelle, leur réalité se dilue, elles deviennent fantomatiques et s’éloignent dans la brume de mes souvenirs comme des spectres décharnés. Il ne reste plus, au bout de quelques semaines, que des lambeaux qui se mélangent à d’autres, plus anciens, que j’essaie malgré tout d’entretenir pour les intégrer, le moment venu, à une histoire nouvelle…
Il est bientôt dix-neuf heures. Par la fenêtre de la chambre, je le vois s’approcher. Il est sur le sentier qui mène à la Jasse du Grand Ravin. Une autre épreuve se prépare et je dois la surmonter. Si tout va bien j’en sortirai plus forte, plus sereine. Il s’approche, mais il est encore trop éloigné pour que je puisse distinguer son visage, qui semble d’ailleurs à moitié masqué par un feutre sombre. Son sac à dos rouge sang accroche les rayons du soleil déclinant et marque de son empreinte le carré verdoyant du pré submergé d’herbes folles.
Je n’ai pas peur. Je vais dans le jardin attendre son arrivée.
3
MIGUEL
Je peux me reposer enfin ! La chambre dans laquelle Julia m’a installé est presque entièrement blanche, des murs au plafond et jusqu’au placard mural, en passant par la petite table peinte dans l’angle opposé à la porte. Seule l’armoire en noyer échappe à ce désastre lacté. Quand j’ai ouvert ses portes pour y placer le contenu de mon sac à dos, un parfum de lavande doux et tenace s’en est échappé. Cette odeur imprègne encore la pièce au moment où j’écris ces mots, et je me demande si par son alchimie diffuse et subtile elle pourra influer sur mon écriture au cours des prochaines journées. Cela n’a d’ailleurs aucune importance, la seule question à me poser étant : pour qui dois-je écrire ce journal ? Pas pour moi, c’est certain. D’abord parce que mon espérance de vie est trop réduite pour pouvoir espérer le lire dans quelques années. Et même si ce n’était pas le cas, ma capacité à mémoriser pendant plusieurs décennies la moindre discussion, chaque évènement vécu ou tout ce que je lis rend inutile toute prise de notes ayant pour but de stimuler mes souvenirs. En bref, je ne sais pas pourquoi ni pour qui j’écris, mais je le fais quand même, et cet acte dérisoire qui pourrait être jugé absurde à l’aune de mon passé jette une lumière cruelle et impitoyable sur le désastre qu’a été ma vie.
Il y a deux heures, le soleil se rapprochait de l’horizon quand j’ai aperçu la maison. Camouflé par le feuillage touffu d’un laurier-amande, je sais en observant les lieux que je me trouve près de mon but. La lettre de Karen que Ludeck m’a confiée au moment de mon départ est pliée en huit dans la poche de ma chemise. Elle me donne une explication détaillée du chemin à prendre et une description précise du lieu. Tout concorde. Inutile de la relire, je la connais par cœur.
Le jardin est situé en contrebas, à une centaine de mètres au-dessous de l’ancienne ferme, un chemin large et sinueux relie les deux endroits. J’aperçois une femme en train de sarcler un potager. Une ample chemise bleue flotte autour de sa longue jupe grise, d’ailleurs tout paraît flotter chez elle, la jupe, la chemise, ainsi que sa chevelure noire qui ondoie librement sur ses épaules, sans attache. Ce n’est pas la meilleure façon de s’habiller pour travailler la terre. Il est vrai que je ne connais rien au jardinage. C’est une activité qui m’est si étrangère qu’elle n’aura aucune chance de me rattraper un jour !
Je m’accroupis pour éviter d’être repéré. Ma jambe droite commence à s’ankyloser. La fatigue de ces huit jours de marche se fait sentir. Je m’approche de la femme avec précaution. Je dois lui inspirer confiance, et pour y parvenir il me faut être vigilant.
Elle lève la tête vers moi, je la salue et nos regards se croisent. Impassible, elle ne manifeste aucune inquiétude. Compte tenu de l’isolement du lieu et de mon aspect plutôt patibulaire – barbe en broussaille, chapeau crasseux délavé par le soleil, chemise imprégnée de sueur –, cette absence de crainte est un élément favorable, mais je dois tout de même atténuer par mes premières paroles ce que mon allure peut avoir de malsain et de louche. Pendant la fin du trajet, j’ai réfléchi à l’abord qui conviendrait le mieux sans rien trouver de convaincant, et ma conclusion a été d’attendre et voir, jauger ses réactions et improviser. Puisque je transpire comme une outre percée, l’entrée en matière est tout indiquée.
— Je viens de faire un long chemin à pied et je n’ai plus rien à boire. Auriez-vous de l’eau ?
Elle me dévisage sans sourire et répond d’une voix douce, agréable à l’oreille, sans l’ombre d’une hésitation.
— Naturellement. Mais je vois que vous êtes arrivé par le chemin du Grand Ravin, vous n’avez pas aperçu de source au bord du sentier ?
— J’étais si épuisé que je n’ai regardé que mes pieds, je n’ai pas vu la source.
Je regrette aussitôt ce mensonge maladroit et inutile. Comment ne pas voir la source alors qu’elle se déverse en partie sur le chemin ? D’ailleurs, je m’y étais effectivement rafraîchi. Faute de pouvoir boire l’eau qui suintait abondamment à différents endroits du rocher, mais sans former un filet suffisant pour être récupérée dans les mains et absorbée, je m’étais contenté de m’asperger le visage en utilisant une des flaques du ruisseau traversant le sentier. Pourquoi mentir au lieu de le lui dire ? Je ne sais pas. Sans doute l’excès de fatigue m'empêche-t-il de me lancer dans une explication, même toute simple.
Elle hoche la tête et me fait signe de la suivre. Le chemin se rétrécit rapidement en montant en direction de la maison après avoir traversé deux bancels successifs. L’accès au premier se fait par un escalier de pierres de schiste irrégulières d’une dizaine de marches. Lorsque ma tête atteint le niveau du premier bancel, une main énorme, grande ouverte, se dresse devant moi. Plus grande que la taille d’un humain, elle semble sortir de terre, seule émerge la partie située au-dessus du poignet, et les doigts crispés semblent exprimer une douleur intense.
Sur le replat, d’une cinquantaine de mètres de longueur et une vingtaine de mètres de largeur, plusieurs dizaines de statues de toutes tailles, à demi cachées par des buissons ou des arbustes divers, sont disposées sans ordre apparent. Inspirée de la même thématique que la main géante, chacune d’elles montre une partie d’un corps sortant de terre : les deux jambes nues coupées à mi-fémur d’un homme dont les pieds sont situés à quatre mètres au-dessus de ma tête ; la partie supérieure d’une tête où le nez est à moitié visible et les yeux largement ouverts ; un abdomen et un thorax, surmontés d’une tête sans visage ; la partie inférieure d’un corps de femme dont les deux pieds reposent sur le sol et dont la partie supérieure s’enfonce dans la terre obliquement au niveau de la taille, les fesses soulevées d’une cinquantaine de centimètres… Elles ont comme caractéristique commune d’être toutes de très grande taille.
D'autres sculptures métalliques sont entremêlées avec différentes variétés d’arbres. Ce sont également des représentations de corps humains. Très épurés, ils sont largement percés par différents orifices laissant passer les branches et les feuillages des arbres. L’intrication des sculptures et de la végétation, forte et complexe, provoque en moi une sensation de malaise que je ne parviens pas à m’expliquer.
Je vais d’une forme à l’autre, tournant autour, observant, détaillant du mieux possible ce qui est pour moi une vision de cauchemar, jusqu’à oublier la femme qui me conduit jusque chez elle. Elle réapparaît au détour d’un buis. Toujours impassible, sans dire un mot, elle me précède à nouveau dans ce labyrinthe végétal parsemé de morceaux de corps. Je ne me sens pas en état de lui parler, les questions viendront plus tard.
Une seconde série de marches permet d’arriver à l’autre bancel. Là, une araignée de plus de trois mètres de hauteur se dresse au-dessus de moi, son orifice buccal menaçant situé à moins d’un mètre au-dessus de ma tête. Sous cette bouche, le corps d’un homme nu représente une proie enveloppée de soie qui va être rapidement absorbée et digérée. Je lui demande si ce sont de vrais filaments d’araignées qui entourent le corps.
— Pas ici. Le cocon, soumis aux contraintes de l’extérieur, serait rapidement détruit ou abîmé. Ces fils de nylon très fins sont une imitation approximative des toiles d’araignées qui m’a demandé beaucoup de travail. Vous verrez des toiles bien réelles dans la maison, sur d’autres sculptures.
Savoir qu’elle envisage de me faire entrer chez elle me réconforte. En attendant, j’observe ce deuxième niveau, entièrement dédié aux araignées. Après avoir monté la dernière série de marches, nous arrivons à la maison par une large terrasse dominant la vallée. Elle m’indique un robinet de cuivre fixé sur le mur près de la porte d’entrée. Mal fermé, il laisse filtrer quelques gouttelettes d’eau.
— Elle n’est pas très fraîche, mais ce sera mieux que rien.
Après avoir bu et rempli ma gourde, je m’installe sur un banc de pierre situé à côté du robinet. Elle m’observe en silence, attendant que je parle. J’estime inutile de temporiser plus longtemps.
— Je viens de marcher pendant plus d’une semaine et j’ai besoin de repos. Pourriez-vous m’héberger quelques jours ? En contrepartie, je ferai les travaux que vous jugerez utiles. Vous n’aurez pas à vous plaindre de moi, je repartirai dès que vous me le demanderez.
— Pourquoi pensez-vous que je pourrais avoir besoin de quelqu’un ?
— Je le disais à tout hasard, mais si vous préférez cette solution je vous dédommagerai.
Elle ne réagit pas.
— Vous savez, je suis réellement très fatigué. Vous me rendriez un grand service en m’hébergeant au moins pour cette nuit.
— Je tiens beaucoup à ma tranquillité.
À la façon dont elle prononce ces mots, je sais qu’elle va accepter. Elle me scrute comme pour lire en moi des arrièrepensées éventuelles, puis toujours sans sourire, elle reprend :
— Mais c’est d’accord. Je vous montre la maison et vous pourrez vous installer.
Elle ne cherche pas à savoir qui je suis, d’où je viens, ce que je veux. Tout se passe simplement. Un peu trop simplement ! Pas question de me plaindre d’un excès de facilité, ce qui reste à venir sera autrement plus compliqué. Nous échangeons nos prénoms et j’ai la confirmation qu’elle est bien Julia. De mon côté, je lui donne le mien, car même ici il est suffisamment banal pour qu’elle ne fasse pas le lien avec l’individu recherché par toutes les polices européennes.
Alors que je suis averti de ce qui m’attend, le premier élément de surprise se produit dès l’entrée dans la pièce principale. Au centre d’une grande salle sombre, dépouillée, où des volets clos aux planches disjointes laissent passer quelques rais de lumière, cinq statues d’êtres humains sont disposées côte à côte, camouflées par un ensemble de toiles d’araignées très denses qui recouvrent la totalité de l’œuvre. Chacune est figée dans une posture étrange ou grotesque, assise, debout, ou allongée pour l’une d’elles. Placées sur le périmètre d’un cercle étroit, elles font une ronde et se contemplent sans se voir dans leur temps immobile. L’entrelacement des fils de soie est si resserré qu’il semble impossible de le briser pour pénétrer dans leur monde, et il forme un réseau trop dense pour distinguer clairement les visages. Quant aux corps, ils se laissent vaguement deviner dans la pénombre, mais paraissent pourtant animés d’une vie latente ne demandant qu’à éclater. Comment des araignées peuvent-elles tisser leur toile d’une façon aussi régulière, resserrée et harmonieuse, autour de chacune de ces statues, en reliant également chacune d’elles à la suivante ? Il est douteux que ce soit naturel, il doit y avoir une autre explication.
Je me concentre sur l’observation de la statue la plus proche de l’angle nord de la pièce. Elle représente une femme dont le bras droit est tendu vers le haut, tordu, sec et noueux. Pour ce que je perçois à travers la toile, sa main crispée cherche à saisir une vie qui fuit entre ses doigts. Ce pourrait être la main d’une noyée dont le bras sortirait de l'eau une dernière fois avant de s’enfoncer définitivement dans l’abîme d’un océan.
Julia répond avec réticence à mes questions sur l’origine de ces statues et leur mode de fabrication.
— Les toiles font partie intégrante de l’œuvre, ce sont elles qui lui donnent tout son sens.
Tout en parlant, elle se dirige vers l’escalier. Alors que nous montons les marches, je lui demande quel sens peuvent bien donner aux statues ces toiles d’araignées qui les enveloppent. Elle hausse les épaules.
— Si la signification n’est pas évidente pour vous, il est inutile que je vous l’explique, de toute évidence vous manquez de finesse et de sensibilité.
Sa morgue me hérisse le poil. Pour lui répondre, je choisis l’ironie, mais je manque de mordant et elle me contre sans difficulté.
— Vous avez certainement raison, mais je suis persuadé que je ne manquerai pas de m’améliorer à votre contact.
— Si vous deviez rester longtemps, je n’en doute pas, mais c’est plus qu’improbable.
Sans plus de commentaires, elle me montre la chambre.
— Nous prendrons le repas dans une heure, sur la terrasse.
Je ne supporte décidément pas cette femme, son air impassible, un peu hautain, son ironie cinglante, sa façon de n’accorder ses paroles qu’au compte-gouttes comme si chacun de ses mots était un nectar précieux. Je déteste les simagrées imbéciles que je dois faire pour entrer dans ses bonnes grâces. Elles sont difficiles à éviter, mais c’est franchement pénible. Le meilleur gage d’une éventuelle réussite consiste à conserver mon calme, quoi qu’il arrive. Un objectif difficile à atteindre avec le caractère que la nature m’a infligé et que je n’ai jamais réussi à modifier ou à contrôler.
La pleine lune se détache avec peine sur le jour finissant. Elle déverse sa faible lueur à travers la fenêtre basse et profonde, à gauche de la table où je suis installé. La taille exiguë de cette fenêtre – presque une lucarne – ne permet qu’une vue malaisée et partielle sur la gorge étroite qui cisaille la vallée, cicatrice brune et sèche brisée par le reflet des eaux de la rivière. J’ai repéré en arrivant qu’aucune autre maison n’est visible dans le bois de châtaigniers, sinon un bâtiment à moitié écroulé à miflanc du versant opposé, sans doute une ancienne bergerie. Je dois avouer à regret que cet endroit sauvage et isolé me plaît, même si aujourd’hui la fatigue m’empêche d’en profiter pleinement. D’ailleurs, comment apprécier la beauté d’un paysage alors que je risque à tout moment d’être reconnu et dénoncé ? Ce dont je suis sûr, c’est que le plaisir que j’éprouve est lié à la ressemblance de cette région avec la Castagniccia, ce coin de la Corse où j’ai vécu mes dernières vacances familiales avant l’explosion du couple de mes parents. Peut-être y a-t-il un lien qu’une psychanalyse me permettrait de découvrir !