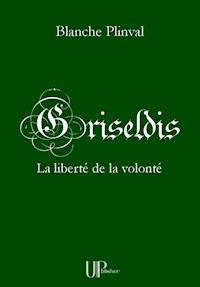
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Plongez au cœur de l'époque médiévale et suivez le parcours d'une adolescente intrépide !
Griseldis a 15 ans. C'est une jeune fille exaltée dont la rencontre avec Hildegarde von Bingen va bouleverser la vie. Son caractère, son intelligence et sa curiosité l'amènent à questionner les dogmes auxquels il est indiqué de se soumettre. Sa rencontre avec Guillaume la précipite dans une série d'aventures périlleuses qui mettront leur vaillance à tous deux à rude épreuve, malgré quelques miracles, fréquents à l'époque, qui vont jalonner leur route. Un récit où l'on voit que l'acceptation de l'emprise naissante de l'Eglise sur les êtres humains - les femmes en particulier - n'est pas évidente pour tous les esprits et que la découverte des différents modes de pensée peut, à chaque rencontre, remettre l'obéissance et la soumission en question.
Une quête identitaire aux multiples rebondissements !
EXTRAIT
Le chanoine Hugo von Gitzer était de fort méchante humeur. Ortiz, sa vieille jument n'en faisait qu'à sa tête. Elle tirait sur le harnais, elle n'évitait aucun des cailloux qui jalonnaient le chemin défoncé menant depuis Trêves jusqu'au presbytère d'Oberstein. Brinquebalé de toutes parts, le chanoine redoutait, à chaque pas, d'être projeté à terre. La pauvre Ortiz vieillissait, et lui aussi. Des douleurs aigues dans tous ses membres le rappelaient à la réalité.
Hugo venait d'avoir soixante dix ans, mais son imposante rondeur l'aidait à paraître quelques années de moins, il en était plutôt fier lorsqu'il se comparait à ses vieux amis des monastères environnants. Il était moins à son avantage chaque fois qu'il lui fallait monter à cheval ou en descendre. Or le moment en était venu : il se trouvait à présent devant sa maison, la seule maison en pierre du village, ce dont il s'enorgueillissait, mais la vieille haridelle ne voulait pas s'arrêter. Il mit ses mains en porte-voix :
« Yachir ! Que fais-tu fainéant, tu ne m'as pas entendu arriver ? Yachir ! Viens m'aider ! »
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Griseldis Blanche Plinval
UPblisher.com
Pour Claude
Je ne crois pas qu'il n'y ait rien de si difficile, de si périlleux qu'un amant ou une amante véritable n'entreprenne et ne vienne à bout d'exécuter.
BOCCACE Le Décaméron, 7ème journée
À Anton, Solé, Lucas, Joséphine
Le plus grand don que Dieu, dans sa largesse, fit en créant, le plus conforme à sa bonté, celui auquel Il accorde le plus de prix, fut la liberté de la volonté.
DANTE La divine comédie, Le Paradis chant V
Chapitre 1
Le chanoine Hugo von Gitzer était de fort méchante humeur. Ortiz, sa vieille jument n'en faisait qu'à sa tête. Elle tirait sur le harnais, elle n'évitait aucun des cailloux qui jalonnaient le chemin défoncé menant depuis Trêves jusqu'au presbytère d'Oberstein. Brinquebalé de toutes parts, le chanoine redoutait, à chaque pas, d'être projeté à terre. La pauvre Ortiz vieillissait, et lui aussi. Des douleurs aigues dans tous ses membres le rappelaient à la réalité.
Hugo venait d'avoir soixante dix ans, mais son imposante rondeur l'aidait à paraître quelques années de moins, il en était plutôt fier lorsqu'il se comparait à ses vieux amis des monastères environnants. Il était moins à son avantage chaque fois qu'il lui fallait monter à cheval ou en descendre. Or le moment en était venu : il se trouvait à présent devant sa maison, la seule maison en pierre du village, ce dont il s'enorgueillissait, mais la vieille haridelle ne voulait pas s'arrêter. Il mit ses mains en porte-voix :
« Yachir ! Que fais-tu fainéant, tu ne m'as pas entendu arriver ? Yachir ! Viens m'aider ! »
La porte en bois s'ouvrit, et rien moins qu'un géant apparut sur le seuil. Sans dire un mot, l'homme prit le chanoine dans ses bras et le déposa en douceur sur le sol, tandis qu'Ortiz, sans doute habituée à tous ces cris, s'était mise à brouter les herbes de l'allée.
Hugo von Gitzer, suivi du géant, se dirigea vers sa maison en fulminant ; il ne décolérait pas. Yachir, le géant turc qu'il avait ramené de son expédition en Terre Sainte, se tenait derrière lui, dos rond, épaules rentrées Ainsi courbé il dépassait encore son maître d'au moins trois têtes.
Le chanoine parlait tout seul, haussait les épaules, secouait vigoureusement la tête, tendait vers le ciel un poing prêt à frapper, ce qui ne laissait pas d'inquiéter son domestique qui n'avait jamais vu son maître agir de la sorte : il se prit à redouter les mauvais effets d'une colère dont il commençait à tâter depuis quelque temps.
Pourtant Yachir était profondément attaché au chanoine, et cela durait depuis quatorze ans, depuis l'hiver de l'année 1149, lorsque les troupes du roi Conrad et du roi Louis avaient échoué dans la reconquête de Jérusalem. Blessé lors de la dernière bataille contre les croisés francs, Yachir avait été laissé pour mort par ses compagnons qui s'en étaient retournés vaille que vaille vers leur camp. Hugo von Gitzer, à la recherche de très rares survivants tant l'acharnement à tuer avait fait rage, s'était penché, intrigué, vers ce corps immense. C'était un ennemi, mais peu importait, il voulait voir de plus près à quoi ressemblait le visage d'un géant. Il était resté surpris devant ce visage défiguré où l'on devinait pourtant les traits de l'adolescence : un sabre lui avait ouvert profondément le crâne, le front, la joue droite jusqu'au menton. Un œil fermé, vide, l'autre était resté ouvert. Hugo y distingua comme une lueur de vie. Il devait aider cet homme, tout Infidèle qu'il fût. On dut faire appel à quatre soldats pour le glisser sur un brancard : épuisés, ils l'y laissèrent tomber. Hugo insista pour qu'on soignât « son » blessé. On lui entoura le visage de bandelettes sous lesquelles on glissa des herbes pour éviter l'infection. Yachir avait perdu un œil, mais, de forte constitution, il se remit sur pied et ne quitta plus jamais son bienfaiteur, qui entreprit illico de le convertir. Il y réussit plus ou moins bien : en cachette, Yachir se tournait vers l'Orient pour prier Allah, mais il servait aussi, et avec ardeur, la messe.
Pour le moment, Yachir perplexe, ne savait que faire. Le chanoine, las, s'était assis dans son siège préféré provenant de l'église toute proche, lequel lui avait fait mauvais accueil, car il avait de plus en plus de mal à s'y glisser. Les deux hauts bras lui donnaient l'impression d'être encagé dans une prison. Avait-il encore grossi ? Il frissonna. C'était l'été, et il avait froid ! Décidément ce soir, tout allait mal. Il s'en prit encore à Yachir en lui demandant rudement de faire du feu. Puis il exigea une bouillie d'herbes du jardin, une galette de pain d'orge accompagnée d'une pomme et d'un peu de vin. Devant l'âtre, le jeu des flammes l'aidant à s'apaiser, le chanoine essayait de trouver des réponses à ses interrogations.
Pourquoi n'était-il pas allé au Concile de Tours ? Son évêque, Conrad de Mayence, lui avait pourtant proposé de l'y accompagner, mais pour une fois Hugo n'avait pas pressenti l'importance de ce qui allait se passer. Il ne savait plus s'il était en colère contre son manque de clairvoyance ou s'il était désespéré de ne pas avoir participé au triomphe du pape Alexandre. Son ami, l'abbé Artus qu'il venait de quitter, le lui avait rapporté : tous les évêques importants de la chrétienté s'étaient retrouvés dans la ville du comte d'Anjou, trois mois plus tôt, en Avril 1163. Conrad y avait siégé en bonne place :
« Le nouveau primat d'Angleterre était-il présent ?
— Même Thomas Beckett était là, avait répondu Artus avec emphase, visiblement impressionné par la belle prestance de l'Archevêque de Canterbury. Il représentait le roi Henri, et le Pape lui a fait l'honneur de le placer à sa droite. La cérémonie d'ouverture du concile de Tours était très impressionnante. Tous les prélats dont l'avis compte pour notre Saint Père s'y trouvaient réunis. La ville n'a certainement jamais connu une ambiance aussi fervente, ni autant d'exaltation. Des cavaliers circulaient dans tous les sens : c'est qu'il fallait faire parvenir les nouvelles les plus récentes aux princes du monde entier et à tous ceux qui n'avaient pu se déplacer. Les marchands avaient considérablement augmenté leurs prix et les aubergistes de Tours avaient aussi profité de cet afflux d'étrangers pour hausser les loyers à des sommes inimaginables. Tout était très cher dans la ville et ses environs. On nous a dit que le roi Louis avait dû intervenir en personne pour limiter trop de débordement. »
Et lui, Hugo, n'était pas de la fête, lui qui avait été de tous les événements de ce siècle, les bons et les mauvais ! Une telle rencontre ne pouvait être qu'une fête ! Le chanoine essaya de sortir de son fauteuil, mais, devant la difficulté, il en abandonna vite l'idée ; il fallait avant tout qu'il se calme !
« Pourquoi Frédéric n'a-t-il pas jugé utile de s'associer à l’événement en y participant en personne ? avait-il demandé à Artus. C'était pourtant l'occasion rêvée de procéder une fois pour toutes à l'unification de notre Église et de se réconcilier !
— C'est ce que nous pensions tous, mais Frédéric Barberousse ne veut pas se soumettre au Pape. Il veut reconstituer le Saint Empire Romain Germanique, reconquérir l'empire de Charlemagne, nommer les évêques et démettre le Pape s'il le juge bon. Naturellement le Saint Père n'est pas d'accord. Nous l'avons tous soutenu ouvertement : il en était très heureux ! »
Comment leur empereur Frédéric, en qui tout le peuple avait mis tant d'espoir, osait-il se rebeller ainsi et persister avec tant de morgue dans l'erreur ? Les deux hommes s'en étonnaient avec une colère mêlée d'effroi. Car ce n'était pas la première fois ! Depuis son arrivée au pouvoir, il n'avait cessé de créer des problèmes à la chrétienté. L’Italie souffrait de ses incessantes invasions, il avait rasé Milan l'année précédente sous prétexte que la ville lui résistait, en emportant même, honte sur lui, les ossements des Rois Mages ! De plus l'empereur soutenait le pape Victor IV qu'Hugo, comme la plus grande partie de l'Église et des religieux, appelait l'antipape, ce qui avait eu pour conséquence de créer un schisme, encore un !
« Et depuis nous vivons dans un climat de conflit insupportable ! Tous ceux qui étaient présents le déplorent et souhaitent que le Pape puisse retourner à Rome dans les états du Saint Siège, avait repris Artus, mais Frédéric refuse. Donc Alexandre est obligé de fuir à chacune des incursions de l'empereur, c'est pour ça qu'il se réfugie en France, ou dans les états amis du roi Louis. Et pendant ce temps, le peuple souffre de famine, les routes sont peuplées de hordes de brigands, les princes passent leur temps à se quereller et à se battre, parce que Frédéric ne pense qu'à une chose, conquérir l'Italie, Rome et imposer son pape ! » Hugo fulminait. S'il avait été plus jeune il aurait aimé prendre les armes contre un tel monarque qui ne savait pas reconnaître la puissance du représentant de Dieu, pourtant élu régulièrement par les évêques quelques années plus tôt.
— Et pendant ce temps, avait poursuivi Artus, tout le monde se comporte mal, même ceux qui prétendent ramener les païens dans le giron de l'Église. Dieu n'autorise pas de telles persécutions en son nom ! »
Alors les deux hommes se taisaient, accablés de tristesse. Ce n'était pas pour ce monde cruel et confus que tous deux avaient suivi Bernard de Clairvaux et le Pape Eugène III lorsqu'ils avaient proclamé la deuxième croisade. Hugo était âgé de cinquante six ans quand il avait suivi le saint commandement, Artus en avait soixante : malgré leur âge avancé ils étaient heureux de mettre leurs pas dans les pas du Christ. Ils étaient revenus au bout de deux ans avec quelques compagnons d'infortune, paysans et hobereaux mélangés, rescapés d'une aventure digne de l'enfer. Hugo en particulier, était désespéré de ce qu'il avait fait et vu. La barbarie des hommes l'effrayait, mais la sienne l'avait terrorisé. Il avait, lui, homme de Dieu, tué pour se défendre lors des attaques de pillards que les croisés subissaient tout au long des chemins et il n'avait rien dit quand ses compagnons attaquaient les villages pour trouver de quoi se nourrir ! Dieu les aurait-il punis pour toutes ces horreurs ? Hugo évoquait cette possibilité de temps à autre, bien qu'il ait immédiatement une autre raison à fournir sur l'origine du désastre. Artus, patiemment, attendait la suite, toujours la même :
« Le roi Louis VII a demandé à son épouse la reine Aliénor de le suivre jusqu'en Palestine, et vous savez bien ce qui est arrivé !
— Je n'écoute pas les rumeurs, mon cher Hugo répondait Artus plein de hauteur. Je sais ce que vous insinuez : que le roi était trop faible pour se séparer de son épouse un temps aussi long, mais on dit aussi qu'aucun homme ne peut résister à la beauté de la reine. N'est-ce pas ce qui est arrivé au roi Henri II Plantagenêt qui, comme vous le savez, n'a pas tardé à la mettre dans son lit ? » Artus savait qu'il allait déclencher la colère d'Hugo qui refusait l'idée même du droit à la volupté de la chair, surtout venant des rois et des reines qui se devaient de donner l'exemple.
« Cette femme, cette créature, Hugo en crachait de colère, a demandé le divorce pour des raisons de parenté trop étroites, mais en fait c'est pour adultère que l'Église aurait dû dénouer les liens de ce mariage : son union avec Henri constitue bel et bien un mariage adultérin. Sait-on qui est le vrai père de l'enfant qu'elle a mis au monde, pendant que son mari combattait ?
— Peu importe, répondait Artus sur un ton léger, puisque c'est une fille ! » Il savait que pour Hugo, toutes les femmes étaient des femelles qui pactisaient avec le démon, qui usaient de sortilèges et que leur corps brûlaient d'un feu inextinguible, feu dont les hommes étaient toujours victimes, surtout les célibataires. En général la conversation sur ce sujet s'arrêtait rapidement, car Hugo se signait et levait les mains au ciel, désespéré : « c'est à cause de la mauvaise conduite de la reine Aliénor, que nous avons échoué. Pardon, ô mon Seigneur ! » Rien n'était moins sûr.
Malgré ces dix années écoulées, Hugo n'acceptait toujours pas ce moment de sa vie : la présence de Yachir à ses côtés ne lui permettait pas d'oublier les images des champs de bataille gravées dans sa mémoire. Il revoyait les milliers d'Infidèles, hommes, femmes et enfants, égorgés, décapités, éventrés et même, lui avait-on dit, dévorés, au nom de Dieu ! Le géant turc représentait la seule bonne action qu'il ait accomplie dans cette aventure. Tout le monde louait sa générosité, l'amour du prochain qu'il avait manifesté en ramenant un Infidèle qu'il traitait comme un bon chrétien, en homme libre, mais il savait, lui, qu'il faisait tout cela pour tenter d'adoucir les émois et les peines de sa conscience.
Tout ce qu'il avait vu en chemin l'avait inquiété : des gens du peuple, des religieux, des nobles qui partaient combattre parfois accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, avec promesse de l'Église, d'une rémission de tous leurs péchés. Forts de cette absolution, ils se comportaient en chemin comme des pillards, des soudards et des brigands. Hugo aurait aimé trouver parmi princes et chevaliers, un homme qui les aurait encouragés à plus de clémence et de modération, un homme qui n'aurait pas exhorté à la tuerie mais à la prière pour tous ceux qui allaient mourir en défendant leur foi ! C'est le regard dévoué de Yachir qui permettait à Hugo de trouver un peu de repos quand le remords le taraudait durement. La plupart du temps il éprouvait un immense courroux contre tous ses congénères et contre lui-même.
Il essayait toutefois de dompter sa nature atrabilaire lorsqu'il rendait visite à sa nièce Magda et à sa famille. Il aimait beaucoup cette nièce qui avait marqué dès son adolescence un comportement où obéissance et volonté coexistaient harmonieusement. Magda, au contraire de ses congénères – matrones effervescentes ou acariâtres – réunissait certaines des vertus requises chez les femmes, et ceci malgré une beauté qu'il jugeait parfois suspecte, car l'âge ne l'avait pas ternie. Mais la piété régnait dans sa maisonnée. Hugo aimait sentir presque physiquement l'atmosphère de tendresse dans laquelle baignait cette famille unie : il y voyait grandir avec plaisir un garçon et deux filles qui l'aimaient beaucoup. Malgré tout Hugo s'inquiétait depuis quelque temps ; il n'était pas du tout en accord avec la manière dont Magda éduquait ses enfants :
« Pourquoi tes filles ne sont-elles pas déjà promises à des hommes de bonne lignée ? Aldebert aussi devrait déjà être fiancé à une jeune fille, il sera bientôt en âge de se marier ! Arnaud et toi ne vous comportez pas comme des parents prévoyants et respectueux des bons principes ! Et pourquoi leur laisser autant de liberté ? Tu sais bien que les maris et les belles-familles de tes filles ne se préoccuperont jamais de connaître leur avis ! On leur demandera d'obéir et de faire de bons héritiers, voilà ce que sera leur devoir, ma nièce ! » Magda éludait toute réponse, gardait respect et déférence, mais souriait, ce qui irritait d'autant plus le vieil homme.
Dieu soit loué, ses petites nièces n'abusaient pas de la situation, mais il lui semblait que l'aînée, Griseldis, d'une rare beauté – le chanoine lui-même était obligé d'en convenir – courait les plus grands dangers. Griseldis, sa préférée, ne montrait aucun intérêt pour cette vie de future épouse qui l'attendait : décidée, cultivée et intelligente, elle montrait des dispositions inattendues au raisonnement ce qui le chagrinait beaucoup dans l'attitude d'une femme. Et pourtant, il ne pouvait lui résister : elle lui demandait de raconter ses aventures et il se laissait aller à conter les exploits de tous les combattants, Croisés et Infidèles. Souvent même il embellissait, il évitait de raconter l'horreur. Il admirait les connaissances que la jeune fille avait de la Bible, ainsi que la manière dont elle lisait les textes et commentait les psaumes. Elle insistait pour lui lire aussi des poésies de Virgile, car elle avait remarqué – il en était persuadé – qu'il faisait la grimace en écoutant les auteurs latins et grecs qu'il jugeait indécents. À quoi lui servirait tout ce savoir ? Il était de son devoir de rappeler à tous – ce qu'il faisait scrupuleusement – que l’Église ne demandait pas à ses fidèles de réfléchir et de raisonner, mais de croire à la parole divine. Et ce moine ! Le dénommé Gerhard attaché à l'éducation des enfants, qui avait annoncé à sa nièce et à son mari, que Griseldis devait aller au monastère poursuivre ses études, parce que lui ne pouvait plus rien lui apporter ! Ainsi elle pourrait continuer à apprendre dans un monastère en attendant de trouver le mari qui aurait l'honneur de l'épouser. L'honneur de l'épouser ! C'était les mots du clerc qui avaient déclenché, cela va de soi, une mémorable colère.
Il avait mis un peu de temps à reprendre ses esprits mais il avait su réagir avec opportunisme. Si Griseldis allait étudier dans un couvent, ce serait dans un couvent qu'il préconiserait, lui, le chanoine ! Alors Hugo von Gitzer avait pensé au couvent de l'abbesse Hildegarde, la femme la plus admirée de son temps en Germanie, et s'était arrangé pour faire obtenir une entrevue à Magda et Arnaud. Au moins dans ce couvent du Rupertsberg, Griseldis recevrait l'enseignement qui convient à une jeune fille vertueuse qui ne doit penser qu'à son futur mariage. Elle y apprendrait l'humilité, la pudeur propre à son sexe, l'obéissance, la mesure en toutes choses, qualités qui manquaient vraisemblablement à sa petite-nièce.
Il avait appris qu'Hildegarde correspondait avec l'empereur Frédéric et qu'elle l'incitait à réfléchir à ses actes : une femme capable de raisonner un tel homme, intelligent mais hélas aussi obstiné qu'un taureau, ne pouvait être qu'une sainte. Après réflexion, Griseldis avait tout intérêt à se rendre dans son couvent au plus tôt !
Chapitre 2
En apercevant dans le lointain les toits de chaume des maisons de Kreuznach, Arnaud et Magda von Duckarn qui chevauchaient en silence, se sentirent un peu rassurés. Le soir commençait à tomber, la famille serait rentrée pour la nuit. Ils se tenaient côte à côte, mais évitaient de se regarder, comme s'il ne fallait surtout pas échanger quelque signe que ce soit. Deux domestiques les suivaient en discutant à voix basse : chargés de surveiller les alentours toujours un peu dangereux ces temps-ci, ils auraient dû se séparer, l'un devançant la marche, l'autre la fermant, mais personne ne songeait à les tancer.
Griseldis, elle, cheminait calmement tout en ayant pris une bonne avance sur la petite troupe : la distance qui la séparait de ses parents lui permettait de s'absenter dans une rêverie qui semblait la charmer. En voyant le toit de l'église de Kreuznach, le sourire qui flottait sur ses lèvres, se transforma en rire joyeux, elle se mit au trot, impatiente d'annoncer très bientôt la nouvelle à tous ceux et celles qui comptaient pour elle. Elle imaginait déjà les visages d'Aldebert et de Marta, son frère et sa sœur, et ceux des servantes et des paysans qui la connaissaient depuis sa toute petite enfance. Ils allaient la complimenter, tous seraient fous de joie. C'est que la nouvelle était d'importance : Griseldis avait décidé, en cette magnifique journée de juillet, d'entrer au couvent pour y devenir nonne !
La veille, elle avait rencontré à nouveau, et sur la demande de celle-ci, la mère abbesse du couvent du Rupertsberg, où il était convenu qu'elle allait continuer ses études. Hildegarde la recevait pour la seconde fois, et lorsqu'elle lui avait posé les questions sur l'Ancien et le Nouveau testament, qu'elle avait insisté en l'interrogeant sur le rôle de l'Esprit-Saint, Griseldis était tombée à genoux :
« L'Esprit-Saint est le souffle divin, il délivre tous les dons que Dieu veut attribuer aux hommes, il les remplit d'espoir et de lumière », avait-elle répondu inexplicablement en pleurs. Etait-ce bien elle qui avait répondu ? Elle n'en était plus sûre du tout : il s'était passé une chose surprenante, une volonté plus forte que la sienne s'était imposée. Elle avait eu la certitude qu'il ne fallait surtout pas partir de ce lieu sans prendre l'engagement d' y revenir au plus tôt.
Ensuite – tous ses souvenirs se chevauchaient et se mouvaient dans une sorte de brume où elle se perdait avec bonheur – elle avait senti les mains d'Hildegarde entourer son visage, mains rugueuses qui cherchaient quelque chose, peut-être une confirmation inconnue d'elle. Griseldis avait à peine osé lever les yeux et entrevu le regard clair, mais ô combien perçant, de l'abbesse. Devant l'expression de surprise de la jeune fille le disputant à la confusion, Hildegarde avait ébauché une sorte de sourire et lui avait murmuré :
« Ne crains rien de moi, tu es la bienvenue, mon enfant. »
Griseldis avait alors senti une onde de bonheur la parcourir : la mère abbesse, qui était si occupée, lui faisait savoir qu'elle était attendue ! Dans l'instant même, elle avait décidé qu'elle ne se contenterait pas seulement de poursuivre son étude de la Bible, des psaumes, et des sciences, et d'attendre comme la plupart de ses futures compagnes l'époux déjà assigné : elle, elle deviendrait nonne et vivrait le reste de ses jours auprès d'Hildegarde !
Ses parents, qui l'accompagnaient, ne comprirent pas immédiatement l'importance de la nouvelle. Magda lui répondit calmement :
« Ma fille, consacre ce temps pendant lequel tu vas t'éloigner de ta famille à te perfectionner et à réfléchir. Tu pourras décider de ta vie et du choix de ton futur époux. Nous sommes heureux que notre mère Hildegarde t'accueille avec bienveillance, mais ne t'égare pas, il faudra travailler, te montrer obéissante et humble comme toutes les élèves qui sont dans ce couvent et cela te sera difficile : tu n'as aucun engagement à prendre, sauf celui de te montrer digne de ta famille. »
Arnaud, son père, n'avait rien ajouté. Il était allé chercher leurs chevaux et lorsqu'il était revenu, Griseldis avait remarqué une certaine pâleur sur son visage. Il s'était entretenu avec Magda, un peu à l'écart, et tous deux de retour près d'elle lui avaient rappelé qu'elle ne rentrerait au couvent qu'en octobre. Elle disposait de trois mois pour revenir sur ses propos : son père avait clos la discussion en lui reprochant son attitude présomptueuse. Griseldis s'en était étonnée, mais ces paroles, curieusement, ne l'avaient pas blessée.
Depuis toujours, Arnaud se sentait relié à sa fille par un lien très fort : il avait compris que Griseldis vivait une émotion intense, contre laquelle aucun raisonnement ne pouvait lutter. Griseldis avait toujours été une enfant déterminée, ardente, allant jusqu'au bout de ses passions et de ses forces lorsqu'elle avait entrepris quelque chose. Elle ne redoutait pas les dangers, s'affrontait sans honte à son frère et à ses camarades, et décidait de leurs jeux à leur place.
Arnaud était très fier de son courage, de son intelligence et de sa beauté. Nombre de familles avaient fait savoir leur intérêt pour une alliance avec la famille von Duckarn. Elles savaient que les enfants qui naîtraient d'une union entre leur fils et Griseldis seraient de bon lignage. Les parentés de Magda et Arnaud leur reprochaient de n'avoir pas arrangé un mariage beaucoup plus tôt, ce qui aurait évité bien des déconvenues aux familles prétendantes blessées par une fin de non-recevoir. Des demandes empressées continuaient néanmoins d'arriver, la beauté de la jeune fille étant connue dans toute la région. Mais à chaque fois, Arnaud et Magda s'attendaient à cette réplique de leur fille :
« Chers parents, laissez-moi encore un peu de temps. Voulez-vous vraiment que je parte vivre loin de vous, et pour toute la vie ? Et puis ce nouveau prétendant est si laid, Mère ! ». Elle suppliait à genoux mais riait sans façon et attendait la fois prochaine : elle savait que Magda soupirerait à fendre l'âme, et qu'Arnaud prendrait un air courroucé, tandis que toute la maisonnée se réjouirait de ses réparties. Griseldis était le soleil de la maison, rieuse, enjouée, elle montrait aussi de l'affection envers tous ceux qui l'entouraient. Les domestiques, qui ne savaient que faire pour la contenter, auraient donné leur vie pour elle. D'ailleurs les deux serviteurs qui les avaient accompagnés semblaient tout aussi navrés que les parents eux-mêmes.
Magda pensait avec tristesse à l'avenir sans enfant que se réserverait Griseldis si elle prononçait ses vœux, les larmes lui en venaient aux yeux. Elle avait cru innocemment que sa petite fille ne pouvait que les remercier de la liberté de choix qu'Arnaud et elle lui laissaient. Elle songeait à sa propre vie, elle avait perdu trop d'enfants pour ne pas savoir quelle chance un enfant qui parvenait à survivre représentait pour une famille. Il lui avait fallu attendre la troisième grossesse pour pouvoir serrer un petit corps de nourrisson contre elle : Aldebert l'avait comblée, surtout quand il prenait goulûment le sein qu'elle lui offrait. Puis était arrivée Griseldis. Elle n'avait jamais vu de plus beau bébé : cette petite fille était si belle qu'elle avait vraiment pris peur ! Et si c'était un ange ? Et si elle devait être rappelée au ciel ?
Quand elle en avait parlé à son époux, Arnaud lui avait dit qu'il ressentait la même crainte. Elle était leur joyau ; ils l'entoureraient des meilleurs soins. Ce n'était point nécessaire car Griseldis était née solide et aussi bien portante que l'avait été son frère. Les enfants avaient échappé aux épidémies, ce qui tenait du miracle. Ils se crurent bénis de Dieu grâce à la présence dans leur foyer de ce petit être lumineux.
Il n'était point difficile à Magda et Arnaud de décider d'une chose en commun. Bien que leur mariage eût été arrangé très tôt – Arnaud était âgé de dix ans et Magda avait cinq ans quand on évoqua leurs fiançailles – ils furent véritablement attirés l'un vers l'autre. Les deux familles, toutes deux originaires de Franconie, se connaissaient de longue date et possédaient les même titres de noblesse. L'entente entre les jeunes époux était évidente et leur union avait témoigné, aux yeux de tous, d'un attachement que rien ne pourrait remettre en question. Arnaud ne prenait aucune décision sans avoir pris l'avis de Magda. Il n'avait donc pas été difficile d'instaurer une éducation qui manifestait les principes qu'ils appliquaient dans leur vie.
Ils avaient décidé de laisser vivre leurs deux enfants au rythme de leur éveil, et suivirent avec intérêt les progrès d'une éducation soignée qui les destinait aux meilleures alliances. Ils avaient élevé sans différence deux enfants doués pour la vie, auxquels vint bientôt s'ajouter Marta, après une troisième fausse-couche où la fièvre avait failli emporter la jeune femme : Marta, différente, si fine, portée davantage à la rêverie et à la prière. Les trois enfants s'entendaient à merveille. Les parents étaient fiers de leur famille et toute la parenté attendait avec impatience les premiers pas dans la vie de ces enfants éduqués avec autant de fermeté que d'indulgence.
Sur le chemin du retour, Magda pensa à son oncle, le chanoine Hugo. Se réjouirait-il ou se mettrait-il en colère ? Il considérerait que cette décision de Griseldis lui échappait encore ! Avec un sourire elle l'entendait déjà lui dire en cachette de Griseldis :
« Elle est bien trop belle pour être nonne ! Trouvez-lui un mari, cette idée de couvent est stupide ! » Il pourrait se révéler comme un allié plus sûr qu'il n'y paraissait. Il appréciait la présence de cette jeune fille qui comprenait souvent plus rapidement que les religieux qu'il côtoyait, les mystères les plus obscurs de la foi. Magda n'était pas dupe : s'il visitait aussi fréquemment son foyer c'était pour converser avec sa petite-nièce. Tout le monde voyait bien que Griseldis le touchait toujours jusqu'au fond du cœur lorsqu'elle lui demandait de raconter son périple en Orient. Elle montrait aussi de l'intérêt lorsqu'il expliquait ce qu'il constatait dans les couvents. Hugo von Gitzer avait la responsabilité de rapporter à l'évêque de Mayence les doléances ou les satisfactions des monastères de la région proche de Basse-Lorraine. Lorsqu'il abordait ce sujet, il se détournait ostensiblement des femmes de la maison et s'adressait à Arnaud :
« Comment appelez-vous, lui demandait-il, ce besoin qu'ont actuellement les abbesses de nos couvents de se séparer des moines pour obtenir leur propre lieu de vie et instituer leurs propres règles ? À quoi sert donc la clôture ? » Arnaud restait muet. À quoi bon lui répondre, il se serait mis en colère quelle que soit la réponse :
« J'appelle cela de la désobéissance, hurlait-il, du refus d'obéir à la doctrine des pères et surtout à celle de Saint Benoît. C'est très grave, le savez-vous ? Les religieuses doivent rester dans la clôture, et bénéficier de l'influence juste et constructive des moines ! Je redoute la colère de Dieu, lorsqu'elle se manifestera ! Qui va rappeler aux moniales leurs devoirs ? Elles vont oublier la valeur de l'exemple, celle de l'humilité en particulier et leurs couvents perdront toute leur bonne et honnête réputation. »
Magda se rappelait la déception du chanoine lorsque, après leur première visite, ils lui avaient appris que le couvent du Rupertsberg était un couvent de femmes : or, il n'en savait rien ! Hugo s'était immédiatement renseigné : en effet l'abbesse Hildegarde s'était séparée des moines du couvent du Disibodenberg, en dépit des résistances manifestées par les autorités religieuses. Tout le monde avait dû se ranger à sa décision, Hugo en avait été très affecté : ainsi cette femme avait donné l'exemple de l'indiscipline et dirigeait à présent son propre couvent ! Magda pensait en chevauchant que malgré toute l'admiration que le chanoine éprouvait pour l'abbesse, il ne serait pas mécontent s'il pouvait encore influencer la décision de Griseldis.
À peine arrivée dans la grande maison, Griseldis annonça son intention : elle fut surprise et s'offusqua des réactions de la famille. Aldebert partit dans le jardin d'où l'on ne put le déloger et Marta, qui aimait tant jouer avec ses chiots et ses chatons, les chassa des couvertures sans ménagement : elle n'adressa plus la parole à sa sœur de la journée.
« Voilà notre chance, pensa Magda, cet accueil va la faire changer d'avis. »
Mais les jours suivants furent maussades, personne ne voulant prendre l'initiative d'entamer un sujet de conversation si douloureux : le silence s'installa dans la maison, ce qui n'était pas chose ordinaire. Griseldis fit comprendre à plusieurs reprises qu'elle persistait dans son intention. L'abbesse avait été reconnue par la Papauté comme une vraie prophétesse, et ces dons de visionnaire renforçaient l'admiration éperdue qu'elle éprouvait pour Hildegarde.
Le chanoine Hugo renonça à essayer de la convaincre, il voyait bien qu'elle ne l'écoutait plus. Après tout, Hildegarde conseillait l'empereur Frédéric, elle était même la seule à pouvoir dire qu'elle s'opposait à ses projets de démettre le Pape et de détruire les villes conquises ; elle écrivait aux plus grands de ce monde que les fidèles devaient marcher sous la bannière d'une Église unie. Les couvents avaient besoin de parler d'une seule voix, il leur était difficile de choisir entre les écoles et les théories qui fleurissaient. Parfois même ils ne comprenaient pas les choix de leurs abbés qui soutenaient l'empereur Frédéric, ou au contraire, le désavouaient ouvertement. Ces inquiétudes n'étaient-elles pas légitimes ?
Des voix de femmes, telle que celle de l'abbesse Hildegarde, ne seraient-elles pas mieux écoutées et plus douces aux oreilles des plus réticents ? À ces pensées, le cœur d'Hugo von Gitzer, depuis trop longtemps amer, retrouva un peu de légèreté. Il n'était pas interdit malgré l'obstination et l'irrévérence de Griseldis, de trouver dans ce choix, un peu de satisfaction.
Chapitre 3
L'abbesse Hildegarde se réveilla en sursaut : elle mit un peu de temps avant de réaliser où elle se trouvait et qu'il faisait encore nuit. Couche défaite, chemise de lin humide, elle avait dû s'agiter beaucoup, trop de mauvais rêves visitaient depuis quelque temps son sommeil. Tout son corps lui faisait mal, elle avait froid et lorsqu'elle entreprit de se redresser pour remettre de l'ordre, elle souffrit mille morts. Force était de constater qu'accomplir certains gestes devenait impossible : à cette heure elle se sentait mal, les membres gourds, la tête douloureuse et l'esprit embrumé. Il était trop tôt pour sonner la sœur converse qui la secourait habituellement : sortir de son lit devenait de plus en plus éprouvant.
En général, après le lever, elle agitait une cloche, et une de ses filles lui apportait une galette d'épeautre et un brouet bien chaud : elle ne se lassait pas de ces grains tendres, cuits à son goût, auxquels elle faisait ajouter une pomme cuite, de la cannelle, et du miel. Elle avait découvert que l'épeautre pouvait supporter différentes cuissons, qu'on pouvait le servir froid ou chaud, et que cette céréale au contraire de la farine d'avoine, de blé, de froment ou de seigle, facilitait la digestion en ne fermentant pas :
« L'épeautre est un don du ciel, et nous montre à quel point Dieu prend soin des hommes en pourvoyant la nature d'une telle plante. Elle a tous les pouvoirs, répétait-elle à ses filles. Elle possède celui de combattre la frilosité, de produire un sang de qualité, et de mettre de bonne humeur en combattant la mélancolie. Nous devons toutes et tous – elle faisait référence aux malades et aux invités qui logeaient au couvent – en consommer le plus souvent possible. »
Elle faisait cultiver cette céréale dans les champs alentour. Lorsque c'était la saison, on ajoutait de la confiture à la galette : elle aimait celle de prunelle et tout particulièrement les fruits provenant de l'état voisin, le Duché de Lorraine. Elle l'avait observé, la prunelle confite dans du miel et consommée en juste quantité, l'aidait à combattre ses douleurs articulaires. Se nourrir de bons aliments, en particulier pour le repas du matin, était excellent pour la santé et préparait à une journée bien remplie. Chaque moniale savait combien la qualité de la nourriture importait à leur mère supérieure car c'était une façon, selon elle, de faire honneur à ce corps que Dieu leur avait donné :
« La maladie n'est pas une punition divine, leur expliquait-elle. Si votre corps est souffrant vous ne pourrez bien servir votre Créateur, trop préoccupées que vous serez par la douleur physique. Il faut repousser le plus longtemps possible les attaques de la maladie. Nous devons donc absorber une nourriture saine, en quantité raisonnable, et jeûner : notre Seigneur Dieu, qui a créé toute chose dans un esprit de bonté, a permis que nous puissions trouver des vertus curatives dans beaucoup des produits de la nature. » Ses écrits mettaient tout cela au clair.
L'abbesse savait mieux que quiconque ce que signifiait souffrir. La douleur ne lui laissait guère de repos depuis son enfance. Dès l'âge de cinq ans, la mort l'avait frôlée, puis tout de suite après, la maladie avait fait son œuvre : ses os et ses articulations s'étaient déformés rendant la marche et les déplacements de plus en plus difficiles. L'avenir se serait annoncé très sombre si depuis vingt ans à peu près, un véritable miracle ne s'était produit dans sa vie. Hildegarde « voyait » : elle voyait le monde divin, le monde céleste et la place que tenait l'Homme dans cet ordonnancement. Dieu lui-même, celui qu'elle appelait la Lumière Vivante, lui disait de raconter ses visions au monde entier, ce qu'elle faisait avec la plus grande des ferveurs depuis qu'elle avait été reconnue comme authentique prophétesse par le Pape Eugène III.
Ces visions étaient particulièrement belles : elle contemplait des couleurs irisées, celle du ciel et des étoiles, elle décrivait les doux effleurements provenant des zéphyrs, mais aussi la force plus violente de vents qui agitaient l'univers. Des personnages célestes richement vêtus lui parlaient, des animaux sauvages venaient se placer tout autour de l'univers. Elle captait d'admirables mélodies. Il était merveilleux de reproduire grâce au chant la louange que la parole seule ne pouvait contenir. Elle composait de la musique pour que tous puissent connaître les enchantements divins des harmonies célestes. La voix de la Lumière Vivante lui avait dit : « Va et clame par le monde. » Ainsi, elle devait décrire tout ce qu'elle voyait et entendait. Elle ne tirait aucun orgueil d'avoir été élue par Dieu : Il parlait par sa voix, tout simplement. Ce miracle souvent renouvelé lui permettait de faire entrer le monde divin dans la réalité des hommes, pour leur permettre de l'honorer davantage. L'univers contenait l'Homme mais l'Homme contenait aussi l'univers, il fallait décrire cette révélation aux hommes.
À chaque fois que le prodige de la vision se manifestait, il emportait au loin ses souffrances physiques. Hildegarde ne redoutait point le retour de la douleur, car, l'espace d'un instant dont elle n'aurait su dire la durée, elle avait connu le bonheur d'un corps délivré, épanoui jusqu'à la plénitude. Lors de moments de très grande souffrance, elle avait recours à la chaleur bienfaisante de l'eau. Elle se rendait dans une petite pièce où de l'eau chauffait sur des pierres brûlantes, et dégageait de la vapeur presque suffocante. Elle se plongeait dans un baquet d'eau chaude ainsi que des pèlerins de retour d'Orient le lui avaient recommandé. Ces bains la soulageaient, mais elle déplorait l'effet de l'humidité de ce côté de la vallée du Rhin qui contribuait à accroître ses douleurs.
Elle avait entendu parler d'un lieu plus favorable, plus ensoleillé, et qui pouvait accueillir davantage de religieuses et de pèlerins. Il se trouvait sur le mont Rupert, près d'Eibingen, sur la rive gauche du Rhin. Elle avait été séduite par la beauté calme du lieu. Mais avant de s'y installer, il lui avait fallu se séparer du couvent du Disibodenberg et convaincre l'abbé Cunon qui avait montré quelques réticences :
« De tous temps, religieux et religieuses ont toujours vécu dans un même lieu, lui avait-il rétorqué. Il est naturellement nécessaire qu'un mur soit construit pour séparer les habitations et préserver la distance obligatoire entre les moines et les moniales. Cette séparation n'est donc point suffisante pour vous ? Je dois en parler aux chanoines, à l'évêque et peut-être même à sa Sainteté le Pape. »
Le père Cunon ne voulait pas tenir compte de ces couvents de femmes qui s'ouvraient depuis peu dans tout l'empire ! L'évêque de Mayence avait soutenu le projet d'Hildegarde, tout en lui faisant entendre qu'il redoutait les effets d'un excès d'activité sur sa santé si précaire. Le Pape, lui aussi consulté, avait donné son accord, ce qui mit fin à toute tentative de tergiversation.
Hildegarde s'était donc installée dans des bâtiments de fortune en attendant les constructions en pierre. Elle était partie avec ses moniales, ses novices et ses élèves. Elle se sentait bien soutenue par ses vingt religieuses, toutes fières de participer à son œuvre. Elles avaient eu à cœur de faire édifier une maison pour tous ceux qui souffrent. Tous les malades de la région pouvaient ainsi bénéficier de leurs bons soins.
Hildegarde ne pouvait décidément trouver le sommeil : durant ses insomnies elle pensait avec mélancolie à celle qui lui avait tant apporté, sa chère Richardis. C'est grâce à sa présence qu'elle avait pu retranscrire ses premières visions. Celles-ci étaient apparues peu de temps après qu'Hildegarde eut été élue abbesse à la direction du couvent féminin. Elle s'en était confiée à l'abbé Cunon et à son confesseur, le vieux moine Volmar. Tous deux conscients de l'importance de l'événement, en avaient parlé à l'évêque de Mayence, qui en avait informé à son tour le pape Eugène III, lequel en était averti, au même moment, par Bernard de Clairvaux pressentant tout l'intérêt que l'Église pouvait retirer de la situation. Portées à la connaissance des fidèles, ces « manifestations » renforceraient leur respect envers une Église soucieuse, au beau milieu de ce douzième siècle, de se réorganiser autour d'une image puissante et indiscutable. Un synode s'était tenu pour discuter de l'origine divine des visions. La Papauté avait garanti l'authenticité des « manifestations » et autorisé Hildegarde à poursuivre son dialogue avec Dieu. Il lui avait été conseillé de les reproduire sur parchemin. Leurs beautés frapperaient l'imagination des hommes et développeraient leur admiration envers leur Créateur et l'Église, pourvoyeuse de tant de merveilles.
Hildegarde s'était adressée à Volmar, un des moines copistes du Disibodenberg, qui s'était également consacré à l'enluminure des textes bibliques. Il avait accepté la charge de peindre les visions d'Hildegarde, mais il avait demandé à se faire aider par une nonne. Hildegarde lui avait recommandé sa préférée : son intelligence, sa finesse et sa douceur ne pourraient que faciliter le travail de Volmar. Richardis, était d'une très grande modestie malgré ses origines nobles : pénétrée de la grandeur de sa mission, elle avait accepté le rôle effacé de secrétaire.
Durant deux années, le vieux moine et la jeune moniale témoignèrent de l'extraordinaire richesse du monde céleste. Soudain, sur une décision de son frère Hartwig, évêque de Brème, Richardis fut avisée qu'elle serait envoyée dans un autre couvent pour en prendre la direction. Hildegarde ressentait encore, à l'instant même, cette douleur coupante comme un couteau qui l'avait traversée en apprenant la nouvelle. Elle avait fait tout son possible pour retenir la jeune femme, en écrivant force lettres à tous ceux qui pouvaient faire changer cette décision. Richardis était cependant partie, et peu de temps après, elle était morte. Le chagrin d'Hildegarde était immense mais elle s'en était remise à la sagesse de Dieu et avait travaillé d'autant plus, sur les sujets les plus divers, satisfaisant ainsi à sa curiosité naturelle.
C'est à tout cela qu'elle songeait à présent : aucun nouveau savoir, aucune nouvelle activité, pas plus que sa croissante célébrité n'avaient pu chasser la douleur de la perte de Richardis. Elle recevait de toutes les provinces avoisinantes, de tous les royaumes, un abondant courrier auquel elle se devait de répondre. Il lui fallait accorder de son temps pour recevoir de nombreux visiteurs, renommés ou non, venant parfois de fort loin pour recueillir de sa bouche des conseils qu'ils ne recevraient jamais ailleurs.
Mais ce matin, Hildegarde n'avait pas envie de rencontrer de nouveaux visages. Elle souhaitait sortir de cette mauvaise nuit où elle avait encore rêvé de Richardis penchée sur les tablettes de cire qu'elle gravait de son stylet, mais étrangement, lorsque la jeune femme avait relevé le visage, pour la regarder et lui répondre, ce n'était pas le visage de sa bien-aimée nonne qu'elle avait vu. Elle avait reconnu une élève qui avait rejoint le couvent trois mois auparavant et qui bousculait la vie religieuse du couvent par une attitude souvent impertinente. Le doux sourire de son visage, exceptionnellement beau, se transformait en un ricanement hideux, les yeux, d'abord haineux, devenaient vitreux. Elle avait peur de ce rêve qui se répétait étrangement.
Hildegarde se rappela son embarras malgré une affection immédiate pour la nouvelle venue. Elle avait hésité, la recevant deux fois, car elle considérait qu'entreprendre ses études après l'âge de douze ans était chose peu facile, le caractère était déjà formé, et pas toujours enclin à accepter dans la soumission les exigences de la vie monacale. Le rayonnement de Griseldis l'avait impressionnée : elle s'était sentie déborder de tendresse lorsque la jeune fille avait dit, en rires et en pleurs, qu'elle voulait devenir nonne. Les choses s'étaient un peu gâtées lorsqu'elle l'avait déclaré haut et fort devant ses compagnes. La sœur Berta, responsable de l'enseignement, à qui les propos avaient été rapportés, était venue, en personne, lui dire dès le premier jour, que les choses ne se passeraient pas aussi facilement.
Hildegarde sourit intérieurement. Etait-ce l'impulsivité, la ferveur enflammée de Griseldis ou le comportement franchement revêche de sœur Berta qui l'amusaient ? L'enthousiasme manifesté par Griseldis dès son arrivée ne s'était pas démenti, et les remontrances, accompagnées de punitions, ne l'empêchaient pas, jusqu'à présent, d'exprimer son désaccord devant certaines contraintes :





























