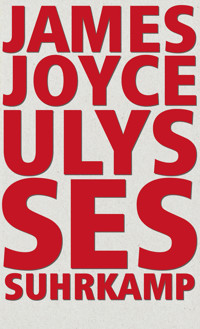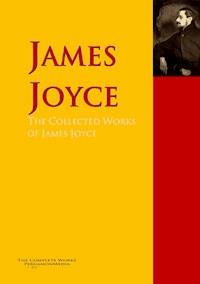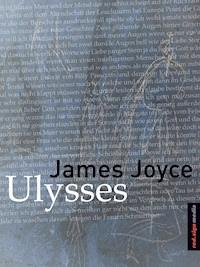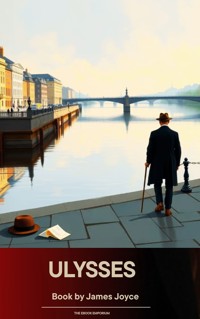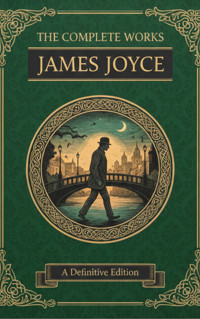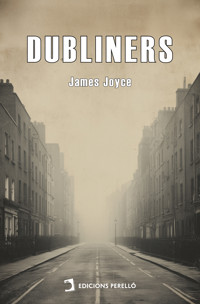3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Cette édition est unique;
- La traduction est entièrement originale et a été réalisée pour l'Ale. Mar. SAS;
- Tous droits réservés.
Considérées comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature du XXe siècle, ces quinze nouvelles - terminées en 1906 mais publiées seulement en 1914 parce que leur audace et leur réalisme étaient rejetés par les éditeurs - forment une mosaïque unitaire représentant les étapes fondamentales de la vie humaine : l'enfance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse et la mort. Ces événements sont encadrés par la capitale magique de l'Irlande, Dublin, avec son air suranné, ses pubs enfumés, le vent froid qui balaie les rues, ses habitants bizarres. Une ville qui, aux yeux et au cœur de Joyce, est en quelque sorte le précipité de toutes les villes occidentales de notre siècle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Table des matières
Les sœurs
Une réunion
Araby
Eveline
Après la course
Deux coqs
La pension
Un petit nuage
Contreparties
Argile
Un cas douloureux
Ivy Day dans la salle du comité
Une mère
Grace
Les morts
HABITANTS DE DUBLIN
JAMES JOYCE
1914
Traduction anglaise et édition 2021 par Planet Editions
Tous droits réservés
Les sœurs
Cette fois, il n'y avait plus d'espoir pour lui : c'était le troisième tir. Nuit après nuit, j'étais passé devant la maison (c'était la période des vacances) et j'avais étudié le carré de fenêtre éclairé : et nuit après nuit, je l'avais trouvé éclairé de la même façon, faiblement et uniformément. S'il était mort, pensais-je, je verrais le reflet des bougies sur le rideau obscurci, car je savais que deux bougies doivent être placées à la tête d'un cadavre. Il m'avait souvent dit : "Je ne resterai pas longtemps dans ce monde", et j'avais pensé que ses paroles étaient inutiles. Maintenant je savais qu'ils étaient vrais. Chaque soir, en regardant par la fenêtre, je me disais doucement le mot paralysie. Il avait toujours sonné étrangement à mes oreilles, comme le mot gnomon dans l'Euclide et le mot simonie dans le Catéchisme. Mais maintenant, ça me semblait être le nom d'un être mauvais et pécheur. Elle me remplissait de peur, et pourtant je désirais ardemment être plus proche d'elle et voir son travail mortel.
Le vieux Cotter était assis près du feu, en train de fumer, quand je suis descendu pour dîner. Alors que ma tante remuait mon bouillon de viande, il a dit, comme s'il revenait sur une de ses précédentes remarques :
" Non, je ne dirais pas que c'était exactement... mais il y avait quelque chose d'étrange... il y avait quelque chose de flippant chez lui. Je vais vous dire mon opinion...."
Il a commencé à souffler dans sa pipe, organisant sans doute son opinion dans son esprit. Vieux fou fatigué ! La première fois que nous l'avons rencontré, il était plutôt intéressant, parlant d'évanouissements et de vers, mais je me suis vite lassé de lui et de ses histoires interminables sur la distillerie.
"J'ai ma propre théorie à ce sujet", a-t-il dit. "Je pense que c'était un de ces... cas particuliers.... Mais c'est difficile à dire...."
Il s'est remis à tirer sur sa pipe sans nous donner sa théorie. Mon oncle a vu que je regardais fixement et a dit :
"Bien, donc votre vieil ami est parti, vous serez désolé d'entendre ça."
"Qui ?" ai-je dit.
"Père Flynn."
"Il est mort ?"
"M. Cotter ici présent vient de nous le dire. Il passait devant la maison."
Je savais que j'étais en observation, alors j'ai continué à manger comme si la nouvelle ne me touchait pas. Mon oncle a expliqué au vieux Cotter.
"Le jeune homme et lui étaient de grands amis. Le vieil homme lui a beaucoup appris, remarquez ; et on dit qu'il avait un grand désir pour lui."
"Que Dieu ait pitié de son âme", dit pieusement ma tante.
Le vieux Cotter m'a regardé pendant un moment. Je pouvais sentir ses petits yeux noirs m'examiner, mais je ne voulais pas le satisfaire en levant les yeux de mon assiette. Il est retourné à sa pipe et a finalement craché grossièrement dans la grille.
"Je ne voudrais pas que mes enfants, dit-il, aient trop à dire à un tel homme."
"Que voulez-vous dire, M. Cotter ?" a demandé ma tante.
"Ce que je veux dire," dit le vieux Cotter, "c'est que ce n'est pas bon pour les enfants. Mon idée est de laisser un garçon courir et jouer avec des garçons de son âge et ne pas être... J'ai raison, Jack ?"
"C'est aussi mon principe", a dit mon oncle. "Qu'il apprenne à boxer dans son coin. C'est ce que je dis toujours à ce rosicrucien là : fais de l'exercice. Parce que, quand j'étais enfant, chaque matin de ma vie, je prenais un bain froid, hiver comme été. Et c'est ce qui est important pour moi maintenant. L'éducation, c'est très bien et génial.... M. Cotter pourrait prendre un morceau de ce gigot de mouton", a-t-il ajouté à ma tante.
"Non, non, pas pour moi", a dit le vieux Cotter.
Ma tante a sorti l'assiette du coffre et l'a posée sur la table.
"Mais pourquoi pensez-vous que ce n'est pas bon pour les enfants, M. Cotter ?" a-t-elle demandé.
"C'est mauvais pour les enfants, dit le vieux Cotter, parce que leur esprit est si impressionnable. Quand les enfants voient des choses comme ça, vous savez, ça a un effet....".
J'ai bourré ma bouche d'étirements de peur d'exprimer ma colère. Espèce de vieux fou au nez rouge !
Il était tard quand je me suis endormi. Bien que je sois en colère contre le vieux Cotter pour avoir fait allusion à moi comme à un enfant, je me suis creusé la tête pour extraire le sens de ses phrases inachevées. Dans l'obscurité de ma chambre, je m'imaginais revoir le visage gris et lourd du paralytique. J'ai tiré les couvertures sur ma tête et j'ai essayé de penser à Noël. Mais le visage gris me suivait toujours. Il murmurait, et je savais qu'il voulait avouer quelque chose. Je sentis mon âme se retirer dans quelque région agréable et vicieuse ; et là, je la retrouvai qui m'attendait. Elle a commencé à se confesser à voix basse, et je me suis demandé pourquoi elle souriait continuellement, et pourquoi ses lèvres étaient si humides de salive. Mais alors je me suis rappelé qu'il était mort de paralysie, et j'ai senti que moi aussi je souriais faiblement, comme pour absoudre le simoniaque de son péché.
Le lendemain matin, après le petit-déjeuner, je suis descendu jeter un coup d'œil à la petite maison de Great Britain Street. C'était une boutique sans prétention, enregistrée sous le nom vague de Draperie. Les draperies étaient principalement constituées de chaussons et de parapluies d'enfants. Les jours ordinaires, un écriteau accroché à la fenêtre indiquait "parapluies couverts". Aucun avis n'était visible maintenant parce que les volets étaient relevés. Un bouquet de crape a été attaché avec un ruban au heurtoir de la porte. Deux pauvres femmes et un télégraphiste lisaient la note épinglée au crapement. Je me suis approché aussi et j'ai lu :
1er juillet 1895Le révérend James Flynn (anciennement de l'église Sainte-Catherine, rue Meath), âgé de soixante-cinq ans. R. I. P.
La lecture de la note m'a convaincu qu'il était mort, et j'ai été troublé de me retrouver à vérifier son état. S'il n'était pas mort, je serais entré dans la petite pièce sombre derrière la boutique pour le trouver assis dans son fauteuil au coin du feu, presque étouffé dans son manteau. Peut-être ma tante m'aurait-elle donné un paquet de High Toast pour lui et ce cadeau l'aurait réveillé de son sommeil stupéfié. C'était toujours moi qui vidais le paquet dans sa tabatière noire, car ses mains tremblaient trop pour qu'il puisse le faire sans renverser la moitié du tabac sur le sol. Même lorsqu'il levait sa grande main tremblante vers son nez, de petits nuages de fumée s'égouttaient entre ses doigts sur le devant de son manteau. C'était peut-être ces constantes averses de tabac à priser qui donnaient à ses vieilles robes de prêtre leur aspect vert et fané, car le mouchoir rouge, noirci, comme toujours, par les taches de tabac d'une semaine, avec lequel il essayait de brosser les grains tombés, était totalement inefficace.
Je voulais entrer et le regarder, mais je n'ai pas eu le courage de frapper. Je m'éloignai lentement le long du côté ensoleillé de la rue, lisant au fur et à mesure toutes les publicités théâtrales dans les vitrines des magasins. Je trouvais étrange que ni moi ni le jour ne semblaient être en deuil, et j'étais même agacé de découvrir en moi un sentiment de liberté, comme si sa mort m'avait libéré de quelque chose. Je m'en étonne, car, comme mon oncle l'avait dit la veille, il m'avait beaucoup appris. Il avait étudié au collège irlandais de Rome et m'avait appris à prononcer correctement le latin. Il m'avait raconté des histoires sur les catacombes et Napoléon Bonaparte, et il m'avait expliqué la signification des différentes cérémonies de la messe et des différents vêtements portés par le prêtre. Parfois, il s'était amusé à me poser des questions difficiles, se demandant ce qu'il fallait faire dans certaines circonstances ou si tel ou tel péché était mortel ou véniel ou simplement une imperfection. Ses questions m'ont montré combien étaient complexes et mystérieuses certaines institutions de l'Église que j'avais toujours considérées comme les actes les plus simples. Les devoirs du prêtre à l'égard de l'Eucharistie et du secret du confessionnal me paraissaient si graves que je me demandais comment quelqu'un avait jamais trouvé en lui la force de les entreprendre ; et je ne fus pas surpris quand il me dit que les pères de l'Église avaient écrit des livres aussi épais que le répertoire postal, et imprimés aussi serrés que les avis de droit dans le journal, qui clarifiaient toutes ces questions compliquées. Souvent, lorsque je pensais à cela, je ne pouvais donner aucune réponse ou seulement une réponse très bête et hésitante à laquelle il souriait et hochait la tête deux ou trois fois. Parfois, il me faisait répéter les réponses de la messe qu'il m'avait fait apprendre par cœur ; et, pendant que je battais, il souriait pensivement et hochait la tête, en enfonçant de temps en temps d'énormes pincées de tabac à priser dans chaque narine. Quand il souriait, il découvrait ses grandes dents décolorées et laissait sa langue sur sa lèvre inférieure - une habitude qui m'avait mis mal à l'aise au début de notre rencontre, avant que je ne le connaisse bien.
En marchant au soleil, je me suis souvenu des paroles du vieux Cotter et j'ai essayé de me rappeler ce qui s'était passé plus tard dans le rêve. Je me suis souvenu avoir remarqué de longs rideaux de velours et une lampe oscillante de mode ancienne. Il m'a semblé que j'étais loin, dans un pays où les coutumes étaient étranges - en Perse, je pense - ..... Mais je ne me souvenais pas de la fin du rêve.
Le soir, ma tante m'a emmené avec elle pour visiter la maison de deuil. La nuit est tombée, mais les fenêtres des maisons donnant sur l'ouest reflètent l'or fauve d'un grand banc de nuages. Nannie nous reçut dans le hall, et comme il aurait été inconvenant de lui crier dessus, ma tante lui serra la main à la vue de tous. La vieille femme a pointé le doigt vers le haut d'un air interrogateur et, sur un signe de tête de ma tante, a commencé à grimper l'escalier étroit devant nous, sa tête inclinée étant juste au-dessus du niveau de la rampe. Au premier palier, il s'est arrêté et nous a fait un signe de tête encourageant vers la porte ouverte de la salle des morts. Ma tante entra, et la vieille femme, voyant que j'hésitais à entrer, commença à me faire des signes de tête à plusieurs reprises.
Je suis entré sur la pointe des pieds. La pièce, à travers la dentelle du rideau, était baignée d'une lumière dorée, crépusculaire, au milieu de laquelle les bougies semblaient de pâles flammes. Il avait été placé dans le cercueil. Nannie a donné l'ordre, et nous nous sommes agenouillées toutes les trois au pied du lit. Je faisais semblant de prier, mais je n'arrivais pas à rassembler mes pensées car les marmonnements de la vieille femme me distrayaient. J'ai remarqué que sa jupe était maladroitement attachée à l'arrière et que les talons de ses bottes en tissu étaient décalés d'un côté. Il m'est apparu que le vieux prêtre souriait alors qu'il était allongé dans son cercueil.
Mais non. Quand nous nous sommes levés et avons grimpé à la tête du lit, j'ai vu qu'il ne souriait pas. Il était là, solennel et copieux, vêtu comme pour l'autel, ses grandes mains tenant lâchement un calice. Son visage était très truculent, gris et massif, avec des narines noires caverneuses et entouré d'une maigre fourrure blanche. Il y avait une forte odeur dans la pièce : des fleurs.
Elle nous a béni et nous sommes partis. Dans la petite pièce en bas, nous avons trouvé Eliza assise dans son fauteuil, en état. Je me suis traîné jusqu'à ma chaise habituelle dans le coin, tandis que Nannie est allée au buffet et en a sorti une carafe de sherry et quelques verres à vin. Elle les a posés sur la table et nous a invités à prendre un petit verre de vin. Puis, sur l'ordre de sa sœur, il a versé le sherry dans les verres et nous les a tendus. Elle m'a incité à prendre aussi des biscuits à la crème, mais j'ai refusé car je pensais que je ferais trop de bruit en les mangeant. Elle semblait un peu déçue par mon refus et s'est dirigée discrètement vers le canapé où elle s'est assise derrière sa sœur. Personne n'a parlé ; nous avons tous regardé la cheminée vide.
Ma tante a attendu qu'Eliza soupire et a dit :
"Ah, eh bien, il est parti dans un monde meilleur."
Eliza soupira de nouveau et inclina la tête en signe d'assentiment. Ma tante a touché le pied de son verre de vin avant de siroter un peu.
"L'a-t-il fait... pacifiquement ?" a-t-elle demandé.
"Oh, assez calmement, madame", a dit Eliza. "On ne pouvait pas dire quand il a perdu son souffle. Il a eu une bonne mort, Dieu soit loué."
"Et tout... ?"
"Le père O'Rourke était avec lui un mardi et il l'a oint et préparé et tout."
"Vous saviez alors ?"
"Il était tout à fait résigné."
"Il semble tout à fait résigné", dit ma tante.
"C'est ce qu'a dit la femme qui devait le laver. Elle a dit qu'on aurait dit qu'il dormait, il avait l'air si paisible et résigné. Personne n'aurait pensé qu'il serait un si beau cadavre."
"Oui, en effet", a dit ma tante.
Il a bu un peu plus dans son verre et a dit :
"Eh bien, Mlle Flynn, en tout cas, cela doit être un grand réconfort pour vous de savoir que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour lui. Vous avez tous deux été très gentils avec lui, je dois dire."
Eliza a lissé sa robe sur ses genoux.
"Ah, pauvre Jacques !" dit-elle. "Dieu sait que nous avons fait tout ce que nous pouvions, pauvres comme nous sommes - nous ne voulions pas qu'il rate quoi que ce soit pendant qu'il était là-dedans."
Nannie avait posé sa tête contre le coussin du canapé et semblait sur le point de s'endormir.
"Voilà la pauvre Nannie, dit Eliza en la regardant, elle est épuisée. Tout le travail que nous avons eu, elle et moi, pour faire venir la femme pour le laver, puis pour l'étendre, puis pour le cercueil, puis pour organiser la messe dans la chapelle. Juste pour le père O'Rourke, je ne sais pas ce que nous aurions fait. C'est lui qui nous a apporté toutes ces fleurs et ces deux chandeliers de la chapelle, qui a rédigé l'avis pour le Freeman's General et qui s'est occupé de toute la paperasse pour le cimetière et l'assurance du pauvre James."
"N'était-ce pas gentil de sa part ?" a dit ma tante.
Eliza a fermé les yeux et a lentement secoué la tête.
"Ah, il n'y a pas d'amis comme les vieux amis", disait-il, "quand tout est dit et fait, il n'y a pas d'amis en qui on peut avoir confiance."
"En effet, c'est vrai", dit ma tante. "Et je suis sûr que maintenant qu'il est parti vers sa récompense éternelle, il ne vous oubliera pas, ni toute votre gentillesse à son égard."
"Ah, pauvre James !" dit Eliza. "Il n'était pas un problème pour nous. Il n'était pas plus senti dans la maison qu'il ne l'est maintenant. Quand même, je sais qu'il est parti et tout sur ce ...."
"C'est quand tout sera fini que ça te manquera", disait ma tante.
"Je sais", a dit Eliza. "Je ne lui apporterai plus sa tasse de thé au bœuf, et vous, madame, ne lui enverrez plus sa prise de tabac. Ah, pauvre James !"
Il a fait une pause, comme s'il communiait avec le passé, puis a dit sagement :
"Remarquez, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui ces derniers temps. Chaque fois que je lui apportais une soupe, je le trouvais avec le bréviaire tombé par terre, couché sur la chaise et la bouche ouverte. "
Il met un doigt sur son nez et fronce les sourcils : puis il continue :
"Mais il n'arrêtait pas de dire qu'avant la fin de l'été, il irait faire un tour en voiture un beau jour pour revoir la vieille maison où nous sommes tous nés à Irishtown et qu'il nous emmènerait, Nannie et moi, avec lui. Si seulement nous pouvions obtenir une de ces nouvelles calèches qui ne font pas de bruit dont le père O'Rourke lui avait parlé - celles qui ont des roues rhumatismales - pour une journée bon marché, disait-il, Johnny Rush en bas de la route pour faire une promenade tous les trois ensemble un dimanche soir. Il s'était mis dans la tête que.... Pauvre James !"
"Que le Seigneur ait pitié de son âme !" dit ma tante.
Eliza a sorti son mouchoir et s'est essuyé les yeux. Puis elle l'a remis dans sa poche et a regardé la grille vide pendant un certain temps sans parler.
"Il était toujours trop minutieux", dit-elle. "Les devoirs de la prêtrise étaient trop lourds pour lui. Et puis sa vie a été, on pourrait dire, traversée."
"Oui", a dit ma tante. "C'était un homme déçu. Vous pouviez le voir."
Un silence s'est emparé de la petite pièce, et, à l'abri de celui-ci, je me suis approché de la table et j'ai goûté mon sherry, puis je suis retourné tranquillement à ma chaise dans l'antichambre. Eliza semblait être tombée dans un profond sommeil. Nous avons attendu respectueusement qu'elle rompe le silence, et après une longue pause, elle a dit lentement :
"C'est ce calice qui a brisé..... C'était le début. Bien sûr, ils disent que c'était bien, que ça ne contenait rien, je veux dire. Mais quand même.... Ils disent que c'est la faute du garçon. Mais le pauvre James était si nerveux, Dieu aie pitié de lui !"
"Et c'est tout ?" dit ma tante. "J'ai entendu quelque chose...."
Eliza a hoché la tête.
"Cela a affecté son esprit", a-t-elle dit. "Après cela, il a commencé à se morfondre tout seul, ne parlant à personne et errant seul. Une nuit, ils l'ont cherché dans un appel et ne l'ont trouvé nulle part. Ils ont cherché partout, mais ne l'ont vu nulle part. Le greffier leur a donc suggéré d'essayer la chapelle. Alors ils ont pris les clés et ont ouvert la chapelle et le clerc et le père O'Rourke et un autre prêtre qui était là ont apporté une lumière pour le chercher ..... Et que pensez-vous qu'il était là, assis seul dans le noir dans son confessionnal, bien réveillé et riant doucement pour lui-même ?
Il s'est arrêté soudainement comme pour écouter. J'écoutais aussi ; mais il n'y avait aucun bruit dans la maison ; et je savais que le vieux prêtre reposait toujours dans son cercueil comme nous l'avions vu, solennel et truculent dans la mort, un calice inactif sur la poitrine.
Eliza a repris :
"Réveillé et riant comme lui-même..... Alors, bien sûr, quand ils l'ont vu, ils ont pensé que quelque chose n'allait pas chez lui. ...."
Une réunion
C'est Joe Dillon qui nous a fait découvrir le Far West. Il avait une petite bibliothèque de vieux numéros de The Union Jack, Pluck et The Halfpenny Marvel. Tous les soirs après l'école, on se retrouvait dans son jardin et on faisait des batailles indiennes. Lui et son jeune et gros frère Leo, le fainéant, tenaient le grenier de la grange pendant que nous essayions de le prendre d'assaut ; ou bien nous menions une bataille rangée sur l'herbe. Mais quelle que soit la qualité de nos combats, nous n'avons jamais gagné le siège ou la bataille, et tous nos combats se sont terminés par la danse guerrière de la victoire de Joe Dillon. Ses parents allaient à la messe de huit heures tous les matins dans la rue Gardiner et l'odeur paisible de Mme Dillon régnait dans le salon de la maison. Mais elle semblait trop farouche pour ceux d'entre nous qui étaient plus jeunes et plus timides. Elle ressemblait à une sorte d'Indien quand elle se promenait dans le jardin, avec un vieux cache-pot sur la tête, frappant une boîte de conserve avec son poing et criant :
"Ya ! yaka, yaka, yaka !"
Tout le monde était incrédule quand on a dit qu'il avait une vocation pour la prêtrise. Pourtant, c'était vrai.
Un esprit d'indiscipline s'est répandu parmi nous et, sous son influence, les différences de culture et de constitution ont pris fin. Nous nous sommes joints à eux, certains courageusement, d'autres en plaisantant, et d'autres encore presque par peur : et parmi ces derniers, les Indiens réticents qui avaient peur de paraître érudits ou manquant de robustesse, je faisais partie. Les aventures relatées dans la littérature du Far West étaient loin de ma nature, mais, au moins, elles ouvraient des portes d'évasion. Je préférais certains romans policiers américains qui étaient croisés de temps en temps avec de belles et féroces filles débraillées. Bien qu'il n'y ait rien de mal à ces histoires, et que leur intention soit parfois littéraire, elles circulaient secrètement à l'école. Un jour, alors que le père Butler écoutait les quatre pages de l'Histoire romaine, le maladroit Leo Dillon fut découvert avec un exemplaire de The Halfpenny Marvel.
"Cette page" ou "cette page" ? Cette page. Maintenant, Dillon, debout ! "A peine la journée terminée"... Allez-y ! Quel jour ? "'A peine la journée terminée'... L'avez-vous étudié ? Qu'est-ce que tu as dans ta poche ?"
Le cœur de chacun a palpité lorsque Leo Dillon a remis le papier et que tout le monde a pris un visage innocent. Le Père Butler a feuilleté les pages, en fronçant les sourcils.
"C'est quoi cette poubelle ?" a-t-il dit. "Le chef des Apaches ! C'est ce que tu lis au lieu d'étudier ton histoire romaine ? Ne me laissez pas trouver d'autres de ces trucs misérables dans ce collège. L'homme qui l'a écrit, je suppose, est un misérable qui écrit de telles choses pour boire. Je suis surpris que des garçons comme vous, instruits, lisent ces trucs. Je pourrais comprendre si vous étiez... des enfants de l'école nationale. Maintenant, Dillon, je vous conseille fortement de vous mettre au travail ou..."
Ce reproche pendant les heures sobres de l'école a fait pâlir la gloire de l'Ouest sauvage pour moi, et le visage tuméfié et confus de Leo Dillon a réveillé l'une de mes consciences. Mais lorsque l'influence restrictive de l'école s'est éloignée, j'ai recommencé à avoir faim de sensations sauvages, de l'évasion que seules ces chroniques de désordre semblaient m'offrir. La guerre mimétique du soir a fini par devenir aussi ennuyeuse pour moi que la routine scolaire du matin, car je voulais que de vraies aventures m'arrivent. Mais les vraies aventures, ai-je réfléchi, n'arrivent pas à ceux qui restent à la maison : il faut les chercher à l'étranger.
Les vacances d'été approchaient lorsque j'ai décidé de briser la lassitude de la vie scolaire, au moins pour une journée. Avec Leo Dillon et un garçon appelé Mahony, j'ai planifié une journée de shopping. Nous avons chacun mis de côté six pence. Nous devions nous retrouver à dix heures du matin sur le pont du canal. La sœur aînée de Mahony devait écrire une excuse pour lui et Leo Dillon devait dire à son frère qu'il était malade. Nous avons convenu de marcher le long de la route du quai jusqu'à ce que nous atteignions les bateaux, puis de traverser en ferry-boat et de marcher pour voir Pigeon House. Leo Dillon craignait que nous ne rencontrions le Père Butler ou quelqu'un d'extérieur au collège ; mais Mahony a demandé, très raisonnablement, ce que le Père Butler faisait à Pigeon House. Nous étions rassurés : et je mis fin à la première étape de l'intrigue en recueillant six pence auprès des deux autres, leur montrant en même temps mes propres six pence. La veille, alors que nous faisions les derniers préparatifs, nous étions tous vaguement excités. Nous nous sommes serrés la main en riant, et Mahony a dit :
"A demain, les amis !"
J'ai mal dormi cette nuit-là. Le matin, j'étais le premier à arriver au pont parce que j'habitais plus près. J'ai caché mes livres dans l'herbe haute près de la poubelle à cendres au fond du jardin, là où personne ne venait jamais, et j'ai couru le long de la rive du canal. C'était un matin doux et ensoleillé de la première semaine de juin. Je me suis assis sur la rive du pont, admirant mes chaussures de toile peu solides que j'avais assoupies pendant la nuit et regardant les chevaux dociles qui tiraient un tramway d'hommes d'affaires vers le haut de la colline. Toutes les branches des grands arbres qui bordaient le centre commercial étaient gaies avec de petites feuilles vert clair et la lumière du soleil les éclairait au-dessus de l'eau. La pierre de granit du pont commençait à être chaude et j'ai commencé à la tapoter avec mes mains en rythme avec un air dans ma tête. J'étais très heureux.
Après être resté assis là cinq ou dix minutes, j'ai vu le costume gris de Mahony s'approcher. Il a remonté la colline, en souriant, et s'est installé à côté de moi sur le pont. Pendant que nous attendions, il a sorti la catapulte qui dépassait de sa poche intérieure et m'a expliqué les améliorations qu'il avait apportées. Je lui ai demandé pourquoi il l'avait apporté et il m'a répondu qu'il l'avait apporté pour alimenter les oiseaux. Mahony utilisait librement l'argot et parlait du Père Butler comme du Vieux Bunser. Nous avons attendu encore un quart d'heure, mais toujours aucun signe de Leo Dillon. Mahony s'est finalement jeté à l'eau et a dit :
"Venez avec moi. Je savais que le gros type allait le déchirer."
"Et vos six pence... ?" J'ai dit.
"C'est un forfait", a dit Mahony. "Et c'est tant mieux pour nous : un shilling et un tanneur au lieu d'un shilling."
Nous avons marché le long de la North Strand Road jusqu'aux Vitriol Works, puis nous avons tourné à droite le long de la Wharf Road. Mahony a commencé à faire l'Indien dès que nous étions hors de vue du public. Il a poursuivi une foule de jeunes filles en haillons, en brandissant sa catapulte non chargée, et, lorsque deux garçons en haillons ont commencé, par galanterie, à nous lancer des pierres, il a proposé de les charger. J'ai objecté que les garçons étaient trop petits, et nous avons donc continué, tandis que la troupe en haillons criait après nous : "Combers ! Swaddlers !", pensant que nous étions protestants parce que Mahony, qui avait les cheveux noirs, portait l'insigne argenté d'un club de cricket sur son chapeau. Lorsque nous sommes arrivés au Fer à repasser, nous avons organisé un siège, mais ce fut un échec car nous devions être au moins trois. Nous nous sommes vengés de Leo Dillon en disant qu'il était un bouffon et en devinant combien il en obtiendrait à trois de M. Ryan.
Nous sommes ensuite arrivés près de la rivière. Nous avons passé un long moment à marcher dans les rues bruyantes bordées de hauts murs de pierre, à observer le travail des grues et des moteurs, et à nous faire souvent engueuler pour notre immobilité par les conducteurs de charrettes grinçantes. Il était midi lorsque nous avons atteint les docks, et comme tous les travailleurs semblaient prendre leur déjeuner, nous avons acheté deux grands sandwichs aux groseilles et nous nous sommes assis pour les manger sur des tuyaux métalliques le long de la rivière. Nous avons apprécié le spectacle du commerce de Dublin - les péniches signalées de loin par leurs volutes de fumée laineuse, la flotte de pêcheurs bruns au-delà de Ringsend, le grand voilier blanc déchargé sur le quai d'en face. Mahony disait que ce serait toute une scène de s'enfuir en mer dans un de ces grands navires, et même moi, en regardant les grands mâts, je voyais, ou j'imaginais, la géographie qui m'avait été mal dosée à l'école prendre peu à peu corps sous mes yeux. L'école et la maison semblaient s'éloigner de nous, et leurs influences sur nous semblaient diminuer.
Nous avons traversé la Liffey en ferry, payant notre péage pour être transportés en compagnie de deux ouvriers et d'un petit juif avec un sac. Nous étions sérieux au point d'être solennels, mais une fois pendant le court trajet, nos regards se sont croisés et nous avons ri. Lorsque nous avons débarqué, nous avons assisté au déchargement du joli trois-quarts que nous avions observé depuis l'autre quai. Un spectateur a dit que c'était un navire norvégien. Je me suis approché de la poupe et j'ai essayé de déchiffrer la légende à son sujet mais, échouant, je suis retourné examiner les marins étrangers pour voir si l'un d'entre eux avait les yeux verts car j'avais des notions confuses..... Les yeux des marins étaient bleus, gris et même noirs. Le seul marin dont les yeux pouvaient être qualifiés de verts était un grand homme qui amusait la foule sur le quai en appelant joyeusement chaque fois que les planches tombaient :
"Très bien ! D'accord !"
Lorsque nous avons été fatigués de ce spectacle, nous avons erré lentement vers Ringsend. La journée était devenue moite et dans les vitrines des épiceries, les biscuits moisis blanchissaient. Nous avons acheté des biscuits et du chocolat que nous avons mangé tranquillement en nous promenant dans les rues miteuses où vivent les familles de pêcheurs. Nous n'avons pas trouvé de produits laitiers, alors nous sommes allés dans une boutique marchande et avons acheté chacun une bouteille de limonade à la framboise. Rafraîchi par cela, Mahony a poursuivi un chat dans une ruelle, mais le chat s'est échappé dans un grand champ. Nous nous sentions tous deux assez fatigués, et lorsque nous avons atteint le champ, nous nous sommes dirigés directement vers un talus en pente au-delà de la crête duquel nous pouvions voir le Dodder.
Il était trop tard et nous étions trop fatigués pour réaliser notre projet de visiter le Pigeonnier. Nous devions être rentrés avant quatre heures, de peur que notre aventure ne soit découverte. Mahony a regardé sa catapulte avec regret, et j'ai dû suggérer que nous rentrions en train avant qu'il ne retrouve un peu de gaieté. Le soleil est arrivé derrière quelques nuages et nous a laissé à nos pensées fatiguées et aux miettes de nos provisions.
Il n'y avait personne d'autre que nous dans le camp. Lorsque nous sommes restés quelque temps sur la rive sans parler, j'ai vu un homme s'approcher de l'extrémité du champ. Je l'ai regardé paresseusement en mâchant une de ces tiges vertes sur lesquelles les filles disent la bonne aventure. Il s'est lentement approché de la rive. Il marchait avec une main sur la hanche et avec l'autre tenait un bâton avec lequel il tapait légèrement l'herbe. Il était habillé d'un costume noir et vert et portait ce que nous appelions un chapeau haut de forme avec une haute couronne. Il semblait être assez âgé, car sa moustache était gris cendré. En passant à nos pieds, il nous a regardés rapidement, puis a continué son chemin. Nous l'avons suivi des yeux et avons vu que lorsqu'il avait fait une cinquantaine de pas, il s'est retourné et a commencé à revenir sur ses pas. Il s'est avancé vers nous très lentement, en frappant toujours le sol avec son bâton, si lentement que j'ai cru qu'il cherchait quelque chose dans l'herbe.
Il s'est arrêté quand il est arrivé à notre hauteur et nous a dit bonjour. Nous l'avons salué en retour et il s'est assis à côté de nous sur la pente, lentement et prudemment. Il a commencé à parler du temps, disant que l'été allait être très chaud et ajoutant que les saisons avaient beaucoup changé depuis qu'il était petit, il y a longtemps. Il a déclaré que la période la plus heureuse de la vie était sans aucun doute celle où l'on était à l'école et qu'il donnerait tout pour être jeune à nouveau. Alors qu'il exprimait ces sentiments qui nous ennuyaient un peu, nous sommes restés silencieux. Puis il a commencé à parler de l'école et des livres. Il nous a demandé si nous avions lu la poésie de Thomas Moore ou les œuvres de Sir Walter Scott et de Lord Lytton. J'ai prétendu avoir lu tous les livres qu'il avait mentionnés, alors finalement il a dit :
"Ah, je vois que vous êtes un rat de bibliothèque comme moi. Maintenant, ajouta-t-il en désignant Mahony, qui nous regardait avec des yeux ouverts, il est différent ; il se consacre aux jeux. "
Il a dit qu'il avait toutes les œuvres de Sir Walter Scott et toutes les œuvres de Lord Lytton à la maison, et qu'il ne se lassait jamais de les lire. "Bien sûr", dit-il, "il y avait certaines œuvres de Lord Lytton que les garçons ne pouvaient pas lire". Mahony a demandé pourquoi les garçons ne pouvaient pas les lire, une question qui m'a agité et chagriné, car j'avais peur que l'homme pense que j'étais aussi stupide que Mahony. L'homme, cependant, s'est contenté de sourire. J'ai vu qu'il avait de grands espaces dans sa bouche entre ses dents jaunes. Puis il a demandé lequel d'entre nous avait le plus de petites amies. Mahony a mentionné à la légère qu'il avait trois putes. L'homme m'a demandé combien j'en avais. J'ai répondu que je n'en avais pas. Il ne m'a pas cru et a dit qu'il était sûr que j'en avais un. Je suis resté silencieux.
"Dites-nous," dit péremptoirement Mahony à l'homme, "combien en avez-vous vous-même ?".
L'homme a souri comme avant et a dit que quand il avait notre âge, il avait beaucoup d'amants.
"Chaque garçon", a-t-il dit, "a un petit trésor".
Son attitude sur ce point m'a paru étrangement libérale pour un homme de son âge. Au fond de moi, je pensais que ce qu'il disait des garçons et des amants était raisonnable. Mais je n'aimais pas les mots dans sa bouche, et je me demandais pourquoi il tremblait une ou deux fois, comme s'il avait craint quelque chose ou ressenti un frisson soudain. Au fur et à mesure qu'il avançait, j'ai remarqué que son accent était bon. Il a commencé à nous parler des filles, disant quels beaux cheveux doux ils avaient et comment leurs mains étaient douces et comment toutes les filles n'étaient pas aussi bonnes qu'elles semblaient l'être si seulement vous saviez. Il n'y avait rien qu'il aimait autant, disait-il, que de regarder une jolie fille, ses jolies mains blanches et ses jolis cheveux doux. Il me donnait l'impression de répéter quelque chose qu'il avait appris par cœur, ou que, magnétisé par certains mots de son propre discours, son esprit tournait lentement autour de la même orbite. Parfois il parlait comme s'il faisait simplement allusion à un fait que tout le monde connaissait, et parfois il baissait la voix et parlait mystérieusement comme s'il nous disait quelque chose de secret qu'il ne voulait pas que les autres entendent. Il répétait sans cesse ses phrases, les variant et les entourant de sa voix monotone. J'ai continué à regarder vers le pied de la pente, en l'écoutant.
Après un long moment, son monologue s'est arrêté. Il s'est levé lentement, disant qu'il devait nous quitter pour une minute, quelques minutes, et, sans changer la direction de mon regard, je l'ai vu s'éloigner lentement de nous vers l'extrémité proche du terrain. Nous sommes restés silencieux quand il est parti. Après un silence de quelques minutes, j'ai entendu Mahony s'exclamer :
"Je dis ! Regardez ce qu'il fait !"
Comme je ne répondais pas et ne levais pas les yeux, Mahony s'exclama à nouveau :
"Je dis... C'est un vieux bouffon !"
"Au cas où il demanderait nos noms," j'ai dit, "tu seras Murphy et je serai Smith."
On ne se disait plus rien. Je me demandais encore si je devais partir ou non lorsque l'homme est revenu et s'est assis à côté de nous. Il ne s'était pas encore assis que Mahony, voyant le chat qui lui avait échappé, s'élança et le poursuivit à travers le champ. L'homme et moi avons regardé la poursuite. Le chat s'est à nouveau échappé et Mahony a commencé à jeter des pierres sur le mur qu'il avait escaladé. Se détournant de cette idée, il commença à errer jusqu'au bout du champ, sans but.
Après un intervalle, l'homme m'a parlé. Il a dit que mon ami était un garçon très rude, et a demandé s'il était souvent fouetté à l'école. J'étais sur le point de répondre avec indignation que nous n'étions pas des écoliers nationaux à fouetter, comme il disait, mais je me suis tu. Il a commencé à parler sur le sujet de la punition des garçons. Son esprit, comme magnétisé à nouveau par son discours, semblait tourner lentement autour de son nouveau centre. Il disait que lorsque les garçons étaient si gentils, ils devaient être fouettés et bien fouettés. Lorsqu'un garçon était brutal et indiscipliné, rien ne pouvait lui faire du bien qu'un bon coup de fouet. Une tape sur la main ou une boîte sur l'oreille ne suffiraient pas : ce qu'il voulait, c'était un bon coup de fouet bien chaud. J'ai été surpris par ce sentiment et j'ai involontairement levé les yeux vers son visage. Ce faisant, j'ai croisé le regard d'une paire d'yeux vert bouteille qui me fixait sous un sourcil tordu. J'ai encore regardé ailleurs.
L'homme a continué son monologue. Il semblait avoir oublié son récent libéralisme. Il a dit que si jamais il trouvait un garçon qui parlait aux filles ou qui avait une fille pour petite amie, il le fouettait et le fouettait ; et cela lui apprendrait à ne pas parler aux filles. Et si un garçon avait une fille comme petite amie et qu'il mentait à ce sujet, il lui donnait un coup de fouet comme aucun garçon n'en a jamais eu dans ce monde. Il a dit qu'il n'y avait rien au monde qu'il aimerait autant. Il a décrit comment il fouettait ce garçon comme s'il élucidait un mystère élaboré. Il aimerait cela, disait-il, plus que tout au monde ; et sa voix, tandis qu'il me guidait monotonement à travers le mystère, devenait presque affectueuse et semblait me supplier de le comprendre.
J'ai attendu que son monologue s'arrête à nouveau. Puis je me suis levé brusquement. Pour ne pas trahir mon agitation, je me suis attardé quelques instants en faisant semblant de réparer ma chaussure correctement, puis, disant que je devais partir, je lui ai dit au revoir. J'ai gravi la pente calmement, mais mon cœur battait la chamade de peur qu'il ne m'attrape par les chevilles. Lorsque j'ai atteint le sommet de la pente, je me suis retourné et, sans le regarder, je l'ai appelé à travers le champ :
"Murphy !"