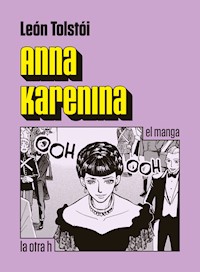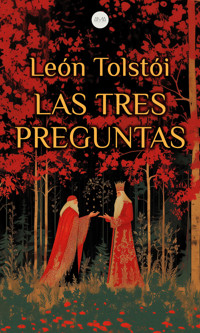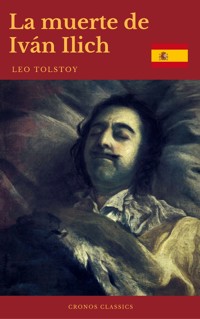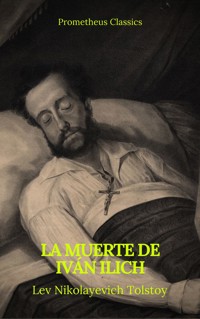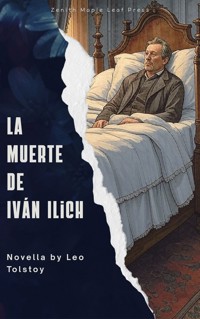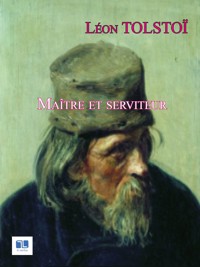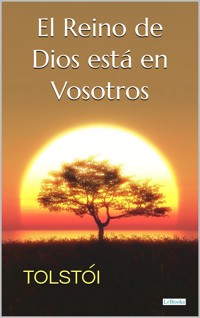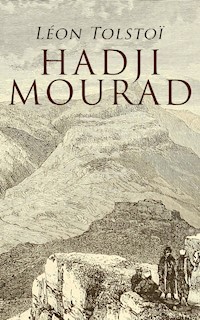
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Hadji-Mourat est un roman de Léon Tolstoï écrit entre 1896 et 1904, et paru à titre posthume en 1912. Son protagoniste est le chef avar Hadji Murad (1790-1852), un des opposants à la conquête russe du Caucase. Ce récit retrace les derniers mois de la vie de Hadji Murad à partir de sa reddition aux Russes. Tolstoï l'enrichit de détails sur son itinéraire de chef rebelle et de portraits remarquables de personnalités liées à son histoire telles que le tsar Nicolas Ier, les généraux russes en charge du front du Caucase, ainsi que son ennemi juré Chamil. L'œuvre fit l'objet de nombreuses coupures lors de sa première publication. En effet, les observations acerbes de Tolstoï (nourries de sa propre expérience d'officier subalterne dans le Caucase et en Crimée entre 1851 et 1856) sur la conduite des troupes russes dans le Caucase (officiers alcooliques, corrompus et joueurs, soldats mal entraînés...) ainsi que sur la personnalité de Nicolas Ier, dont le portrait en autocrate borné et satisfait de lui-même est saisissant, ne pouvaient échapper à la censure.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hadji Mourad
Table des matières
HADJI MOURAD
Pour rentrer à la maison, j’avais pris par les champs. On était en plein milieu de l’été. Déjà l’herbe était fauchée et l’on se préparait à couper le seigle. À cette époque de l’année, il y a une merveilleuse variété de fleurs: celles des trèfles, rouges ou blanches, parfumées et duvetées; les blanches marguerites au cœur jaune vif; la campanule jaune, à l’odeur agréable et épicée; les pois, violets et blancs, avec leur senteur de miel et leur haute tige grimpante; les scabieuses jaunes, rouges, roses; le plantain lilas, au duvet légèrement rosé, au subtil et agréable parfum; les bleuets, bleu vif au soleil lorsqu’ils viennent d’éclore, bleu rougeâtre le soir quand ils sont à leur déclin; et les fleurs fragiles, éphémères, à l’odeur d’amande, de la cuscute.
J’avais cueilli un gros bouquet de ces différentes fleurs et rentrais chez moi, quand je remarquai dans le fossé une magnifique bardane violette, en pleine floraison, une de ces bardanes qu’on appelle chez nous «tatare», que le faucheur coupe avec soin, et qu’on rejette du foin, si par hasard elle s’y trouve, pour ne pas se piquer les mains. Il me vint l’idée d’arracher cette bardane et de la mettre au milieu de mon bouquet. Je descendis dans le fossé et, après avoir chassé un bourdon velu qui s’était accroché au milieu d’une fleur et s’y était endormi doucement, mollement, je me mis à arracher la plante. Mais c’était très difficile. Non seulement la tige piquait de tous côtés, même à travers le mouchoir dont j’avais entouré ma main, mais elle était si résistante que je luttai contre elle presque cinq minutes, la déchirant fibre par fibre. Quand enfin je l’eus détachée, la tige était en lambeaux et la fleur ne paraissait déjà plus ni aussi fraîche ni aussi belle. Outre cela, à cause de sa rudesse, de sa raideur, elle n’allait pas du tout avec les fleurs délicates de mon bouquet. J’eus du regret d’avoir détruit en vain la fleur qui était si belle sur sa tige et la jetai. «Quelle énergie! Quelle vitalité! Me dis-je, me rappelant les efforts déployés pour l’arracher. Comme elle se défendait, et comme elle a chèrement vendu sa vie!»
Pour rentrer chez moi, je devais traverser un champ de terre grasse fraîchement labourée, après avoir gravi la pente douce de la route poussiéreuse. Le champ était très vaste, de sorte que de chaque côté ainsi que devant, en montant, on ne voyait que la terre noire retournée avec une grande régularité. Le labourage était bon, et sur toute l’étendue du champ on ne voyait pas la moindre plante ni herbe, tout était noir. «Quel destructeur que l’homme! Combien d’êtres vivants, sans compter les plantes, détruit-il pour assurer son existence!» pensai-je, en cherchant malgré moi quelque chose de vivant dans ce champ noir et mort. Devant moi, à droite de la route, une touffe quelconque se dressait. Je m’en approchai et reconnus cette même «tatare» que j’avais arrachée en vain et dont j’avais jeté la fleur. La touffe était formée de trois tiges; l’une d’elles avait été en partie arrachée et ce qui restait ressemblait à un bras coupé; chacune des deux autres portait une fleur. Ces fleurs, primitivement rouges, étaient maintenant noirâtres. Une des tiges était brisée, et la partie supérieure, portant la fleur maculée, pendait vers le sol. L’autre, bien que couverte de boue noire, tenait encore debout. On voyait qu’elle avait été abattue par une roue, puis s’était redressée. Il semblait qu’on lui avait tranché une partie du corps, qu’on lui avait labouré les entrailles, arraché un bras, un œil et cependant elle restait debout, ne cédant pas à l’homme qui avait détruit autour d’elle toutes les plantes, ses sœurs.
«Quelle énergie! Pensai-je. L’homme est vainqueur, il a détruit des millions d’herbes, mais celle-ci n’a pas cédé!»
Et je me rappelai une vieille histoire du Caucase, dont je fus témoin pour une partie, et que je tiens, pour l’autre, de témoins oculaires; quant au reste, c’est mon imagination qui l’a créé. Cette histoire telle qu’elle s’est formée par l’union de mes souvenirs et de mon imagination, la voici.
I
C’était à la fin de 1851. Par une froide soirée de novembre, Hadji Mourad entrait dans l’aoul Machnet, d’où se dégageait la fumée odorante du kiziak; c’était un aoul non pacifié de Tchetchenz, sis à vingt verstes des possessions russes.
Le chant monotone du muezzin venait de cesser, et dans l’air pur des montagnes, imprégné de l’odeur de la fumée du kiziak, on entendait distinctement, à travers les meuglements des vaches et les bêlements des brebis qui se dispersaient parmi les huttes de l’aoul accolées les unes aux autres comme des alvéoles, les sons gutturaux de voix qui discutaient, des voix d’hommes, de femmes et d’enfants qui revenaient des fontaines.
Ce Hadji Mourad était le caïd de Schamyl, célèbre par ses exploits. Il ne sortait jamais sans ses insignes ni sans être escorté de quelques dizaines de murides qui galopaient autour de lui; mais ce soir-là il était enveloppé d’un bachelik et d’un manteau de drap à col de fourrure sous lequel apparaissait son fusil, et accompagné d’un seul muride. S’efforçant de se faire remarquer aussi peu que possible, il fixait de ses yeux noirs et mobiles les visages des habitants qu’il rencontrait sur son chemin.
Parvenu au milieu de l’aoul, au lieu de prendre la rue qui menait à la place, Hadji Mourad tourna à gauche dans une ruelle étroite. Il s’arrêta devant la deuxième cabane qui se trouvait dans cette ruelle et regarda de tous côtés. Sous l’auvent, devant la cabane, il n’y avait personne, mais sur le toit, à côté des tuyaux fraîchement enduits d’argile, était couché un homme enroulé dans un manteau en peau de mouton. Hadji Mourad effleura l’homme avec sa cravache et fit claquer sa langue. Du manteau émergea un vieillard en bonnet et vêtu d’un vieux bechmet luisant. Ses yeux étaient rouges, chassieux, sans cils, et il se mit à cligner les paupières pour les décoller. Hadji Mourad prononça le salut habituel: «Sélam-Aleikoum», et découvrit son visage.
«Aleikoum-Sélam!» répondit le vieillard en souriant de sa bouche édentée, car il avait reconnu Hadji Mourad.
Il se dressa sur ses jambes maigres, chercha ses socques qui se trouvaient près du tuyau.
S’étant chaussé, il endossa sans se hâter son manteau usé et descendit à reculons l’échelle accotée au toit. Tout le temps qu’il s’habillait et descendait, le vieillard remuait la tête et son cou maigre, ridé et bruni, en mâchonnant de sa bouche édentée. Aussitôt à terre, il saisit hospitalièrement la bride du cheval de Hadji Mourad, ainsi que l’étrier droit. Mais le muride de Hadji Mourad, un homme leste et vigoureux, sauta rapidement de son cheval et écarta le vieux pour prendre sa place. Hadji Mourad descendit de cheval et s’avança sous l’auvent en boitant légèrement. Un garçon d’une quinzaine d’années sortit vivement sur le seuil à sa rencontre. Surpris, il contempla les voyageurs de ses yeux brillants et noirs comme des cassis.
«Cours à la mosquée, appelle ton père!» lui ordonna le vieillard et, devançant Hadji Mourad, il ouvrit devant lui la légère porte grinçante donnant accès à la cabane.
Au moment où Hadji Mourad franchissait le seuil, il se trouva face à face avec une femme d’un certain âge, maigre, vêtue d’un bechmet rouge jeté sur une chemise jaune et d’un pantalon bleu. Elle portait des coussins.
«Bienvenue dans notre maison!» dit-elle en s’inclinant profondément, et elle se mit à disposer les coussins contre le mur de devant, afin que les visiteurs pussent s’asseoir.
«Longue vie à tes fils!» répondit Hadji Mourad en se débarrassant de son manteau, de son fusil et de son sabre, et remettant l’ensemble au vieillard.
Celui-ci accrocha avec précaution le fusil et le sabre à un clou près des armes du maître, entre deux grands plateaux brillants suspendus au mur peint avec soin et d’une blancheur éclatante.
Hadji Mourad, après avoir glissé son pistolet à sa ceinture, s’approcha des coussins rangés sur le sol, croisa soigneusement son vêtement et s’assit sur l’un d’eux. Le vieux prit place à côté de lui, ferma les yeux et leva les mains, les paumes en dehors. Hadji Mourad en fit autant, puis tous deux récitèrent des prières tout en passant sur leurs visages leurs mains qu’ils joignaient à l’extrémité de la barbe.
«Nié khabar? (C’est-à-dire: Qu’y a-t-il de nouveau?) demanda Hadji Mourad au vieillard.
— Khabar-Yok. (C’est-à-dire: Rien de nouveau), répondit le vieux en regardant de ses yeux rouges, éteints, non le visage de Hadji Mourad, mais sa poitrine. Je vis habituellement dans le rucher. Mais aujourd’hui, je suis venu prendre des nouvelles de mon fils. Il sait.»
Hadji Mourad comprit que le vieux ne voulait pas dire ce qu’il savait et que lui avait besoin de savoir, aussi lui fit-il un léger signe de tête et ne le questionna pas davantage.
«Il n’y a aucune bonne nouvelle, reprit le vieillard en grommelant. Comme d’habitude: le lièvre se demande toujours comment chasser les aigles. Et ceux-ci les capturent toujours. La semaine dernière, ces chiens de Russes – que le diable les emporte! – ont incendié le foin chez les habitants de Miguitsk.»
Le muride de Hadji Mourad entra sans bruit et s’avança à grandes et solides enjambées sur le sol d’argile. Comme l’avait fait son maître, il ôta son manteau, son fusil et son sabre pour les suspendre au clou, et ne garda que son poignard et son pistolet.
«Qui est-ce? Demanda le vieillard à Hadji Mourad en désignant le nouveau venu.
— Mon muride. Il se nomme Eldar, répondit Hadji Mourad.
— Bon», dit le vieux, et il indiqua à Eldar une place sur le tapis, près de Hadji Mourad.
Eldar s’assit, les jambes croisées, et fixa silencieusement de ses beaux yeux de brebis le visage du vieillard qui se remit à parler. Il raconta comment son fils avait capturé, la semaine passée, deux soldats: il en avait tué un et envoyé l’autre à Schamyl.
Hadji Mourad ne lui prêtait qu’une oreille distraite et se tournait vers la porte pour entendre les bruits qui provenaient du dehors. Sous l’auvent, devant la cabane, des pas se firent entendre; la porte grinça, et le maître du logis entra. Il s’appelait Sado. C’était un homme d’une quarantaine d’années; il avait une petite barbiche, le nez long, les yeux aussi noirs, bien que moins brillants, que ceux de son fils, le garçon de quinze ans qui courait derrière lui et pénétra dans la cabane à la suite de son père pour aller s’asseoir près de la porte. Le chef de famille ôta ses socques sur le seuil, et rejeta sur sa nuque son vieux bonnet usé, découvrant ainsi une tête à la chevelure noire, qui n’avait pas été rasée depuis longtemps. Il s’accroupit ensuite en face de Hadji Mourad.
Ainsi que le vieux, il ferma les yeux, leva les mains, les paumes en dehors, les passa sur son visage, et commença alors seulement à parler. Il rappela l’ordre de Schamyl de se saisir à tout prix de Hadji Mourad, mort ou vif: ses émissaires n’étaient partis que la veille, mais le peuple avait peur de désobéir à Schamyl et il fallait donc être très prudent.
«Chez moi, assura Sado, personne de mon vivant ne touchera à mon kounak. Mais dehors, qu’arrivera-t-il? Il faut y songer sérieusement.»
Hadji Mourad écoutait attentivement et acquiesçait de la tête. Quand Sado eut terminé, il prit la parole: «Bon. Il faut envoyer aujourd’hui un homme porter une lettre aux Russes. Mon muride peut y aller mais il lui faut un guide.
— J’enverrai mon frère Bata, dit Sado. Appelle Bata», ordonna-t-il à son fils.
Le jeune garçon bondit sur ses jambes agiles comme sur un ressort et, balançant vivement ses bras, sortit de la cabane. Dix minutes après il était de retour avec un Tchetchenz au visage tanné par le soleil, musculeux et court sur jambes. Il était vêtu d’une tcherkeska jaune aux manches effrangées, déchirée de tous côtés et d’un pantalon noir tombant bas.
Hadji Mourad salua le nouveau venu, et sans paroles inutiles, lui exposa aussitôt sa requête: «Te sens-tu capable de conduire mon muride chez les Russes?
— Parfaitement, répondit gaiement Bata. Aucun Tchetchenz ne peut rivaliser avec moi. Un autre se chargera de cette responsabilité, promettra tout et ne fera rien. Mais avec moi ce sera fait.
— Bien, fit Hadji Mourad. Pour ta peine, tu recevras trois…»
Et il lui montra trois doigts. Bata hocha la tête pour indiquer qu’il avait compris mais ajouta aussitôt que ce n’était pas la récompense qui l’attirait, qu’il était prêt à servir Hadji Mourad uniquement pour l’honneur.
«Tous, dans les montagnes, savent comment Hadji Mourad a tué ces cochons de Russes!
— Allons, allons, fit Hadji Mourad. La corde est bonne quand elle est longue, et le discours quand il est bref!
— Eh bien, je me tairai, dit Bata.
— À l’endroit où l’Argouna tourne en face du précipice, là-bas, dans la forêt, il y a une clairière où se trouvent deux meules. Tu connais?
— Oui, je vois.
— Là-bas, trois de mes amis m’attendent, à cheval, dit Hadji Mourad.
— Aya! Fit Bata en hochant la tête.
— Tu demanderas Khan-Magom. Lui, il sait ce qu’il faut faire et dire. Il faudra le conduire au chef russe, au prince Vorontzoff. T’en sens-tu capable?
— Oui, je le pourrai.
— Le conduire et le ramener?
— Oui.
— Alors tu le conduiras, puis tu retourneras dans la forêt. J’y serai.
— Tout sera fait selon ta volonté», dit Bata. Il se leva, croisa les bras sur sa poitrine, s’inclina et sortit.
«Il faut aussi envoyer un homme à Tchekhi, dit Hadji Mourad au maître du logis, quand Bata fut sorti. Voici ce qu’il faudra faire», enchaîna-t-il en saisissant un bouton de sa tcherkeska; mais aussitôt il baissa la main et se tut, car il venait d’apercevoir deux femmes entrer dans la cabane. L’une était la femme de Sado, cette même femme maigre d’un certain âge qui avait posé les coussins. L’autre était une toute jeune fillette en pantalons rouges et bechmet vert, une sorte de plastron fait de pièces d’argent lui couvrait toute la poitrine. À l’extrémité de sa courte natte noire, épaisse et serrée, qui tombait entre ses épaules sur son dos maigre, était attaché un rouble en argent. Les mêmes yeux que son père et son frère, noirs comme des cassis, éclairaient gaiement son jeune visage qu’elle essayait de rendre sérieux. Elle ne regarda pas les visiteurs, mais on voyait que leur présence l’intimidait.
La femme de Sado portait une table basse et ronde, sur laquelle se trouvaient du thé, des crêpes au beurre, du fromage, du pain coupé en tranches minces, et du miel. La fillette portait une cuvette, une cruche et des serviettes. Tout le temps que les femmes, en faisant tintinnabuler leurs piécettes, circulèrent à pas feutrés dans leurs souples pantoufles rouges sans semelle de cuir, pour placer devant les hôtes ce qu’elles avaient apporté, Sado et Hadji Mourad demeurèrent silencieux. Eldar, ses yeux de brebis baissés sur ses jambes croisées, resta immobile comme une statue tant que les femmes se trouvèrent dans la cabane, et il ne respira à l’aise qu’après qu’eut disparu derrière la porte le bruit léger de leurs pas.
Hadji Mourad tira une cartouche de la cartouchière de sa tcherkeska et saisit dans la gaine restée vide un billet qui s’y trouvait.
«Donne cela à mon fils, dit-il en montrant le billet.
— Où faudra-t-il apporter la réponse? Demanda Sado.
— Chez toi, et tu me la feras parvenir.
— Ce sera fait», dit Sado en glissant le billet dans une des gaines à cartouches de sa propre tcherkeska. Ensuite il prit la cruche et avança la cuvette vers Hadji Mourad. Celui-ci releva les manches de son bechmet au-dessus du poignet musclé de ses mains blanches et les plaça sous le jet d’eau froide et claire que Sado lui versa de la cruche; puis il les essuya avec une serviette propre et rêche, et s’approcha des mets. Eldar fit de même. Pendant que ses hôtes mangeaient, Sado, assis en face d’eux, les remercia de leur visite. Le garçon, toujours assis près de la porte, contemplait Hadji Mourad de ses yeux noirs et brillants en souriant, comme pour confirmer les paroles de son père.
Hadji Mourad n’avait rien mangé depuis plus d’un jour; cependant il ne prit qu’un peu de pain et de fromage, et tira un petit couteau de dessous son poignard pour le plonger dans le miel qu’il étendit sur son pain.
«Notre miel est très bon, et cette année il y en a beaucoup, dit le vieux, visiblement content que Hadji Mourad en ait pris.
— Merci», dit Hadji Mourad, et il s’éloigna des mets. Eldar aurait bien mangé davantage, mais, comme son chef, il s’éloigna de la table, puis lui présenta la cuvette et la cruche.
Sado savait qu’en les recevant il risquait sa vie, car depuis la querelle survenue entre Schamyl et Hadji Mourad, il était interdit à tout habitant de Tchetchnia, sous menace de mort, de l’héberger. Il savait que les gens de l’aoul pouvaient d’un moment à l’autre apprendre la présence de Hadji Mourad dans sa maison et exiger qu’il le livrât. Non seulement cela ne troublait pas Sado, mais il s’en réjouissait. Pour lui c’était un devoir de défendre son hôte, même si cela devait lui coûter la vie. Et il était fier de lui, parce qu’il agissait selon sa conscience.
«Tant que tu es dans ma maison et que ma tête reste sur mes épaules, personne ne te fera du mal», répéta-t-il à Hadji Mourad.
Ce dernier leva sur lui ses yeux brillants et, s’étant assuré qu’il disait vrai, déclara solennellement: «Que la joie et la vie te soient accordés!»
Sado, sans mot dire, croisa ses mains sur sa poitrine en signe de reconnaissance pour cette bonne parole.
Après avoir fermé les volets de la cabane et préparé des branches pour le feu, le maître des lieux, d’humeur particulièrement gaie et animée, quitta la partie de sa demeure réservée aux hôtes pour se rendre dans celle où vivait sa famille. Les femmes ne dormaient pas encore et parlaient des hôtes dangereux qui passaient la nuit chez eux.
II
Cette même nuit, trois soldats accompagnés d’un sous-officier quittaient la forteresse d’avant-garde, Vozdvijenskaia, sise à quinze verstes de l’aoul où Hadji Mourad passait la nuit, derrière les portes de Chahguirinsk. Les soldats étaient en pelisse courte de peau de mouton et bonnets de fourrure, leurs manteaux roulés en travers des épaules, et ils étaient chaussés de bottes montant au-dessus du genou, comme les portaient alors les soldats du Caucase.
Le fusil à l’épaule, ils marchèrent d’abord sur la route; au bout de cinq cents pas environ ils la quittèrent pour bifurquer sur leur droite. Ils avancèrent encore d’une vingtaine de pas, écrasant sous leurs bottes des feuilles sèches, puis s’arrêtèrent près d’un platane brisé dont on apercevait le tronc noir dans l’obscurité. C’était là, près de ce platane, qu’on envoyait ordinairement le guet. Les étoiles brillantes qui semblaient courir au-dessus de la cime des arbres pendant que les soldats marchaient dans la forêt, paraissaient maintenant immobiles entre les branches nues.
«Sacrebleu!» lança rageusement le sous-officier Panoff en ôtant de son épaule son long fusil armé de la baïonnette pour le poser dans un cliquetis contre le tronc de l’arbre. Les trois soldats firent de même.
«Ça y est! Je l’ai perdue! Grommela avec humeur Panoff. Je l’ai oubliée, ou perdue en route.
— Qu’est-ce que tu cherches? Demanda l’un des soldats d’un ton joyeux.
— J’ai perdu ma pipe, le diable sait où!
— Et le tuyau, tu l’as? Demanda la voix enjouée.
— Le tuyau? Le voilà.
— Alors enfonce-le dans la terre.
— Mais non! On ne va pas faire ça.
— Nous allons arranger cela en un tour de main.»
Il était normalement interdit au guet de fumer, mais celui-là n’était pas très rigoureux: c’était plutôt une garde d’avant-poste envoyée là afin que les montagnards ne pussent, comme ils l’avaient fait autrefois, avancer un canon et tirer sur la forteresse; aussi Panoff ne trouvait-il pas nécessaire de se priver du plaisir de fumer, et finit par acquiescer à la proposition joyeuse du soldat.
Celui-ci sortit de sa poche un couteau et se mit à creuser dans le sol un petit trou dont il tassa soigneusement toutes les irrégularités; puis il mit du tabac dans le trou, y ajusta le tuyau, et la pipe se trouva prête. Le briquet brilla, éclairant un instant le visage musclé du soldat couché sur le ventre. Un sifflement se fit entendre dans le tuyau et Panoff sentit l’odeur agréable du tabac.
«Ça y est? Fit-il, tandis que l’autre se relevait.
— Sans doute.
— Quel gaillard tu es, Avdéieff! Un inventeur, ma foi! Eh bien, à mon tour!»
Avdéieff s’écarta pour laisser la place à Panoff, et souffla la fumée. Panoff se coucha sur le ventre et, après avoir essuyé le tuyau avec sa manche, se mit à fumer. Quand il eut fini, la conversation s’engagea entre les soldats.
«On dit que notre capitaine a de nouveau piqué dans la caisse, commença l’un des soldats d’une voix traînante. Il a perdu au jeu.
— Il rendra, dit Panoff.
— Sans doute. C’est un brave officier, confirma Avdéieff.
— Bon, bon, grommela celui qui avait entamé la conversation. Mais selon moi, il faut que la compagnie lui en touche un mot. S’il a pris de l’argent, il faut qu’il dise combien et quand il le rendra.
— La compagnie prendra bien une décision, rétorqua Panoff.
— Ce qui est certain, c’est que la compagnie réagira, confirma Avdéieff.
— Il faut acheter de l’avoine, de nouvelles bottes pour le printemps; on a besoin d’argent, et comme il l’a pris…, insista le mécontent.
— La compagnie décidera, répéta Panoff. Ce n’est pas la première fois; il a pris et rendra.»
À cette époque, au Caucase, chaque compagnie confiait la gestion de ses affaires à ses élus. Elle recevait de l’argent du trésor, six roubles cinquante kopecks par homme, mais se nourrissait elle-même, plantait des choux, fauchait le foin, avait ses chariots et était fière de ses chevaux gras et bien nourris. Quant à l’argent de la compagnie, il se trouvait dans une caisse dont le commandant avait la clef – et il arrivait souvent que celui-ci fît des emprunts à la caisse. C’était précisément ce qui venait de se produire et qui faisait l’objet de la discussion.
Le soldat mécontent, Nikitine, voulait qu’on exigeât des comptes du capitaine, mais Panoff et Avdéieff ne jugeaient pas la chose nécessaire.
Après Panoff, ce fut au tour de Nikitine de fumer. Il mit sous lui son manteau et s’assit, adossé à l’arbre. Les soldats redevinrent silencieux. On n’entendait que le frôlement du vent, très haut au-dessus des têtes, sur la cime des arbres. Tout à coup, à travers ce doux bruissement, retentirent les hurlements, les cris, les pleurs, le rire du chacal.
«Ah! Le maudit! Comme il hurle! Dit Avdéieff.
— Il se moque de toi, à cause de ta gueule de travers», lança d’une voix aiguë de Petit-Russien le quatrième soldat.
De nouveau tout redevint calme; seul le vent agitait les branches des arbres, découvrant et masquant les étoiles.
«Dis donc, Antonitch, demanda soudain à Panoff le joyeux Avdéieff, est-ce qu’il t’arrive de t’ennuyer?
— Qu’est-ce que c’est que l’ennui? Répondit nonchalamment Panoff.
— Moi, il m’arrive de m’ennuyer tellement, tellement, qu’il me semble que je ne saurais même pas que faire de ma personne…
— Ah bon? Fit Panoff.
— L’argent que j’ai autrefois dépensé à boire, c’était à cause de l’ennui. Ça me saisit, ça me saisit, et je ne pense alors qu’à me soûler…
— Mais il arrive qu’après, ce soit encore pire.
— Oui, ça arrive, mais que peut-on y faire?
— Mais pourquoi t’ennuies-tu ainsi?
— Je crois que j’ai le mal du pays…
— Vraiment! La vie était-elle à ce point agréable chez toi?
— On n’était pas riches, mais on était à l’aise. C’était une bonne vie.»
Et Avdéieff se mit à raconter ce qu’il avait déjà raconté plusieurs fois au même Panoff: «Je me suis engagé de plein gré, à la place de mon frère. Il avait cinq enfants, tandis que moi je venais de me marier. C’est ma mère qui m’a supplié… Je me suis dit: au fond, qu’est-ce que ça peut me faire; et puis, ils me regretteront peut-être… Je suis allé trouver notre maître. C’est un bon maître… Et il m’a dit: Tu es un brave garçon, va! Et voilà, c’est comme ça que je me suis engagé pour mon frère.
— Félicitations! Fit Panoff.
— Oui, mais le croirais-tu, Antonitch, maintenant je m’ennuie. Et tout ça parce que je me suis engagé à la place de mon frère. Lui, maintenant, il vit comme un roi, et moi, voilà où j’en suis, je m’énerve. Et plus j’y songe, plus ça me tourmente. Évidemment c’est déjà un péché…»
Avdéieff se tut.
«Veux-tu encore fumer? Demanda-t-il.
— Je veux bien. Arrange-moi ça.»
Mais les soldats n’eurent pas le loisir de fumer. Pendant qu’Avdéieff se levait pour aller préparer de nouveau la pipe, on entendit, au milieu du bruit du vent, des pas sur la route.
Panoff saisit son fusil et poussa du pied Nikitine. Nikitine se leva et ramassa son manteau. Le troisième, Bondarenko, bondit également sur ses pieds: «Ah, mes amis, je faisais pourtant un si beau rêve!»
Avdéieff lui fit signe de se taire et les soldats dressèrent l’oreille. Des pas sourds, d’hommes non chaussés de bottes, s’approchaient. On entendit de plus en plus distinctement dans l’obscurité, le craquement des feuilles et des branches sèches, puis l’écho d’une conversation en cette langue particulière, gutturale, des Tchetchenz. Les soldats pouvaient maintenant distinguer entre les arbres deux ombres qui se déplaçaient. L’une d’elles était ramassée, l’autre plus allongée. Quand les ombres furent tout près des soldats, Panoff mit son fusil en joue, et ses deux camarades bondirent sur la route.
«Qui va là? Cria Panoff.
— Un Tchetchenz pacifique», déclara le plus petit. C’était Bata. «Fusil yok! Sabre yok! Dit-il en montrant ses mains vides. Il me faut arriver au prince!»
L’autre, de plus haute taille, restait près de son compagnon sans mot dire. Lui non plus n’avait pas d’armes.
«C’est un émissaire envoyé au colonel, expliqua Panoff à ses camarades.
— Prince Vorontzoff… Grand besoin de lui… Affaire importante…
— Bon, bon, on va t’y conduire», dit Panoff. Puis il s’adressa à Avdéieff: «Toi et Bondarenko, conduisez-les, et quand vous les aurez remis au planton de service, revenez ici. Mais prends garde, ajouta-t-il, ordonne-leur de marcher devant vous.
— Et ça, c’est quoi? Rétorqua Avdéieff, en faisant semblant de les embrocher avec la baïonnette ajustée au canon de son fusil. Je pique une fois et après je tire.
— Ça ne sert à rien si tu les transperces, observa Bondarenko.
— Allons, en route!»
Quand s’éteignit le bruit des pas des deux soldats qui accompagnaient les émissaires, Panoff et Nikitine regagnèrent leur poste.
«Le diable les emporte de s’amener en pleine nuit! Grommela Nikitine.
— Probablement une affaire urgente, dit Panoff. L’air est devenu frais», ajouta-t-il; il déplia son manteau pour s’en couvrir et alla s’asseoir contre un arbre.
Avdéieff et Bondarenko revinrent deux heures plus tard.
«Alors, tu les as remis au colonel? Demanda Panoff.