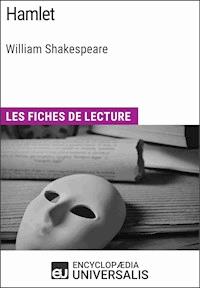
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
La Tragique histoire d’Hamlet, prince du Danemark (représentée en 1601 et en 1603) est probablement la tragédie de William Shakespeare (1564-1616) qui a fait couler le plus d’encre, tant est grand le pouvoir de fascination de son héros.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Hamlet de William Shakespeare
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 50
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852292321
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Nito/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Hamlet, William Shakespeare (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
HAMLET, William Shakespeare (Fiche de lecture)
La Tragique histoire d’Hamlet, prince du Danemark (représentée en 1601 et en 1603) est probablement la tragédie de William Shakespeare (1564-1616) qui a fait couler le plus d’encre, tant est grand le pouvoir de fascination de son héros. C’est une pièce complexe, foisonnante, qui s’inscrit dans le contexte de la « tragédie de vengeance » – genre à la mode autour de 1600 –, mais va bien au-delà : le vengeur, investi de sa mission dès le premier acte, passe les quatre suivants à hésiter sur la conduite à adopter. Ce que la pièce y perd en concentration, elle le gagne en intensité métaphysique et symbolique. Œuvre ouverte, pleine de zones d’ombre, Hamlet est profondément baroque par la place fondamentale qu’occupe en son cœur le principe d’incertitude : le personnage d’Hamlet, ses motivations, sa folie apparente, son désespoir nous demeurent à jamais mystérieux.
• Sanglantes vengeances
Hamlet apprend dès l’acte I (scène 5), par le fantôme de son père, récemment mort, qu’il a été assassiné par son frère Claudius, qui a ainsi pu usurper la couronne en épousant la reine Gertrude. Le spectre charge alors solennellement le jeune Hamlet de le venger. Mais Hamlet doute : s’agit-il là d’un « bon » spectre ou d’un esprit malin ? Claudius, qu’Hamlet, déjà, déteste, est-il coupable ? Hamlet, espionné par les sbires du nouveau roi, décide de feindre la folie pour en apprendre davantage (acte II). Il congédie violemment la jeune Ophélie, fille du conseiller Polonius, qu’on lui envoie, et décide d’utiliser la présence d’une troupe de comédiens ambulants pour prendre Claudius au piège de ce miroir qu’est le théâtre : en faisant jouer devant la cour la scène de l’assassinat d’un roi – c’est la « Souricière », célèbre scène de « théâtre-dans-le-théâtre » qui permet à Shakespeare de révéler sa propre conception du théâtre, tout en offrant à la pièce une vertigineuse mise en abyme –, il amène Claudius à se trahir à ses yeux. Après qu’Hamlet a tué par erreur le vieux Polonius embusqué (acte III), Claudius projette de se débarrasser d’Hamlet, mais ses manœuvres échouent. L’assassinat malencontreux de Polonius donne entre-temps naissance à un deuxième projet de vengeance : Laerte, fils de Polonius, désireux de venger la mort de son père (puis celle de sa sœur dont on annonce la noyade), se laisse convaincre par Claudius de participer à un duel truqué pour assassiner Hamlet (acte IV). C’est après la célèbre scène du cimetière, où Hamlet médite sur l’humaine condition en contemplant le crâne du bouffon Yorick, qu’a lieu le duel qui met un terme aux deux intrigues de vengeance : Laerte et Hamlet meurent touchés par la même pointe d’épée empoisonnée, réconciliés, après que Gertrude a bu le poison destiné à Hamlet par Claudius, lui-même tué par son neveu. Fortinbras, prince de Norvège, reçoit les suffrages d’Hamlet pour assurer l’intérim et s’empare du pouvoir.
• Le principe d’ambiguïté
Les nombreuses digressions – qu’il s’agisse des scènes apparemment peu en rapport avec les deux intrigues de vengeance ou des longs monologues métaphysiques d’Hamlet – tendent à diluer l’action, concentrée à l’acte V. Mais ces digressions renforcent l’unité thématique et métaphorique de la pièce par les effets d’échos, de parallélismes et d’oppositions, comme les thèmes de l’espionnage et de l’incertitude. Toute la pièce semble de fait obéir à un principe d’ambiguïté. Les personnages, d’abord, demeurent à nos yeux presque indécidables : ainsi, si Hamlet est bien le héros positif de la pièce, il peut faire preuve d’un cynisme troublant, en sacrifiant ses amis d’enfance, Rosencrantz et Guilderstern, ou même Ophélie, ou encore en riant de la mort de Polonius. Claudius, fratricide et usurpateur, est aussi un bon roi, soucieux de la paix du royaume. Quant à Gertrude, mère inquiète et aimante, elle est aussi une femme faible peu fidèle à la mémoire du père. L’opportuniste Fortinbras, rebelle contre le Danemark rallié par raccroc, est-il le seul héritier légitime ou détourne-t-il avec habileté la situation à son profit pour s’approprier le pouvoir ? Réflexion sur le pouvoir et l’attrait qu’il suscite, la pièce démontre de fait la parenté qui existe entre le théâtre et le gouvernement de l’État : Fortinbras, comme Claudius, sera sans doute un disciple de Machiavel, puisque, dans les dernières lignes, le dénouement, particulièrement ambigu, le montre mettant en scène les funérailles d’Hamlet pour exploiter le soutien populaire dont bénéficiait ce dernier.
Ce principe d’ambiguïté s’applique à la signification même de la tragédie. Hamlet est, à un premier niveau, la subversion d’une tragédie de vengeance : contrairement à Laerte, justicier dominé par l’indignation, Hamlet place au cœur de ses hésitations l’opposition entre l’éthique expéditive de la vengeance, fondée sur l’individualisme et le mépris des lois, et une éthique chrétienne doublée de l’obéissance aux lois civiles, qui interdisent tout meurtre. Par là-même, la pièce devient une tragédie de l’attente, une quête métaphysique du sens dans un monde qu’Hamlet voit dominé par l’incertitude et la déréliction. Le dénouement lui-même confirme l’indétermination fondamentale : Hamlet n’accomplit sa vengeance que grâce à celle de Laerte, dont il a provoqué le courroux par hasard. Nul destin d’ordre supérieur ne vient donner tout son sens à cette fin, qui aurait pu, sans les effets à retardement du poison, voir la réconciliation des deux héros.





























