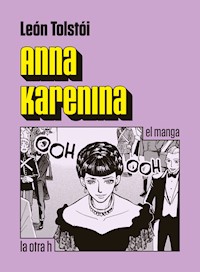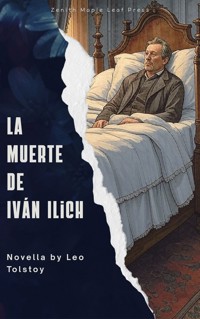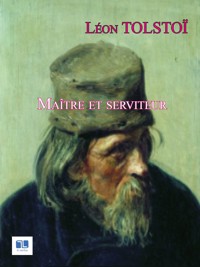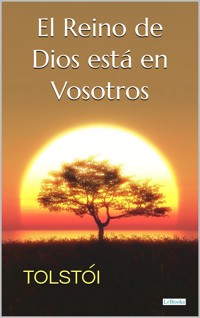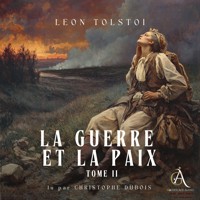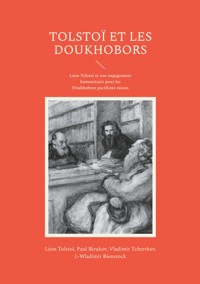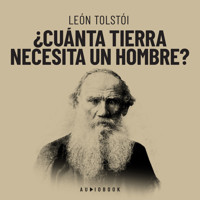Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les Doutlof sont bien à plaindre, madame. Ce sont tous de braves gens. Si nous ne nous mettons pas sur la liste un des serfs attachés à la maison, ce sera le tour d'un des fils Doutlof. Mais il sera fait selon votre volonté. Il posa sa main droite sur la gauche, les mit sur son ventre, courba légèrement sa tête, serra ses lèvres minces, ferma les yeux et se prépara évidemment à écouter avec patience toutes les sottises que lui débiterait sa maîtresse."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Doutlof sont bien à plaindre, madame. Ce sont tous de braves gens. Si nous ne nous mettons pas sur la liste un des serfs attachés à la maison, ce sera le tour d’un des fils Doutlof. Mais il sera fait selon votre volonté.
Il posa sa main droite sur la gauche, les mit sur son ventre, courba légèrement sa tête, serra ses lèvres minces, ferma les yeux et se prépara évidemment à écouter avec patience toutes les sottises que lui débiterait sa maîtresse.
C’était un ancien serf devenu intendant, vêtu d’une longue redingote, qui, chaque soir, venait recevoir les ordres de sa maîtresse et lui faire son rapport.
Selon la maîtresse, le rapport consistait en ce que l’intendant lui communiquait ce que l’on avait fait dans la journée et demandait ce qu’il fallait faire le lendemain.
Selon l’intendant, Iégor Ivanovitch, le rapport était une cérémonie qui consistait en ce que, debout, dans un coin, il écoutait avec patience les sottises de sa maîtresse. Puis, une fois qu’elle avait terminé, il l’amenait à consentir à tout ce qu’il voulait bien – et à lui répondre avec impatience :
– C’est bon, c’est bon, Iégor.
Au moment où commence notre récit, il était question du recrutement.
Le village de Pokrofski devait fournir trois recrues. Deux étaient choisies par le sort et, par suite des conditions sociales et économiques, il ne pouvait y avoir aucune discussion pour ce qui les concernait, ni de la part des paysans, ni de la part de la maîtresse, ni de la part de l’opinion publique. Pour la troisième, c’était autre chose.
L’intendant prenait le parti du troisième garçon, neveu de Doutlof, et proposait à sa place le domestique Polikouchta, qui jouissait d’une mauvaise réputation, qui avait été pris en flagrant délit de vol. La maîtresse caressait souvent les enfants de Polikouchta et cherchait à lui relever le moral par des citations de l’Évangile. Aussi s’opposait-elle à ce qu’on le fît soldat. D’un autre côté, elle ne voulait aucun mal aux Doutlof, qu’elle n’avait jamais vus, mais elle avait de la peine à comprendre une chose bien simple pourtant, c’est que, si Polikouchta ne partait pas, Doutlof devait absolument partir.
– Mais je ne veux pas du tout le malheur de ces pauvres Doutlof, disait-elle avec pitié.
– Si vous ne voulez pas leur malheur, payez pour le conscrit trois cents roubles, aurait-on dû lui répondre.
Mais la politique ne permettait pas de pareilles réponses. Et Iégor Ivarovitch écouta avec patience tout ce que débitait sa maîtresse.
Il examinait avec intérêt le mouvement de ses lèvres, l’ombre que faisait son bonnet à ruches épaisses, et ne cherchait même pas à comprendre le sens de ses paroles.
La maîtresse parla longtemps et beaucoup. Il commençait par éprouver le besoin de bâiller, mais, heureusement pour lui, il mit la main à sa bouche et fit semblant de tousser. Pendant tout ce temps, sa figure avait une expression d’obséquieuse attention.
J’ai vu, dernièrement, à une séance du Parlement anglais, lord Palmerston écouter le discours d’un de ses adversaires pendant trois heures, la figure recouverte de son claque. Aussitôt qu’il eut fini, lord Palmerston se leva et répondit au discours de son adversaire de point en point. Je ne m’en doutais nullement, parce que j’avais assisté souvent aux entretiens d’Iégor Ivanovitch et de sa maîtresse.
Je ne sais s’il avait peur de s’endormir, mais il transporta le poids de son corps du pied gauche sur le pied droit, et commença de sa voix sacramentelle :
– Qu’il en soit fait selon votre volonté, madame, mais… mais le peuple est réuni devant la maison, et il faut que vous preniez une décision. Il est écrit, dans l’ordre que nous avons reçu, que les conscrits doivent être amenés en ville avant la Toussaint. Parmi les paysans, il n’y a personne d’autre que les Doutlof. Il va sans dire que les paysans ne prennent pas vos intérêts à cœur ; cela leur est bien égal si les Doutlof sont ruinés. Je sais quels efforts ils ont faits pour joindre les deux bouts. Les voilà enfin un peu à flot depuis que le neveu est revenu et nous allons les ruiner ! Vous savez, madame, que je prends vos intérêts à cœur comme si c’étaient les miens. C’est dommage, madame. Ils ne sont ni mes parents, ni mes compères, et ils ne m’ont rien donné pour prendre leur parti.
– Mais j’en suis sûre, Iégor, interrompit sa maîtresse, en se disant qu’il avait été corrompu par les Doutlof.
– C’est la meilleure famille de tout Pokrofski, tous des gens laborieux, pieux. Le vieux est marguillier à l’église depuis trente ans. Il ne boit jamais et se garde bien de prononcer une mauvaise parole. Il est toujours assidu à l’église. (Iégor savait bien ce qu’il fallait dire à sa maîtresse pour l’influencer.) Et surtout, madame, je dois vous rappeler qu’il n’a que deux fils. Les autres sont des neveux qu’il a recueillis. Si l’on voulait être juste, on aurait dû le mettre sur le même rang que les autres familles qui n’ont que deux fils. Faudrait-il que ce pauvre homme soit puni pour sa vertu ?
La pauvre maîtresse finit par ne plus rien comprendre. Elle écoutait le son de la voix sans saisir le sens des paroles. Au désespoir, elle examina les boutons de la longue redingote de son intendant.
– Le bouton supérieur se boutonne plus rarement que l’inférieur, qui risque de tomber et que l’on aurait dû recoudre depuis longtemps, pensait-elle.
On sait depuis longtemps qu’il n’est pas du tout nécessaire pour soutenir une conversation d’écouter son interlocuteur et il suffit de bien savoir ce que l’on veut dire soi-même.
C’était aussi l’opinion de la maîtresse d’Iégor.
– Comment ne peux-tu pas comprendre encore que je ne veux pas du tout le malheur de ces pauvres Doutlof. Tu me connais assez, il me semble, pour savoir que je fais tout ce qui dépend de moi pour soulager mes paysans. Tu sais que je suis capable de faire les plus grands sacrifices pour n’envoyer ni Doutlof ni Koriouchkine.
Je ne sais s’il vint à l’idée de l’intendant qu’il ne fallait pas du tout faire de grands sacrifices pour sauver le paysan, mais donner simplement trois cents roubles.
– Je te déclare une chose seulement, c’est que je ne donnerai Polikei pour rien au monde. Lorsque, après l’affaire de la montre, il est venu m’avouer tout, lui-même, en pleurant, il m’a juré qu’il se corrigerait. J’ai longuement causé avec lui, et j’ai vu qu’il était vraiment touché et qu’il se repentait sérieusement.
– La voilà sur son dada, pensa Iégor Ivanovitch, et il examina le sirop qu’on avait préparé pour madame dans un verre d’eau.
– Est-elle au citron ou à l’orange ? Cela doit être légèrement amer, pensa-t-il.
– Sept mois se sont écoulés depuis lors, continue madame, et il ne s’est pas enivré une seule fois. Sa conduite est irréprochable. Comment veux-tu que je punisse un homme qui s’est repenti et corrigé ?… Ne trouves-tu pas que c’est inhumain de donner un homme qui a cinq enfants et qui est tout seul pour les nourrir ? Non, Iégor, ne m’en parle même pas, je t’en prie.
Et la dame avala une gorgée d’eau au sirop.
Iégor Ivanovitch suivit le trajet de l’eau à travers la gorge de madame et il répondit d’un ton sec :
– Vous ordonnez donc, madame, que je désigne Doutlof ?…
Madame leva les bras d’étonnement.
– Décidément tu ne peux pas me comprendre. Puis-je souhaiter le malheur des Doutlof ? Ai-je quelque chose contre lui ?… Dieu m’est témoin que je ferai tout au monde pour eux.
Elle regarda un tableau qui se trouvait vis-à-vis d’elle, puis baissa les yeux se souvenant que ce n’était pas une image.
– Mais il ne s’agit pas de cela maintenant, pensa-t-elle.
Décidément l’idée de payer trois cents roubles pour le malheureux paysan ne lui venait pas à l’esprit.
– Que veux-tu que je fasse ? Est-ce que je connais toutes ces affaires-là ? Je me fie à toi complètement ; fais en sorte que tout le monde soit content. Que faire ? Ils ne sont ni les premiers, ni les derniers… c’est un mauvais moment à passer… Tout ce que je sais, c’est qu’il est impossible d’envoyer Polikei… Tâche donc de comprendre que cela serait terrible de ma part.
Elle aurait encore parlé longtemps sur le même ton, tellement elle s’était montée, mais à ce moment la porte s’ouvrit et la femme de chambre entra.
– Que veux-tu ? Dounachia ?
– Un paysan est venu demander à Iégor Ivanovitch si la foule devait l’attendre ou s’en aller ?… dit-elle en lançant un regard de colère à Iégor Ivanovitch.
– Cet intendant est insupportable, pensait-elle, il a chagriné madame, et elle ne me laissera pas dormir jusqu’à deux heures de la nuit…
– Eh bien ! va, Iégor, et fais en sorte que tout le monde soit content.
– Très bien, madame.
Et il ne parla plus de Doutlof.
– Qui faudra-t-il envoyer chez le marchand pour lui demander l’argent ?
– Piétroucha n’est pas encore revenu de la ville ?
– Non, madame.
– Nicolas ne pourra-t-il pas y aller ?
– Mon père est malade, madame, dit Dounacha.
– Madame désire-t-elle que j’y aille moi-même, demanda l’intendant.
– Non, Iégor, ta présence est nécessaire ici.
– Quelle somme est-ce ?
– Quatre cent soixante-deux roubles, madame.
– Envoie Polikei, dit madame, en regardant Ivanovitch.
L’intendant eut un sourire imperceptible et répondit :
– Très bien, madame.
Et Iégor Ivanovitch s’éloigna.
Polikei était un homme insignifiant, un étranger. Venu d’un autre village, il ne jouissait ni de la protection de la femme de charge, ni de celle du sommelier, ni de celle de la femme de chambre, aussi le coin qu’il occupait lui, sa femme et leurs cinq enfants, était-il des plus misérables. Ces coins avaient été construits par le défunt maître, sur le plan que voici :
Au milieu d’une cabane en pierre de dix archines, se trouvait un grand poêle russe, entouré d’un corridor, et chacun des quatre coins de la cabane était séparé des autres par des cloisons en planches. Quatre familles occupaient donc une cabane, chacune ayant son coin.
Polikei n’avait donc pas beaucoup de place dans son coin, pour lui, sa femme et leurs cinq enfants. Le lit nuptial, recouvert d’une couverture en perse, un berceau, une table boiteuse qui servait pour tous les besoins de la maison et pour Polikei qui était vétérinaire, composaient tout l’ameublement. Outre les sept habitants, le coin était encombré de tous les ustensiles de ménage, les habits, les poules, le petit veau. On pouvait à peine y circuler ; heureusement le poêle commun formait encore une annexe, sur laquelle venaient se coucher grands et petits. Il y avait aussi le perron, mais on ne pouvait l’utiliser qu’en été. Au mois d’octobre, déjà il faisait trop froid.
Toute la famille n’avait qu’une pelisse pour se vêtir et se couvrir. Il est vrai que les enfants pouvaient se réchauffer en jouant et en courant et les grandes personnes en travaillant. Il y avait un autre moyen de se réchauffer, c’était de grimper sur le poêle où la température atteignait 40 degrés.
Il paraîtrait que la vie dans ces conditions devait être insupportable ; il n’en était rien en réalité.
Akoulina, la femme, nettoyait les enfants, cousait tout ce qu’il leur fallait, filait, tissait, blanchissait la toile, faisait la cuisine sur le grand poêle commun, se querellait et cancanait avec les voisines.
La part mensuelle du seigle que leur donnaient les maîtres était suffisante pour faire tout le pain de la famille et nourrir les poules. Le bois était à discrétion, le fourrage pour les bêtes aussi. On avait un petit morceau de terre pour potager. La vache avait ses petits, les poules pondaient.
Polikei était attaché à l’écurie. Il avait chargé de deux étalons, soignait les chevaux et le bétail ; nettoyait les sabots des chevaux et en cas de besoin les frictionnait avec une pommade de son invention.
Pour tous ses services, il recevait de temps en temps quelque gratification en argent ou en provisions. Il jouissait aussi des restes d’avoine qui lui rendaient bien service, car un paysan dans le village lui fournissait vingt livres de mouton par mois pour deux mesures d’avoine. On aurait pu être heureux, si l’on n’avait pas eu de chagrin, et ce chagrin faisait souffrir toute la famille.
Dès son jeune âge, Polikei avait été attaché à un haras dans un village voisin. Le palefrenier, son chef immédiat était un voleur de premier ordre. Polikei fit chez lui son apprentissage et s’habitua tellement à voler, que, plus tard, il lui fut impossible de se défaire de cette mauvaise habitude. C’était un homme faible, il n’avait ni père ni mère pour lui apprendre à marcher dans la bonne voie. Il aimait à boire, et ne pouvait résister au besoin de voler tout ce qui n’était pas gardé assez soigneusement. La chose la plus inutile le tentait, il trouvait partout des personnes qui, en échange de l’objet volé, lui donnaient du vin ou de l’argent.
Ce moyen de gagner sa vie est le plus aisé, comme dit le peuple, et une fois qu’on s’y est fait, on n’a plus envie de travailler d’une autre manière.
Le seul inconvénient de ce métier, c’est qu’un beau jour on s’attaque à une personne méchante et désagréable qui vous cause des ennuis et vous fait payer cher le plaisir que vous avez éprouvé grâce à ce genre de vie.
C’est ce qui arriva à Polikei.
Il se maria. Dieu bénit son union. Sa femme, la fille du vacher, était une paysanne robuste, travailleuse et intelligente. Elle lui donnait chaque année un enfant superbe. Polikei continua son métier, et tout semblait aller bien, lorsqu’un beau jour il fut pris en flagrant délit, et pour une bagatelle. Il détourna les guides en cuir d’un paysan et on les trouva chez lui. On le battit. On se plaignit à la maîtresse. Dès lors, on le surveilla. Il fut pris une seconde, puis une troisième fois, enfin une quatrième. Tout le monde cria. La maîtresse le gronda. Haro sur lui.
Comme nous l’avons dit, c’était un homme bon, mais faible qui aimait la boisson et ne pouvait se défaire de ce défaut. Lorsqu’il revenait ivre à la maison, sa femme le grondait, le rouait de coups même, et lui, pour toute réponse, il se mettait à pleurer comme un enfant.
– Je suis un homme bien malheureux, que vais-je devenir !… Que mes yeux crèvent si je recommence.
Au bout d’un mois il disparaissait tout à coup pour un jour ou deux et revenait ivre à la maison.
– Il doit trouver de l’argent d’une manière ou d’une autre pour s’amuser, disaient les paysans.
La dernière histoire qu’il eut, fut à propos de la pendule du comptoir.
Il y avait au comptoir une vieille pendule qui ne marchait plus depuis longtemps. Or, un beau jour, il s’y trouva tout seul. La pendule le tenta ; il l’emporta et alla la vendre en ville.
Pour son malheur, le marchand, à qui il l’avait vendue, était parent de l’un des serviteurs attachés à la maison. Il vint lui faire visite et lui raconta toute l’histoire. Le serviteur n’eut rien de plus pressé que de la communiquer à tout le monde. On fit une enquête et l’on découvrit le coupable.
L’intendant, qui n’aimait pas Polikei, s’occupa de cette affaire avec un acharnement tout particulier. La maîtresse en fut instruite, elle appela Polikei. Il se jeta à ses pieds (comme le lui avait recommandé sa femme), et lui avoua tout en sanglotant.
La maîtresse lui fit la morale, lui parla de Dieu, de la vertu, de la vie future, de sa femme, de ses enfants, elle finit par lui dire :
– Je te pardonne, promets-moi de ne plus recommencer.
– Je ne le ferai plus jamais ! Que je meure, que je crève si je recommence ! disait Polikei en sanglotant.
Il revint à la maison en hurlant comme un veau. Depuis lors, on ne put accuser Polikei d’aucune mauvaise action. Mais il perdit sa gaîté. Tout le village le considérait comme un voleur et, lorsque vint l’époque du recrutement, il fut désigné par tout le monde, comme ayant mérité d’être envoyé au régiment.
Polikei était vétérinaire, on le sait. Personne n’aurait pu dire comment il l’était devenu, lui moins que les autres.
Au haras, sa seule occupation consistait à enlever le fumier, à apporter l’eau et quelquefois à brosser les chevaux ? Plus tard, il devint tisserand, puis garçon jardinier. Il passait ses journées à ratisser les allées, puis pour le punir on l’envoya à une briqueterie.
Lors de son dernier séjour dans son village, – on ne sait pas trop comment il acquit la réputation d’un vétérinaire distingué, – il saigna un cheval, une fois, puis une seconde fois, le renversa, lui gratta les sabots ; puis, l’ayant reconduit dans l’enclos lui incisa une veine sur la cuisse droite, prétendit, que pour guérir un cheval, il fallait aussi ouvrir la veine du côté opposé. Ensuite il pansa toutes les plaies avec du vitriol, et plus il tourmentait les pauvres bêtes, plus sa réputation grandissait.
Je sens moi-même que, nous autres gens instruits, nous n’avons pas le droit de nous moquer de Polikei. Les moyens dont il se servait pour inspirer la confiance, étaient les mêmes que ceux qu’on a employés avec nos pères, qu’on emploie avec nous et que l’on emploiera avec nos enfants.
Le paysan qui amène à Polikei son cheval souffrant, ce cheval qui n’est pas seulement toute sa richesse, mais un membre de sa famille, ce paysan, en suivant avec intérêt les manipulations de Polikei, en le voyant faire des incisions, ne peut s’imaginer que cet homme soit capable de tourmenter la pauvre bête sans savoir ce qu’il fait.
Je ne sais s’il vous est arrivé comme à moi, de suivre les mouvements d’un médecin qui tourmente un des miens à ma prière. En quoi les paroles du rebouteux diffèrent-elles des mots savants que nous lancent à la tête tous les médecins et de l’air important qu’ils prennent lorsqu’ils parlent de choses qu’ils ne connaissent pas du tout.
Pendant que les paysans réunis devant le comptoir, discutaient, lequel des deux candidats, de Doutlof ou de Polikei, il fallait que le village envoyât au régiment, Polikei, assis sur le bord du lit, triturait sur la table, avec le cul d’une bouteille, une drogue qui devait guérir infailliblement les chevaux de toute espèce de maladies.
Toutes sortes d’ingrédients y étaient mélangés ; du sublimé, du soufre et une herbe qu’il avait cueillie un soir, prétendant qu’elle jouissait de vertus miraculeuses.
Les enfants étaient déjà couchés, deux sur le poêle, deux sur le lit, le dernier-né dans le berceau auprès duquel Akoulina filait.
Un bout de chandelle volé aux maîtres, brûlait sur la fenêtre dans un chandelier de bois. Pour ne pas déranger son mari de ses occupations, Akoulina se levait de temps en temps et mouchait la mèche avec ses doigts.
Certains sceptiques considéraient Polikei comme un homme léger et un charlatan, d’autres, et c’était le plus grand nombre, – prétendaient qu’il était un vaurien, mais un homme très fort. Quant à sa femme quoiqu’elle le grondât et le battît même parfois, elle pensait que c’était le premier vétérinaire et la tête la plus forte qu’il y eût au monde.
Elle le regardait avec admiration préparer sa drogue.
– Quelle tête ! Où a-t-il appris tout cela ?
Le papier dans lequel était enveloppé un des ingrédients tomba sur la table.
– Anioutka, cria-t-elle, tu vois que ton père a laissé tomber un papier.
Anioutka sortit de dessous la couverture ses petites jambes maigres, descendit avec la rapidité d’un chat, et ramassa le papier.
– Voici papa, dit-elle, en lui tendant le papier.
Puis elle courut se cacher sous la couverture.
– Tu pousses, méchante, cria la petite sœur qui partageait le lit avec elle.
– Voulez-vous vous taire ! Attendez un peu, cria la mère, et les deux têtes se cachèrent sous la couverture.
– S’il me donne trois roubles, dit Polikei en bouchant la bouteille, je guérirai son cheval. Et ce n’est pas cher du tout. Est-ce qu’ils sont capables d’inventer des drogues comme moi ! Akoulina, va demander un peu de tabac à Nikita. Je le lui rendrai demain.
Akoulina sortit sans rien bousculer, ce qui était assez difficile.
Polikei ouvrit la petite armoire, y serra sa bouteille et prit un litre vide qu’il renversa dans sa bouche, espérant trouver au fond quelques gouttes d’eau-de-vie.
Son espoir fut déçu.
La femme revint, apportant une pincée de tabac. Il en remplit sa pipe, s’installa sur le lit, et la figure épanouie se mit à fumer d’un air satisfait comme un homme qui a fait son devoir.
Pensait-il à la manière dont il ferait avaler son médicament au cheval malade, en lui tenant la langue, ou bien se disait-il qu’on ne refusait jamais rien à un homme aussi utile que lui ? On ne le sut jamais, car à ce moment la porte d’entrée s’ouvrit et une femme de chambre d’en haut entra.
Tout le monde savait qu’en haut voulait dire la maison de la maîtresse, quoiqu’elle fût située en bas, au fond d’une vallée.
Aksioutka était une petite fille que l’on envoyait faire les commissions. Elle était connue pour la rapidité avec laquelle elle exécutait les ordres qu’on lui donnait. Elle entra comme un ouragan dans le coin de Polikei et, se tenant au poêle on ne sait trop pourquoi, se mit à parler avec une volubilité extraordinaire, tâchant de prononcer deux ou trois mots à la fois.
– Madame a ordonné, dit-elle en s’adressant à Akoulina, que Polikei Illitch vienne en haut immédiatement. (Elle s’arrêta pour souffler.) Iégor Ivanovitch a longtemps parlé avec madame des conscrits… il fut question de Polikei Illitch… Madame veut qu’il vienne à la minute… (Elle souffla de nouveau) sans perdre de temps.
Elle examina pendant quelques secondes Polikei, Akoulina, les enfants, puis ramassant une coquille de noix, elle la jeta à Anioutka qui la regardait bouche béante et puis répétant : qu’il vienne tout de suite, elle sortit de nouveau comme un ouragan.
Akoulina se leva, prépara les bottes usées de son mari, son cafetan et, sans le regarder, lui demanda :
– Faut-il te préparer une chemise ?
– Non, répondit-il.
Akoulina ne jeta pas un seul regard à son mari, pendant qu’il faisait sa toilette, et elle eut raison de le laisser tranquille.
Il était d’une pâleur extrême. Sa lèvre inférieure tremblait, toute sa figure portait cette expression de tristesse et de soumission que l’on voit chez les personnes bonnes, mais faibles de caractère, qui se sentent coupables.
Il se coiffa et voulut sortir. Sa femme s’approcha de lui, arrangea les bouts de corde qui lui servaient de ceinture, et lui mit son chapeau sur la tête…
– Qu’est-ce qu’il y a, Polikei Illitch ? Est-ce Madame qui vous appelle ?… demanda la femme du menuisier de l’autre côté de la cloison.
La femme du menuisier avait eu une grande querelle avec Akoulina pour une cuve de lessive que les enfants de Polikei avaient renversée. Elle était enchantée que Madame fît appeler Polikei. Ce ne pouvait être que pour le gronder.
– On veut vous envoyer en ville, pour des commissions probablement, continua-t-elle d’une voix moqueuse. On veut envoyer un homme sûr et naturellement on ne peut trouver mieux. Vous aurez la bonté de m’acheter un quart de thé, n’est-ce pas, Polikei Illitch ?
Akoulina eut de la peine à retenir ses larmes. Avec quel plaisir elle se serait jetée sur cette tigresse et lui aurait secoué sa vilaine tignasse.
Puis, à l’idée que ses enfants allaient rester orphelins et qu’elle serait seule à les soigner, lorsque son mari irait au régiment, elle oublia et la femme du menuisier et toutes ses méchancetés, elle cacha sa tête dans l’oreiller et ne put retenir ses larmes qui coulaient à flots.
– Maman, tu m’écrases, cria la petite en se levant.
– Tenez, vous feriez bien de mourir tous tant que vous êtes !… Pourquoi vous ai-je mis au monde ?… cria-t-elle à la grande joie de la femme du menuisier qui n’avait pas encore oublié sa cuve de lessive.
Une demi-heure s’écoula ainsi.
Le bébé dans le berceau se mit à crier de toutes ses forces. Akoulina se leva pour lui donner à téter. Elle ne pleurait plus. Elle avait appuyé sa jolie figure amaigrie contre le rebord du lit, et fixait le bout de bougie, se demandant pourquoi elle s’était mariée, pourquoi il fallait tant de soldats, et comment elle ferait pour se venger de la femme du menuisier.
Elle entendit le pas de son mari, se leva rapidement, en essuyant ses larmes.
Polikei entra d’un air vainqueur, jeta son chapeau sur le lit et se mit à défaire la corde qui attachait son cafetan.
– Eh bien ! pourquoi t’a-t-elle fait venir ?
– Hum ! c’est toujours comme cela ! Polikouchka est le dernier des hommes, mais lorsqu’il s’agit d’une affaire sérieuse, à qui pense-t-on ? À lui naturellement.
– Quelle affaire ?
Polikei ne se hâta pas de répondre. Il alluma sa pipe et cracha.
– Elle m’envoie chercher de l’argent chez un marchand.
– Chercher de l’argent ? demanda Akoulina.
Polikei sourit d’un air affirmatif.
– Elle est bien adroite quand elle s’y met, notre maîtresse. « Tu sais, Polikei, qu’on a eu des soupçons sur ton compte, m’a-t-elle dit, mais moi j’ai confiance en toi plus qu’en n’importe qui. »
Polikei parlait à voix haute pour que les voisins l’entendissent.
« – Tu as promis de te corriger, continua-t-elle. Eh bien ! voilà une occasion de le prouver ; va chez le marchand, demande l’argent qu’il me doit et apporte-le-moi.
– Nous sommes tous tes serfs, madame, lui ai-je répondu, nous devons te servir et nous dévouer à toi, je me sens capable de donner ma dernière goutte de sang, pour toi, maîtresse, et tout ce que tu m’ordonneras de faire, je le ferai, parce que je suis ton esclave. »
Il sourit de son sourire d’homme faible bon et coupable.
« – Tu comprends, me dit-elle, que ton sort dépend de cela ?
– Certainement, maîtresse, comment ne comprendrais-je pas que vous voulez mon bien. On m’a calomnié, c’est le moment de montrer que jamais je n’ai même eu l’idée de vous faire du tort, maîtresse. »
J’ai tant et si bien parlé, qu’elle s’est complètement attendrie.
« – Tu es mon meilleur serviteur, m’a-t-elle dit. »
Le même sourire éclaira de nouveau la figure de Polikei.
– Je sais bien, moi, parler aux maîtres.
– Est-ce une grande somme ? demanda sa femme.
– Quatre cent soixante-deux roubles, répondit Polikei d’un air indifférent.
Elle secoua la tête.
– Quand y vas-tu ?
– Elle m’a ordonné d’y aller demain. « Prends, a-t-elle dit, le cheval que tu voudras… va au comptoir demander les ordres de l’intendant, et que Dieu t’accompagne. »
– Que Dieu soit loué, dit Akoulina avec ferveur. Que Dieu te protège, Polikei, ajouta-t-elle à voix basse, pour ne pas être entendue des voisins. Illitch, écoute-moi, au nom du Christ, je te supplie de me promettre que tu ne boiras pas une seule goutte d’eau-de-vie.
– Voyons, voyons, est-ce qu’on boit quand on a une somme pareille dans sa poche ? lui répondit-il en ricanant. Si tu avais entendu comme on jouait du piano, là-bas, je ne te dis que cela, continua-t-il d’un ton calme. Ça doit être Mademoiselle. J’étais là devant Madame comme un piquet, et derrière la porte de sa chambre on entendait Mademoiselle jouer. Cela m’a donné envie ; si j’avais eu l’occasion, je l’aurais appris moi aussi ; tu sais que je suis un malin… Il me faudra une chemise propre pour demain.
Et ils se couchèrent heureux et contents.
Les paysans réunis devant le comptoir continuaient à discuter.
L’affaire était grave.
Lorsqu’Iégor Ivanovitch fut chez Madame, ils se couvrirent la tête et les voix s’élevèrent. Ces voix semblaient gronder. De loin elles arrivaient comme le tonnerre jusqu’aux oreilles de madame et la rendaient nerveuse.
Elle s’attendait toujours à ce que ces voix devinssent de plus en plus menaçantes et qu’il arrivât un malheur quelconque.
– Est-ce que tout ne pourrait se passer doucement, convenablement, sans bruit ni querelle, pensait-elle ; comme s’ils ne pouvaient pas se conduire comme de vrais chrétiens.
On entendait le son de beaucoup de voix qui parlaient en même temps.
L’une d’elles, cependant, dominait les autres, c’était celle du charpentier Fédor Riézoun.
Il n’avait que deux fils et attaquait Doutlof avec acharnement.
Le vieux Doutlof se défendait, il s’était avancé et de sa voix chevrotante cherchait à prouver que ce n’était pas son tour.