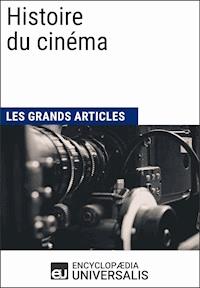
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La première projection du cinématographe Lumière a lieu le 28 décembre 1895, au Grand Café, boulevard des Capucines à Paris. Le nouvel art puisera abondamment dans le trésor dramatique aussi bien théâtral que romanesque, du XIXe siècle finissant. Il lui empruntera sa puissance d'évocation liée à l'appétit de conquête d'une...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852297340
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Ponsulak/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Histoire du cinéma
La première projection du cinématographe Lumière a lieu le 28 décembre 1895, au Grand Café, boulevard des Capucines à Paris. Le nouvel art puisera abondamment dans le trésor dramatique aussi bien théâtral que romanesque, du XIXe siècle finissant. Il lui empruntera sa puissance d’évocation liée à l’appétit de conquête d’une société industrielle en plein essor. Il prolongera sa vocation à l’universel.
Ni Dickens, ni Dumas père (morts en 1870), ni Dostoïevski (mort en 1881), ni Herman Melville (mort en 1891), ni Dumas fils (mort en 1893) n’ont pu soupçonner les immenses virtualités cinématographiques de leurs œuvres. Au cours de ces mêmes années naissent D. W. Griffith (1875), Carl Dreyer (1889), Fritz Lang (1890), Jean Renoir (1894), John Ford (1895) et S. M. Eisenstein (1898).
À l’aube du XXe siècle, au moment où tous les arts se découvrent dans une impasse et doivent se soumettre à des mutations, le jeune cinéma voit s’ouvrir devant lui le plus vaste et le plus neuf des champs d’investigation.
1. Le temps des pionniers (1895-1914)
• « Le vocabulaire le plus riche »
Le cinéaste ignore, pour l’instant, les scrupules et les doutes de l’artiste moderne.
En France, Louis Lumière se contente de cinématographier, comme il a toujours photographié, avec une science discrète de la composition. Il filme la sortie de ses usines, l’entrée d’un train en gare, une baignade en mer, une partie d’écarté, un bocal de poissons rouges. Il envoie ses opérateurs à travers le monde filmer Venise ou le couronnement du tsar Nicolas II. Le cinéma permet désormais d’enregistrer un événement, du plus mince au plus considérable, dans sa durée propre. Il donne corps à la fugacité même. Le cinéma ne reproduit pas seulement le réel, il fixe à raison de 16 (puis de 24) images par seconde des moments d’attention pure, exacte, singulière. Jusqu’à Lumière, la réalité n’était que le modèle proposé à l’artiste. Dès ses premiers films, elle change radicalement de fonction en devenant une matière, aussi digne que le marbre du sculpteur, la couleur du peintre, les mots de l’écrivain. « Écrire pour le cinéma, écrire des films, dira plus tard Alexandre Astruc, c’est écrire avec le vocabulaire le plus riche qu’aucun artiste ait eu jusqu’ici à sa disposition, c’est écrire avec la pâte du monde. »
• Le spectacle et le récit
Parallèlement, Georges Méliès poursuit par d’autres voies son métier d’illusionniste. Il se sert du même appareil pour saper les vérités irréfutables établies par Lumière. Les personnages apparaissent, disparaissent, se substituent les uns aux autres, voyagent « à travers l’impossible ». L’« automaboulof », dans ce film tourné en 1904, emporte ses passagers dans le Soleil, puis retombe sur la Terre et s’enfonce dans l’océan, mais une explosion le ramène à la surface. La seule magie de la réalité découverte par Lumière ne suffit plus. Il s’agit, comme dit Guillaume Apollinaire, rendant visite à Méliès, d’« enchanter la vulgaire réalité ». La poésie du Voyage dans la Lune (1902), de L’Homme à la tête de caoutchouc (1901) ou des Quatre Cents Farces du diable (1906) est d’autant plus sensible, aujourd’hui, qu’elle ne se donne pas d’abord comme poésie. La fantaisie et la fièvre hallucinatoire qui emportent les films de Méliès visent avant tout à l’effet de surprise ou d’émerveillement, à l’effet de spectacle.
La caméra de Lumière nous éveille au monde. Méliès tend derrière ses personnages les toiles peintes de l’inconscient collectif. Avec les cinéastes anglais de l’école de Brighton, le cinéma découvre sa troisième fonction, celle du récit visuel. Anciens photographes de plage, Williamson et Smith seront les premiers à faire valoir l’utilisation du découpage et des différentes échelles de plans. Dans La Loupe de grand-mère, réalisé en 1900 par G. A. Smith, des gros plans de détail s’insèrent dans le tableau principal. La loupe du garçonnet isole successivement une montre, un canari, l’œil de grand-mère ou la tête du chat.
• Thèmes et tensions
Avant la guerre de 1914, le cinéma explore les voies où il s’engagera dans les cinquante années suivantes. L’appât du gain aidant, l’art se confond très vite avec la fabrication et le commerce de pellicule impressionnée. En France, Charles Pathé et Léon Gaumont bâtissent leur empire. Aux États-Unis, William Fox, Louis B. Mayer, Adolph Zukor, les frères Warner s’emparent du marché de l’exploitation avant de conquérir les instruments de production. Le cinéma international est une gigantesque foire d’empoigne, où la propriété artistique se débite au mètre, où l’on s’attaque allégrement aux plus grands thèmes de la culture universelle. En 1904, Ferdinand Zecca tourne La Passion en s’inspirant de tableaux célèbres, dont La Cène de Vinci. Or c’est déjà la troisième vie du Christ portée à l’écran, sans compter Le Christ marchant sur les eaux (1899) de Méliès. Le cinéma exploite tous les thèmes existants avant de donner un éclat jusqu’alors inconnu à certains d’entre eux, qui apparaîtront bientôt comme les siens propres : l’érotisme, le grand spectacle, le réalisme, le suspense, la tarte à la crème, le western.
Déjà les premières tensions apparaissent. La projection de sujets grivois, dans les nickel odeons (permanents à 5 cents) américains, suscite une première levée de boucliers des ligues de vertu, qui imposent la création d’une censure, ou plutôt de quarante-huit censures différentes, correspondant à chacun des États américains. Mais l’érotisme reparaît au Danemark, qui invente la vamp (avec Asta Nielsen) et filme le baiser prolongé. À la veille de la guerre, les cinéastes danois Urban Gad (L’Abîme, Le Vertige) et Holger Madsen (Les Morphinomanes, L’Amitié mystique) se sont acquis une réputation internationale.
L’Italie invente le « peplum », c’est-à-dire l’épopée historico-légendaire à grand spectacle. Les cinéastes italiens bénéficient du soleil, des décors et d’une figuration à bon marché. On construit les remparts de Troie, on déploie les légions romaines, on jette les chrétiens aux lions. Gabriele d’Annunzio signe le scénario de Cabiria (1914), mais c’est Giovanni Pastrone qui l’écrit et le réalise. Ce film marque l’apogée du genre.
Cabiria, de Giovanni Pastrone, 1914, affiche. Affiche de «Cabiria», de Giovanni Pastrone, d'après un scénario de Gabriele D'Annunzio (1914). (Electa/ AKG)
Cependant, la tradition réaliste se maintient face à l’épopée et au drame mondain. Zola inspire Les Victimes de l’alcoolisme (1902) de Zecca, Germinal (1913) de Capellani, la série de films de La Vie telle qu’elle est (1911-1913) de Louis Feuillade, ainsi qu’une Thérèse Raquin italienne réalisée par Nino Martoglio (1915). La contradiction du réalisme et de la fiction apparaît féconde, comme en témoigne la série des Fantomas, réalisée en 1913 par Feuillade, qui lançait trois ans plus tôt le manifeste de La Vie telle qu’elle est (« Ces scènes, écrivait-il, veulent être et sont des tranches de vie. Elles s’interdisent toute fantaisie et représentent les choses et les gens tels qu’ils sont et non tels qu’ils devraient être »). La poésie de Fantomas et des Vampires (1915) s’inscrira tout naturellement dans la réalité du paysage parisien.
En 1908, le « film d’art » se propose d’élever le niveau de la production cinématographique. Cette contradiction entre l’esthétique et le spectacle populaire est assez grave, dans la mesure où elle demeure théorique et par conséquent promise à un bel avenir de malentendus. On ouvre donc les portes du cinéma aux gloires de la littérature et de la Comédie-Française. L’Assassinat du duc de Guise (scénario de Lavedan, musique de Saint-Saëns, réalisation de Le Bargy) connaît un grand succès mondain. Les ambitions académiques du « film d’art » s’opposent à la fraîcheur d’invention des bandes comiques de l’époque (André Deed, Jean Durand, Max Linder), à la merveilleuse naïveté des films à épisodes et des mélodrames, à tout ce qui fait, précisément, le génie des primitifs.
« Ceux qui nous ont précédés avaient bien de la veine, dira Jean Renoir en 1948 : pellicule orthochromatique interdisant toute nuance et forçant l’opérateur le plus timide à accepter des contrastes violents ; pas de son, ce qui amenait l’acteur le moins imaginatif et le metteur en scène le plus vulgaire à l’emploi de moyens d’expression involontairement simplifiés.
« Heureux les potiers étrusques qui, pour la décoration de leurs vases, ne connaissaient que deux couleurs... / « Heureux les faiseurs de films qui se croyaient encore des forains. »
2. L’ère du muet
• La souveraineté américaine
En 1914, l’entrée en guerre inaugure une période lourde de conséquences pour les différentes écoles européennes. Elles chercheront des voies nouvelles, en marge de la suprématie tant matérielle qu’esthétique du cinéma américain.
En l’espace de deux ans, grâce à deux films réalisés par D. W. Griffith, le cinéma accède à la maturité. Naissance d’une nation (Birth of a Nation, 1915) et Intolérance (1916) concentrent tous les faisceaux jusqu’alors divergents du spectacle et de l’intimité, de l’épopée et du naturel, de la tension dramatique et de la contemplation. Il n’est pas un cinéaste de la génération des Renoir, Vidor, Hitchcock, Gance, Hawks qui ne se réclame de Griffith. Intolérance porte l’avenir du cinéma mondial. La partie babylonienne et la Passion du Christ demeurent des modèles de composition plastique, d’exaltation de l’espace. La partie contemporaine contient en puissance tout le cinéma social à venir. L’orchestration du suspense y est déjà parfaite. Le montage alterné de quatre lignes dramatiques (« Chute de Babylone », « Vie et Passion du Christ », « Massacre de la Saint-Barthélemy », « La Mère et la loi ») préfigure les recherches soviétiques.
Naissance d’une nation pourrait s’intituler « Naissance du cinéma américain ». On y trouve cette ampleur, cette générosité et cette fièvre de l’invention, cette simplicité, enfin, qui imposeront les films d’Hollywood sous toutes les latitudes. La jeune Amérique a trouvé dans le cinéma son moyen d’expression privilégié. À la « guerre civile » désastreuse que se livrent les pays de la vieille Europe, elle oppose l’exemple de son unité continentale durement gagnée à l’issue de la guerre de Sécession. L’intervention des États-Unis dans la guerre va leur conférer une responsabilité mondiale, qui était celle des puissances coloniales européennes à la fin du XIXe siècle.
« Certitude de l’espace, de l’accroissement, de la liberté, du futur », écrivait Walt Whitman cinquante ans plus tôt. La conquête de l’Ouest est à peine achevée lorsque, dans les studios de Hollywood hâtivement bâtis sur les lieux mêmes de la Terre promise californienne, l’Amérique se donne un miroir à sa mesure, à la fois précis et déformant. Rien de plus échevelé que les « films poursuites » que dirige alors Mack Sennett. Ils révèlent pourtant la fièvre d’action et la fabuleuse dépense d’énergie qui caractérisent le bond en avant de la civilisation industrielle. Le goût de l’efficacité, de la préparation méthodique, de l’expression juste, directe, se retrouve dans le découpage technique des westerns de Thomas Ince : Pour sauver sa race (The Aryan, 1916), Carmen du Klondyke (1918). Douglas Fairbanks incarne la magnifique santé d’un peuple, sa bonne conscience et son humour : Robin des bois (Robin Hood, 1922) ; Le Signe de Zorro (The Mark of Zorro, 1920) ; Le Voleur de Bagdad (The Thief of Bagdad, 1924). Ses exploits acrobatiques ne sont pas seulement des performances sportives. Ils apparaissent sur l’écran comme des raccourcis saisissants, des figures de liberté. « L’art américain, en cette période, écrit Henri Langlois, est surtout caractérisé par une concision extrême, une simplicité totale, la pureté du style. Tout y est dit en quelques instants et l’on passe aussitôt à ce qui va suivre. L’image est à la fois concise, pleine et aérienne. »
Mais déjà dans L’Émigrant (The Immigrant, 1917), le personnage de Charlot attaque de sa verve corrosive les belles certitudes américaines. Il montre la misère réelle sous la générosité officielle, la férocité dissimulée par le dynamisme. Déjà, le Viennois Stroheim se prépare à opérer la « révolution du concret » : Folies de femmes (Foolish Wives, 1919). « J’ai voulu, disait-il, et je veux toujours montrer au cinéma la vraie vie avec sa crasse, sa noirceur, sa violence, sa sensualité et – singulier contraste –, au milieu de cette fange, la pureté. »
Hollywood accueille les apports étrangers et les naturalise sans rien leur ôter de leur accent propre. L’unité du cinéma américain est faite de mille contributions diverses et contradictoires. Là comme ailleurs n’est-ce pas le signe de la puissance et de l’originalité américaines que de tout fondre en un creuset, un melting-pot ? En 1920, le cinéma européen renaît de ses cendres. En France, en Suède, en Allemagne, en Union soviétique, de nouvelles écoles naissent. Des cinéastes de génie s’imposent. Beaucoup d’entre eux s’accompliront à Hollywood.





























